
Jules Verne
HECTOR SERVADAC
Voyages et aventures
à travers le monde solaire
(1877)
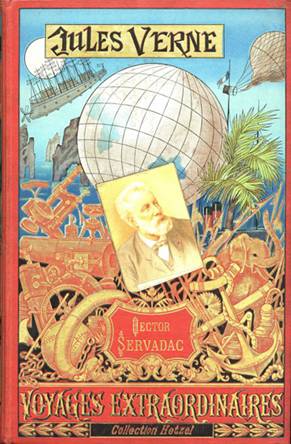
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » - http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
Le comte : « Voici ma carte. » – Le capitaine : « Voici la mienne. »
Qui permet au lecteur de multiplier à l’infini les points d’exclamation et d’interrogation !
Dans lequel Ben-Zouf croit devoir se plaindre de la négligence du gouverneur général à son égard
Où il est question de Vénus et de Mercure, qui menacent de devenir des planètes d’achoppement
Dans lequel le capitaine Servadac pose une série de demandes qui restent sans réponses
Où le capitaine Servadac retrouve, épargné par la catastrophe, un îlot qui n’est qu’une tombe
Dans lequel, après avoir agi en marin, le lieutenant Procope s’en remet à la volonté de Dieu
Dans lequel on discute pour arriver à découvrir une vérité dont on s’approche peut-être
Dans lequel on verra le capitaine Servadac tenir dans sa main tout ce qui reste d’un vaste continent
Qui pourrait sans inconvénient être très justement intitulé : du même aux mêmes
Qui tend à prouver qu’en regardant bien, on finit toujours par apercevoir un feu à l’horizon
Où l’on verra quelle charmante surprise la nature fait, un beau soir, aux habitants de Gallia
Qui se termine par une petite expérience assez curieuse de physique amusante
Qui traite d’un événement de haute importance, lequel met en émoi toute la colonie Gallienne
Dans lequel on présente sans cérémonie le trente-sixième habitant du sphéroïde gallien
Dont le dernier mot apprend au lecteur ce que, sans doute, il avait déjà deviné
Quelques variations sur le vieux thème si connu des comètes du monde solaire et autres
Dans lequel l’élève Servadac est assez malmené par le professeur Palmyrin Rosette
Dans lequel on verra que Palmyrin Rosette est fondé à trouver insuffisant le matériel de la colonie
Dans lequel il sera uniquement question de Jupiter, surnommé le grand troubleur de comètes
Dans lequel il sera nettement établi qu’il vaut mieux trafiquer sur la terre que sur Gallia
Dans lequel le monde savant de Gallia se lance, en idée, au milieu des infinis de l’espace
Comment on célébra le 1er janvier sur Gallia, et de quelle façon se termina ce jour de fête
Dans lequel le capitaine Servadac et ses compagnons font la seule chose qu’il y eut à faire
Dans lequel le capitaine Servadac et Ben-Zouf partent et reviennent comme ils étaient partis
Dans lequel on chiffre, minute par minute, les sensations et impressions des passagers de la nacelle
Qui, contrairement à toutes les règles du roman, ne se termine pas par le mariage du héros
Note des éditeurs[1]
M. Jules Verne, en commençant la série des Voyages extraordinaires, a eu pour but de faire connaître à ses lecteurs, sous la forme du roman, les diverses parties du monde. L’Afrique dans Cinq Semaines en ballon et les Aventures de trois Russes et de trois Anglais, l’Asie centrale dans Michel Strogoff, l’Amérique du Sud et l’Australie dans Les Enfants du capitaine Grant, les régions arctiques dans Le capitaine Hatteras, l’Amérique septentrionale dans Le Pays des fourrures, les différents océans du globe dans Vingt mille lieues sous les mers, le nouveau et l’ancien monde dans Le Tour du monde en 80 jours, etc., enfin un coin du ciel dans Le Voyage à la lune (sic) et Autour de la lune, telles sont les portions de l’univers qu’il a jusqu’ici fait parcourir aux lecteurs, à la suite de ses héros imaginaires.
D’autre part, dans L’île mystérieuse, Le Chancellor, Le Docteur Ox, le Voyage au centre de la terre, la Ville flottante, M. J. Verne a mis en scène différents faits de la science moderne.
Aujourd’hui, dans Hector Servadac, M. J. Verne continue cette série par un voyage à travers le monde solaire. Il dépasse de beaucoup cette fois l’orbite lunaire, et transporte ses lecteurs à travers les trajectoires des principales planètes jusqu’au-delà de l’orbite de Jupiter. C’est donc là un roman « cosmographique ». L’extrême fantaisie s’y allie à la science sans l’altérer. C’est l’histoire d’une hypothèse et des conséquences qu’elle aurait si elle pouvait, par impossible, se réaliser. Ce roman complétera la série des voyages dans l’univers céleste publiés, comme la plupart des œuvres de M. Verne, dans le Magasin d’éducation ; il y a obtenu un succès considérable, et partout, dès les premiers chapitres publiés, les traducteurs autorisés par nous se sont mis à l’œuvre.
Les Indes Noires, qui viennent de paraître, ont pour but de nous initier aux mystérieux travaux des houillères. Et un autre roman, en préparation, Un Héros de quinze ans, est destiné à nous conduire dans les parties les plus curieuses et les plus nouvellement explorées du globe terrestre.
Il nous sera permis de dire ici que dans notre longue carrière d’éditeur nous n’avons jamais rencontré un succès plus universel que celui de l’œuvre générale de M. Jules Verne. Il est lu, il est populaire, son nom et son œuvre sont célèbres dans tous les pays, comme ils le sont en France, et partout son succès est le même, partout les lecteurs de tout âge lui font le même accueil.
L’œuvre complète de Jules Verne est traduite et se publie simultanément en Russie, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Brésil, en Suède, en Hollande, en Portugal, en Grèce, en Croatie, en Bohême, au Canada. Quelques-uns de ses livres ont été traduits même en Perse.
Aucun écrivain jusqu’à ce jour n’a porté plus loin le nom français et ne l’a fait accepter et aimer dans un plus grand nombre de pays et dans des langues plus différentes.
PREMIÈRE PARTIE
Chapitre I
Le comte : « Voici ma carte. » – Le capitaine : « Voici la mienne. »
« Non, capitaine, il ne me convient pas de vous céder la place !
– Je le regrette, monsieur le comte, mais vos prétentions ne modifieront pas les miennes !
– Vraiment ?
– Vraiment.
– Je vous ferai cependant remarquer que je suis, incontestablement, le premier en date !
– Et moi, je répondrai que, en pareille matière, l’ancienneté ne peut créer aucun droit.
– Je saurai bien vous forcer à me céder la place, capitaine.
– Je ne le crois pas, monsieur le comte.
– J’imagine qu’un coup d’épée…
– Pas plus qu’un coup de pistolet…
– Voici ma carte !
– Voici la mienne ! »
Après ces paroles, qui partirent comme des ripostes d’escrime, deux cartes furent échangées entre les deux adversaires.
L’une portait :
HECTOR SERVADAC,
Capitaine d’état-major.
Mostaganem.
L’autre :
COMTE WASSILI TIMASCHEFF,
À bord de la goélette Dobryna.
Au moment de se séparer :
« Où mes témoins rencontreront-ils les vôtres ? demanda le comte Timascheff.
– Aujourd’hui, à deux heures, si vous le voulez bien, répondit Hector Servadac, à l’État-Major.
– À Mostaganem ?
– À Mostaganem. »
Cela dit, le capitaine Servadac et le comte Timascheff se saluèrent courtoisement. Mais, au moment où ils allaient se quitter, une dernière observation fut faite par le comte Timascheff.
« Capitaine, dit-il, je pense qu’il convient de tenir secrète la véritable cause de notre rencontre ?
– Je le pense aussi, répondit Servadac.
– Aucun nom ne sera prononcé !
– Aucun.
– Et alors le prétexte ?
– Le prétexte ? – Une discussion musicale, si vous le voulez bien, monsieur le comte.
– Parfaitement, répondit le comte Timascheff. J’aurai tenu pour Wagner, – ce qui est dans mes idées !
– Et moi, pour Rossini, – ce qui est dans les miennes », répliqua en souriant le capitaine Servadac. Puis, le comte Timascheff et l’officier d’état-major, s’étant salués une dernière fois, se séparèrent définitivement.
Cette scène de provocation venait de se passer, vers midi, à l’extrémité d’un petit cap de cette partie de la côte algérienne comprise entre Tenez et Mostaganem, et à trois kilomètres environ de l’embouchure du Chéliff. Ce cap dominait la mer d’une vingtaine de mètres, et les eaux bleues de la Méditerranée venaient mourir à ses pieds, en léchant les roches de la grève, rougies par l’oxyde de fer. On était au 31 décembre. Le soleil, dont les obliques rayons semaient ordinairement de paillettes éblouissantes toutes les saillies du littoral, était alors voilé par un opaque rideau de nuages. De plus, d’épaisses brumes couvraient la mer et le continent. Ces brouillards, qui, par une circonstance inexplicable, enveloppaient le globe terrestre depuis plus de deux mois, ne laissaient pas de gêner les communications entre les divers continents. Mais à cela, il n’y avait rien à faire.
Le comte Wassili Timascheff, en quittant l’officier d’état-major, se dirigea vers un canot, armé de quatre avirons, qui l’attendait dans une des petites criques de la côte. Dès qu’il y eut pris place, la légère embarcation déborda, afin de rallier une goélette de plaisance qui, sa brigantine bordée et sa trinquette traversée au vent, l’attendait à quelques encablures.
Quant au capitaine Servadac, il appela d’un signe un soldat, resté à vingt pas de lui. Ce soldat, tenant en main un magnifique cheval arabe, s’approcha sans prononcer une parole. Le capitaine Servadac, s’étant lestement mis en selle, se dirigea vers Mostaganem, suivi de son ordonnance, qui montait un cheval non moins rapide que le sien.
Il était midi et demi lorsque les deux cavaliers passèrent le Chéliff, sur le pont que le génie avait construit récemment. Une heure trois quarts sonnaient au moment où leurs chevaux, blancs d’écume, s’élançaient à travers la porte de Mascara, l’une des cinq entrées ménagées dans l’enceinte crénelée de la ville.
En cette année-là, Mostaganem comptait environ quinze mille habitants, dont trois mille Français. C’était toujours un des chefs-lieux d’arrondissement de la province d’Oran et aussi un chef-lieu de subdivision militaire. Là se fabriquaient encore des pâtes alimentaires, des tissus précieux, des sparteries ouvrées, des objets de maroquinerie. De là s’exportaient pour la France des grains, des cotons, des laines, des bestiaux, des figues, des raisins. Mais, à cette époque, on eût vainement cherché trace de l’ancien mouillage sur lequel, autrefois, les navires ne pouvaient tenir par les mauvais vents d’ouest et de nord-ouest. Mostaganem possédait actuellement un port bien abrité, qui lui permettait d’utiliser tous les riches produits de la Mina et du bas Chéliff.
C’était même grâce à ce refuge assuré que la goélette Dobryna avait pu se risquer à hiverner sur cette côte, dont les falaises n’offrent aucun abri. Là, en effet, depuis deux mois, on voyait flotter à sa corne le pavillon russe, et, en tête de son grand mât, le guidon du Yacht Club de France, avec ce signal distinctif : M.C.W.T.
Le capitaine Servadac, dès qu’il eut franchi l’enceinte de la ville, gagna le quartier militaire de Matmore. Là, il ne tarda pas à rencontrer un commandant du 2e tirailleurs et un capitaine du 8e d’artillerie, – deux camarades sur lesquels il pouvait compter.
Ces officiers écoutèrent gravement la demande que leur fit Hector Servadac de lui servir de témoins dans l’affaire en question, mais ils ne laissèrent pas de sourire légèrement, lorsque leur ami donna pour le véritable prétexte de cette rencontre une simple discussion musicale intervenue entre lui et le comte Timascheff.
« Peut-être pourrait-on arranger cela ? fit observer le commandant du 2e tirailleurs.
– Il ne faut même pas l’essayer, répondit Hector Servadac.
– Quelques modestes concessions !… reprit alors le capitaine du 8e d’artillerie.
– Aucune concession n’est possible entre Wagner et Rossini, répondit sérieusement l’officier d’état-major. C’est tout l’un ou tout l’autre. Rossini, d’ailleurs, est l’offensé dans l’affaire. Ce fou de Wagner a écrit de lui des choses absurdes, et je veux venger Rossini.
– Au surplus, dit alors le commandant, un coup d’épée n’est pas toujours mortel !
– Surtout lorsqu’on est bien décidé, comme moi, à ne point le recevoir », répliqua le capitaine Servadac.
Sur cette réponse, les deux officiers n’eurent plus qu’à se rendre à l’État-Major, où ils devaient rencontrer, à deux heures précises, les témoins du comte Timascheff.
Qu’il soit permis d’ajouter que le commandant du 2e tirailleurs et le capitaine du 8e d’artillerie ne furent point dupes de leur camarade. Quel était le motif, au vrai, qui lui mettait les armes à la main ? ils le soupçonnaient peut-être, mais n’avaient rien de mieux à faire que d’accepter le prétexte qu’il avait plu au capitaine Servadac de leur donner.
Deux heures plus tard, ils étaient de retour, après avoir vu les témoins du comte et réglé les conditions du duel. Le comte Timascheff, aide de camp de l’empereur de Russie, comme le sont beaucoup de Russes à l’étranger, avait accepté l’épée, l’arme du soldat.
Les deux adversaires devaient se rencontrer le lendemain, 1er janvier, à neuf heures du matin, sur une portion de la falaise, située à trois kilomètres de l’embouchure du Chéliff.
« À demain donc, heure militaire ! dit le commandant.
– Et la plus militaire de toutes les heures », répondit Hector Servadac.
Là-dessus, les deux officiers serrèrent vigoureusement la main de leur ami et retournèrent au café de la Zulma pour y faire un piquet en cent cinquante sec.
Quant au capitaine Servadac, il rebroussa chemin et quitta immédiatement la ville.
Depuis une quinzaine de jours, Hector Servadac ne demeurait plus à son logement de la place d’Armes. Chargé d’un levé topographique, il habitait un gourbi sur la côte de Mostaganem, à huit kilomètres du Chéliff, et n’avait pas d’autre compagnon que son ordonnance. Ce n’était pas très gai, et tout autre que le capitaine d’état-major eût pu considérer son exil dans ce poste désagréable comme une pénitence.
Il reprit donc le chemin du gourbi, en chassant quelques rimes qu’il essayait d’ajuster les unes aux autres sous la forme un peu surannée de ce qu’il appelait un rondeau. Ce prétendu rondeau – il est inutile de le cacher – était à l’adresse d’une jeune veuve, qu’il espérait bien épouser, et il tendait à prouver que, lorsqu’on a la chance d’aimer une personne aussi digne de tous les respects, il faut aimer « le plus simplement du monde ». Que cet aphorisme fût vrai ou non, d’ailleurs, c’était le moindre des soucis du capitaine Servadac, qui rimait un peu pour rimer.
« Oui ! oui ! murmurait-il, pendant que son ordonnance trottait silencieusement à son côté, un rondeau bien senti fait toujours son effet ! Ils sont rares, les rondeaux, sur la côte algérienne, et le mien n’en sera que mieux reçu, il faut l’espérer ! »
Et le poète-capitaine commença ainsi :
En vérité ! lorsque l’on aime,
C’est simplement…
« Oui ! simplement, c’est-à-dire honnêtement et en vue du mariage, et moi qui vous parle… Diable ! cela ne rime plus ! Pas commodes ces rimes en « ème » ! Singulière idée que j’ai eue d’aligner mon rondeau là-dessus ! Hé ! Ben-Zouf ! »
Ben-Zouf était l’ordonnance du capitaine Servadac.
« Mon capitaine, répondit Ben-Zouf.
– As-tu fait des vers quelquefois ?
– Non, mon capitaine, mais j’en ai vu faire !
– Et par qui ?
– Par le pitre d’une baraque de somnambule, un soir, à la fête de Montmartre.
– Et tu les as retenus, ces vers de pitre ?
– Les voici, mon capitaine :
Entrez ! C’est le bonheur suprême,
Et vous en sortirez charmé !
Ici l’on voit celle qu’on aime,
Et celle que l’on est aimé !
– Mordioux ! Ils sont détestables, tes vers !
– Parce qu’ils ne sont pas enroulés autour d’un mirliton, mon capitaine ! Sans cela, ils en vaudraient bien d’autres !
– Tais-toi, Ben-Zouf ! s’écria Hector Servadac. Tais-toi ! Je tiens enfin ma troisième et ma quatrième rime ! »
En vérité ! lorsque l’on aime,
C’est simplement…
Et fiez-vous à l’amour même
Plus qu’au serment !
Mais tout l’effort poétique du capitaine Servadac ne put le mener au-delà, et quand, à six heures, il fut de retour au gourbi, il ne tenait encore que son premier quatrain.
Chapitre II
Dans lequel on photographie physiquement et moralement le capitaine Servadac et son ordonnance Ben-Zouf
Cette année-là et à cette date, on pouvait lire sur ses états de service, au ministère de la Guerre :
« Servadac (Hector), né le 19 juillet 18.., à Saint-Trélody, canton et arrondissement de Lespare, département de la Gironde.
« Fortune : Douze cents francs de rente.
« Durée des services : 14 ans 3 mois 5 jours.
« Détail des services et des campagnes : École de Saint-Cyr : 2 ans. École d’application : 2 ans. Au 87e de ligne : 2 ans. Au 3e chasseurs : 2 ans. Algérie : 7 ans. Campagne du Soudan. Campagne du Japon.
« Position : Capitaine d’état-major à Mostaganem.
« Décorations : Chevalier de la Légion d’honneur du 13 mars 18.. »
Hector Servadac avait trente ans. Orphelin, sans famille, presque sans fortune, ambitieux de gloire sinon d’argent, quelque peu cerveau brûlé, plein de cet esprit naturel toujours prêt à l’attaque comme à la riposte, cœur généreux, courage à toute épreuve, visiblement le protégé du Dieu des batailles, auquel il n’épargnait pas les transes, pas hâbleur pour un enfant de l’Entre-deux-Mers qu’avait allaité pendant vingt mois une vigoureuse vigneronne du Médoc, véritable descendant de ces héros qui fleurirent aux époques de prouesses guerrières, tel était, au moral, le capitaine Servadac, l’un de ces aimables garçons que la nature semble prédestiner aux choses extraordinaires, et qui ont eu pour marraines à leur berceau la fée des aventures et la fée des bonnes chances.
Au physique, Hector Servadac était un charmant officier : cinq pieds six pouces, élancé, gracieux, chevelure noire à frisons naturels, jolies mains, jolis pieds, moustache galamment troussée, yeux bleus avec un regard franc, en un mot fait pour plaire, et, on peut le dire, plaisant sans avoir trop l’air de s’en douter.
Il faut convenir que le capitaine Servadac – il l’avouait volontiers – n’était pas plus savant qu’il ne fallait. « Nous ne sabotons pas, nous autres », disent les officiers d’artillerie, entendant par là qu’ils ne boudent jamais à la besogne. Hector Servadac, lui, « sabotait » volontiers, étant aussi naturellement flâneur que détestable poète ; mais, avec sa facilité à tout apprendre, à tout s’assimiler, il avait pu sortir de l’école dans un bon rang et entrer dans l’état-major. Il dessinait bien, d’ailleurs ; il montait admirablement à cheval, et l’indomptable sauteur du manège de Saint-Cyr, le successeur du fameux Oncle Tom, avait trouvé en lui son maître. Ses états de service mentionnaient qu’il avait été plusieurs fois porté à l’ordre du jour, et ce n’était que justice.
On citait de lui ce trait :
Un jour, il conduisait dans la tranchée une compagnie de chasseurs à pied. À un certain endroit, la crête de l’épaulement, criblée d’obus, avait cédé et n’offrait plus une hauteur suffisante pour couvrir les soldats contre la mitraille qui sifflait drue. Ceux-ci hésitèrent. Le capitaine Servadac monta alors sur l’épaulement ; puis, se couchant en travers de la brèche, que son corps bouchait tout entière :
« Passez maintenant », dit-il.
Et la compagnie passa au milieu d’une grêle de balles, dont pas une n’atteignit l’officier d’état-major.
Depuis sa sortie de l’École d’application, à l’exception de deux campagnes qu’il fit (Soudan et Japon), Hector Servadac fut toujours détaché en Algérie. À cette époque, il remplissait les fonctions d’officier d’état-major à la subdivision de Mostaganem. Spécialement chargé de travaux topographiques sur cette portion du littoral comprise entre Tenez et l’embouchure du Chéliff, il habitait un gourbi qui l’abritait tant bien que mal. Mais il n’était pas homme à s’inquiéter de si peu. Il aimait à vivre en plein air, avec toute la somme de liberté qu’un officier peut avoir. Tantôt arpentant à pied les sables de la grève, tantôt parcourant à cheval les crêtes des falaises, il ne hâtait pas outre mesure le travail dont il était chargé.
Cette vie, à demi indépendante, lui allait. D’ailleurs, ses occupations ne l’absorbaient pas au point qu’il lui fût interdit de prendre le chemin de fer deux ou trois fois par semaine, et de figurer, soit aux réceptions du général à Oran, soit aux fêtes du gouverneur à Alger.
Ce fut même dans une de ces occasions que lui apparut Mme de L…, à laquelle était destiné le fameux rondeau dont les quatre premiers vers venaient seulement d’éclore. C’était la veuve d’un colonel, jeune femme, très belle, très réservée, un peu hautaine même, ne remarquant pas ou ne voulant pas remarquer les hommages dont elle était l’objet. Aussi le capitaine Servadac n’avait-il pas encore osé se déclarer. Il se connaissait des rivaux, et entre autres, on vient de le voir, le comte Timascheff. C’était même cette rivalité qui allait mettre les deux adversaires les armes à la main, et cela, sans que la jeune veuve s’en doutât en aucune façon. D’ailleurs, on le sait, son nom, respecté de tous, n’avait pas été prononcé.
Avec le capitaine Hector Servadac demeurait au gourbi son ordonnance Ben-Zouf.
Ce Ben-Zouf était dévoué corps et âme à l’officier qu’il avait l’honneur de « brosser ». Entre les fonctions d’aide de camp du gouverneur général de l’Algérie et celles d’ordonnance du capitaine Servadac, Ben-Zouf n’eût pas hésité, même un instant. Mais, s’il n’avait aucune ambition personnelle en ce qui le concernait, c’était autre chose à l’endroit de son officier, et, chaque matin, il regardait si, pendant la nuit, il n’avait pas poussé quelques graines d’épinard sur l’épaule gauche de l’uniforme du capitaine d’état-major.
Ce nom de Ben-Zouf pourrait donner à croire que le brave soldat était indigène de l’Algérie. Pas le moins du monde. Ce nom n’était qu’un surnom. Maintenant pourquoi, ce brosseur, le nommait-on Zouf, puisqu’il s’appelait Laurent ? pourquoi Ben, puisqu’il était de Paris et même de Montmartre ? c’est une de ces anomalies que les plus savants étymologistes eux-mêmes n’arriveraient pas à expliquer.
Or, non seulement Ben-Zouf était de Montmartre, mais il était originaire de la célèbre butte de ce nom, ayant vu le jour entre la tour Solférino et le moulin de la Galette. Or, lorsqu’on a eu le bonheur de naître dans ces conditions exceptionnelles, il est bien naturel qu’on éprouve pour sa butte natale une admiration sans réserve et qu’on ne voie rien de plus magnifique au monde. Aussi, aux yeux du brosseur, Montmartre était-elle la seule montagne sérieuse qu’il y eût dans l’univers, et, le quartier de ce nom, le regardait-il comme un composé de toutes les merveilles du globe. Ben-Zouf avait voyagé. À l’entendre, il n’avait jamais vu, en n’importe quel pays, que des Montmartres, plus grands peut-être, mais à coup sûr moins pittoresques. Montmartre, en effet, n’a-t-il pas une église qui vaut la cathédrale de Burgos, des carrières qui ne le cèdent point à celles du Pentélique, un bassin dont la Méditerranée serait jalouse, un moulin qui ne se contente pas de produire une vulgaire farine, mais des galettes renommées, une tour Solférino qui se tient plus droite que la tour de Pise, un reste de ces forêts qui étaient parfaitement vierges avant l’invasion des Celtes, et enfin une montagne, une véritable montagne, à laquelle des envieux seuls osaient donner l’humiliante qualification de « butte » ? On eût haché Ben-Zouf en morceaux plutôt que de lui faire avouer que cette montagne ne mesurait pas cinq mille mètres de hauteur !
Où rencontrerait-on donc, dans le monde entier, tant de merveilles réunies sur un seul point ?
« Nulle part ! » répondait Ben-Zouf à quiconque s’avisait de trouver son opinion légèrement exagérée.
Innocente manie, après tout ! Quoi qu’il en soit, Ben-Zouf n’avait qu’une seule aspiration, revenir à Montmartre, sur la butte, et finir ses jours là où ils avaient commencé, – avec son capitaine, cela va sans dire. Aussi Hector Servadac avait-il les oreilles sans cesse rebattues des beautés sans pareilles accumulées dans le XVIIIe arrondissement de Paris, et commençait-il à le prendre en horreur.
Cependant, Ben-Zouf ne désespérait pas de convertir son capitaine, – bien décidé, d’ailleurs, à ne le jamais quitter. Son temps était fini. Il avait même fait deux congés et allait abandonner le service à l’âge de vingt-huit ans, lui simple chasseur à cheval de première classe au 8e régiment, quand il fut élevé à la position d’ordonnance d’Hector Servadac. Il fit campagne avec son officier. Il se battit à ses côtés en plusieurs circonstances, et si courageusement même qu’il fut porté pour la croix ; mais il la refusa, afin de rester l’ordonnance de son capitaine. Si Hector Servadac sauva la vie à Ben-Zouf au Japon, Ben-Zouf lui rendit la pareille pendant la campagne du Soudan. Ce sont là de ces choses qui ne s’oublient jamais.
Bref, voilà pourquoi Ben-Zouf mettait au service du capitaine d’état-major deux bras « trempés de tout leur dur », comme on dit en langue métallurgique, une santé de fer, forgée sous tous les climats, une vigueur physique qui lui eût donné droit à s’appeler le « rempart de Montmartre », et enfin, avec un cœur à tout oser, un dévouement à tout faire.
Il faut ajouter que si Ben-Zouf n’était pas « poète », comme son capitaine, il pouvait du moins passer pour une encyclopédie vivante, un ana inépuisable de toutes les calembredaines et coq-à-l’âne du troupier. Sur ce chapitre-là, il en eût remontré à quiconque, et son imperturbable mémoire lui fournissait des flons-flons à la douzaine.
Le capitaine Servadac savait ce que valait l’homme. Il l’appréciait, il lui passait bien des manies que l’inaltérable bonne humeur de l’ordonnance rendait d’ailleurs supportables, et, à l’occasion, il savait lui dire de ces choses qui cimentent un serviteur à son maître.
Une fois, entre autres, que Ben-Zouf, ayant enfourché son dada, caracolait « moralement » dans le XVIIIe arrondissement :
« Ben-Zouf, lui dit le capitaine, sais-tu bien, après tout, que si la butte Montmartre avait seulement quatre mille sept cent cinq mètres de plus, elle serait aussi haute que le mont Blanc ? »
À cette observation, les yeux de Ben-Zouf avaient lancé deux éclairs, et, depuis ce jour, sa butte et son capitaine s’étaient indistinctement confondus dans son cœur.
Chapitre III
Où l’on verra que l’inspiration poétique du capitaine Servadac est interrompue par un choc malencontreux
Un gourbi n’est autre chose qu’une sorte de hutte, construite en boulins, et recouverte d’un chaume que les indigènes appellent « driss ». C’est un peu plus que la tente de l’Arabe nomade, mais beaucoup moins que l’habitation faite de pierres ou de briques.
Le gourbi habité par le capitaine Servadac n’était donc, à tout prendre, qu’une cahute, et il n’aurait pas suffi aux besoins de ses hôtes, s’il n’eût attenu à un ancien poste, construit en pierres, qui servait au logement de Ben-Zouf et de deux chevaux. Ce poste avait été précédemment occupé par un détachement du génie, et il renfermait encore une certaine quantité d’outils, tels que pioches, pics, pelles, etc.
Certes, le confortable laissait à désirer dans ce gourbi, mais ce n’était qu’un campement provisoire. D’ailleurs, ni le capitaine ni son ordonnance n’étaient difficiles en matière de nourriture et de logement.
« Avec un peu de philosophie et un bon estomac, répétait volontiers Hector Servadac, on est bien partout ! »
Or, la philosophie, c’est comme la monnaie de poche d’un Gascon, il en a toujours dans sa bourse, et, pour l’estomac, toutes les eaux de la Garonne auraient pu passer à travers celui du capitaine sans le troubler un seul instant.
Quant à Ben-Zouf, la métempsycose une fois admise, il devait avoir été autruche dans une existence antérieure ; il en avait conservé un de ces viscères phénoménaux, aux puissants sucs gastriques, qui digèrent des cailloux comme des blancs de poulet.
Il convient de faire observer que les deux hôtes du gourbi étaient munis de provisions pour un mois, qu’une citerne leur donnait l’eau potable en abondance, que le fourrage emplissait les greniers de l’écurie, et que, au surplus, cette portion de la plaine comprise entre Tenez et Mostaganem, merveilleusement fertile, peut rivaliser avec les riches campagnes de la Mitidja. Le gibier n’y était pas trop rare ; or, il n’est pas défendu à un officier d’état-major d’emporter un fusil de chasse pendant ses tournées, du moment qu’il n’oublie ni son éclymètre ni sa planchette.
Le capitaine Servadac, rentré au gourbi, dîna avec un appétit que la promenade avait rendu féroce. Ben-Zouf savait remarquablement faire la cuisine. Avec lui, pas de fades préparations à craindre ! Il salait, vinaigrait et poivrait militairement. Mais, on l’a dit, il s’adressait à deux estomacs qui défiaient les condiments les plus pimentés et sur lesquels la gastralgie n’avait aucune prise.
Après le dîner, et pendant que son ordonnance serrait précieusement les restes du repas dans ce qu’il appelait « son armoire abdominale », le capitaine Servadac quitta le gourbi et alla prendre l’air, en fumant, sur la crête de la falaise.
La nuit commençait à tomber. Le soleil avait disparu, depuis plus d’une heure, derrière les épais nuages, au-dessous de cet horizon que la plaine coupait nettement au-delà du cours du Chéliff. Le ciel présentait alors un aspect singulier, que tout observateur des phénomènes cosmiques eût remarqué non sans quelque surprise. En effet, vers le nord, et bien que l’obscurité fût assez profonde déjà pour limiter la portée du regard à un rayon d’un demi-kilomètre, une sorte de lumière rougeâtre imprégnait les brumes supérieures de l’atmosphère. On ne voyait ni franges régulièrement découpées ni rayonnement de jets lumineux, projetés par un centre ardent. Par conséquent, rien n’indiquait l’apparition de quelque aurore boréale dont les magnificences, d’ailleurs, ne s’épanouissent que sur les hauteurs du ciel qui sont plus élevées en latitude. Un météorologiste eût donc été fort empêché de dire à quel phénomène était due l’illumination superbe de cette dernière nuit de l’année.
Mais le capitaine Servadac n’était pas précisément météorologiste. Depuis sa sortie de l’école, on peut croire qu’il n’avait jamais remis le nez dans son Cours de cosmographie. D’ailleurs, ce soir-là, il se sentait peu porté à observer la sphère céleste. Il flânait, il fumait. Songeait-il seulement à cette rencontre qui devait, le lendemain, le mettre face à face avec le comte Timascheff ? En tout cas, si cette pensée lui traversait parfois l’esprit, ce n’était pas pour l’exciter plus qu’il ne convenait contre le comte. On peut l’avouer, les deux adversaires étaient sans haine l’un pour l’autre, bien qu’ils fussent rivaux. Il s’agissait simplement de dénouer une situation où être deux c’est être un de trop. Aussi Hector Servadac tenait-il le comte Timascheff pour un fort galant homme, et le comte ne pouvait-il avoir pour l’officier qu’une sérieuse estime.
À huit heures du soir, le capitaine Servadac rentra dans l’unique chambre du gourbi, qui contenait son lit, une petite table de travail montée sur crémaillère, et quelques malles servant d’armoires. C’était dans le poste voisin, non au gourbi, que l’ordonnance exécutait ses préparations culinaires, et c’est là qu’il couchait, comme il le disait, « sur un sommier en bon cœur de chêne ! » Cela ne l’empêchait pas de dormir douze heures sans désemparer, et, là-dessus, il aurait rendu des points à un loir.
Le capitaine Servadac, assez peu pressé de dormir, s’assit à la table, sur laquelle étaient épars ses instruments de travail. Machinalement, il prit d’une main son crayon rouge et bleu, et de l’autre son compas de réduction. Puis, le papier à décalquer sous les yeux, il commença à le zébrer de lignes diversement colorées et inégales, qui ne rappelaient en rien le dessin sévère d’un levé topographique.
Pendant ce temps, Ben-Zouf, qui n’avait pas encore reçu ordre d’aller se coucher, étendu dans un coin, essayait de dormir, ce que l’agitation singulière de son capitaine rendait difficile.
C’est qu’en effet ce n’était pas l’officier d’état-major, mais le poète gascon, qui avait pris place à la table de travail. Oui ! Hector Servadac s’escrimait de plus belle ! Il s’acharnait à ce rondeau, évoquant une inspiration qui se faisait terriblement prier. Maniait-il donc le compas pour donner à ses vers une mesure rigoureusement mathématique ? Employait-il le crayon multicolore afin de mieux varier ses rimes rebelles ? on eût été tenté de le croire. Quoi qu’il en soit, le travail était laborieux.
« Eh, mordioux ! s’écriait-il, pourquoi ai-je été choisir cette forme de quatrain, qui m’oblige à ramener les mêmes rimes comme des fuyards pendant la bataille ? De par tous les diables ! je lutterai ! Il ne sera pas dit qu’un officier français aura reculé devant des rimes. Une pièce de vers, c’est comme un bataillon ! La première compagnie a déjà donné ! – Il voulait dire le premier quatrain. – En avant les autres ! »
Les rimes poursuivies à outrance revinrent enfin à l’appel, car une ligne rouge et une ligne bleue s’allongèrent bientôt sur le papier :
De beaux discours remplis d’emphases,
Qu’est-il besoin ?
« Que diable marmotte donc mon capitaine ? se demandait Ben-Zouf, en se tournant et retournant. Voilà une heure qu’il s’agite comme un canard qui revient de semestre. »
Hector Servadac arpentait le gourbi en proie à toute la fureur de l’inspiration poétique :
Et que vraiment des longues phrases
Le cœur est loin !
« Bien sûr, il fait des vers ! se dit Ben-Zouf en se redressant dans son coin. En voilà un métier bruyant ! Il n’y a pas moyen de dormir ici. »
Et il poussa un sourd grognement.
« Eh ! qu’as-tu donc, Ben-Zouf ? demanda Hector Servadac.
– Rien, mon capitaine. C’est le cauchemar !
– Le diable t’emporte !
– Je le veux bien, et tout de suite, murmura Ben-Zouf, surtout s’il ne fait pas de vers !
– Cet animal-là m’a coupé ma verve ! dit le capitaine Servadac. Ben-Zouf !
– Présent, mon capitaine ! répondit l’ordonnance, qui se releva, une main à son bonnet, l’autre à la couture de son pantalon.
– Ne bouge pas, Ben-Zouf ! Ne bouge pas ! Je tiens au moins le dénouement de mon rondeau ! »
Et, d’une voix inspirée, Hector Servadac d’ajouter avec de grands gestes de poète :
Croyez-moi, ma tendresse est sûre !
Je vous promets
Que je vous aime…, je le jure,
Et pour…
Ce dernier mot n’était pas prononcé, que le capitaine Servadac et Ben-Zouf étaient précipités la face contre terre avec une effroyable violence.
Chapitre IV
Qui permet au lecteur de multiplier à l’infini les points d’exclamation et d’interrogation !
Pourquoi, à ce moment même, l’horizon s’était-il si étrangement et si subitement modifié, que l’œil exercé d’un marin n’eût pu reconnaître la ligne circulaire sur laquelle devaient se confondre le ciel et l’eau ?
Pourquoi la mer élevait-elle alors ses lames à une hauteur que les savants avaient refusé d’admettre jusqu’alors ?
Pourquoi, au milieu des craquements du sol qui se déchirait, s’était-il produit un épouvantable fracas, composé de bruits divers, tels que grincements dus à une dislocation violente de la charpente du globe, mugissements des eaux entrechoquées à une profondeur anormale, sifflements des nappes d’air aspirées comme elles le sont dans un cyclone ?
Pourquoi, à travers l’espace, cet éclat extraordinaire, plus intense que les fulgurations d’une aurore boréale, éclat qui envahit le firmament et éclipsa momentanément les étoiles de toutes grandeurs ?
Pourquoi le bassin de la Méditerranée, qui semblait s’être vidé un instant, se remplit-il à nouveau de ses eaux étrangement furieuses ?
Pourquoi le disque de la lune parut-il s’agrandir démesurément, comme si, en quelques secondes, l’astre des nuits se fût rapproché de quatre-vingt-seize mille lieues à dix mille ?
Pourquoi, enfin, un nouveau sphéroïde énorme, flamboyant, inconnu des cosmographes, apparut-il au firmament, pour aller bientôt se perdre derrière d’épaisses couches de nuages ?
Enfin, quel étrange phénomène avait produit ce cataclysme, qui bouleversa si profondément la terre, la mer, le ciel, tout l’espace ?
Qui eût pu le dire ? et restait-il même un seul des habitants sur le globe terrestre pour répondre à ces questions ?
Chapitre V
Dans lequel il est parlé de quelques modifications apportées à l’ordre physique, sans qu’on puisse en indiquer la cause
Cependant, aucun changement ne semblait s’être produit dans cette portion du littoral algérien, bornée à l’ouest par la rive droite du Chéliff et au nord par la Méditerranée. Bien que la commotion eût été très violente, ni sur cette fertile plaine, peut-être un peu bossuée çà et là, ni sur la ligne capricieuse de la falaise, ni sur la mer qui s’agitait outre mesure, rien n’indiquait qu’une modification eût altéré leur aspect physique. Le poste de pierre, sauf en quelques parties de la muraille assez profondément disjointes, avait suffisamment résisté. Quant au gourbi, il s’était aplati sur le sol comme un château de cartes au souffle d’un enfant, et ses deux hôtes gisaient sans mouvement sous le chaume affaissé.
Ce fut deux heures seulement après la catastrophe, que le capitaine Servadac reprit connaissance. Il eut tout d’abord quelque peine à rassembler ses souvenirs, mais les premiers mots qu’il prononça – cela ne surprendra personne – furent les derniers de ce fameux rondeau, qui avaient été si extraordinairement coupés sur ses lèvres :
« … je le jure, Et pour… »
Puis aussitôt : « Ah çà, dit-il, qu’est-il arrivé ? »
À cette demande qu’il s’adressa, il lui était assez difficile de répondre. Soulevant alors le bras, il parvint à défoncer la couverture de paille, et sa tête apparut hors du chaume.
Le capitaine Servadac regarda d’abord autour de lui.
« Le gourbi par terre ! s’écria-t-il. C’est quelque trombe qui aura passé sur le littoral ! »
Il se tâta. Pas une luxation, pas même une égratignure.
« Mordioux ! et mon brosseur ! »
Il se releva. Puis :
« Ben-Zouf ! » cria-t-il.
À la voix du capitaine Servadac, une seconde tête fit sa trouée à travers le chaume.
« Présent ! » répondit Ben-Zouf.
On eût dit que l’ordonnance n’attendait que cet appel pour paraître militairement.
« As-tu quelque idée de ce qui est arrivé, Ben-Zouf ? demanda Hector Servadac.
– J’ai idée, mon capitaine, que nous avons tout l’air de tirer notre dernière étape.
– Bah ! Une trombe, Ben-Zouf, une simple trombe !
– Va pour une trombe ! répondit philosophiquement l’ordonnance. – Rien de particulièrement cassé, mon capitaine ?
– Rien, Ben-Zouf. »
Un instant après, tous deux étaient debout ; ils déblayaient l’emplacement du gourbi ; ils retrouvaient leurs instruments, leurs effets, leurs ustensiles, leurs armes à peu près intacts, et l’officier d’état-major disait :
« Ah çà, quelle heure est-il ?
– Au moins huit heures, répondit Ben-Zouf en regardant le soleil, qui était très sensiblement élevé au-dessus de l’horizon.
– Huit heures !
– Au moins, mon capitaine !
– Est-il possible ?
– Oui, et il faut partir !
– Partir ?
– Sans doute, pour notre rendez-vous.
– Quel rendez-vous ?
– Notre rencontre avec le comte…
– Ah ! mordioux ! s’écria le capitaine, j’allais l’oublier ! »
Et tirant sa montre :
« Qu’est-ce que tu dis donc, Ben-Zouf ? Tu es fou ! il n’est que deux heures à peine.
– Deux heures du matin, ou deux heures du soir ? » répondit Ben-Zouf en regardant le soleil.
Hector Servadac approcha la montre de son oreille.
« Elle marche, dit-il.
– Et le soleil aussi, répliqua l’ordonnance.
– En effet, à sa hauteur au-dessus de l’horizon… Ah ! de par tous les crus du Médoc !…
– Qu’avez-vous, mon capitaine ?
– Mais il serait donc huit heures du soir ?
– Du soir ?
– Oui ! Le soleil est dans l’ouest, et il est évident qu’il va se coucher !
– Se coucher ? Non pas, mon capitaine, répondit Ben-Zouf. Il se lève bel et bien, comme un conscrit au coup de la diane ! Et voyez ! Depuis que nous causons, il a déjà monté sur l’horizon.
– Le soleil se lèverait maintenant dans l’ouest ! murmura le capitaine Servadac. Allons donc ! Ce n’est pas possible ! »
Cependant, le fait n’était pas discutable. L’astre radieux, apparaissant au-dessus des eaux du Chéliff, parcourait alors cet horizon occidental, sur lequel il avait tracé jusqu’alors la seconde moitié de son arc diurne.
Hector Servadac comprit sans peine qu’un phénomène absolument inouï, en tout cas inexplicable, avait modifié, non pas la situation du soleil dans le monde sidéral, mais le sens même du mouvement de rotation de la terre sur son axe.
C’était à s’y perdre. L’impossible pouvait-il donc devenir vrai ? Si le capitaine Servadac avait eu sous la main un des membres du Bureau des longitudes, il aurait essayé d’obtenir de lui quelques informations. Mais, absolument réduit à lui-même :
« Ma foi, dit-il, cela regarde les astronomes ! Je verrai, dans huit jours, ce qu’ils diront dans les journaux. »
Puis, sans s’arrêter plus longtemps à rechercher la cause de cet étrange phénomène :
« En route ! dit-il à son ordonnance. Quel que soit l’événement qui s’est accompli, et quand bien même toute la mécanique terrestre et céleste serait sens dessus dessous, il faut que j’arrive le premier sur le terrain pour faire au comte Timascheff l’honneur…
– De l’embrocher », répondit Ben-Zouf. Si Hector Servadac et son ordonnance eussent été d’humeur à observer les changements physiques qui s’étaient instantanément accomplis dans cette nuit du 31 décembre au 1er janvier, après avoir constaté cette modification dans le mouvement apparent du soleil, ils auraient, à coup sûr, été très frappés de l’incroyable variation qui s’était opérée dans les conditions atmosphériques. En effet, pour parler d’eux tout d’abord, ils se sentaient haletants, forcés de respirer plus rapidement, ainsi qu’il arrive aux ascensionnistes sur les montagnes, comme si l’air ambiant eût été moins dense, et, par conséquent, moins chargé d’oxygène. En outre, leur voix était plus faible. Donc, de deux choses l’une : ou bien ils avaient été frappés d’une demi-surdité, ou bien il fallait admettre que l’air fût tout à coup devenu moins propre à la transmission des sons.
Mais ces modifications physiques n’impressionnèrent, en ce moment, ni le capitaine Servadac ni Ben-Zouf, et tous deux se dirigèrent vers le Chéliff, en suivant l’abrupt sentier de la falaise.
Le temps, qui était très embrumé la veille, ne présentait plus la même apparence. Un ciel singulièrement teinté, qui se couvrit bientôt de nuages très bas, ne permettait plus de reconnaître l’arc lumineux que le soleil traçait d’un horizon à l’autre. Il y avait dans l’air des menaces d’une pluie diluvienne, sinon d’un orage à grand fracas. Toutefois, ces vapeurs, faute d’une condensation incomplète, n’arrivèrent pas à se résoudre.
La mer, pour la première fois sur cette côte, semblait être complètement déserte. Pas une voile, pas une fumée ne se détachaient sur les fonds grisâtres du ciel et de l’eau. Quant à l’horizon – était-ce une illusion d’optique ? – il semblait être extrêmement rapproché, aussi bien celui de la mer que celui qui circonscrivait la plaine, en arrière du littoral. Ses infinis lointains avaient disparu pour ainsi dire, comme si la convexité du globe eût été plus accusée.
Le capitaine Servadac et Ben-Zouf, marchant d’un pas rapide, sans échanger aucune parole, devaient avoir bientôt franchi les cinq kilomètres qui séparaient le gourbi du lieu de rendez-vous. L’un et l’autre, ce matin-là, purent observer qu’ils étaient physiologiquement organisés d’une tout autre manière. Sans trop s’en rendre compte, ils se sentaient particulièrement légers de corps, comme s’ils eussent eu des ailes aux pieds. Si l’ordonnance eût voulu formuler sa pensée, il aurait dit qu’il était « tout chose ».
« Sans compter que nous avons oublié de casser une forte croûte », murmura-t-il.
Et, il faut en convenir, ce genre d’oubli n’était pas dans les habitudes du brave soldat.
En ce moment, une sorte d’aboiement désagréable se fit entendre sur la gauche du sentier. Presque aussitôt un chacal s’échappa d’un énorme fourré de lentisques. Cet animal appartenait à une espèce particulière à la faune africaine qui porte un pelage régulièrement tacheté d’éclaboussures noires, et dont une raie, noire également, sillonne le devant des jambes.
Le chacal peut être dangereux, pendant la nuit, lorsqu’il chasse en troupe nombreuse. Seul, il n’est donc pas plus redoutable qu’un chien. Ben-Zouf n’était pas homme à s’inquiéter de celui-ci, mais Ben-Zouf n’aimait pas les chacals, – peut-être bien parce qu’il n’en existait pas une espèce spéciale à la faune de Montmartre.
L’animal, après avoir quitté le fourré, s’était acculé au pied d’une haute roche, qui mesurait bien dix mètres de hauteur. Il regardait avec une visible inquiétude les deux survenants. Ben-Zouf fit mine de l’ajuster, et, sur ce geste menaçant, l’animal, à la profonde stupéfaction du capitaine et de son ordonnance, s’élança et atteignit d’un seul bond le sommet de la roche.
« Quel sauteur ! s’écria Ben-Zouf. Il s’est enlevé à plus de trente pieds de bas en haut !
– C’est parbleu vrai ! répondit le capitaine Servadac tout songeur. Je n’ai jamais vu faire un bond pareil ! »
Le chacal, posé au sommet de la roche et planté sur son derrière, restait à les observer tous deux d’un air goguenard. Aussi, Ben-Zouf ramassa-t-il une pierre pour le forcer à déguerpir.
La pierre était fort grosse, et, cependant, elle ne pesa pas plus à la main de l’ordonnance que si elle n’eût été qu’une éponge pétrifiée.
« Satané chacal ! se dit Ben-Zouf. Cette pierre-là ne lui fera pas plus de mal qu’une brioche ! Mais pourquoi est-elle à la fois si légère et si grosse ? »
Cependant, n’ayant pas autre chose sous la main, il lança vigoureusement la susdite brioche.
Le chacal fut manqué. Toutefois, l’acte de Ben-Zouf, indiquant des intentions peu conciliantes, avait suffi à mettre en fuite le prudent animal, qui, bondissant par-dessus les haies et les rideaux d’arbres, disparut après une série de sauts gigantesques, comme eût pu faire un kangourou en gomme élastique.
Quant à la pierre, au lieu de frapper le but visé, elle avait décrit une trajectoire très tendue, à l’extrême surprise de Ben-Zouf, qui la vit tomber à plus de cinq cents pas au-delà de la roche.
« Nom d’un bédouin ! s’écria-t-il, mais je rendrais maintenant des points à un obusier de quatre ! »
Ben-Zouf se trouvait alors à quelques mètres en avant de son capitaine, près d’un fossé, rempli d’eau et large de dix pieds, qu’il s’agissait de franchir. Il prit donc son élan et sauta avec l’entrain d’un gymnaste.
« Eh bien ! Ben-Zouf, où vas-tu donc ? Qu’est-ce qui te prend ? Tu vas te casser les reins, imbécile ! »
Ces paroles échappèrent soudain au capitaine Servadac, et elles étaient provoquées par la situation de son ordonnance, qui se trouvait alors à une quarantaine de pieds en l’air.
Hector Servadac, à la pensée du danger que Ben-Zouf pouvait courir en retombant, s’élança à son tour pour franchir le fossé ; mais l’effort musculaire qu’il fit le porta lui-même à une hauteur qui ne pouvait être moindre de trente pieds. Il croisa même, en montant, Ben-Zouf qui redescendait. Puis, obéissant à son tour aux lois de la gravitation, il revint au sol avec une vitesse croissante, mais sans éprouver un choc plus violent que s’il ne se fût élevé qu’à quatre ou cinq pieds de hauteur.
« Ah çà ! s’écria Ben-Zouf, en éclatant de rire, nous voilà donc passés clowns, mon capitaine ! »
Hector Servadac, après quelques instants de réflexion, s’avança vers son ordonnance, et lui mettant la main sur l’épaule :
« Ne t’envole plus, Ben-Zouf, lui dit-il, et regarde-moi bien ! Je ne suis pas réveillé, réveille-moi, pince-moi jusqu’au sang, s’il le faut ! Nous sommes fous ou bien nous rêvons !
– Le fait est, mon capitaine, répondit Ben-Zouf, que ces choses-là ne me sont jamais arrivées que dans le pays des rêves, quand je rêvais que j’étais hirondelle, et que je franchissais la butte Montmartre, comme j’aurais fait de mon képi ! Tout ça n’est pas naturel ! Il nous est arrivé quelque chose, mais là, quelque chose qui n’est arrivé à personne encore ! Est-ce que c’est particulier à la côte d’Algérie, ce qui s’est passé ? »
Hector Servadac était plongé dans une sorte de stupeur.
« C’est à devenir enragé ! s’écria-t-il. Nous ne dormons pas, nous ne rêvons pas !… »
Mais il n’était pas homme à s’arrêter éternellement devant ce problème, très difficile à résoudre en ces circonstances.
« Après tout, arrive que pourra ! s’écria-t-il, décidé désormais à ne plus s’étonner de rien.
– Oui, mon capitaine, répondit Ben-Zouf, et, avant toute chose, terminons notre affaire avec le comte Timascheff. »
Au-delà du fossé, s’étendait une petite prairie d’un demi-hectare, tapissée d’une herbe moelleuse et à laquelle des arbres, plantés depuis une cinquantaine d’années, chênes-verts, palmiers, caroubiers, sycomores, mêlés aux cactus et aux aloès, que dominaient deux ou trois grands eucalyptus, faisaient un cadre charmant.
C’était précisément le champ clos où devait s’effectuer la rencontre des deux adversaires.
Hector Servadac promena un rapide regard sur la prairie. Puis, ne voyant personne :
« Mordioux ! dit-il, nous sommes tout de même les premiers arrivés au rendez-vous !
– Ou les derniers ! répliqua Ben-Zouf.
– Comment ? Les derniers ? Mais il n’est pas neuf heures, répliqua le capitaine Servadac en tirant sa montre qu’il avait à peu près réglée sur le soleil avant de quitter le gourbi.
– Mon capitaine, demanda l’ordonnance, voyez-vous cette boule blanchâtre à travers les nuages ?
– Je la vois, répondit le capitaine, en regardant un disque fortement embrumé, qui, en ce moment, apparaissait au zénith.
– Eh bien, reprit Ben-Zouf, cette boule-là, ça ne peut être que le soleil ou son suppléant !
– Le soleil au zénith, au mois de janvier, et sur le trenteneuvième degré de latitude nord ? s’écria Hector Servadac.
– Lui-même, mon capitaine, et il marque bien midi, ne vous en déplaise. Paraît qu’il était pressé aujourd’hui, et je parie mon képi contre une soupière de couscoussou, qu’il sera couché avant trois heures d’ici ! »
Hector Servadac, les bras croisés, resta pendant quelques instants immobile. Puis, après avoir fait un tour sur lui-même, ce qui lui avait permis d’examiner les divers points de l’horizon :
« Les lois de la pesanteur modifiées ! murmura-t-il, les points cardinaux changés, la durée du jour réduite de cinquante pour cent !… Voilà qui pourrait bien retarder indéfiniment ma rencontre avec le comte Timascheff ! Il y a quelque chose ! Ce n’est pas ma cervelle, que diable ! ni celle de Ben-Zouf qui ont déménagé ! »
L’indifférent Ben-Zouf, auquel le plus extraordinaire des phénomènes cosmiques n’aurait pas arraché une interjection quelconque, regardait tranquillement l’officier.
« Ben-Zouf ? dit celui-ci.
– Mon capitaine ?
– Tu ne vois personne ?
– Je ne vois personne. Notre Russe est reparti !
– En admettant qu’il fût reparti, mes témoins, eux, seraient restés à m’attendre, et, ne me voyant pas venir, ils n’auraient pas manqué de pousser jusqu’au gourbi.
– Juste, cela, mon capitaine.
– J’en conclus donc qu’ils ne sont pas venus !
– Et que s’ils ne sont pas venus ?…
– C’est que, très certainement, ils n’ont pas pu venir. Quant au comte Timascheff… »
Au lieu d’achever sa phrase, le capitaine Servadac s’approcha de la lisière rocheuse qui dominait le littoral, et il regarda si la goélette Dobryna n’était pas en vue à quelques encablures de la côte. Il pouvait se faire, après tout, que le comte Timascheff vînt par mer au lieu du rendez-vous, ainsi qu’il avait fait la veille.
La mer était déserte, et, pour la première fois, le capitaine Servadac observa que, bien qu’il ne fît aucun vent, elle était extraordinairement agitée, comme eût été de l’eau qui aurait été soumise à une ébullition prolongée sur un feu ardent. Certainement, la goélette n’aurait pas tenu sans peine contre cette houle anormale.
En outre, et pour la première fois aussi, Hector Servadac remarqua avec stupéfaction combien le rayon de cette circonférence, sur laquelle se confondaient le ciel et l’eau, avait diminué.
En effet, pour un observateur placé sur la crête de cette haute falaise, la ligne d’horizon aurait dû être reculée à une distance de quarante kilomètres. Or, dix kilomètres au plus formaient actuellement l’étendue du regard, comme si le volume du sphéroïde terrestre eût été considérablement diminué depuis quelques heures.
« Tout cela est par trop étrange ! » dit l’officier d’état-major.
Pendant ce temps, Ben-Zouf, aussi leste que le plus leste des quadrumanes, s’était hissé à la cime d’un eucalyptus. De ce point élevé, il observa le continent aussi bien dans la direction de Tenez et de Mostaganem que dans sa partie méridionale. Puis, une fois redescendu, il put affirmer à son capitaine que la plaine paraissait être absolument déserte.
« Au Chéliff ! dit Hector Servadac. Gagnons le fleuve ! Là, nous saurons peut-être à quoi nous en tenir !
– Au Chéliff ! » répondit Ben-Zouf.
Trois kilomètres au plus séparaient la prairie du fleuve que le capitaine Servadac comptait franchir, afin de pousser ensuite jusqu’à Mostaganem. Il lui fallait se hâter, s’il voulait atteindre la ville avant la chute du jour. À travers l’opaque couche de nuages, on sentait bien que le soleil déclinait très rapidement, et, – singularité inexplicable à joindre à tant d’autres –, au lieu de tracer la courbe oblique qu’exigeait la latitude de l’Algérie à cette époque de l’année, il tombait perpendiculairement à l’horizon.
Tout en marchant, le capitaine Servadac réfléchissait à ces étrangetés diverses. Si, par quelque phénomène absolument inouï, le mouvement de rotation du globe semblait avoir été modifié, si même, à considérer le passage du soleil au zénith, on devait admettre que la côte algérienne avait été reportée au-delà de l’équateur dans l’hémisphère austral, il ne semblait pas que la terre, sauf en ce qui concernait sa convexité, eût éprouvé quelque modification importante, – du moins en cette portion de l’Afrique. Le littoral était ce qu’il avait toujours été, une succession de falaises, de grèves et de roches arides, rouges comme si elles eussent été ferrugineuses. Aussi loin que le regard pouvait s’étendre, la côte n’avait subi aucune déformation. Aucune modification n’apparaissait sur la gauche, vers le sud, ou du moins vers ce que le capitaine Servadac persistait à appeler le sud, bien que la position de deux points cardinaux eût été évidemment changée, – car, pour le moment, il fallait bien se rendre à l’évidence, ils étaient intervertis. À trois lieues environ se développaient les premières rampes des monts Merjejah, et leur ligne de faîte traçait nettement sur le ciel son profil accoutumé.
En ce moment, une trouée se fit dans les nuages, et les rayons obliques du soleil arrivèrent jusqu’au sol. Il était patent que l’astre radieux, après s’être levé à l’ouest, allait se coucher à l’est.
« Mordioux ! s’écria le capitaine Servadac, je suis curieux de savoir ce qu’ils pensent de tout cela à Mostaganem ! Que dira le ministre de la Guerre, lorsqu’il aura appris par télégramme que sa colonie d’Afrique est désorientée au physique comme elle ne l’a, en aucun temps, été au moral ?
– La colonie d’Afrique, répondit Ben-Zouf, on la fourrera tout entière à la salle de police !
– Et que les points cardinaux sont en désaccord complet avec les règlements militaires !
– Aux compagnies de discipline, les points cardinaux !
– Et qu’au mois de janvier, le soleil vient me frapper perpendiculairement de ses rayons !
– Frapper un officier ! Fusillé le soleil ! »
Ah ! c’est que Ben-Zouf était à cheval sur la discipline. Cependant, Hector Servadac et lui se hâtaient le plus possible. Servis par l’extraordinaire légèreté spécifique, devenue leur essence même, faits déjà à cette décompression de l’air qui rendait leur respiration plus haletante, ils couraient mieux que des lièvres, ils bondissaient comme des chamois. Ils ne suivaient plus le sentier qui serpentait au sommet de la falaise et dont les détours eussent allongé leur route. Ils se dirigeaient par le plus court – à vol d’oiseau, comme on dit sur l’ancien continent –, à vol d’abeilles, comme on dit sur le nouveau. Nul obstacle ne pouvait les arrêter. Une haie, ils s’élançaient par-dessus ; un ruisseau, ils le franchissaient d’un bond ; un rideau d’arbres, ils le sautaient à pieds joints ; une butte, ils la passaient au vol. Montmartre, dans ces conditions, n’eût coûté qu’une enjambée à Ben-Zouf. Tous deux n’avaient plus qu’une crainte : c’était de s’allonger suivant la verticale en voulant s’accourcir suivant l’horizontale. Vraiment, c’est à peine s’ils touchaient ce sol, qui semblait ne plus être qu’un tremplin d’une élasticité sans limites.
Enfin, les bords du Chéliff apparurent, et, en quelques bonds, le capitaine Servadac et son ordonnance étaient sur sa rive droite.
Mais là, ils furent bien forcés de s’arrêter. Le pont, en effet, n’existait plus, et pour cause.
« Plus de pont ! s’écria le capitaine Servadac. Il y a donc eu par là une inondation, une reprise du déluge !
– Peuh ! » fit Ben-Zouf.
Et, cependant, il y avait lieu d’être étonné. En effet, le Chéliff avait disparu. De sa rive gauche il n’existait plus aucune trace. Sa rive droite, qui se dessinait la veille à travers la fertile plaine, était devenue un littoral. Dans l’ouest, des eaux tumultueuses, grondantes et non plus murmurantes, bleues et non plus jaunes, remplaçaient à perte de vue son cours paisible. C’était comme une mer qui s’était substituée au fleuve. Là finissait maintenant la contrée dont le développement formait hier encore le territoire de Mostaganem.
Hector Servadac voulut en avoir le cœur net. Il s’approcha de la rive, toute cachée sous les touffes de lauriers-roses, il puisa de l’eau avec sa main, il la porta à sa bouche…
« Salée ! dit-il. La mer, en quelques heures, a englouti toute la partie ouest de l’Algérie !
– Alors, mon capitaine, dit Ben-Zouf, cela durera plus longtemps, sans doute, qu’une simple inondation ?
– C’est le monde changé ! répondit l’officier d’état-major en secouant la tête, et ce cataclysme peut avoir des conséquences incalculables ! Mes amis, mes camarades, que sont-ils devenus ? »
Ben-Zouf n’avait jamais vu Hector Servadac si vivement impressionné. Il accorda donc sa figure avec la sienne, bien qu’il comprit encore moins que lui ce qui avait pu se passer. Il en aurait même pris philosophiquement son parti, s’il n’eût été de son devoir de partager « militairement » les sentiments de son capitaine.
Le nouveau littoral, dessiné par l’ancienne rive droite du Chéliff, courait nord et sud, suivant une ligne légèrement arrondie. Il ne semblait pas que le cataclysme, dont cette portion de l’Afrique venait d’être le théâtre, ne l’eût aucunement touché. Il était resté tel que l’établissait le levé hydrographique, avec ses bouquets de grands arbres, sa berge capricieusement découpée, le tapis vert de ses prairies. Seulement, au lieu d’une rive de fleuve, il formait à présent le rivage d’une mer inconnue.
Mais c’est à peine si le capitaine Servadac, devenu très sérieux, eut le temps d’observer les changements qui avaient si profondément altéré l’aspect physique de cette région. L’astre radieux, arrivé sur l’horizon de l’est, y tomba brusquement, comme fait un boulet dans la mer. On eût été sous les tropiques, au 21 septembre ou au 21 mars, à cette époque où le soleil coupe l’écliptique, que le passage du jour à la nuit ne se fût pas opéré plus rapidement. Ce soir-là, il n’y eut pas de crépuscule, et, le lendemain, il était probable qu’il n’y aurait pas d’aurore. Terre, mer, ciel, tout s’ensevelit instantanément dans une obscurité profonde.
Chapitre VI
Qui engage le lecteur à suivre le capitaine Servadac pendant sa première excursion sur son nouveau domaine
Le caractère aventureux du capitaine Servadac étant donné, on accordera sans peine qu’il ne se montrât point définitivement abasourdi de tant d’événements extraordinaires. Seulement, moins indifférent que Ben-Zouf, il aimait assez à savoir le pourquoi des choses. L’effet lui importait peu, mais à cette condition que la cause lui fût connue. À l’entendre, être tué par un boulet de canon n’était rien, du moment que l’on savait en vertu de quelles lois de balistique et par quelle trajectoire il vous arrivait en pleine poitrine. Telle était sa manière d’envisager les faits de ce monde. Aussi, après s’être préoccupé, autant que le comportait son tempérament, des conséquences du phénomène qui s’était produit, il ne songeait plus guère qu’à en découvrir la cause.
« Pardieu ! s’écria-t-il, au moment où la nuit se faisait subitement, il faudra voir cela au grand jour… en admettant que le jour, grand ou petit, revienne, car je veux qu’un loup me croque si je sais où s’en est allé le soleil !
– Mon capitaine, dit alors Ben-Zouf, sans vous commander, que faisons-nous maintenant ?
– Nous restons ici, et demain, s’il y a un demain, nous reviendrons au gourbi, après avoir reconnu la côte à l’ouest et au sud. Le plus important est de savoir où nous sommes et où nous en sommes, à défaut de pouvoir nous rendre compte de ce qui s’est passé par là-bas. Donc, après avoir suivi la côte à l’ouest et au sud.
– S’il y a une côte, fit observer l’ordonnance.
– Et s’il y a un sud ! répondit le capitaine Servadac.
– Alors on peut dormir ?
– Oui, si on le peut ! »
Et sur cette autorisation, Ben-Zouf, que tant d’incidents ne pouvaient émouvoir, se blottit dans une anfractuosité du littoral, mit ses deux poings sur ses yeux et s’endormit du sommeil de l’ignorant, qui est quelquefois plus profond que celui du juste. Le capitaine Servadac, lui, alla errer sur le rivage de la nouvelle mer, au milieu d’un fourmillement de points d’interrogation qui s’entrecroisaient devant ses yeux. Et d’abord, quelle pouvait être l’importance de la catastrophe ? S’était-elle exercée sur une portion restreinte de l’Afrique ? Alger, Oran, Mostaganem, ces villes si voisines cependant, avaient-elles été épargnées ? Hector Servadac devait-il croire que ses amis, ses camarades de la subdivision, étaient présentement engloutis avec les nombreux habitants de cette côte, ou que la Méditerranée, déplacée par une commotion quelconque avait seulement envahi cette partie du territoire algérien par l’embouchure du Chéliff ? Cela expliquait bien, dans une certaine mesure, la disparition du fleuve. Mais les autres faits cosmiques, cela ne les expliquait pas du tout.
Autre hypothèse. Fallait-il admettre que le littoral africain avait été soudain reporté jusqu’à la zone équatoriale ? Cela expliquait à la fois et le nouvel arc diurne décrit par le soleil et l’absence totale de crépuscule, mais non pas pourquoi des jours de six heures remplaçaient ceux de douze, ni comment il se faisait que le soleil se levait à l’ouest et se couchait à l’est !
« Et il est pourtant bien certain, se répétait le capitaine Servadac, que nous n’avons eu aujourd’hui que six heures de jour, et que les points cardinaux sont changés cap pour cap, comme dirait un marin, du moins en ce qui concerne le levant et le couchant ! Enfin, nous verrons demain, quand le soleil reviendra, – s’il revient ! »
Le capitaine Servadac était devenu très méfiant.
Il était vraiment fâcheux que le ciel fût couvert et que le firmament ne montrât pas son habituel étincellement d’étoiles. Bien que peu savant en cosmographie, Hector Servadac n’était pas sans connaître les principales constellations. Il aurait donc vu si la polaire était toujours à sa place, ou si, au contraire, quelque autre étoile ne la remplaçait pas, – ce qui eût irréfutablement prouvé que le globe terrestre tournait sur un nouvel axe, et peut-être en sens inverse, ce qui eût déjà donné la raison de bien des choses. Mais aucune trouée ne se fit dans ces nuages qui semblaient être assez denses pour contenir un déluge, et pas une étoile ne s’offrit aux yeux de l’observateur désappointé.
Quant à la lune, il ne fallait pas l’attendre, car elle était précisément nouvelle à cette époque du mois, et, par conséquent, elle avait disparu avec le soleil au-dessous de l’horizon.
Quelle fut donc la surprise du capitaine Servadac, lorsque, après une heure et demie de promenade, il aperçut au-dessus de l’horizon une forte lueur dont les rayons se tamisaient à travers le rideau de nuages.
« La lune ! s’écria-t-il. Mais non, ce ne peut être elle ! Est-ce que, par hasard, la chaste Diane ferait aussi des siennes et se lèverait dans l’ouest ? Non ! ce n’est pas la lune ! Elle ne produirait pas une lumière aussi intense, à moins qu’elle ne se fût singulièrement rapprochée de la terre. »
En effet, la lumière développée par cet astre, quel qu’il fût, était si considérable, qu’elle traversa l’écran des vapeurs, et un véritable demi-jour se répandit sur la campagne.
« Serait-ce donc le soleil ? se demanda l’officier. Mais il n’y a pas cent minutes qu’il s’est couché dans l’est ! Et pourtant, si ce n’est ni le soleil ni la lune, qu’est-ce donc ? Quelque monstrueux bolide ? Ah ! mille diables ! ces satanés nuages ne s’entrouvriront donc pas ? »
Puis, faisant un retour sur lui-même :
« Je vous demande un peu, se dit-il, si je n’aurais pas mieux fait d’employer une partie du temps que j’ai si sottement perdu, à apprendre l’astronomie ! Qui sait ? C’est peut-être très simple, tout ce que je me casse la tête à vouloir comprendre maintenant ! »
Les mystères de ce nouveau ciel restèrent impénétrables. L’énorme lueur, évidemment projetée par un disque éblouissant, de dimension gigantesque, inonda de ses rayons le dôme supérieur des nuages pendant une heure environ. Puis – particularité non moins surprenante – le disque, au lieu de décrire un arc, comme tout astre fidèle aux lois de la mécanique céleste, au lieu de redescendre sur l’horizon opposé, sembla s’éloigner suivant une ligne perpendiculaire au plan de l’équateur, entraînant avec lui ce demi-jour, si doux à l’œil, qui imprégnait vaguement l’atmosphère.
Tout rentra donc dans l’obscurité, et le cerveau du capitaine Servadac n’échappa point à cet assombrissement général. Le capitaine n’y comprenait absolument rien. Les règles les plus élémentaires de la mécanique étaient enfreintes, la sphère céleste ressemblait à une horloge dont le grand ressort vient de s’affoler subitement, les planètes manquaient à toutes les lois de la gravitation, et il n’existait plus aucune raison de penser que le soleil dût reparaître jamais sur un horizon quelconque de ce globe.
Trois heures après, cependant, l’astre du jour, sans aube à son lever, revenait à l’ouest, la lumière matinale blanchissait l’amas des nuées, le jour succédait à la nuit, et le capitaine Servadac, consultant sa montre, notait que cette nuit avait duré exactement six heures.
Six heures ne pouvaient faire le compte de Ben-Zouf. Il fallut donc réveiller l’intrépide dormeur.
Hector Servadac le secoua sans plus de façon.
« Allons ! lève-toi, et en route ! lui cria-t-il.
– Eh, mon capitaine ! répondit Ben-Zouf en se frottant les yeux, il me semble que je n’ai pas mon compte ! C’est à peine si je commence à m’endormir !
– Tu as dormi toute la nuit !
– Une nuit, ça !…
– Une nuit de six heures, mais il faudra bien t’y faire !
– On s’y fera.
– En route. Pas de temps à perdre. Retournons au gourbi par le plus court, et voyons ce que sont devenus nos chevaux et ce qu’ils pensent de tout cela !
– Ils pensent, sans doute, répondit l’ordonnance, qui ne répugnait pas au calembour, que je ne les ai guère « pansés » depuis hier. Aussi, je vais leur faire une toilette complète, mon capitaine !
– C’est bon, c’est bon ! mais tu feras vite, et, dès qu’ils seront sellés, nous opérerons une reconnaissance. C’est bien le moins que nous sachions ce qui reste de l’Algérie !
– Et puis ?…
– Et puis, si nous ne pouvons gagner Mostaganem par le sud, nous nous rabattrons sur Tenez par l’est. »
Le capitaine Servadac et son ordonnance reprirent le sentier des falaises, pour revenir au gourbi. Comme ils se sentaient grand appétit, ils ne se firent pas faute de cueillir, chemin faisant, figues, dattes et oranges qui pendaient à portée de leur main. Sur cette partie du territoire, absolument déserte, dont de nouvelles plantations avaient fait un riche et vaste verger, ils n’avaient à craindre aucun procès-verbal.
Une heure et demie après avoir quitté ce rivage qui avait été la rive droite du Chéliff, ils arrivaient au gourbi. Là, ils retrouvèrent les choses dans l’état où ils les avaient laissées. Personne, évidemment, n’était venu en cet endroit pendant leur absence, et la partie est du territoire semblait être aussi déserte que cette partie ouest qu’ils venaient de parcourir.
Les préparatifs de départ furent lestement faits. Quelques biscuits et des conserves de gibier emplirent la musette de Ben-Zouf. Quant à la boisson, l’eau ne manquait pas. De nombreux et limpides ruisseaux coulaient à travers la plaine. Ces anciens affluents d’un fleuve, devenus fleuves à leur tour, étaient maintenant tributaires de la Méditerranée.
Zéphyr – c’était le cheval du capitaine Servadac – et Galette (un souvenir du moulin de Montmartre) – c’était la jument de Ben-Zouf – furent harnachés en un tour de main. Les deux cavaliers se mirent rapidement en selle, et les voilà galopant vers le Chéliff.
Mais si eux-mêmes avaient déjà ressenti le effets de la diminution de la pesanteur, si leur force musculaire leur avait paru au moins quintuplée, les deux chevaux subirent dans la même proportion les mêmes modifications physiques. Ce n’étaient plus de simples quadrupèdes. Véritables hippogriffes, c’est à peine si leurs pieds touchaient le sol. Fort heureusement, Hector Servadac et Ben-Zouf étaient bons cavaliers, et, rendant la main, ils excitèrent plutôt qu’ils ne retinrent leurs montures.
En vingt minutes, les huit kilomètres qui séparaient le gourbi de l’embouchure du Chéliff furent franchis, et, prenant une allure plus modérée, les deux chevaux commencèrent à descendre vers le sud-est, en suivant l’ancienne rive droite du fleuve.
Ce littoral avait gardé l’aspect qui le caractérisait, lorsqu’il ne formait qu’une simple berge du Chéliff. Seulement, toute l’autre partie riveraine, on se le rappelle, avait disparu, et elle était remplacée par un horizon de mer. Ainsi donc, au moins jusqu’à la limite tracée par cet horizon, toute cette portion de la province d’Oran, en avant de Mostaganem, devait avoir été engloutie pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier.
Le capitaine Servadac connaissait parfaitement ce territoire, qu’il avait exploré. Il en avait fait autrefois la triangulation, et il pouvait s’orienter avec une exactitude parfaite. Son but, après l’avoir reconnu sur la plus grande étendue possible, était de faire un rapport qu’il adresserait… où, à qui et quand ? il l’ignorait.
Pendant les quatre heures de jour qui restaient, les deux cavaliers firent environ trente-cinq kilomètres depuis l’embouchure du Chéliff. La nuit venue, ils campèrent près d’un léger coude de ce qui avait été le fleuve, et devant lequel, la veille encore, se déversaient les eaux d’un affluent de sa rive gauche, la Mina, maintenant absorbée par la nouvelle mer.
Pendant cette excursion, on n’avait pas rencontré âme qui vive, ce qui ne laissait pas d’être surprenant.
Ben-Zouf organisa la couchée tant bien que mal. Les chevaux furent entravés et purent paître à loisir l’herbe épaisse qui tapissait la berge. La nuit se passa sans incident.
Le lendemain, 2 janvier, c’est-à-dire au moment où aurait dû commencer la nuit du 1er au 2 janvier suivant l’ancien calendrier terrestre, le capitaine Servadac et son ordonnance, remontant à cheval, continuèrent l’exploration du littoral. Partis au lever du soleil, ils franchirent pendant les six heures de jour une distance de soixante-dix kilomètres.
La délimitation du territoire était toujours formée par l’ancienne rive droite du fleuve. Seulement, à vingt kilomètres environ de la Mina, une portion importante de la rive avait disparu, et, avec elle, s’étaient engloutis l’annexe de Surkelmittou et les huit cents habitants qu’elle renfermait. Et qui sait si tel n’avait pas été le sort d’autres villes plus considérables de cette partie de l’Algérie, située au-delà du Chéliff, telles que Mazagran, Mostaganem, Orléansville ?
Après avoir contourné la petite baie créée nouvellement par la rupture de la rive, le capitaine Servadac retrouva la berge du fleuve, précisément en face de la place qu’aurait dû occuper la commune mixte d’Ammi-Moussa, l’ancienne Khamis des Béni-Ouragh. Mais il ne restait pas un seul vestige de ce chef-lieu de cercle, ni même du pic de Mankoura, haut de onze cent vingt-six mètres, en avant duquel il était bâti.
Ce soir-là, les deux explorateurs campèrent à un angle qui, de ce côté, terminait brusquement leur nouveau domaine. C’était presque à l’endroit où aurait dû se trouver l’importante bourgade de Memounturroy, dont il n’y avait plus aucune trace.
« Et moi qui comptais, ce soir, souper et coucher à Orléansville ! dit le capitaine Servadac, en considérant la sombre mer, étendue alors devant ses yeux.
– Impossible, mon capitaine, répondit Ben-Zouf, à moins d’y aller en bateau !
– Sais-tu bien, Ben-Zouf, que, tous les deux, nous avons eu une fière chance !
– Bon, mon capitaine ! C’est notre habitude ! Et vous verrez que nous trouverons le moyen de traverser cette mer pour aller flâner du côté de Mostaganem !
– Hum ! si nous sommes sur une presqu’île, ce qu’il faut espérer, c’est plutôt à Tenez que nous irons chercher des nouvelles !…
– Ou en donner », répondit fort judicieusement Ben-Zouf. Au retour du soleil, six heures plus tard, le capitaine Servadac pouvait examiner la nouvelle conformation du territoire. Du point où il avait campé pendant la nuit, le littoral courait maintenant sud et nord. Ce n’était plus une rive naturelle, ainsi que l’était autrefois celle du Chéliff. Une brisure, nouvellement faite, délimitait là l’ancienne plaine. À cet angle manquait, on l’a dit, la bourgade de Memounturroy. En outre, Ben-Zouf, ayant sauté sur une colline située en arrière, ne put rien apercevoir au-delà de l’horizon de mer. Pas de terre en vue. Par conséquent, rien d’Orléansville, qui aurait dû se trouver à dix kilomètres dans le sud-ouest.
Le capitaine Servadac et lui, abandonnant donc le lieu de campement, suivirent la nouvelle lisière au milieu des terres éboulées, des champs tranchés brusquement, des arbres à demi déracinés et pendant sur les eaux, – entre autres quelques vieux oliviers dont le tronc, fantastiquement contourné, semblait avoir été coupé à la hache.
Les deux cavaliers allaient plus lentement, car le littoral, frangé de criques et de caps, les obligeait à faire d’incessants détours. Si bien qu’au soleil couchant, après un nouveau parcours de trente-cinq kilomètres, ils avaient seulement atteint le pied des montagnes de Dj Merjejah, qui, avant la catastrophe, terminaient de ce côté la chaîne du Petit-Atlas.
En cet endroit, la chaîne était violemment rompue et s’élevait à pic sur le littoral.
Le lendemain matin, après avoir franchi à cheval une des gorges de la montagne, le capitaine Servadac et Ben-Zouf gravissaient à pied l’un des plus hauts sommets, et ils prenaient enfin une connaissance exacte de cette étroite portion du territoire algérien, dont, maintenant, ils semblaient être les seuls habitants.
Une nouvelle côte se développait depuis la base de la Merjejah jusqu’aux derniers rivages de la Méditerranée, sur une longueur de trente kilomètres environ. Aucun isthme ne rattachait ce territoire à celui de Tenez, qui avait disparu. Ce n’était donc point une presqu’île, mais une île que les deux explorateurs venaient d’explorer. Des hauteurs qu’il occupait, le capitaine Servadac fut obligé à sa grande surprise, de constater que la mer l’entourait de toutes parts, et, si loin que se portassent ses regards, il ne put découvrir aucune apparence de terre.
Cette île, nouvellement découpée dans le sol algérien, affectait la forme d’un quadrilatère irrégulier, presque un triangle, dont le périmètre pouvait se décomposer ainsi : cent vingt kilomètres sur l’ancienne rive droite du Chéliff ; trente-cinq kilomètres du sud au nord, en remontant vers la chaîne du Petit-Atlas ; trente kilomètres d’une ligne oblique qui aboutissait à la mer, et cent kilomètres de l’ancien littoral de la Méditerranée. En tout, deux cent quatre-vingt-cinq kilomètres.
« Très bien ! dit l’officier, mais pourquoi ?
– Bah ! Pourquoi pas ? répondit Ben-Zouf. C’est comme ça, parce que c’est comme ça ! Si le Père éternel l’a voulu, mon capitaine, faudra s’en arranger tout de même ! »
Tous deux redescendirent la montagne et reprirent leurs chevaux, qui broutaient tranquillement l’herbe verte. Ce jour-là, ils poussèrent jusqu’au littoral de la Méditerranée, sans trouver aucun vestige de la petite ville de Montenotte, disparue comme Tenez, dont pas une maison en ruine ne put même être aperçue à l’horizon.
Le lendemain, 5 janvier, ils firent une marche forcée le long du rivage méditerranéen. Ce littoral n’avait pas été respecté aussi complètement que le pensait l’officier d’état-major. Quatre bourgades manquaient sur cette côte : Callaat-Chimah, Agmiss, Marabout et Pointe-Basse. Les caps n’avaient pu résister au choc et s’étaient détachés du territoire. Du reste, les explorateurs avaient pu constater que leur île était absolument dépourvue d’habitants autres qu’eux-mêmes, mais la faune y était représentée par quelques troupeaux de ruminants qui erraient à travers la plaine.
Le capitaine Servadac et son ordonnance avaient employé à parcourir le périmètre de cette île cinq des nouveaux jours, soit, en réalité, deux et demi des anciens. Il y avait donc soixante heures qu’ils avaient quitté le gourbi, lorsqu’ils y rentrèrent.
« Eh bien, mon capitaine ? dit Ben-Zouf.
– Eh bien, Ben-Zouf ?
– Vous voilà gouverneur général de l’Algérie !
– Une Algérie sans habitants !
– Bon ! Est-ce que je ne compte pas ?
– Alors tu serais ?…
– La population, mon capitaine, la population !
– Et mon rondeau ? dit le capitaine Servadac en se couchant. C’était bien la peine de tant m’escrimer à le faire ! »
Chapitre VII
Dans lequel Ben-Zouf croit devoir se plaindre de la négligence du gouverneur général à son égard
Dix minutes après, le gouverneur général et la « population » dormaient profondément dans une des chambres du poste, le gourbi ne s’étant pas encore relevé de ses ruines. Cependant, le sommeil de l’officier fut légèrement troublé par cette pensée que, s’il avait constaté tant d’effets nouveaux, les causes premières lui étaient toujours inconnues. Sans être autrement cosmographe, un effort de sa mémoire lui rappela certaines lois générales qu’il croyait avoir oubliées. Il se demanda donc si un changement dans l’inclinaison de l’axe terrestre sur l’écliptique n’avait pas engendré ces phénomènes. Mais, si un pareil changement eût expliqué le déplacement des mers et peut-être celui des points cardinaux, il n’avait pu produire l’accourcissement des jours, ni la diminution de l’intensité de la pesanteur à la surface du globe. Hector Servadac dut bientôt renoncer à cette hypothèse, – ce qui ne laissa pas de le tracasser fort, car il était, comme on dit, au bout de son rouleau. Mais, sans doute, la série des singularités n’était pas close, et il était possible que quelque autre étrangeté le mît sur la voie. Il espérait, du moins.
Le lendemain, le premier soin de Ben-Zouf fut de préparer un bon déjeuner. Il fallait se refaire, que diable ! Lui avait faim comme trois millions d’Algériens. C’était le cas ou jamais d’en finir avec une douzaine d’œufs, que le cataclysme qui avait « cassé le pays » avait cependant respectés. Avec un bon plat de ce couscoussou que l’ordonnance savait préparer remarquablement, cela ferait un excellent repas.
Or, le fourneau était là, dans le poste, la casserole de cuivre luisait comme si elle sortait des mains du fourbisseur, l’eau fraîche attendait dans une de ces grandes alcarazas dont l’évaporation perlait la surface. Avec trois minutes d’immersion dans l’eau bouillante, Ben-Zouf se chargeait d’obtenir d’excellents œufs à la coque.
Le feu fut allumé en un tour de main, et, suivant sa coutume, l’ordonnance entonna le refrain militaire :
Y a-t-il du sel Dans la gamelle ? Y a-t-il du veau Pour le fricot ?
Le capitaine Servadac, allant et venant, observait d’un œil curieux ces préparatifs culinaires. À l’affût de nouveaux phénomènes qui pussent le tirer d’incertitude, il se demandait si quelque singularité n’allait pas encore se produire. Le fourneau fonctionnerait-il comme d’habitude ? L’air, modifié, lui apporterait-il son contingent d’oxygène ?
Oui, le fourneau s’alluma, et, sous le souffle un peu haletant de Ben-Zouf, une belle flamme se dégagea des brindilles mêlées aux morceaux de charbon. Donc, à cet égard, rien d’extraordinaire.
La casserole fut mise sur le fourneau, l’eau remplit la casserole, et Ben-Zouf attendit que le liquide entrât en ébullition pour y plonger ses œufs, qui paraissaient vides, tant ils pesaient peu à sa main.
La casserole n’était pas depuis deux minutes sur le fourneau, que l’eau bouillait déjà.
« Diable ! comme le feu chauffe à présent ! s’écria Ben-Zouf.
– Ce n’est pas le feu qui chauffe davantage, répondit le capitaine Servadac, après avoir réfléchi, c’est l’eau qui bout plus vite. »
Et, prenant un thermomètre centigrade suspendu au mur du poste, il le plongea dans l’eau bouillante. L’instrument ne marqua que soixante-six degrés. « Bon ! s’écria l’officier, voilà l’eau qui bout à soixante-six degrés au lieu de cent !
– Eh bien, mon capitaine ?
– Eh bien, Ben-Zouf, je te conseille de laisser tes œufs un bon quart d’heure dans ta casserole, et encore seront-ils à peine cuits !
– Mais ils seront durs ?
– Non, mon ami, et c’est tout au plus s’ils seront assez cuits pour colorer nos mouillettes ! »
La cause de ce phénomène était évidemment une diminution de hauteur de la couche atmosphérique, ce qui concordait avec la diminution de densité de l’air déjà observée. Le capitaine Servadac ne s’y trompa pas. La colonne d’air, au-dessus de la surface du globe, avait décru d’un tiers environ, et c’est pourquoi l’eau, soumise à une moindre pression, bouillait à soixante-six degrés au lieu de cent. Un phénomène identique se fût produit au sommet d’une montagne dont l’altitude aurait été de onze mille mètres, et si le capitaine Servadac avait possédé un baromètre, il eût déjà constaté cette décroissance de la colonne atmosphérique. C’est même cette circonstance qui avait provoqué chez Ben-Zouf et chez lui cet affaiblissement de la voix, cette aspiration plus vive, et cette décompression des vaisseaux sanguins, à laquelle ils étaient faits déjà.
« Et cependant, se dit-il, il me paraît difficile d’admettre que notre campement ait été transporté à une telle hauteur, puisque la mer est là, qui baigne les falaises ! »
Mais si, en cette occasion, Hector Servadac avait tiré des conséquences justes, il ne pouvait encore dire quelle en était la cause, Inde irae.
Cependant, grâce à une immersion plus longue, les œufs furent presque cuits. Il en fut de même pour le couscoussou. Ben-Zouf observa justement qu’il en serait quitte, à l’avenir, pour commencer ses opérations culinaires une heure plus tôt, et il servit son capitaine.
Et pendant que celui-ci mangeait de grand appétit, en dépit de ses préoccupations :
« Eh bien, mon capitaine ? dit Ben-Zouf, qui n’entrait jamais en matière sans employer cette formule interrogative.
– Eh bien, Ben-Zouf ? répondit l’officier, suivant l’invariable habitude qu’il avait de répondre ainsi à son ordonnance.
– Qu’allons-nous faire ?
– Nous allons attendre.
– Attendre ?…
– Que l’on vienne nous chercher.
– Par mer ?
– Par mer, nécessairement, puisque nous sommes maintenant campés dans une île.
– Alors, mon capitaine, vous pensez que les camarades…
– Je pense, ou du moins j’espère que la catastrophe a limité ses ravages à quelques points de la côte algérienne, et que, par conséquent, nos camarades sont sains et saufs.
– Oui, mon capitaine, il faut l’espérer.
– Il n’est donc pas douteux que le gouverneur général ne veuille avoir le cœur net de ce qui s’est passé. Il a dû expédier d’Alger quelque bâtiment pour explorer le littoral, et j’ose croire qu’il ne nous aura pas oubliés. Surveille donc la mer, Ben-Zouf, et, dès qu’un navire sera en vue, nous lui ferons des signaux.
– Et s’il ne vient pas de navire ?
– Alors nous construirons une embarcation, et nous irons à ceux qui ne seront pas venus à nous.
– Bon, mon capitaine. Vous êtes donc marin ?
– On est toujours marin quand il est nécessaire de l’être », répondit imperturbablement l’officier d’état-major.
Et voilà pourquoi Ben-Zouf, une longue-vue aux yeux, ne cessa d’interroger l’horizon pendant les jours qui suivirent. Mais aucune voile n’apparut dans le champ de sa lunette.
« Nom d’un Kabyle ! s’écriait-il, Son Excellence le gouverneur général met quelque négligence à notre endroit ! »
Au 6 janvier, la situation des deux insulaires ne s’était aucunement modifiée. Ce 6 janvier était la date vraie, c’est-à-dire celle du calendrier, avant que les anciens jours terrestres eussent perdu douze heures sur vingt-quatre. Le capitaine Servadac, non sans raison et dans le but de mieux s’y reconnaître, avait préféré s’en tenir à l’ancienne méthode. Aussi, bien que le soleil se fût levé et couché douze fois sur l’horizon de l’île, ne comptait-il que six jours depuis le 1er janvier à minuit, commencement du jour de l’année civile. Sa montre lui servait à noter exactement les heures écoulées. Bien évidemment, une horloge à balancier, dans les circonstances où il se trouvait, ne lui eût donné que des indications fausses, par suite de la diminution de la pesanteur ; mais une montre, mue par un ressort, n’est pas soumise aux effets de l’attraction, et, si la montre du capitaine Servadac était bonne, elle devait marcher régulièrement, même après tant de trouble apporté à l’ordre physique des choses. C’est ce qui arriva en cette occasion.
« Bigre ! mon capitaine, dit alors Ben-Zouf, qui avait quelque littérature, il me semble que vous tournez au Robinson et que je frise le Vendredi ! Est-ce que je suis Nègre ?…
– Non, Ben-Zouf, répondit le capitaine Servadac, tu es encore d’un joli blanc… foncé !
– Un Vendredi blanc, reprit Ben-Zouf, ça n’est pas complet, mais j’aime mieux ça ! »
Donc, le 6 janvier, n’ayant rien vu venir, le capitaine jugea convenable de faire ce qu’ont fait tous les Robinsons avant lui, c’est-à-dire d’inventorier les ressources végétales et animales de son domaine.
L’île Gourbi – il lui donna ce nom – avait une contenance superficielle de trois mille kilomètres carrés environ, soit trois cent mille hectares. Bœufs, vaches, chèvres et moutons s’y trouvaient en assez grand nombre, mais le chiffre ne pouvait en être fixé. Le gibier abondait, et il n’y avait plus à craindre qu’il abandonnât le territoire. Les céréales ne manquaient pas. Trois mois plus tard, les récoltes de blé, de maïs, de riz et autres seraient bonnes à engranger. Donc, la nourriture du gouverneur, de la population, des deux chevaux était assurée et bien au-delà. Si même de nouveaux habitants atterrissaient sur l’île, leur existence s’y trouverait complètement garantie.
Du 6 au 13 janvier, la pluie tomba avec une extrême abondance. Le ciel était constamment couvert d’épais nuages, que leur condensation ne parvenait pas à diminuer. Plusieurs gros orages éclatèrent aussi, – météores rares à cette époque de l’année. Mais Hector Servadac n’avait pas été sans observer que la température avait une tendance anormale à s’élever. Été singulièrement précoce que celui-là, car il commençait au mois de janvier ! Remarque encore plus étonnante, cet accroissement de température était non seulement constant, mais progressif, comme si le globe terrestre se fût rapproché du soleil d’une manière régulière et continue.
En même temps que la chaleur, la lumière devenait aussi plus intense, et, sans cet épais écran de vapeurs que les nuages interposaient entre le ciel et la surface de l’île, l’irradiation solaire eût éclairé les objets terrestres avec une vivacité tout à fait nouvelle.
Ce qu’était la rage d’Hector Servadac de ne pouvoir observer ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni aucun point de ce firmament qui eût peut-être répondu à ses questions si la brume se fût dissipée, on le comprend de reste. Ben-Zouf essaya une ou deux fois de calmer son capitaine en lui prêchant cette résignation qu’il poussait, lui, jusqu’à l’indifférence ; mais il fut si mal reçu, qu’il ne se hasarda plus à rien dire. Il se bornait donc à remplir convenablement ses fonctions de vigie. Malgré la pluie, malgré le vent, malgré l’orage, il montait sa garde, jour et nuit, au sommet de la falaise, ne donnant que quelques heures au sommeil. Mais c’était vainement qu’il parcourait des yeux cet horizon invariablement désert. D’ailleurs, quel navire eût pu tenir par ce mauvais temps et sous de telles bourrasques ? La mer soulevait ses lames à une inconcevable hauteur, et l’ouragan s’y déchaînait avec une fureur incomparable. Certes, à la seconde période de formation, lorsque les premières eaux, volatilisées par la chaleur interne, s’élevaient en vapeurs dans l’espace pour retomber en torrents sur la terre, les phénomènes de l’époque diluvienne n’avaient pu s’accomplir avec une plus surprenante intensité.
Mais, le 13, ce déluge cessa comme par enchantement. Les dernières violences du vent dissipèrent les derniers nuages dans la nuit du 13 au 14. Hector Servadac, depuis six jours confiné dans le poste, le quitta dès qu’il vit la pluie cesser et le vent calmir. Il courut se poster, lui aussi, sur la falaise. Qu’allait-il lire dans les astres ? Ce gros disque, un instant entrevu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, reparaîtrait-il à ses yeux ? Le secret de sa destinée lui serait-il révélé enfin ?
Le ciel resplendissait. Aucune vapeur ne voilait les constellations. Le firmament se tendait au regard comme une immense carte céleste, et quelques nébuleuses se dessinaient là où l’œil d’un astronome n’eût pu autrefois les distinguer sans télescope.
Le premier soin de l’officier fut d’observer la polaire, car observer la polaire, c’était son fort.
Elle était là, mais très abaissée sur l’horizon, et il était probable qu’elle ne servait plus de pivot central à tout le système stellaire. En d’autres termes, l’axe de la terre, indéfiniment prolongé, ne passait plus par le point fixe que cette étoile occupait ordinairement dans l’espace. Et en effet, une heure après, elle s’était sensiblement déplacée déjà et s’abaissait sur l’horizon, comme si elle eût appartenu à quelque constellation zodiacale.
Restait donc à trouver quelle était l’étoile qui la remplaçait, c’est-à-dire par quel point du ciel passait maintenant l’axe prolongé de la terre. Ce fut à cette observation que, pendant plusieurs heures, Hector Servadac s’attacha uniquement. La nouvelle polaire devait être immobile comme l’était l’ancienne, au milieu des autres étoiles qui, dans leur mouvement apparent, accomplissent autour d’elle leur révolution diurne.
Le capitaine Servadac reconnut bientôt que l’un de ces astres, très rapproché de l’horizon septentrional, remplissait ces conditions d’immobilité et semblait être stationnaire entre tous. C’était l’étoile Véga de la Lyre, – celle-là même qui, par suite de la précession des équinoxes, doit remplacer la polaire dans douze mille ans. Or, comme il ne s’était pas écoulé douze mille ans depuis quatorze jours, il fallait bien en conclure que l’axe de la terre avait été brusquement changé.
« Et alors, observa le capitaine, non seulement l’axe aurait été changé, mais, puisqu’il passe par un point si rapproché de l’horizon, il faudrait admettre que la Méditerranée se trouverait reportée à l’équateur. »
Et il tomba dans un abîme de réflexions, pendant que ses regards erraient de la Grande Ourse, devenue une constellation zodiacale et dont la queue seule sortait alors des eaux, jusqu’à ces nouvelles étoiles de l’hémisphère austral, qui, pour la première fois, se levaient à ses yeux.
Un cri de Ben-Zouf le ramena sur la terre.
« La lune ! s’écria l’ordonnance.
– La lune ?
– Oui ! la lune ! » répliqua Ben-Zouf, enchanté de revoir « la compagne des nuits terrestres », comme on dit en langage poétique.
Et il montrait un disque qui s’élevait à l’opposé de la place que devait occuper le soleil en ce moment.
Était-ce la lune ou quelque autre planète inférieure, grossie par le rapprochement ? Le capitaine Servadac eût été fort embarrassé de se prononcer. Il prit une assez forte lunette, dont il se servait habituellement dans ses opérations géodésiques, et il la braqua sur l’astre signalé.
« Si c’est la lune, dit-il, il faut avouer qu’elle s’est considérablement éloignée de nous ! Ce ne serait plus par milliers, ce serait par millions de lieues qu’il faudrait maintenant évaluer sa distance ! »
Après une minutieuse observation, il crut pouvoir affirmer que ce n’était point la lune. Il ne reconnaissait pas sur ce disque pâli ces jeux de lumière et d’ombre qui lui donnent en quelque sorte l’apparence d’une face humaine. Il n’y retrouvait aucune trace des plaines ou mers, ni de cette auréole de rainures qui rayonnent autour du splendide mont Tycho.
« Eh non ! Ce n’est pas la lune ! dit-il.
– Pourquoi n’est-ce pas la lune ? demanda Ben-Zouf, qui tenait particulièrement à sa découverte.
– Parce que cet astre-là possède lui-même une petite lune, qui lui sert de satellite ! »
En effet, un point lumineux, tel qu’apparaissent les satellites de Jupiter au foyer des instruments de médiocre puissance, se montrait assez nettement dans le champ de la lunette.
« Mais, si ce n’est pas la lune, qu’est-ce donc alors ? s’écria le capitaine Servadac en frappant du pied. Ce n’est pas Vénus, ce n’est pas Mercure, puisque ces deux planètes n’ont pas de satellites ! Et, cependant, il s’agit là d’une planète dont l’orbite est contenue dans celle de la terre, puisqu’elle accompagne le soleil dans son mouvement apparent ! Mais, mordioux ! si ce n’est ni Vénus ni Mercure, ce ne peut être que la lune, et, si c’est la lune, où diable a-t-elle volé ce satellite-là ? »
Chapitre VIII
Où il est question de Vénus et de Mercure, qui menacent de devenir des planètes d’achoppement
Le soleil reparut bientôt, et tout le fourmillement des étoiles s’effaça devant son intense irradiation. Plus d’observations possibles. Il fallait les remettre aux nuits prochaines, si l’état du ciel le permettait.
Quant à ce disque dont la lueur s’était glissée à travers la couche de nuages, le capitaine Servadac en avait en vain cherché quelque trace. Il avait disparu, soit que son éloignement, soit que les détours d’une course vagabonde l’eussent entraîné au-delà des limites du regard.
Le temps était décidément devenu magnifique. Le vent s’était presque complètement calmé, après avoir sauté à l’ancien ouest. Le soleil se levait toujours sur son nouvel horizon et se couchait à l’opposé avec une exactitude remarquable. Les jours et les nuits étaient mathématiquement de six heures, – d’où cette conséquence que le soleil ne s’écartait point du nouvel équateur, dont le cercle passait par l’île Gourbi.
En même temps, la température s’accroissait d’une manière continue. Le capitaine Servadac interrogeait plusieurs fois par jour le thermomètre, suspendu dans sa chambre, et, le 15 janvier, il constata que cet instrument marquait, à l’ombre, cinquante degrés centigrades.
Il va sans dire que, si le gourbi ne s’était pas encore relevé de ses ruines, le capitaine Servadac et Ben-Zouf avaient confortablement approprié la principale chambre du poste. Après les avoir mieux abrités contre les pluies diluviennes des premiers jours, ces murs de pierre les préservaient mieux aussi des ardeurs du jour. La chaleur commençait à devenir insoutenable, d’autant plus qu’aucun nuage ne tempérait l’ardeur du soleil, et jamais ni le Sénégal ni les parties équatoriales de l’Afrique n’avaient reçu pareilles averses de feu. Si cette température se maintenait, toute végétation serait inévitablement brûlée sur l’île.
Fidèle à ses principes, Ben-Zouf ne voulait point paraître surpris d’éprouver cette température anormale ; mais la sueur qui l’inondait protestait pour lui. Il n’avait pas voulu, d’ailleurs, et malgré les recommandations de son capitaine, abandonner sa faction sur le sommet de la falaise. Là, tandis qu’il observait cette Méditerranée, calme comme un lac, mais toujours déserte, il se laissait consciencieusement rôtir. Il fallait qu’il eût la peau doublée et le crâne blindé pour supporter si impunément les rayons perpendiculaires du soleil de midi.
Et un jour que le capitaine Servadac, le regardant, lui en faisait l’observation en disant :
« Ah çà, tu es donc né au Gabon ?
– Non, mon capitaine, à Montmartre, et c’est tout comme ! »
Du moment que le brave Ben-Zouf prétendait qu’il faisait aussi chaud sur sa butte favorite que dans les régions intertropicales, il n’y avait même pas à discuter.
Cette température ultra-caniculaire devait nécessairement influer sur les produits du sol de l’île Gourbi. Aussi la nature éprouva-t-elle les conséquences de cette modification climatérique. En peu de jours, la sève eut porté la vie jusqu’aux plus extrêmes branches des arbres, les bourgeons éclatèrent, les feuilles se développèrent, les fleurs s’épanouirent, les fruits apparurent. Il en fut de même pour les céréales. Épis de blé, de maïs poussèrent à vue d’œil, on peut l’affirmer, et les prairies se tapissèrent d’une herbe épaisse. Ce fut à la fois l’époque de la fenaison, de la moisson et de la récolte des fruits. Été et automne se confondirent dans une saison unique.
Pourquoi le capitaine Servadac n’était-il pas plus ferré sur la cosmographie ? Il se fût dit, en effet :
« Si l’inclinaison de l’axe de la terre a été modifiée, et si, comme tout semble l’indiquer, il forme un angle droit avec l’écliptique, les choses se passeront maintenant comme elles se passent dans Jupiter. Il n’y aura plus de saison sur le globe, mais des zones invariables, pour lesquelles l’hiver, le printemps, l’été et l’automne seront éternels. »
Et il n’eût pas manqué d’ajouter :
« Mais, de par tous les crus de la Gascogne ! Qu’est-ce qui peut nous avoir amené ce changement-là ? »
Cette saison hâtive ne laissa pas d’embarrasser le capitaine et son ordonnance. Il était bien évident que les bras manqueraient pour tant de travaux à la fois. Quand même on eût réquisitionné toute la « population » de l’île, on n’y fût pas arrivé. L’extrême chaleur eût empêché aussi de faire la besogne d’une façon continue. En tout cas, il n’y avait pas encore péril en la demeure. Les provisions du gourbi étaient abondantes, et, d’ailleurs, on pouvait espérer maintenant, la mer étant calme et le temps magnifique, qu’un navire ne tarderait pas à passer en vue de l’île. En effet, cette partie de la Méditerranée est très visitée, soit par les bâtiments de l’État qui font le service de la côte, soit par les caboteurs de toutes nationalités, dont les relations sont fréquentes avec les moindres points du littoral.
Cette façon de raisonner était juste, mais enfin, pour une raison ou pour une autre, aucun bâtiment n’apparaissait sur les eaux de la mer, et Ben-Zouf eût inutilement cuit à la cime des roches calcinées de la falaise, s’il ne s’y fût abrité sous une sorte de parasol.
Pendant ce temps, le capitaine Servadac essayait, mais en vain, de rappeler ses souvenirs de collège et d’école. Il se livrait à des calculs furibonds pour tirer au clair cette nouvelle situation faite au sphéroïde terrestre, mais sans trop y réussir. Et, cependant, il aurait dû être amené à penser que si le mouvement de rotation de la terre sur son axe s’était modifié, son mouvement de translation autour du soleil avait dû l’être également, et que, par conséquent, la durée de l’année ne pouvait plus être la même, soit qu’elle se fût accrue, soit qu’elle se fût restreinte.
Manifestement, en effet, la terre se rapprochait de l’astre radieux. Son orbite s’était évidemment déplacée, et ce déplacement concordait non seulement avec l’accroissement progressif de la température, mais de nouvelles observations auraient dû permettre au capitaine Servadac de constater ce rapprochement qui ramenait le globe vers son centre attractif.
En effet, le disque du soleil apparaissait alors sous un diamètre double de celui qu’il présentait à l’œil nu avant ces faits extraordinaires. Des observateurs, placés à la surface de Vénus, c’est-à-dire à une distance moyenne de vingt-cinq millions de lieues, l’auraient vu tel qu’il se montrait maintenant sous ces dimensions agrandies. Donc, comme conséquence à tirer de cette remarque, la terre ne devait plus être éloignée du soleil que de vingt-cinq millions de lieues au lieu de trente-huit millions. Restait à savoir si cette distance ne diminuerait pas encore, auquel cas on pouvait craindre que, par suite d’une rupture d’équilibre, le globe terrestre ne fût irrésistiblement entraîné jusqu’à la surface du soleil. C’eût été son complet anéantissement.
Si les jours, très beaux alors, donnaient toute facilité pour observer le ciel, les nuits, non moins belles, mettaient à la disposition du capitaine Servadac le magnifique ensemble du monde stellaire. Étoiles et planètes étaient là comme les lettres d’un immense alphabet qu’il enrageait de ne pouvoir qu’épeler. Sans doute, les étoiles n’eussent offert aucun changement à ses yeux, ni dans leurs dimensions, ni dans leurs distances relatives. On sait, en effet, que le soleil, qui s’avance vers la constellation d’Hercule avec une vitesse de soixante millions de lieues par an, n’a pas encore présenté un changement de position appréciable, tant est considérable l’éloignement de ces astres. Il en est de même pour Arcturus, qui se meut dans l’espace sidéral avec une vitesse de vingt-deux lieues par seconde, soit trois fois plus rapidement que la terre.
Mais si les étoiles ne pouvaient rien enseigner, il n’en était pas de même des planètes, – du moins de celles dont l’orbite se dessine intérieurement à l’orbite de la terre.
Deux planètes sont dans ces conditions, Vénus et Mercure. La première gravite à une distance moyenne de vingt-sept millions de lieues du soleil, la seconde à une distance de quinze millions. L’orbite de Vénus enveloppe donc celle de Mercure, et l’orbite de la terre les enveloppe toutes deux. Or, après longues observations et réflexions profondes, le capitaine Servadac fit cette remarque que la quantité de chaleur et de lumière, actuellement reçue par la terre, égalait à peu près celle que Vénus reçoit du soleil, soit le double de celle que lui envoyait le soleil avant la catastrophe. Or, s’il en tira cette conséquence que la terre avait dû considérablement se rapprocher de l’astre radieux, il en fut bien autrement certain, lorsqu’il eut observé de nouveau cette splendide Vénus, que les plus indifférents admirent eux-mêmes, lorsque, le soir ou le matin, elle se dégage des rayons du soleil.
Phosphorus ou Lucifer, Hespérus ou Vesper, comme l’appelaient les anciens, l’étoile du soir, l’étoile du matin, l’étoile du berger – jamais astre ne reçut autant de noms, si ce n’est peut-être l’astre de la nuit –, Vénus, enfin, s’offrait aux regards du capitaine Servadac sous la forme d’un disque relativement énorme. C’était comme une petite lune, et l’on distinguait parfaitement bien ses phases à l’œil nu. Tantôt pleine, tantôt en quadrature, toutes ses parties étaient nettement visibles. Les échancrures de son croissant montraient que les rayons solaires, réfractés par son atmosphère, pénétraient dans des régions pour lesquelles cependant il devait être déjà couché. Preuve que Vénus possédait une atmosphère, puisque les effets de réfraction se produisaient à la surface de son disque. Certains points lumineux, détachés du croissant, étaient autant de hautes montagnes auxquelles Schroeter a eu raison de donner en altitude dix fois la hauteur du mont Blanc, soit la cent quarante-quatrième partie du rayon de la planète[2].
Or, le capitaine Servadac, vers cette époque, se crut en droit d’affirmer que Vénus n’était pas à plus de deux millions de lieues de la terre, et il le dit à Ben-Zouf.
« Eh bien, mon capitaine, répondit l’ordonnance, c’est encore joli, cela, d’être séparé par deux millions de lieues !
– Ce serait quelque chose pour deux armées en campagne, répondit le capitaine Servadac, mais pour deux planètes, ce n’est rien !
– Que peut-il donc arriver ?
– Mordioux ! Que nous allions tomber sur Vénus !
– Eh ! eh ! mon capitaine, y a-t-il de l’air par là ?
– Oui.
– Et de l’eau ?
– Évidemment.
– Bon ! Allons voir Vénus !
– Mais le choc sera épouvantable, car les deux planètes paraissent marcher en sens inverse à présent, et, comme leurs masses sont à peu près égales, la collision sera terrible pour l’une et pour l’autre !
– Deux trains, quoi ! deux trains qui se rencontrent ! répondit Ben-Zouf d’un ton calme qui risquait de mettre le capitaine hors de lui.
– Oui ! deux trains, animal ! s’écria Hector Servadac, mais deux trains marchant mille fois plus vite que des express, ce qui amènera certainement la dislocation de l’une des planètes, de toutes deux peut-être, et nous verrons ce qui restera alors de ta motte de terre de Butte-Montmartre ! »
C’était toucher au vif Ben-Zouf. Ses dents se serrèrent, ses poings se crispèrent, mais il se contint, et, après quelques instants, pendant lesquels il parvint à digérer « motte de terre » :
« Mon capitaine, dit-il, je suis là !… Commandez !… S’il y a un moyen d’empêcher cette rencontre…
– Il n’y en a pas, imbécile, et va-t’en au diable ! »
Sur cette réponse, le déconfit Ben-Zouf quitta la place et ne prononça plus un mot. Pendant les jours suivants, la distance qui séparait les deux astres diminua encore, et il fut évident que la terre, en suivant une nouvelle orbite, allait couper celle de Vénus. En même temps, elle s’était aussi très rapprochée de Mercure. Cette planète, rarement visible à l’œil nu, à moins qu’elle ne soit dans le voisinage de ses plus grandes digressions orientales ou occidentales, se montrait alors avec toute sa splendeur. Ses phases, analogues aux phases lunaires, sa réverbération des rayons du soleil, qui lui versent une chaleur et une lumière sept fois plus fortes qu’au globe terrestre, ses zones glaciales et torrides, presque entièrement confondues grâce à l’inclinaison considérable de son axe de rotation, ses bandes équatoriales, ses montagnes hautes de dix-neuf kilomètres, tout cela rendait digne du plus curieux examen ce disque auquel les anciens donnèrent le nom d’« Étincelant ». Mais le danger ne venait pas encore de Mercure. C’était Vénus, dont le choc menaçait la terre. Vers le 18 janvier, la distance des deux astres était réduite environ à un million de lieues. L’intensité lumineuse de la planète faisait projeter aux objets terrestres des ombres violentes. On la voyait tourner sur elle-même en vingt-trois heures et vingt et une minutes, ce qui démontrait que la durée de ses jours n’avait pas changé. On pouvait distinguer les nuages dont une atmosphère, continuellement chargée de vapeurs, zébrait son disque. On apercevait les sept taches qui, ainsi que l’a prétendu Bianchini, sont de véritables mers communiquant entre elles. Enfin, la superbe planète était visible en plein jour, visibilité qui flatta le capitaine Servadac infiniment moins qu’elle n’avait flatté le général Bonaparte, lorsque, sous le Directoire, il aperçut Vénus en plein midi et laissa volontiers dire que c’était « son étoile ».
Au 20 janvier, la distance « réglementaire », assignée aux deux astres par la mécanique céleste, avait encore décru.
« Dans quelles transes doivent être nos camarades d’Afrique, nos amis de France, et tous les habitants des deux continents ? se demandait parfois le capitaine Servadac. Quels articles doivent publier les journaux des deux continents ! Quelle foule dans les églises ! On peut se croire à la fin du monde ! J’imagine, Dieu me pardonne, qu’elle n’a jamais été si proche ! Et moi, dans ces circonstances, je m’étonnerais qu’un navire ne parût pas en vue de l’île pour nous rapatrier ! Est-ce que le gouverneur général, est-ce que le ministre de la Guerre ont le temps de s’occuper de nous ? Avant deux jours, la terre sera brisée en mille pièces, et ses morceaux iront graviter capricieusement dans l’espace ! »
Il ne devait pas en être ainsi.
Au contraire, à partir de ce jour, les deux astres menaçants semblèrent s’éloigner peu à peu l’un de l’autre. Très heureusement, les plans des orbites de Vénus et de la Terre ne coïncidaient pas, et par conséquent, la terrible collision ne put se produire.
Ben-Zouf voulut bien pousser un soupir de confiance, lorsque son capitaine lui apprit la bonne nouvelle.
Au 25 janvier, la distance était déjà suffisamment augmentée pour que toute crainte dût disparaître à cet égard.
« Allons, dit le capitaine Servadac, ce rapprochement aura toujours servi à nous démontrer que Vénus n’a pas de lune ! »
Et, en effet, Dominique Cassini, Short, Montaigne de Limoges, Montbarron et quelques autres astronomes, ont très sérieusement cru à l’existence de ce satellite.
« Et cela est fâcheux, ajouta Hector Servadac, car cette lune, nous l’aurions peut-être prise en passant, ce qui en eût mis deux à notre service. Mais, mordioux ! je ne parviendrai donc pas à avoir l’explication de tout ce dérangement de la mécanique céleste !
– Mon capitaine ? dit Ben-Zouf.
– Que veux-tu ?
– Est-ce qu’il n’y a pas à Paris, au bout du Luxembourg, une maison avec une grosse calotte sur la tête ?
– L’Observatoire ?
– Précisément. Eh bien, est-ce que ce n’est pas aux messieurs qui demeurent dans cette calotte d’expliquer tout cela ?
– Sans doute.
– Alors, attendons patiemment leur explication, mon capitaine, et soyons philosophes !
– Eh, Ben-Zouf ! sais-tu seulement ce que c’est que d’être philosophe ?
– Oui ! puisque je suis soldat.
– Et qu’est-ce donc ?
– C’est de se soumettre, quand on ne peut pas faire autrement, et c’est notre cas, mon capitaine. »
Hector Servadac ne répondit rien à son ordonnance, mais on est fondé à croire qu’il renonça, provisoirement du moins, à vouloir expliquer ce qui était alors inexplicable pour lui.
D’ailleurs, un événement inattendu allait se produire, dont les conséquences devaient être très importantes. Le 27 janvier, Ben-Zouf, vers neuf heures du matin, vint tranquillement trouver l’officier dans la chambre du poste.
« Mon capitaine ? dit-il avec le plus grand calme.
– Qu’est-ce qu’il y a ? répondit le capitaine Servadac.
– Un navire !
– Animal, qui vient me dire cela, tranquillement, comme il me dirait que la soupe est servie !
– Dame, puisque nous sommes philosophes ! » répondit Ben-Zouf.
Chapitre IX
Dans lequel le capitaine Servadac pose une série de demandes qui restent sans réponses
Hector Servadac s’était élancé hors du poste, et, à toutes jambes, il avait gagné le haut de la falaise.
Un bâtiment était en vue de l’île, ce n’était pas douteux, et il se trouvait alors à moins de dix kilomètres de la côte ; mais la convexité actuelle de la terre, raccourcissant le rayon de vue, ne laissait encore apercevoir que le haut d’une mâture au-dessus des flots.
Cependant, quoique la coque du navire ne fût pas visible, ce que l’on apercevait du gréement devait permettre de reconnaître à quelle catégorie de bâtiments il appartenait. C’était évidemment une goélette, et d’ailleurs, deux heures après qu’elle eut été signalée par Ben-Zouf, elle était absolument reconnaissable.
Le capitaine Servadac, sa longue-vue à l’œil, n’avait pas cessé un instant de l’observer.
« La Dobryna ! s’écria-t-il.
– La Dobryna ? répondit Ben-Zouf. Ce ne peut être elle. On ne voit pas sa fumée !
– Elle est sous voile, répliqua le capitaine Servadac, mais c’est bien la goélette du comte Timascheff ! »
C’était la Dobryna, en effet, et si le comte était à bord, le plus grand des hasards allait le remettre en présence de son rival.
Il va sans dire que le capitaine Servadac ne voyait plus que l’un de ses semblables, non un adversaire, dans celui que la goélette ramenait à l’île, et qu’il ne songea pas un instant à la rencontre projetée entre le comte et lui, ni aux motifs qui l’avaient décidée. Les circonstances se trouvaient tellement changées, qu’il n’éprouva que le plus vif désir de revoir le comte Timascheff et de s’entretenir avec lui de tant d’événements extraordinaires. La Dobryna, en effet, après vingt-sept jours d’absence, avait pu reconnaître les côtes voisines de l’Algérie, remonter peut-être jusqu’à l’Espagne, jusqu’à l’Italie, jusqu’à la France, parcourir cette Méditerranée si étrangement modifiée, et, conséquemment, elle devait apporter des nouvelles de toutes ces contrées dont l’île Gourbi était séparée maintenant. Hector Servadac allait donc apprendre non seulement quelle avait été l’importance de la catastrophe, mais aussi quelle pouvait être la cause qui l’avait provoquée. En outre, le comte Timascheff était un galant homme et se ferait un devoir de les rapatrier, son ordonnance et lui.
« Mais où la goélette va-t-elle accoster, dit alors Ben-Zouf, maintenant que l’embouchure du Chéliff n’existe plus ?
– Elle n’accostera pas, répondit le capitaine. Le comte enverra son canot à terre, et nous nous y embarquerons. »
La Dobryna approchait, mais assez lentement, car elle avait vent debout et ne pouvait gagner qu’en naviguant plus près. Il était même singulier qu’elle n’utilisât pas sa machine, car on devait avoir hâte, à bord, de reconnaître quelle était cette île nouvelle qui se relevait à l’horizon. Il était possible, après tout, que le combustible manquât et que la Dobryna fût réduite à se servir seulement de sa voilure, que, d’ailleurs, elle ménageait. Très heureusement, bien que le ciel fût sillonné de nouveau par quelques nuages effilés, le temps était beau, la brise maniable, la mer belle, et la goélette, que la houle ne contrariait pas, faisait bonne route.
Hector Servadac ne douta pas un instant que la Dobryna ne cherchât à atterrir sur ce littoral. Le comte Timascheff devait être fort dérouté. Où il croyait rencontrer le continent africain, il ne voyait plus qu’une île. Ne pouvait-il craindre, toutefois, de ne trouver aucun refuge sur cette côte nouvelle et de n’y pouvoir relâcher ? Peut-être le capitaine Servadac ferait-il bien de chercher un poste de mouillage, au cas où la goélette eût hésité à s’approcher, et, le poste trouvé, de l’indiquer par des signaux.
Il fut bientôt évident que la Dobryna se dirigeait vers l’ancienne embouchure du Chéliff. Le capitaine Servadac prit donc rapidement son parti. Zéphyr et Galette furent sellés, et, leurs cavaliers au dos, s’élancèrent vers la pointe ouest de l’île.
Vingt minutes après, l’officier d’état-major et son ordonnance mettaient pied à terre et exploraient cette portion du littoral.
Hector Servadac remarqua bientôt qu’en retour de la pointe et abritée par elle, se dessinait une petite crique, dans laquelle un bâtiment de médiocre tonnage pouvait utilement chercher refuge. Cette crique était couverte au large par un semis de gros écueils, entre lesquels un étroit canal donnait passage. Même par les gros temps, les eaux devaient y rester assez calmes. Mais alors, en examinant attentivement les roches du rivage, le capitaine Servadac fut tout surpris d’y voir les traces d’une très haute marée, nettement figurées par de longues bandes de varech.
« Ah çà ! dit-il, il y a donc de véritables marées maintenant dans la Méditerranée ? »
Évidemment, le flux et le reflux des eaux s’y étaient fait sérieusement sentir, et même à une hauteur considérable, – nouvelle étrangeté ajoutée à tant d’autres, car jusqu’alors les marées avaient toujours été à peu près nulles dans le bassin méditerranéen.
Toutefois, on pouvait remarquer que depuis la plus haute de ces marées, provoquée sans doute par le voisinage de cet énorme disque dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, le phénomène avait toujours été diminuant, et qu’il était réduit, maintenant, aux modestes proportions qui le caractérisaient avant la catastrophe.
Mais cette observation notée, le capitaine Servadac ne s’occupa que de la Dobryna.
La goélette n’était plus qu’à deux ou trois kilomètres du littoral. Les signaux qui lui furent faits ne pouvaient manquer d’être aperçus et compris. En effet, elle modifia légèrement sa direction et commença à amener ses voiles hautes. Bientôt elle ne porta plus que ses deux huniers, sa brigantine et son grand foc, de façon à être bien dans la main du timonier. Enfin elle tourna la pointe de l’île, et, manœuvrant vers le canal que l’officier d’état-major indiquait du geste, elle y entra hardiment. Quelques minutes après, son ancre mordait le fond de sable de la crique, le canot était mis à la mer, et le comte Timascheff débarquait sur le rivage.
Le capitaine Servadac courut vers lui.
« Monsieur le comte, s’écria l’officier d’état-major, avant toute autre explication, qu’est-il arrivé ? »
Le comte Timascheff, homme froid, dont le flegme inaltérable contrastait singulièrement avec la vivacité de l’officier français, s’inclina légèrement, et, avec l’accent particulier aux Russes :
« Capitaine, répondit-il, avant toute autre explication, permettez-moi d’affirmer que je ne m’attendais pas à l’honneur de vous revoir ici. Je vous avais laissé sur un continent, et je vous retrouve dans une île…
– Sans que j’aie quitté la place, monsieur le comte.
– Je le sais, capitaine, et je vous prie de m’excuser si j’ai manqué au rendez-vous convenu, mais…
– Oh ! monsieur le comte, répondit vivement le capitaine Servadac, nous reparlerons de cela plus tard, si vous le voulez bien.
– Je serai toujours à vos ordres.
– Et moi aux vôtres. Laissez-moi seulement vous répéter cette question. Qu’est-il arrivé ?
– J’allais vous le demander, capitaine.
– Quoi ! Vous ne savez rien ?
– Rien.
– Et vous ne pouvez me dire par suite de quel cataclysme cette portion du continent africain s’est changée en île ?
– Je ne le puis.
– Ni jusqu’où se sont étendus les effets de la catastrophe ?
– Je ne le sais pas plus que vous, capitaine.
– Mais, au moins, pouvez-vous m’apprendre si, sur le littoral nord de la Méditerranée…
– Est-ce toujours la Méditerranée ? demanda le comte Timascheff, interrompant le capitaine Servadac par cette question singulière.
– Vous devez le savoir mieux que moi, monsieur le comte, puisque vous venez de la parcourir.
– Je ne l’ai point parcourue.
– Vous n’avez relâché sur aucun point du littoral ?
– Ni un jour ni une heure, et je n’ai pas même eu connaissance d’une terre quelconque ! »
L’officier d’état-major regardait son interlocuteur, en homme qui est absolument stupéfié.
« Mais au moins, monsieur le comte, dit-il, vous avez observé que, depuis le 1er janvier, le levant a pris la place du couchant ?
– Oui.
– Que la durée du jour n’est plus que de six heures ?
– En effet.
– Que l’intensité de la pesanteur a diminué ?
– Parfaitement.
– Que nous avons perdu notre lune ?
– Complètement.
– Que nous avons failli nous heurter à Vénus ?
– Comme vous dites.
– Et que, par conséquent, les mouvements de translation et de rotation du globe terrestre sont modifiés.
– Rien n’est plus certain.
– Monsieur le comte, dit le capitaine Servadac, veuillez excuser mon étonnement. Je pensais bien que je n’aurais rien à vous apprendre, mais je comptais beaucoup apprendre de vous.
– Je ne sais rien de plus, capitaine, répondit le comte Timascheff, si ce n’est que, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, j’allais par mer à notre rendez-vous, lorsque ma goélette a été enlevée, par une lame énorme, à une hauteur inappréciable. Les éléments nous ont paru bouleversés par un phénomène cosmique dont la cause m’échappe. Depuis ce moment, nous avons erré à l’aventure, désemparés de notre machine, qui avait subi quelques avaries, et à la merci de la terrible bourrasque qui s’est déchaînée pendant quelques jours. C’est un miracle que la Dobryna ait résisté, et je l’attribue à ce fait, qu’occupant le centre de ce vaste cyclone, elle ne s’est que fort peu déplacée sous l’action des éléments. Aussi n’avons-nous vu aucune terre, et votre île est-elle la première dont nous ayons connaissance.
– Mais alors, monsieur le comte, s’écria le capitaine Servadac, il faut reprendre la mer, il faut explorer la Méditerranée, il faut voir jusqu’où le cataclysme a porté ses désastres.
– C’est mon avis.
– M’offrez-vous passage à votre bord, monsieur le comte ?
– Oui, capitaine, et pour faire le tour du monde, si cela est nécessaire à nos recherches.
– Oh ! le tour de la Méditerranée suffira !
– Qui nous dit, répliqua le comte Timascheff en secouant la tête, que le tour de la Méditerranée ne sera pas le tour du monde ? »
Le capitaine Servadac ne répondit pas et demeura pensif.
Cependant, il n’y avait pas autre chose à faire que ce qui venait d’être décidé, c’est-à-dire reconnaître, ou plutôt rechercher ce qui restait du littoral africain, aller prendre à Alger des nouvelles du reste de l’univers habité, puis, si ce littoral sud de la Méditerranée avait totalement disparu, revenir au nord pour se mettre en relation avec les populations riveraines de l’Europe.
Toutefois, il fallait attendre que les avaries survenues à la machine de la Dobryna fussent réparées. Plusieurs des tubes, placés à l’intérieur de sa chaudière, avaient crevé, et l’eau fuyait dans les fourneaux. On ne pouvait donc chauffer avant que ces réparations eussent été faites. Quant à naviguer à la voile, c’était à la fois lent et difficile, si la mer devenait mauvaise et le vent contraire. Or, comme la Dobryna, appropriée pour une assez longue campagne aux Échelles du Levant, possédait encore pour deux mois de charbon dans ses soutes, mieux valait utiliser ce combustible dans une traversée rapide, quitte à se réapprovisionner au premier port de relâche.
Donc, point d’hésitation à cet égard.
Très heureusement, les avaries purent être promptement réparées. Dans le matériel de la goélette se trouvaient plusieurs tubes de rechange, qui remplacèrent les anciens mis hors d’usage. Trois jours après son arrivée à l’île Gourbi, la chaudière de la Dobryna était en état de fonctionner.
Pendant son séjour sur l’île, Hector Servadac avait mis le comte Timascheff au courant de ce qu’il avait observé sur son étroit domaine. Tous deux parcoururent à cheval le périmètre du nouveau littoral, et, cette exploration faite, ils n’eurent plus d’autre pensée que d’aller chercher au-dehors la raison de tout ce qui s’était passé sur cette partie de l’Afrique.
Le 31 janvier, la goélette était prête à partir. Aucun nouveau changement ne s’était produit dans le monde solaire. Seulement, les thermomètres commençaient à indiquer un léger abaissement de la température, qui avait été excessive pendant un mois. Fallait-il donc en conclure que le mouvement de translation du globe autour du soleil s’opérait sur la courbe d’une orbite nouvelle ? on ne pouvait se prononcer avant quelques jours.
Quant au temps, il se maintenait imperturbablement au beau, bien que de nouvelles vapeurs s’accumulassent dans l’air et eussent provoqué une certaine baisse de la colonne barométrique. Mais ce n’était pas là une raison suffisante pour retarder le départ de la Dobryna.
Restait la question de savoir si Ben-Zouf accompagnerait ou non son capitaine. Une raison, entre bon nombre d’autres assez graves, l’engagea à rester dans l’île. En effet, on ne pouvait embarquer les deux chevaux sur la goélette, qui n’était pas aménagée à cet effet, et Ben-Zouf n’eût jamais consenti à se séparer de Zéphyr et de Galette, – de Galette surtout. D’ailleurs, la surveillance du nouveau domaine, la possibilité que des étrangers vinssent y atterrir, le soin d’une partie des troupeaux qu’il ne fallait pas abandonner absolument à eux-mêmes, pour le cas improbable où ils deviendraient l’unique ressource des survivants de l’île, etc., ces divers motifs décidèrent l’ordonnance à rester, et le capitaine Servadac y consentit, quoiqu’à regret. Il n’y avait, au surplus, pour le brave garçon, aucun danger probable à ne pas quitter l’île. Lorsque le nouvel état de choses serait connu, on reviendrait prendre Ben-Zouf, et on le rapatrierait.
Le 31 janvier, Ben-Zouf, un peu ému, il en convenait, et « investi de tous les pouvoirs du gouverneur », fit ses adieux au capitaine Servadac. Il lui recommanda, au cas où, par hasard, il pousserait jusqu’à Montmartre, de voir si la « montagne » n’avait pas été déplacée par quelque phénomène, et la Dobryna, sortant de l’étroite crique sous l’action de son hélice, flotta bientôt en pleine mer.
Chapitre X
Où, la lunette aux yeux, la sonde à la main, on cherche à retrouver quelques vestiges de la province d’Alger
La Dobryna, admirablement et solidement construite dans les chantiers de l’île de Wight, était une excellente embarcation de deux cents tonneaux, qui eût parfaitement suffi à un voyage de circumnavigation. Colomb et Magellan n’eurent jamais, à beaucoup près, de navires ni aussi grands ni aussi sûrs, lorsqu’ils s’aventurèrent à travers l’Atlantique et le Pacifique. En outre, la Dobryna avait pour plusieurs mois de vivres dans ses cambuses, – ce qui, le cas échéant, lui permettrait de faire le tour de la Méditerranée sans être obligée à se ravitailler en route. Il faut ajouter qu’il n’avait pas été nécessaire d’accroître son lest à l’île Gourbi. En effet, si elle pesait moins, comme tous les objets matériels, depuis la catastrophe, l’eau qui la portait pesait moins aussi. Le rapport des deux poids était donc exactement le même, et la Dobryna se trouvait dans les mêmes conditions de navigabilité.
Le comte Timascheff n’était pas marin. Aussi, la direction, sinon le commandement de la goélette, appartenait-elle au lieutenant Procope.
Ce lieutenant était un homme de trente ans. Né sur les terres du comte, fils d’un serf affranchi bien avant le fameux édit du tsar Alexandre, par reconnaissance autant que par amitié, il appartenait corps et âme à son ancien maître. Excellent marin, ayant appris son métier à bord des navires de l’État et sur les bâtiments de commerce, il était pourvu du brevet de lieutenant, lorsqu’il passa sur la Dobryna . C’était à bord de cette goélette que le comte Timascheff naviguait la plus grande partie de l’année, parcourant la Méditerranée pendant l’hiver, pendant l’été sillonnant les mers du Nord.
Le lieutenant Procope était un homme très instruit, même en dehors des choses de son métier. Il faisait honneur au comte Timascheff et à lui-même, ayant acquis une instruction digne de celui qui l’avait fait élever. La Dobryna ne pouvait être entre des mains meilleures. En outre, son équipage était excellent. Il se composait du mécanicien Tiglew, des quatre matelots Niegoch, Tolstoy, Etkef, Panofka, du cuisinier Mochel, tous fils de tenanciers du comte Timascheff, qui continuait sur mer les traditions des grandes familles russes. Ces marins ne s’inquiétaient pas autrement du trouble apporté à l’ordre physique, du moment que leur ancien maître partageait leur destinée. Quant au lieutenant Procope, il était fort inquiet et savait bien qu’au fond le comte Timascheff éprouvait la même inquiétude.
La Dobryna courait donc dans l’est, mue par ses voiles et sa vapeur, car le vent était favorable, et elle aurait certainement marché avec une vitesse de onze nœuds à l’heure, si les hautes lames n’eussent à chaque moment « cassé » cette vitesse.
En effet, bien que le vent, qui soufflait de l’ouest – maintenant le nouvel est –, ne fût qu’à l’état de belle brise, la mer était, sinon très forte, du moins soumise à des dénivellations considérables. Et cela se comprenait. Les molécules liquides, moins pesantes, grâce à la moindre attraction de la masse terrestre, s’élevaient, par un simple effet d’oscillation, à des hauteurs énormes. De son temps, Arago, qui ramenait au chiffre maximum de sept à huit mètres l’élévation possible des plus hautes lames, eût été singulièrement surpris en les voyant portées jusqu’à cinquante et soixante pieds. Et ce n’étaient point de ces lames déferlantes qui rebondissent après s’être entrechoquées, mais de longues ondulations, et elles imprimaient parfois à la goélette des différences de niveau de vingt mètres. La Dobryna, moins lourde aussi, depuis la décroissance de l’attraction, s’enlevait avec plus de facilité et, franchement, si le capitaine Servadac eût été sujet au mal de mer, il aurait été bien malade dans de telles conditions !
Cependant, ces dénivellations ne se produisaient pas brusquement, car elles n’étaient dues qu’à une sorte de houle très allongée. Aussi, la goélette ne fatiguait pas plus, en somme, que si elle eût été soumise à l’action des lames ordinairement si courtes et si dures de la Méditerranée. Le seul inconvénient du nouvel état de choses était surtout une diminution de la vitesse normale de l’embarcation.
La Dobryna suivait, à une distance de deux à trois kilomètres environ, la ligne qu’aurait dû occuper le littoral algérien. Il n’y avait aucune apparence de terre dans le sud. Bien que le lieutenant Procope ne fût plus à même de relever la situation de la goélette par l’observation des planètes, dont les positions respectives étaient troublées, et quoiqu’il ne pût faire son point, c’est-à-dire obtenir sa longitude et sa latitude en calculant la hauteur du soleil au-dessus de l’horizon, puisque le résultat de son calcul n’aurait pu être reporté utilement sur des cartes établies avant le nouveau système cosmographique, cependant, la route de la Dobryna pouvait être relevée d’une manière assez approximative. D’une part, l’estime du chemin parcouru obtenue au moyen du loch, de l’autre, la direction exactement indiquée par la boussole étaient suffisantes pour cette petite navigation.
Il faut dire que, très heureusement, la boussole n’avait été ni troublée ni affolée, même un seul instant. Les phénomènes cosmiques n’avaient eu aucune influence sur l’aiguille aimantée, qui marquait toujours le nord magnétique dans ces parages, à vingt-deux degrés environ du nord du monde. Si donc l’est et l’ouest s’étaient substitués l’un à l’autre, en ce sens que le soleil se levait à l’occident et se couchait à l’orient, le nord et le sud avaient immuablement gardé leur position dans l’ordre des points cardinaux. On pouvait donc s’en rapporter aux indications de la boussole et du loch, à défaut du sextant, dont l’usage était impossible, – du moins provisoirement.
Pendant ce premier jour d’exploration, le lieutenant Procope, plus instruit en ces matières que l’officier d’état-major, lui expliqua ces différentes particularités en présence du comte Timascheff. Il parlait parfaitement français, comme la plupart des Russes. La conversation avait naturellement porté sur ces phénomènes, dont la cause échappait encore au lieutenant Procope tout aussi bien qu’au capitaine Servadac. Or, précisément et dès le début, il fut question du nouvel orbe que traçait le globe terrestre à travers le monde solaire depuis le 1er janvier.
« Il est évident, capitaine, dit le lieutenant Procope, que la terre ne suit plus sa route habituelle autour du soleil, dont une cause inconnue l’a singulièrement rapprochée !
– Je n’en suis que trop certain, répondit le capitaine Servadac, et la question, maintenant, est de savoir si, après avoir coupé l’orbite de Vénus, nous n’irons pas couper l’orbite de Mercure !…
– Pour tomber, en fin de compte, et nous anéantir sur le soleil, ajouta le comte Timascheff.
– Ce serait alors une chute, et une chute terrible ! s’écria le capitaine Servadac.
– Non, répondit le lieutenant Procope, je crois pouvoir affirmer que ce n’est pas une chute dont la terre est menacée en ce moment ! Elle ne se précipite pas vers le soleil, et c’est incontestablement une nouvelle trajectoire qu’elle décrit autour de lui.
– As-tu donc une preuve à l’appui de cette hypothèse ? demanda le comte Timascheff.
– Oui, père, répondit le lieutenant Procope, et une preuve qui te convaincra. En effet, si c’était une chute que subissait le globe terrestre, la catastrophe finale se produirait à bref délai, et nous serions extrêmement rapprochés déjà de notre centre attractif. Si c’était une chute, c’est que la vitesse tangentielle, qui, combinée avec l’action solaire, fait circuler les planètes suivant des ellipses, aurait été subitement anéantie, et, dans ce cas, la terre ne mettrait que soixante-quatre jours et demi à tomber sur le soleil.
– Et vous en concluez ?… demanda le capitaine Servadac.
– Qu’il n’y a pas chute, répondit le lieutenant Procope. En effet, voilà plus d’un mois déjà que son orbite a été modifiée, et, cependant, c’est à peine si le globe terrestre a dépassé celle de Vénus. Il ne s’est donc rapproché du soleil, dans ce laps de temps, que de onze millions de lieues sur trente-huit millions que mesure le rayon terrestre. Donc, nous avons le droit d’affirmer que ce n’est point une chute que subit la terre. C’est là une circonstance très heureuse. D’ailleurs, j’ai lieu de croire que nous commençons à nous éloigner du soleil, car la température a progressivement diminué, et la chaleur n’est pas plus forte maintenant à la surface de l’île Gourbi qu’elle ne le serait en Algérie, si l’Algérie se trouvait encore située sur le trente-sixième parallèle.
– Vous devez avoir raison dans vos déductions, lieutenant, répondit le capitaine Servadac. Non. La terre n’est pas précipitée sur le soleil, et elle gravite encore autour de lui.
– Mais il est non moins évident, répondit le lieutenant Procope, que, par suite du cataclysme dont nous cherchons vainement la cause, la Méditerranée, comme le littoral africain, a été brusquement reportée sous la zone équatoriale.
– S’il y a encore un littoral africain, dit le capitaine Servadac.
– Et une Méditerranée », ajouta le comte Timascheff. Autant de questions à résoudre. En tout cas, il paraissait certain que, à cette époque, la terre s’éloignait peu à peu du soleil, et qu’une chute à la surface de ce centre attractif n’était plus à craindre. Mais que restait-il de ce continent africain dont la goélette cherchait à retrouver au moins les débris ? Vingt-quatre heures après avoir quitté l’île, la Dobryna avait évidemment passé devant les points qu’auraient dû occuper, sur la côte algérienne, Tenez, Cherchell, Koleah, Sidi-Ferruch. Cependant, pas une de ces villes n’avait apparu dans le champ des lunettes. La mer s’étendait à l’infini, là où le continent aurait dû arrêter ses flots.
Le lieutenant Procope n’avait pu se tromper, cependant, sur la direction qu’il avait donnée à la Dobryna . En tenant compte des indications de la boussole, de l’orientation assez constante des vents, de la vitesse de la goélette, relevée au loch, en même temps que du parcours effectué, ce jour-là, à la date du 2 février, il pouvait se dire par 36° 47’ de latitude et 0° 44’ de longitude, c’est-à-dire à la place qu’aurait dû occuper la capitale de l’Algérie.
Et Alger, aussi bien que Tenez, Cherchell, Koleah, Sidi-Ferruch, s’était abîmée dans les profondeurs du globe.
Le capitaine Servadac, sourcils froncés, dents serrées, regardait d’un œil farouche l’immense mer, qui s’étendait au-delà d’un horizon sans bornes. Tous les souvenirs de sa vie lui revenaient. Son cœur battait à se rompre. Dans cette ville d’Alger, où il avait vécu pendant plusieurs années, il revoyait ses camarades, ses amis qui n’étaient plus. Sa pensée se reportait sur son pays, sur la France. Il se demandait si l’épouvantable cataclysme n’avait pas poussé jusque-là ses ravages. Puis, il essayait de chercher, sous ces eaux profondes, quelques traces de la capitale engloutie.
« Non ! s’écriait-il. Une telle catastrophe est impossible ! Une ville ne disparaît pas ainsi tout entière ! On en retrouverait des épaves ! Les hauts sommets auraient émergé ! De la Casbah, du fort l’Empereur, bâti à cent cinquante mètres de hauteur, il resterait au moins quelques portions au-dessus des flots, et, à moins que toute l’Afrique ne soit descendue dans les entrailles du globe, il faut bien que nous en retrouvions les vestiges ! »
C’était, en effet, une circonstance fort extraordinaire, que pas une épave ne flottât à la surface de la mer, pas un seul de ces arbres brisés dont les branches auraient dû aller en dérive, pas une planche de ces bâtiments mouillés dans la magnifique baie, large de vingt kilomètres, qui s’ouvrait, un mois auparavant, entre le cap Matifou et la pointe Pescade.
Mais, si le regard s’arrêtait à la surface de ces eaux, ne pouvait-on les interroger avec la sonde et tenter de ramener quelque épave de la ville si étrangement disparue ?
Le comte Timascheff, ne voulant pas qu’un doute pût exister dans l’esprit du capitaine Servadac, donna l’ordre de sonder. Le plomb de sonde fut garni de suif et envoyé par le fond.
À l’extrême surprise de tous, et plus particulièrement à l’extrême étonnement du lieutenant Procope, la sonde indiqua une cote de nivellement presque constante, à quatre ou cinq brasses seulement au-dessous de la surface de la mer. Cette sonde fut promenée pendant deux heures sur un large espace, et elle n’accusa jamais ces différences de niveau qu’aurait dû présenter une ville telle qu’Alger, bâtie en amphithéâtre. Fallait-il donc admettre que, la catastrophe produite, les eaux eussent nivelé tout cet emplacement de la capitale algérienne ?
C’était bien invraisemblable.
Quant au fond de la mer, il ne se composait ni de roches, ni de vase, ni de sable, ni de coquille. Le plomb ne ramena qu’une sorte de poussière métallique, remarquable par ses irisations dorées, mais dont il fut impossible de déterminer la nature. Ce n’était pas, à coup sûr, ce que les sondes rapportaient habituellement du fond méditerranéen.
« Vous le voyez, lieutenant ! dit Hector Servadac. Nous sommes plus loin de la côte algérienne que vous ne le supposiez.
– Si nous en étions plus loin, répondit le lieutenant Procope en secouant la tête, nous n’aurions pas seulement cinq brasses de profondeur, mais deux ou trois cents !
– Alors ?… demanda le comte Timascheff.
– Je ne sais que penser.
– Monsieur le comte, dit le capitaine Servadac, je vous le demande en grâce, poussons une pointe au sud, et voyons si nous ne trouverons pas plus loin ce que nous cherchons vainement ici ! »
Le comte Timascheff conféra avec le lieutenant Procope, et, le temps étant maniable, il fut convenu que, pendant trente-six heures encore, la Dobryna descendrait vers le sud.
Hector Servadac remercia son hôte, et la route nouvelle fut donnée au timonier.
Pendant trente-six heures, c’est-à-dire jusqu’au 4 février, l’exploration de cette mer fut faite avec le soin le plus scrupuleux. On ne se contenta pas d’envoyer sous ces eaux suspectes la sonde, qui accusa partout un fond plat par quatre et cinq brasses, mais ce fond fut raclé avec des dragues de fer, et ces dragues ne rencontrèrent jamais ni une pierre taillée, ni un débris de métal, ni un morceau de branche brisée, ni même une seule de ces hydrophytes ou de ces zoophytes dont est ordinairement semé le sol des mers. Quel fond s’était donc ainsi substitué à l’ancien fond méditerranéen ?
La Dobryna descendit jusqu’au trente-sixième degré de latitude. En relevant les terres portées sur les cartes du bord, il fut constant qu’elle naviguait là où devait jadis s’étendre le Sahel, massif qui sépare de la mer la riche plaine de la Mitidja, là où dominait autrefois le point culminant de la Bouzaréah, à une hauteur de quatre cents mètres ! Et cependant, même après l’engloutissement des terres environnantes, ce sommet aurait dû encore apparaître comme un îlot au-dessus de cet océan !
La Dobryna, descendant toujours, alla plus loin que Douera, la principale bourgade du Sahel, plus loin que Boufarick, la ville aux larges rues ombragées de platanes, plus loin que Blidah, dont on n’aperçut pas même le fort, qui surpassait l’Oued-el-Kebir de quatre cents mètres !
Le lieutenant Procope, craignant de s’aventurer plus au loin sur cette mer absolument inconnue, demanda alors à revenir vers le nord ou l’est, mais, sur les instances du capitaine Servadac, la Dobryna s’enfonça de plus en plus dans le sud.
L’exploration fut donc prolongée jusqu’à ces montagnes de la Mouzaïa, aux grottes légendaires, que fréquentaient autrefois les Kabyles, que boisaient les caroubiers, les micocouliers et les chênes de toute espèce, qu’habitaient les lions, les hyènes et les chacals !… Leur plus haut sommet, qui se dressait, six semaines auparavant, entre le Bou-Roumi et la Chiffa, aurait dû émerger à une hauteur considérable au-dessus des flots, puisque son altitude dépassait seize cents mètres !… On ne vit rien, ni à cette place ni à l’horizon sur lequel se confondaient le ciel et la mer !
Il fallut enfin revenir au nord, et la Dobryna, virant cap pour cap, se retrouva dans les eaux de l’ancienne Méditerranée, sans avoir retrouvé aucun vestige de ce qui constituait autrefois la province d’Alger.
Chapitre XI
Où le capitaine Servadac retrouve, épargné par la catastrophe, un îlot qui n’est qu’une tombe
L’engloutissement subit d’une importante portion de la colonie algérienne ne pouvait donc être mis en doute. C’était même plus qu’une simple disparition de terres au fond des eaux. Il semblait que les entrailles du globe, entrouvertes pour l’anéantir, se fussent refermées sur un territoire tout entier. En effet, le massif rocheux de la province s’était abîmé sans avoir laissé aucune trace, et un sol nouveau, fait d’une substance inconnue, avait remplacé le fond de sable sur lequel reposait la mer.
Quant à la cause qui avait provoqué cet effroyable cataclysme, elle échappait toujours aux explorateurs de la Dobryna. Il s’agissait donc de reconnaître, maintenant, où était la limite de ces désastres.
Après sérieuse discussion, il fut convenu que la goélette continuerait sa marche vers l’est et longerait la ligne que traçait autrefois le continent africain sur cette mer dont on ne retrouvait plus les limites. La navigation se faisait sans trop de difficultés, et il fallait profiter des chances qu’offraient alors un temps favorable et un vent propice.
Mais aucun vestige ne fut revu, sur ce parcours, de la côte qui s’étendait depuis le cap Matifou jusqu’à la frontière de Tunis, ni la ville maritime de Dellys, bâtie en amphithéâtre, ni aucune apparence à l’horizon de cette chaîne du Jurjura, dont le point culminant s’élevait à deux mille trois cents mètres d’altitude, ni la ville de Bougie, ni les pentes abruptes du Gouraya, ni le mont Adrar, ni Didjela, ni les montagnes de la Petite Kabylie, ni le Triton des anciens, cet ensemble de sept caps dont la plus haute cime mesurait onze cents mètres, ni Collo, l’ancien port de Constantine, ni Stora, le port moderne de Philippeville, ni Bône, assise sur son golfe de quarante kilomètres d’ouverture. On ne vit plus rien, ni du cap de Garde, ni du cap Rose, ni des croupes des montagnes d’Edough, ni des dunes sablonneuses du littoral, ni de Mafrag, ni de Calle, célèbre par l’importante industrie de ses corailleurs, et, lorsqu’une sonde eut été pour la centième fois envoyée par le fond, elle ne rapporta pas même un spécimen des admirables zoophytes des eaux méditerranéennes.
Le comte Timascheff résolut alors de suivre la latitude qui coupait autrefois la côte tunisienne jusqu’au cap Blanc, c’est-à-dire jusqu’à la pointe la plus septentrionale de l’Afrique. En cet endroit, la mer, très resserrée entre le continent africain et la Sicile, présenterait peut-être quelque particularité qu’il convenait de relever.
La Dobryna se tint donc dans la direction du trente-septième parallèle, et, le 7 février, elle dépassait le septième degré de longitude.
Voici la raison qui avait engagé le comte Timascheff, d’accord avec le capitaine Servadac et le lieutenant Procope, à persévérer dans cette exploration vers l’est.
À cette époque – et bien que pendant longtemps on eût renoncé à cette entreprise –, la nouvelle mer saharienne avait été créée, grâce à l’influence française. Cette grande œuvre, simple restitution de ce vaste bassin du Triton sur lequel fut jeté le vaisseau des Argonautes, avait changé avantageusement les conditions climatériques de la contrée, et monopolisé au profit de la France tout le trafic entre le Soudan et l’Europe.
Quelle influence avait eu la résurrection de cette antique mer sur le nouvel état de choses ? c’était à vérifier.
À la hauteur du golfe de Gabès, sur le trente-quatrième degré de latitude, un large canal donnait maintenant accès aux eaux de la Méditerranée dans la vaste dépression du sol occupée par les chotts Kébir, Gharsa et autres. L’isthme, existant à vingt-six kilomètres au nord de Gabès, à l’endroit même où la baie du Triton s’amorçait jadis sur la mer, avait été coupé, et les eaux avaient repris leur ancien lit d’où, faute d’une alimentation permanente, elles s’étaient évaporées autrefois sous l’action du soleil libyen.
Or, n’était-ce pas à cet endroit même où la section avait été pratiquée, que s’était produite la fracture à laquelle on devait la disparition d’une partie notable de l’Afrique ? Après être descendue jusqu’au-delà du trente-quatrième parallèle, la Dobryna ne retrouverait-elle pas la côte tripolitaine, qui, dans ce cas, aurait irrésistiblement mis obstacle à l’extension des désastres ?
« Si, arrivés à ce point, dit très justement le lieutenant Procope, nous voyons la mer s’étendre encore à l’infini dans le sud, il ne nous restera plus qu’à venir demander aux rivages européens la solution d’un problème qui aura été insoluble dans ces parages. »
La Dobryna, ne ménageant pas le combustible, continua donc à toute vapeur sa marche vers le cap Blanc, sans retrouver ni le cap Negro, ni le cap Serrat. Arrivée à la hauteur de Bizerte, cette charmante ville tout orientale, elle ne revit ni le lac qui s’épanouissait au-delà de son goulet, ni ses marabouts ombragés de palmiers magnifiques. La sonde, jetée sur l’emplacement de ces eaux transparentes, ne rencontra que ce fond plat et aride qui supportait invariablement les flots méditerranéens.
Le cap Blanc, ou, pour parler plus exactement, l’endroit où ce cap se projetait cinq semaines auparavant, fut doublé dans la journée du 7 février. La goélette trancha alors de son étrave des eaux qui auraient dû être celles de la baie de Tunis. Mais, de cet admirable golfe, il ne restait plus aucune trace, ni de la ville bâtie en amphithéâtre, ni du fort de l’Arsenal, ni de la Goulette, ni des deux pitons de Bou-Kournein. Le cap Bon, ce promontoire qui formait la pointe la plus avancée de l’Afrique vers la Sicile, avait été également entraîné, avec le continent, dans les entrailles du globe.
Autrefois, avant tant d’événements si bizarres, le fond de la Méditerranée remontait en cet endroit par une pente très raide et se dessinait en dos d’âne. La charpente terrestre se redressait là comme une échine, barrant le détroit de Libye, sur lequel il ne restait environ que dix-sept mètres d’eau. De chaque côté de la crête, au contraire, la profondeur était de cent soixante-dix mètres. Probablement même, aux époques de formations géologiques, le cap Bon avait été réuni au cap Furina, à l’extrémité de la Sicile, comme l’était, sans doute, Ceuta à Gibraltar.
Le lieutenant Procope, en marin auquel la Méditerranée était parfaitement connue en tous ses détails, ne pouvait ignorer cette particularité. C’était donc une occasion de constater si le fond avait été récemment modifié entre l’Afrique et la Sicile, ou si la crête sous-marine du détroit libyen existait encore.
Le comte Timascheff, le capitaine Servadac, le lieutenant assistaient tous trois à cette opération de sondage.
Au commandement, le matelot placé sur le porte-hauban de misaine envoya le plomb de sonde.
« Combien de brasses ? demanda le lieutenant Procope.
– Cinq[3], répondit le matelot.
– Et le fond ?
– Plat. »
Il s’agissait alors de reconnaître quelle était l’importance de la dépression de chaque côté de la crête sous-marine. La Dobryna se porta donc successivement à un demi-mille sur la droite et sur la gauche, et le sondage de ces deux fonds fut opéré. Cinq brasses toujours et partout ! Fond invariablement plat ! Cote immuable ! La chaîne, immergée entre le cap Bon et le cap Furina, n’existait plus. Il était évident que le cataclysme avait provoqué un nivellement général du sol de la Méditerranée. Quant à la nature de ce sol, même poussière métallique et de composition inconnue. Plus de ces éponges, de ces actinies, de ces comatules, de ces cydippes hyalines, hydrophytes ou coquilles, dont les roches sous-marines étaient autrefois tapissées.
La Dobryna, virant de bord, mit le cap au sud et continua son voyage d’exploration.
Parmi les étrangetés de cette navigation, il fallait noter aussi que la mer était toujours déserte. On ne signalait pas à sa surface un seul bâtiment vers lequel l’équipage de la goélette eût pu courir afin de demander des nouvelles d’Europe. La Dobryna semblait être seule à parcourir ces flots abandonnés, et chacun, sentant l’isolement se faire autour de lui, se demandait si la goélette n’était pas maintenant l’unique point habité du globe terrestre, une nouvelle arche de Noé qui renfermait les seuls survivants de la catastrophe, les seuls vivants de la terre !
Le 9 février, la Dobryna naviguait précisément au-dessus de la ville de Didon, l’ancienne Byrsa, plus détruite à présent que la Carthage punique ne l’avait jamais été par Scipion Émilien, que la Carthage romaine ne le fut par Hassan le Gassanide.
Ce soir-là, au moment où le soleil disparaissait sous l’horizon de l’est, le capitaine Servadac, appuyé sur le couronnement de la goélette, était absorbé dans ses réflexions. Son regard allait vaguement du ciel, où brillaient quelques étoiles à travers les mobiles vapeurs, à cette mer dont les longues lames commençaient à tomber avec la brise.
Soudain, pendant qu’il était tourné vers l’horizon méridional par l’avant de la goélette, son œil ressentit une sorte d’impression lumineuse. Il crut d’abord avoir été troublé par quelque illusion d’optique, et il regarda avec plus d’attention.
Une lointaine lumière lui apparut réellement alors, et un des matelots qu’il appela la vit distinctement.
Le comte Timascheff et le lieutenant Procope furent aussitôt prévenus de cet incident.
« Est-ce une terre ?… demanda le capitaine Servadac.
– N’est-ce pas plutôt un navire avec ses feux de position ? répondit le comte Timascheff.
– Avant une heure, nous saurons à quoi nous en tenir ! s’écria le capitaine Servadac.
– Capitaine, nous ne le saurons pas avant demain, répondit le lieutenant Procope.
– Tu ne mets donc pas le cap sur ce feu ? lui demanda le comte Timascheff, assez surpris.
– Non, père. Je désire rester en panne sous petite voilure, et attendre le jour. S’il existe là quelque côte, je craindrais de m’aventurer pendant la nuit sur des atterrages inconnus. »
Le comte fit un signe approbatif, et la Dobryna, orientant ses voiles de manière à ne faire que peu de route, laissa la nuit envahir toute la mer.
Une nuit de six heures n’est pas longue, et celle-ci, cependant, parut durer tout un siècle. Le capitaine Servadac, qui n’avait pas quitté le pont, craignait à chaque instant que la faible lueur ne vînt à s’éteindre. Mais elle continua de briller dans l’ombre comme brille un feu de second ordre à l’extrême limite de sa portée.
« Et toujours à la même place ! fit observer le lieutenant Procope. On peut donc en conclure, avec grande probabilité, que c’est une terre que nous avons en vue, et non pas un navire. »
Au soleil levant, toutes les lunettes du bord étaient braquées vers le point qui avait paru lumineux pendant la nuit. La lueur s’évanouit bientôt sous les premiers rayons du jour ; mais, à sa place, apparut, à six milles de la Dobryna, une sorte de rocher singulièrement découpé. On eût dit un îlot isolé au milieu de cette mer déserte.
« Ce n’est qu’un rocher, dit le comte Timascheff, ou plutôt c’est le sommet de quelque montagne engloutie ! »
Cependant, il importait de reconnaître ce rocher, quel qu’il fût, car il formait un dangereux récif dont les bâtiments devraient se méfier à l’avenir. Le cap fut donc mis sur l’îlot signalé, et, trois quarts d’heure plus tard, la Dobryna n’en était plus qu’à deux encablures.
Cet îlot était une sorte de colline, aride, dénudée, abrupte, qui ne s’élevait que d’une quarantaine de pieds au-dessus du niveau de la mer. Aucun semis de roches n’en défendait les abords, – ce qui donnait à croire qu’elle s’était peu à peu enfoncée, sous l’influence de l’inexplicable phénomène, jusqu’à ce qu’un nouveau point d’appui l’eût définitivement maintenue à cette hauteur au-dessus des flots.
« Mais il y a une habitation sur cet îlot ! s’écria le capitaine Servadac, qui, la lunette aux yeux, ne cessait d’en fouiller les moindres anfractuosités. Et peut-être quelque survivant… »
À cette hypothèse du capitaine, le lieutenant Procope répondit par un hochement de tête très significatif. L’îlot paraissait être absolument désert, et, en effet, un coup de canon que tira la goélette n’amena aucun habitant sur son rivage.
Il était vrai, cependant, qu’une sorte d’édifice de pierre se dressait à la partie supérieure de l’îlot. Ce monument offrait dans son ensemble quelque ressemblance avec un marabout arabe.
Le canot de la Dobryna fut aussitôt mis à la mer. Le capitaine Servadac, le comte Timascheff, le lieutenant Procope y prirent place, et quatre matelots l’enlevèrent rapidement.
Quelques instants après, les explorateurs mettaient pied à terre, et, sans perdre un instant, ils gravissaient les pentes abruptes de l’îlot qui montaient jusqu’au marabout.
Là, ils furent d’abord arrêtés par un mur d’enceinte, incrusté de débris antiques, tels que vases, colonnes, statues, stèles, disposés sans aucun ordre et en dehors de toute préoccupation d’art.
Le comte Timascheff et ses deux compagnons, après avoir contourné ce mur d’enceinte, arrivèrent devant une étroite porte, toute ouverte, qu’ils franchirent aussitôt.
Une seconde porte, ouverte aussi, leur permit de pénétrer à l’intérieur du marabout. Les murailles en étaient sculptées à la mode arabe, mais ces enjolivures n’avaient aucune valeur.
Au milieu de l’unique salle du marabout s’élevait un tombeau d’une grande simplicité. Au-dessus s’épanouissait une énorme lampe d’argent, contenant encore plusieurs litres d’huile, et dans laquelle plongeait une longue mèche allumée.
C’était la lumière de cette lampe qui, pendant la nuit, avait frappé l’œil du capitaine Servadac.
Le marabout était inhabité. Son gardien – s’il en avait jamais eu un – s’était sans doute enfui au moment de la catastrophe. Quelques cormorans s’y étaient réfugiés depuis, et encore ces sauvages oiseaux s’envolèrent-ils à tire-d’aile vers le sud, lorsque les explorateurs y pénétrèrent.
Un vieux livre de prières était posé sur un angle du tombeau. Ce livre, écrit en langue française, était ouvert au rituel spécial de l’anniversaire du 25 août.
Une révélation se fit aussitôt dans l’esprit du capitaine Servadac. Le point de la Méditerranée qu’occupait cet îlot, cette tombe maintenant isolée au milieu de la mer, la page à laquelle le lecteur du livre s’était arrêté, tout lui apprit en quel lieu se trouvaient ses compagnons et lui.
« Le tombeau de saint Louis, messieurs », dit-il.
C’était là, en effet, que le roi de France était venu mourir. C’était là que, depuis plus de six siècles, des mains françaises entouraient son tombeau d’un culte pieux.
Le capitaine Servadac s’inclina devant la tombe vénérée, et ses deux compagnons l’imitèrent respectueusement.
Cette lampe, brûlant sur le tombeau d’un saint, était peut-être le seul phare qui éclairât maintenant les flots de la Méditerranée, et encore allait-il bientôt s’éteindre !
Les trois explorateurs quittèrent alors le marabout, puis le rocher désert. Le canot les ramena à bord, et la Dobryna, remettant le cap au sud, perdit bientôt de vue le tombeau du roi Louis IX, seul point de la province tunisienne qu’eut épargné l’inexplicable catastrophe.
Chapitre XII
Dans lequel, après avoir agi en marin, le lieutenant Procope s’en remet à la volonté de Dieu
C’était vers le sud que les cormorans, effarouchés, avaient pris leur vol en fuyant le marabout. Cette direction indiquait peut-être qu’il existait vers le midi quelque terre peu éloignée. De là, un espoir auquel se rattachèrent les explorateurs de la Dobryna .
Quelques heures après avoir quitté l’îlot, la goélette naviguait sur ces eaux nouvelles, dont les couches peu profondes recouvraient actuellement toute cette presqu’île du Dakhul, qui séparait autrefois la baie de Tunis du golfe de H’Amamât.
Deux jours plus tard, après avoir vainement cherché la côte du Sahel tunisien, elle atteignait le trente-quatrième parallèle, qui aurait dû traverser en cet endroit le golfe de Gabès.
Aucune trace ne restait de l’estuaire sur lequel s’amorçait, six semaines auparavant, le canal de la mer saharienne, et la surface liquide s’étendait à perte de vue dans l’ouest.
Cependant, ce jour-là, 11 février, le cri de : « Terre ! » retentit enfin dans les barres de la goélette, et une côte apparut là où, géographiquement, on ne devait pas encore la rencontrer.
En effet, cette côte ne pouvait être le littoral tripolitain, qui est généralement bas, sablonneux, difficile à relever d’une grande distance. En outre, ce littoral ne devait être situé que deux degrés plus au sud.
Or, la nouvelle terre, très accidentée, s’étendait largement de l’ouest à l’est et fermait tout l’horizon méridional. À gauche, elle coupait en deux parties le golfe de Gabès et ne permettait plus d’apercevoir l’île de Djerba, qui en formait la pointe extrême.
Cette terre fut soigneusement portée sur les cartes du bord, et on put en conclure que la mer saharienne avait été en partie comblée par l’apparition d’un continent nouveau.
« Ainsi donc, fit observer le capitaine Servadac, après avoir jusqu’ici sillonné la Méditerranée là où était autrefois le continent, voici que nous rencontrons le continent là où devrait être la Méditerranée !
– Et sur ces parages, ajouta le lieutenant Procope, on ne voit pas une de ces tartanes maltaises, pas un de ces chébecs levantins, qui les fréquentent ordinairement !
– Il s’agit maintenant, dit alors le comte Timascheff, de décider si nous suivrons cette côte vers l’est ou vers l’ouest.
– Vers l’ouest, si vous le permettez, monsieur le comte, répondit vivement l’officier français. Que je sache au moins si, au-delà du Chéliff, il n’est rien resté de notre colonie algérienne ! Nous pourrons prendre, en passant, mon compagnon que j’ai laissé à l’île Gourbi, et nous pousserons jusqu’à Gibraltar, où nous aurons peut-être des nouvelles de l’Europe !
– Capitaine Servadac, répondit le comte Timascheff, avec cet air réservé qui lui était habituel, la goélette est à votre disposition. Procope, donne tes ordres en conséquence.
– Père, j’ai une observation à te faire, dit le lieutenant, après avoir réfléchi quelques instants.
– Parle.
– Le vent souffle de l’ouest, et il tend à fraîchir, répondit Procope. Avec la vapeur seule, nous gagnerons sans doute contre lui, mais non sans d’extrêmes difficultés. En marchant vers l’est, au contraire, avec voiles et machine, la goélette aura en quelques jours atteint la côte égyptienne, et là, à Alexandrie ou sur tout autre point, nous trouverons les renseignements que pourrait nous fournir Gibraltar.
– Vous entendez, capitaine ? » dit le comte Timascheff en se tournant vers Hector Servadac.
Celui-ci, quelque désir qu’il eût de se rapprocher de la province d’Oran et de revoir Ben-Zouf, trouva l’observation du lieutenant très juste. La brise d’ouest fraîchissait, et, à lutter contre elle, la Dobryna ne pouvait faire une route rapide, tandis que, vent sous vergues, elle devait avoir promptement rallié la côte égyptienne.
Le cap fut donc mis à l’est. Le vent menaçait de passer au grand frais. Heureusement, la longue houle courait dans le même sens que la goélette, et les lames ne déferlaient pas.
Depuis une quinzaine de jours, on avait pu constater que la température, qui avait singulièrement diminué, ne donnait plus qu’une moyenne de quinze à vingt degrés au-dessus du zéro thermométrique. Cette décroissance, qui était progressive, était due à une cause toute naturelle, c’est-à-dire à l’éloignement croissant du globe sur sa nouvelle trajectoire. Aucun doute ne pouvait exister à cet égard. La terre, après s’être approchée de son centre attractif jusqu’à dépasser l’orbite de Vénus, s’en éloignait graduellement et en était plus distante alors qu’elle ne l’avait jamais été autrefois dans ses positions périgéennes. Il semblait que, au 1er février, elle fût revenue à trente-huit millions de lieues du soleil, ainsi qu’elle l’était au 1er janvier, et que, depuis lors, son éloignement se fût accru d’un tiers environ. Cela ressortait non seulement de l’abaissement de la température, mais aussi de l’aspect du disque solaire, qui ne sous-tendait plus qu’un arc visiblement réduit. Vu de Mars, c’est précisément cette même réduction diamétrale qu’il eût présenté à l’œil d’un observateur. On pouvait donc en déduire que la terre arrivait sur l’orbite de cette planète, dont la constitution physique est presque semblable à la sienne. D’où cette conséquence, que la nouvelle route qu’elle était appelée à parcourir dans le monde solaire affectait la forme d’une ellipse très allongée.
Cependant, ces phénomènes cosmiques ne préoccupaient pas alors les explorateurs de la Dobryna . Ils ne s’inquiétaient plus des mouvements désordonnés du globe dans l’espace, mais seulement des modifications accomplies à sa surface et dont l’importance leur échappait encore.
La goélette suivait donc, à deux milles de distance, le nouveau cordon littoral, et, vraiment, tout navire poussé à cette côte eût été immanquablement perdu, s’il n’avait pu s’en élever.
En effet, la lisière du nouveau continent n’offrait pas un seul refuge. À sa base, que les longues lames, venues du large, battaient avec violence, il était absolument accore et se redressait jusqu’à une hauteur qui variait entre deux cents et trois cents pieds. Cette base, lisse comme le mur d’une courtine, ne présentait pas une saillie sur laquelle le pied eût pu trouver un point d’appui. Au-dessus, se découpait une forêt de flèches, d’obélisques, de pyramidions. On eût dit une sorte de concrétion énorme, dont les cristallisations mesuraient plus de mille pieds d’altitude.
Mais là n’était pas le plus bizarre aspect de ce gigantesque massif. Ce qui devait prodigieusement étonner les explorateurs de la Dobryna, c’est qu’il semblait être « tout neuf ». L’action atmosphérique ne paraissait avoir encore altéré ni la pureté de ses arêtes, ni la netteté de ses lignes ni la couleur de sa substance. Il se profilait sur le ciel avec une incomparable sûreté de dessin. Tous les blocs qui le composaient étaient polis et brillants comme s’ils fussent à l’instant sortis du moule d’un fondeur. Leur éclat métallique, piqué d’irisations dorées, rappelait celui des pyrites. C’était à se demander si un métal unique, semblable à celui dont la sonde avait rapporté la poussière sous-marine, ne formait pas ce massif, que les forces plutoniennes avaient rejeté au-dessus des eaux.
Autre observation à l’appui de la première. Ordinairement, et en quelque endroit du globe que ce soit, les masses rocheuses les plus arides sont sillonnées d’humides filets que la condensation des vapeurs émet à leur surface et qui s’écoulent suivant le caprice des pentes. En outre, il n’est pas de falaise si désolée qu’il n’y pousse quelques plantes lapidaires et ne s’y abrite quelques touffes de broussailles peu exigeantes. Mais ici, rien, ni le plus mince filet de cristal, ni la plus maigre verdure. Aussi, pas un oiseau n’animait-il cet âpre territoire. Rien n’y vivait, rien ne s’y mouvait, ni dans l’ordre végétal, ni dans l’ordre animal.
L’équipage de la Dobryna n’eut donc pas à s’étonner si les oiseaux de mer, albatros, mouettes et goélands, aussi bien que les pigeons de roche, vinrent chercher refuge sur la goélette. Aucun coup de fusil ne pouvait en éloigner ces volatiles, qui, nuit et jour, restaient perchés sur les vergues. Quelques bribes de nourriture étaient-elles jetées sur le pont, ils s’y précipitaient aussitôt, se battant avec fureur, se repaissant avec voracité. À les voir si affamés, on devait croire qu’il n’y avait pas un seul point de ces parages qui pût leur procurer quelque aliment. En tout cas, ce n’était pas ce littoral, puisqu’il paraissait être absolument privé de plantes et d’eau.
Telle était cette côte bizarre, que prolongea la Dobryna pendant plusieurs jours. Son profil se modifiait parfois et présentait alors, pendant plusieurs kilomètres, une seule arête, vive et nette, comme si elle eût été finement menuisée. Puis, les grandes lamelles prismatiques reparaissaient dans un inextricable enchevêtrement. Mais jamais, au pied de la falaise, ne s’étendait ni une grève de sable, ni un rivage de galets, ni une bande de ces écueils qui sèment ordinairement les eaux peu profondes. À peine d’étroites criques s’ouvraient-elles ça et là. Pas une aiguade ne se voyait, à laquelle un navire pût faire sa provision d’eau. Partout se développaient ces larges rades foraines qui sont découvertes sur trois points du compas.
La Dobryna, après avoir suivi la côte pendant quatre cents kilomètres environ, fut arrêtée enfin par un brusque retour du littoral. Le lieutenant Procope, qui avait, heure par heure, porté sur la carte le tracé de ce nouveau continent, constata que la falaise courait alors du sud au nord. La Méditerranée était donc fermée en cet endroit, presque sur le douzième méridien ? Ce barrage s’étendait-il jusqu’aux terres d’Italie et de Sicile ? on le saurait avant peu, et, si cela était, ce vaste bassin dont les eaux baignent l’Europe, l’Asie, l’Afrique se trouverait réduit de moitié.
La goélette, persistant à explorer tous les points de ce nouveau rivage, mit le cap au nord et remonta droit vers les terres d’Europe. À filer dans cette direction pendant quelques centaines de kilomètres, elle devait avoir prochainement connaissance de Malte, si, toutefois, la vieille île que possédèrent successivement les Phéniciens, les Carthaginois, les Siciliens, les Romains, les Vandales, les Grecs, les Arabes et les chevaliers de Rhodes avait été respectée par le cataclysme.
Mais il n’en fut rien, et, le 14 février, la sonde, envoyée sur l’emplacement de Malte, ne rapporta que cette même poussière métallique, recouverte par les flots méditerranéens, et dont la nature restait inconnue.
« Les ravages se sont étendus au-delà du continent africain, fit alors observer le comte Timascheff.
– Oui, répondit le lieutenant Procope, et nous ne pouvons même assigner de limite à cet effroyable désastre ! – Maintenant, père, quels sont tes projets ? Sur quelle partie de l’Europe la Dobryna doit-elle se diriger ?
– Sur la Sicile, sur l’Italie, sur la France, s’écria le capitaine Servadac, là où nous pourrons enfin savoir…
– Si la Dobryna ne porte pas à son bord les seuls survivants du globe ! » répondit gravement le comte Timascheff.
Le capitaine Servadac ne prononça pas un mot, car ses tristes pressentiments s’identifiaient avec ceux du comte Timascheff. Cependant, le cap avait été changé, et la goélette dépassa le point où se croisaient le parallèle et le méridien de l’île disparue.
La côte se projetait toujours sud et nord, et interdisait toute communication avec le golfe de Sydra, l’ancienne Grande Syrte, qui s’étendait autrefois jusqu’aux terres d’Égypte. Il fut aussi constant que, même dans les parages du nord, l’accès par mer n’était plus permis avec les rivages de la Grèce et les ports de l’empire ottoman. Donc, impossibilité d’aller, par l’Archipel, les Dardanelles, la mer de Marmara, le Bosphore, la mer Noire, atterrir aux confins méridionaux de la Russie.
La goélette, lors même que ce projet eût dû être mis à exécution, n’avait donc qu’une seule route à suivre, celle de l’ouest, afin de gagner ainsi les portions septentrionales de la Méditerranée.
Elle l’essaya dans la journée du 16 février. Mais, comme si les éléments eussent voulu lutter contre elle, le vent et les lames réunirent leurs efforts pour enrayer sa marche. Une furieuse tempête s’éleva, qui rendit la mer bien difficile à tenir pour un navire de deux cents tonneaux seulement. Le danger devint même très grand, car le vent battait en côte.
Le lieutenant Procope fut extrêmement inquiet. Il avait dû serrer toutes ses voiles, amener ses mâts de hune ; mais, alors, réduit à l’action de la machine, il ne put gagner contre le mauvais temps. Les énormes lames enlevaient la goélette jusqu’à cent pieds dans les airs et la replongeaient d’autant au milieu du gouffre qui se creusait entre les flots. L’hélice, tournant à vide le plus souvent, ne mordait plus sur les couches liquides et perdait toute sa puissance. Bien que la vapeur surchauffée fut portée à son maximum de tension, la Dobryna reculait sous l’ouragan.
Dans quel port pouvait-on chercher refuge ? L’inabordable côte n’en offrait aucun ! Le lieutenant Procope en serait-il donc réduit à cette extrémité de se mettre au plein ? Il se le demanda. Mais alors, que deviendraient les naufragés, si toutefois ils pouvaient prendre pied sur cette falaise si accore ? Quelles ressources devaient-ils attendre de cette terre d’une aridité désespérante ? Leurs provisions épuisées, comment les renouvelleraient-ils ? Pouvait-on espérer de retrouver au-delà de cet inaccessible cadre quelque portion épargnée de l’ancien continent ?
La Dobryna essaya de tenir contre la tempête, et son équipage, courageux et dévoué, manœuvra avec le plus grand sang-froid. Pas un de ces matelots, confiants dans l’habileté de leur chef et dans la solidité du navire, ne faiblit un instant. Mais la machine était forcée, parfois, au point qu’elle menaçait de se disloquer. D’ailleurs, la goélette ne sentait plus son hélice, et, étant à sec de toile, car il n’avait pas été possible d’établir même un tourmentin que l’ouragan eût déchiré, elle fut entraînée vers la côte.
Tout l’équipage était sur le pont, comprenant la situation désespérée que lui faisait la tempête. La terre n’était pas alors à plus de quatre milles sous le vent, et la Dobryna y dérivait avec une vitesse qui ne laissait plus aucun espoir de la relever.
« Père, dit le lieutenant Procope au comte Timascheff, la force de l’homme a ses limites. Je ne puis résister à cette dérive qui nous emporte !
– As-tu fait tout ce qu’un marin pouvait faire ? demanda le comte Timascheff, dont la figure ne trahissait aucune émotion.
– Tout, répondit le lieutenant Procope. Mais, avant une heure, notre goélette se sera mise à la côte !
– Avant une heure, dit le comte Timascheff, et de manière à être entendu de tous, Dieu peut nous avoir sauvés !
– Il ne nous sauvera que si ce continent s’entrouvre pour livrer passage à la Dobryna !
– Nous sommes entre les mains de Celui qui peut tout ! » répondit le comte Timascheff en se découvrant.
Hector Servadac, le lieutenant, les matelots, sans rompre le silence, l’imitèrent religieusement.
Procope, regardant comme impossible de s’éloigner de la terre, prit alors toutes les mesures pour faire côte dans les moins mauvaises conditions. Il songea aussi à ce que les naufragés, si quelques-uns échappaient à cette mer furieuse, ne fussent pas sans ressource pendant les premiers jours de leur installation sur ce nouveau continent. Il fit monter sur le pont des caisses de vivres et des tonneaux d’eau douce qui, liés à des barriques vides, pourraient surnager après la démolition du bâtiment. En un mot, il prit toutes les précautions qu’un marin devait prendre.
En vérité, il n’avait plus aucun espoir de sauver la goélette ! Cette immense muraille ne présentait pas une crique, pas une embouchure dans laquelle un navire en perdition pût se réfugier. La Dobryna ne pouvait être relevée que par une subite saute de vent qui la rejetterait au large, ou, comme l’avait dit le lieutenant Procope, que si Dieu entrouvrait miraculeusement ce littoral pour lui livrer passage.
Mais le vent ne changeait pas. Il ne devait pas changer.
Bientôt, la goélette ne fut plus qu’à un mille de la côte. On voyait l’énorme falaise grandir peu à peu, et, par une illusion d’optique, il semblait que ce fût elle qui se précipitât sur la goélette, comme pour l’écraser. En quelques instants, la Dobryna n’en fut plus qu’à trois encablures. Il n’était personne à bord qui ne se crût à l’heure suprême !
« Adieu, comte Timascheff, dit le capitaine Servadac, en tendant la main à son compagnon.
– À Dieu, capitaine ! » répondit le comte, qui montra le ciel.
En ce moment, la Dobryna, soulevée par les monstrueuses lames, allait être broyée contre la falaise.
Soudain, une voix retentit :
« Allons, leste, garçons ! Hisse le grand foc ! Hisse la trinquette ! La barre droite ! »
C’était Procope qui, debout sur l’avant de la Dobryna, donnait ces ordres. Si inattendus qu’ils fussent, l’équipage les exécuta rapidement, tandis que le lieutenant, courant à l’arrière, saisit lui-même la roue du gouvernail.
Que voulait donc le lieutenant Procope ? Diriger, sans doute, la goélette de manière à la mettre au plein par l’avant.
« Attention ! cria-t-il encore. Veille aux écoutes ! »
En ce moment, un cri retentit… mais ce ne fut pas un cri de terreur qui s’échappa de toutes les poitrines.
Une coupée de la falaise, large de quarante pieds au plus, venait d’apparaître entre deux murs à pic. C’était un refuge, sinon un passage. La Dobryna, évoluant alors sous la main du lieutenant Procope, poussée par le vent et la mer, s’y précipita !… Peut-être n’en devait-elle plus jamais sortir !
Chapitre XIII
Où il est question du brigadier Murphy, du major Oliphant, du caporal Pim, et d’un projectile qui se perd au-delà de l’horizon
« Je prendrai votre fou si vous voulez bien le permettre, dit le brigadier Murphy, qui, après deux jours d’hésitation, se décida enfin à jouer ce coup, longuement médité.
– Je le permets, puisque je ne puis l’empêcher », répondit le major Oliphant, absorbé dans la contemplation de l’échiquier.
Cela se passait dans la matinée du 17 février – ancien calendrier –, et la journée entière s’écoula avant que le major Oliphant eût répondu au coup du brigadier Murphy.
Du reste, il convient de dire que cette partie d’échecs était commencée depuis quatre mois, et que les deux adversaires n’avaient encore joué que vingt coups. Tous deux étaient, d’ailleurs, de l’école de l’illustre Philidor, qui prétend que nul n’est fort à ce jeu, s’il ne sait jouer les pions, – qu’il appelle « l’âme des échecs ». Aussi, pas un pion n’avait-il été légèrement livré jusqu’alors.
C’est que le brigadier Hénage Finch Murphy et le major Sir John Temple Oliphant ne donnaient jamais rien au hasard et n’agissaient, en toutes circonstances, qu’après mûres réflexions.
Le brigadier Murphy et le major Oliphant étaient deux honorables officiers de l’armée anglaise, que le sort avait réunis dans une station lointaine, dont ils charmaient les loisirs en jouant aux échecs. Tous deux âgés de quarante ans, tous deux grands, tous deux roux, la figure ornée des plus beaux favoris du monde, à l’angle desquels venaient se perdre leurs longues moustaches, toujours en uniforme, toujours flegmatiques, très fiers d’être Anglais et restés ennemis de tout ce qui n’était pas Anglais par fierté naturelle, ils admettaient volontiers que l’Anglo-Saxon est pétri d’un limon spécial, qui a échappé jusqu’ici à toute analyse chimique. C’étaient peut-être deux mannequins que ces officiers, mais de ces mannequins dont les oiseaux ont peur et qui défendent merveilleusement le champ confié à leur garde. Ces Anglais-là se sentent toujours chez eux, même lorsque la destinée les envoie à quelques milliers de lieues de leur pays, et, très aptes à coloniser, ils coloniseront la lune, – le jour où ils pourront y planter le pavillon britannique.
Le cataclysme, qui avait si profondément modifié une portion du globe terrestre, s’était accompli, il faut bien le dire, sans avoir procuré un étonnement immodéré ni au major Oliphant ni au brigadier Murphy, deux types véritablement exceptionnels. Ils s’étaient trouvés tout d’un coup isolés avec onze hommes sur un poste qu’ils occupaient au moment de la catastrophe, et, de l’énorme rocher où plusieurs centaines d’officiers et de soldats étaient casernés avec eux la veille, il ne restait plus qu’un étroit îlot, entouré par l’immense mer.
« Aoh ! s’était contenté de dire le major. Voici ce qu’on peut appeler une circonstance particulière !
– Particulière, en effet ! avait simplement répondu le brigadier.
– Mais l’Angleterre est là !
– Toujours là !
– Et ses vaisseaux viendront nous rapatrier ?
– Ils viendront !
– Restons donc à notre poste.
– À notre poste. »
D’ailleurs, les deux officiers et les onze hommes auraient eu quelque peine à quitter leur poste, quand même ils l’eussent voulu, car ils ne possédaient qu’un simple canot. De continentaux qu’ils étaient la veille, le lendemain devenus insulaires, ainsi que leurs dix soldats et leur domestique Kirke, ils attendaient le plus patiemment du monde le moment où quelque navire viendrait leur donner des nouvelles de la mère patrie. Au surplus, la nourriture de ces braves gens était assurée. Il y avait dans les souterrains de l’îlot de quoi alimenter treize estomacs – fussent treize estomacs anglais –, et pendant dix ans au moins. Or, quand le bœuf salé, l’ale et le brandy sont là, « all right », comme ils disent ! Quant aux phénomènes physiques qui s’étaient produits, tels que changement des points cardinaux est et ouest, diminution de l’intensité de la pesanteur à la surface du globe, accourcissement des jours et des nuits, déviation de l’axe de rotation, projection d’une nouvelle orbite dans le monde solaire, ni les deux officiers ni leurs hommes, après les avoir constatés, ne s’en étaient inquiétés autrement. Le brigadier et le major avaient remis sur l’échiquier les pièces renversées par la secousse, et ils avaient repris flegmatiquement leur interminable partie. Peut-être les fous, les cavaliers, les pions, plus légers maintenant, tenaient-ils moins bien qu’autrefois à la surface de l’échiquier, – les rois, les reines, surtout, que leur grandeur exposait à des chutes plus fréquentes ; mais, avec quelque précaution, Oliphant et Murphy finirent par assurer solidement leur petite armée d’ivoire.
Il a été dit que les dix soldats emprisonnés sur l’îlot ne s’étaient pas autrement préoccupés des phénomènes cosmiques. Pour être véridique, il faut ajouter, cependant, que l’un de ces phénomènes provoqua deux réclamations de leur part.
En effet, trois jours après la catastrophe, le caporal Pim, se faisant l’interprète de ses hommes, avait demandé une entrevue aux deux officiers.
L’entrevue ayant été accordée, Pim, suivi des neuf soldats, entra dans la chambre du brigadier Murphy. Là, la main au bonnet d’ordonnance campé sur son oreille droite et retenu au-dessous de la lèvre inférieure par la jugulaire, étroitement sanglé dans sa veste rouge et flottant dans son pantalon verdâtre, le caporal attendit le bon plaisir de ses chefs.
Ceux-ci interrompirent leur partie d’échecs.
« Que veut le caporal Pim ? demanda le brigadier Murphy, en relevant la tête avec dignité.
– Faire une observation à mon brigadier, relativement au paiement des hommes, répondit le caporal Pim, et en faire une seconde à mon major, relativement à leur nourriture.
– Que le caporal produise sa première observation, répondit Murphy en approuvant du geste.
– C’est par rapport à la solde, Votre Honneur, dit le caporal Pim. Maintenant que les jours ont diminué de moitié, est-ce que la solde diminuera dans la même proportion ? »
Le brigadier Murphy, pris à l’improviste, réfléchit un instant, et quelques oscillations approbatives de sa tête indiquèrent qu’il trouvait l’observation du caporal fort opportune. Puis, il se retourna vers le major Oliphant, et, après avoir échangé un regard avec son collègue :
« Caporal Pim, dit-il, la solde étant calculée sur l’intervalle de temps qui s’écoule entre deux levers de soleil, quelle que soit la durée de cet intervalle, la solde restera ce qu’elle était autrefois. L’Angleterre, elle aussi, est assez riche pour payer ses soldats ! »
C’était une manière aimable d’indiquer que l’armée et la gloire anglaises se confondaient dans une même pensée.
« Hurrah ! » répondirent les dix hommes, mais sans plus élever la voix que s’ils eussent dit : « Merci ! »
Le caporal Pim se retourna alors vers le major Oliphant.
« Que le caporal produise sa seconde réclamation, dit le major en regardant son subordonné.
– C’est par rapport à la nourriture, Votre Honneur, dit le caporal Pim. Maintenant que les journées ne durent plus que six heures, est-ce que nous n’aurons plus droit qu’à deux repas au lieu de quatre ? »
Le major réfléchit un instant et fit au brigadier Murphy un signe approbateur, indiquant qu’il trouvait le caporal Pim un homme véritablement plein de sens et de logique.
« Caporal, dit-il, les phénomènes physiques ne peuvent rien contre les règlements militaires. Vous et vos hommes, vous ferez vos quatre repas, à une heure et demie d’intervalle chacun. L’Angleterre est assez riche pour se conformer aux lois de l’univers quand le règlement l’exige ! ajouta le major, qui s’inclina légèrement vers le brigadier Murphy, heureux d’approprier à un fait nouveau la phrase de son supérieur.
– Hurrah ! » redirent les dix soldats, en accentuant un peu plus cette seconde manifestation de leur contentement.
Puis, tournant sur leurs talons, le caporal Pim en tête, ils quittèrent au pas réglementaire la chambre des deux officiers, qui reprirent aussitôt leur partie interrompue.
Ces Anglais avaient raison de compter sur l’Angleterre, car l’Angleterre n’abandonne jamais les siens. Mais, sans doute, elle était fort occupée en ce moment[4], et les secours, si patiemment attendus, d’ailleurs, n’arrivèrent pas. Peut-être, après tout, ignorait-on dans le nord de l’Europe ce qui s’était passé dans le midi.
Cependant, quarante-neuf des anciens jours de vingt-quatre heures s’étaient écoulés depuis cette mémorable nuit du 31 décembre au 1er janvier, et aucun navire anglais ou autre n’avait paru à l’horizon. Cette portion de mer, que dominait l’îlot, quoique l’une des plus fréquentées du globe, restait invariablement déserte. Mais officiers et soldats n’éprouvaient ni la moindre inquiétude, ni la moindre surprise, ni, par conséquent, le plus léger symptôme de découragement. Tous faisaient leur service comme à l’ordinaire et montaient régulièrement leur garde. Régulièrement aussi, le brigadier et le major passaient la revue de la garnison. Tous, d’ailleurs, se trouvaient parfaitement bien d’un régime qui les engraissait à vue d’œil, et si les deux officiers résistaient à ces menaces d’obésité, c’est que leur grade leur interdisait tout excès d’embonpoint de nature à compromettre l’uniforme.
En somme, ces Anglais passaient convenablement le temps sur cet îlot. Les deux officiers, ayant le même caractère et les mêmes goûts, s’accordaient en tous points. Un Anglais, d’ailleurs, ne s’ennuie jamais, à moins que ce ne soit dans son pays, – et encore n’est-ce que pour se conformer aux exigences de ce qu’il nomme le « cant ».
Quant à ceux de leurs compagnons qui avaient disparu, ils les regrettaient, sans doute, mais avec une réserve toute britannique. Étant donné, d’une part, qu’ils étaient dix-huit cent quatre-vingt-quinze hommes avant la catastrophe, d’autre part, qu’ils ne s’étaient plus retrouvés que treize après, une simple soustraction leur avait appris que dix-huit cent quatre-vingt-deux manquaient à l’appel, et cela avait été mentionné sur le rapport.
On a dit que l’îlot – reste d’un énorme massif qui s’élevait à une hauteur de deux mille quatre cents mètres au-dessus du niveau de la mer –, maintenant occupé par treize Anglais, était le seul point solide qui apparût hors des eaux de ces parages. Ceci n’est pas tout à fait exact. En effet, un second îlot, presque semblable au premier, émergeait dans le sud, à vingt kilomètres de distance environ. C’était la partie supérieure d’un massif qui faisait autrefois le pendant de celui des Anglais. Le même cataclysme les avait réduits tous les deux à ne plus être que deux rochers à peine habitables.
Ce second îlot était-il désert, ou servait-il de refuge à quelque survivant de la catastrophe ? C’est ce que se demandèrent les officiers anglais, et, très probablement, entre deux coups de leur partie d’échecs, ils traitèrent à fond cette question. Elle leur parut même assez importante pour être complètement élucidée, car, un jour, profitant d’un beau temps, ils s’embarquèrent dans le canot, traversèrent le bras de mer qui séparait les deux îlots, et ils ne revinrent que trente-six heures après.
Était-ce un sentiment d’humanité qui les conduisit à explorer ce rocher ? Était-ce un intérêt de toute autre nature ? Ils ne dirent rien du résultat de leur excursion, pas même au caporal Pim. L’îlot était-il habité ? Le caporal n’en put rien savoir. En tout cas, les deux officiers, partis seuls, étaient revenus seuls. Toutefois, malgré leur réserve, le caporal Pim crut comprendre qu’ils étaient satisfaits. Un gros pli fut même préparé par le major Oliphant, signé par le brigadier Murphy, puis scellé du sceau du 33e régiment, de manière à pouvoir être immédiatement remis au premier navire qui paraîtrait en vue de l’île. Ce pli portait en suscription :
À l’amiral Fairfax,
Premier lord de l’Amirauté.
Royaume-Uni.
Mais aucun bâtiment ne s’était montré, et le 18 février arriva sans que les communications eussent été rétablies entre l’îlot et l’administration métropolitaine.
Ce jour-là, le brigadier Murphy, en se réveillant, avait adressé la parole au major Oliphant.
« C’est aujourd’hui, lui dit-il, un jour de fête pour tout cœur véritablement anglais.
– Un grand jour de fête, répondit le major.
– Je ne pense pas, reprit le brigadier, que les circonstances particulières dans lesquelles nous sommes doivent empêcher deux officiers et dix soldats du Royaume-Uni de fêter un anniversaire royal.
– Je ne le pense pas, répondit le major Oliphant.
– Si Sa Majesté ne s’est pas encore mise en communication avec nous, c’est qu’elle n’a pas jugé convenable de le faire.
– En effet.
– Un verre de porto, major Oliphant ?
– Volontiers, brigadier Murphy. »
Ce vin, qui semble spécialement réservé à la consommation anglaise, alla se perdre dans cette embouchure britannique que les cockneys appellent « le piège aux pommes de terre », mais que l’on pourrait tout aussi justement nommer « la perte du porto », par analogie avec la « perte du Rhône ».
« Et maintenant, dit le brigadier, procédons réglementairement au salut d’usage.
– Réglementairement », répondit le major. Le caporal Pim fut mandé et parut, les lèvres encore humides du brandy matinal.
« Caporal Pim, lui dit le brigadier, c’est aujourd’hui le 18 février, si nous comptons, comme tout bon Anglais doit le faire, suivant l’ancienne méthode du calendrier britannique.
– Oui, Votre Honneur, répondit le caporal.
– C’est donc l’anniversaire royal. »
Le caporal fit le salut militaire.
« Caporal Pim, reprit le brigadier, les vingt et un coups de canon suivant l’ordonnance.
– À vos ordres, Votre Honneur.
– Ah ! caporal, ajouta le brigadier, veillez autant que possible à ce que les servants n’aient pas le bras emporté !
– Autant que possible », répondit le caporal, qui ne voulait pas s’engager plus qu’il ne convenait.
Des nombreuses pièces qui garnissaient autrefois le fort, il ne restait plus qu’un gros canon se chargeant par la bouche, du calibre de vingt-sept centimètres. C’était donc un énorme engin, et, bien que les saluts fussent ordinairement faits par des bouches à feu de moindre dimension, il fallait bien employer ce canon, puisqu’il formait, à lui seul, toute l’artillerie de l’îlot.
Le caporal Pim, après avoir prévenu ses hommes, se rendit au réduit blindé, qui laissait passer la volée de la pièce par une embrasure oblique. On apporta les gargousses nécessaires pour les vingt et un coups d’usage. Cela va sans dire, ils ne devaient être tirés qu’à poudre.
Le brigadier Murphy et le major Oliphant, en grande tenue et le chapeau à plumes sur la tête, vinrent assister à l’opération.
Le canon fut chargé suivant toutes les règles du Manuel de l’artilleur, et les joyeuses détonations commencèrent.
Après chaque coup, suivant la recommandation qui lui avait été faite, le caporal veillait à ce que la lumière fût soigneusement bouchée, afin d’empêcher que le coup, partant intempestivement, ne changeât les bras des refouleurs en projectiles, – phénomène qui se produit fréquemment dans les réjouissances publiques. Mais, cette fois, il n’y eut aucun accident.
Il convient aussi de faire observer que, dans cette occasion, les couches d’air, moins denses, s’ébranlèrent avec moins de fracas sous la poussée des gaz vomis par le canon, et que, conséquemment, les détonations ne furent pas aussi bruyantes qu’elles l’eussent été il y a six semaines, – ce qui ne laissa pas de causer un certain déplaisir aux deux officiers. Plus de ces éclatantes répercussions que renvoyaient les cavités rocheuses et qui transformaient le bruit sec des décharges en roulements de tonnerre. Plus de ces grondements majestueux que l’élasticité de l’air propageait à de grandes distances. On comprend donc que, dans ces conditions, l’amour-propre de deux Anglais, en train de fêter un anniversaire royal, fût compromis dans une certaine mesure.
Vingt coups avaient été tirés.
Au moment de charger la pièce pour la vingt et unième fois, le brigadier Murphy arrêta d’un geste le bras du servant.
« Mettez un projectile, dit-il. Je ne serais pas fâché de connaître la nouvelle portée de cette pièce.
– C’est une expérience à faire, répondit le major. – Caporal, vous avez entendu ?
– À vos ordres, Votre Honneur ! » répondit le caporal Pim.
Un des servants amena sur un chariot un projectile plein, qui ne pesait pas moins de deux cents livres, projectile que le canon envoyait ordinairement à une distance de deux lieues. En suivant avec une lunette ce boulet pendant sa trajectoire, on pourrait facilement voir le point où il tomberait dans la mer, et, par conséquent, évaluer approximativement la portée actuelle de l’énorme bouche à feu.
Le canon fut chargé, on le braqua sous un angle de quarante-deux degrés de manière à accroître le développement de la trajectoire, et, au commandement du major, le coup partit.
« Par saint Georges ! s’écria le brigadier.
– Par saint Georges ! » s’écria le major.
Les deux exclamations avaient été lancées en même temps. Les deux officiers étaient restés là, bouche béante, et ils ne pouvaient en croire leurs yeux. En effet, il avait été impossible de suivre le projectile, sur lequel l’attraction agissait moins qu’elle n’eût agi à la surface de la terre. On ne put, même avec les lunettes, constater sa chute dans la mer. Il fallut donc en conclure qu’il avait été se perdre bien au-delà de l’horizon.
« Plus de trois lieues ! dit le brigadier.
– Plus… oui… certes ! » répondit le major.
Et – était-ce une illusion ? – à cette détonation de la pièce anglaise, sembla répondre une faible détonation qui venait du large. Les deux officiers et les soldats écoutèrent en prêtant l’oreille avec une extrême attention. Trois autres détonations successives se firent encore entendre dans la même direction.
« Un navire ! dit le brigadier. Et si c’est un navire, ce ne peut être qu’un navire anglais ! »
Une demi-heure plus tard, les deux mâts d’un bâtiment apparaissaient au-dessus de l’horizon.
« L’Angleterre vient à nous ! dit le brigadier Murphy du ton d’un homme auquel les événements ont donné raison.
– Elle a reconnu le bruit de notre canon, répondit le major Oliphant.
– Pourvu que notre boulet n’ait pas atteint ce navire ! » murmura à part lui le caporal Pim.
Une demi-heure plus tard, la coque du bâtiment aperçu était parfaitement visible à l’horizon. Une longue traînée de fumée noire, s’étendant sur le ciel, indiquait que c’était un steamer. Bientôt, on put reconnaître une goélette à vapeur, qui, tout dessus, s’approchait de l’îlot avec l’évidente intention d’y atterrir. Un pavillon flottait à sa corne, mais il était encore malaisé d’en distinguer la nationalité.
Murphy et Oliphant, la lunette aux yeux, ne perdaient pas la goélette de vue et avaient hâte de saluer ses couleurs.
Mais, soudain, les deux lunettes s’abaissèrent, comme par un mouvement automatique et simultané des deux bras, et les officiers se regardèrent, stupéfaits en disant :
« Le pavillon russe ! »
Et, en effet, l’étamine blanche, sur laquelle s’écartèle la croix bleue de Russie, flottait à la corne de la goélette.
Chapitre XIV
Qui montre une certaine tension dans les relations internationales et aboutit à une déconvenue géographique
La goélette accosta rapidement l’îlot, et les Anglais purent lire à son tableau d’arrière le nom de Dobryna.
Un retour des roches formait dans la partie sud une petite crique, qui n’aurait pu contenir quatre bateaux de pêche, mais la goélette y devait trouver un mouillage suffisant et même sûr, à la condition que les vents du sud et de l’ouest ne vinssent pas à fraîchir. Elle entra donc dans cette crique. L’ancre fut mouillée, et un canot à quatre avirons, portant le comte Timascheff et le capitaine Servadac, accosta bientôt le littoral de l’îlot.
Le brigadier Murphy et le major Oliphant, raides et guindés, attendaient gravement.
Ce fut Hector Servadac qui, impétueux comme un Français, leur adressa le premier la parole.
« Ah ! messieurs, s’écria-t-il, Dieu soit loué ! Vous avez, comme nous, échappé au désastre, et nous sommes heureux de pouvoir serrer la main à deux de nos semblables ! »
Les officiers anglais, qui n’avaient pas fait un seul pas, ne firent pas même un seul geste.
« Mais, reprit Hector Servadac, sans même remarquer cette superbe raideur, avez-vous des nouvelles de la France, de la Russie, de l’Angleterre, de l’Europe ? Où s’est arrêté le phénomène ? Êtes-vous en communication avec la mère patrie ? Avez-vous ?…
– À qui avons-nous l’honneur de parler ? demanda le brigadier Murphy, en se développant de manière à ne pas perdre un pouce de sa taille.
– C’est juste, dit le capitaine Servadac, qui fit un imperceptible mouvement d’épaule, nous n’avons pas encore été présentés les uns aux autres. »
Puis, se retournant vers son compagnon, dont la réserve russe égalait la froideur britannique des deux officiers :
« M. le comte Wassili Timascheff, dit-il.
– Le major Sir John Temple Oliphant », répondit le brigadier en présentant son collègue. Le Russe et l’Anglais se saluèrent.
« Le capitaine d’état-major Hector Servadac, dit à son tour le comte Timascheff.
– Le brigadier Hénage Finch Murphy », répondit d’un ton grave le major Oliphant. Nouveau salut des nouveaux présentés. Les lois de l’étiquette avaient été rigoureusement observées. On pouvait causer sans déchoir.
Il va de soi que tout cela était dit en français, langue familière aux Anglais comme aux Russes, – résultat que les compatriotes du capitaine Servadac ont obtenu en s’entêtant à n’apprendre ni le russe ni l’anglais.
Le brigadier Murphy, ayant fait un signe de la main, précéda ses hôtes, que suivit le major Oliphant, et il les conduisit à la chambre que son collègue et lui occupaient.
C’était une sorte de casemate, creusée dans le roc, mais qui ne manquait pas d’un certain confortable. Chacun prit un siège, et la conversation put suivre un cours régulier.
Hector Servadac, que tant de cérémonies avaient agacé, laissa la parole au comte Timascheff. Celui-ci, comprenant que les deux Anglais étaient « censés » n’avoir rien entendu de ce qui s’était dit avant les présentations, reprit les choses ab ovo.
« Messieurs, dit-il, vous savez sans doute qu’un cataclysme, dont nous n’avons pas encore pu reconnaître ni la cause ni l’importance, s’est produit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. À voir ce qui reste du territoire que vous occupiez auparavant, c’est-à-dire cet îlot, il est évident que vous en avez ressenti violemment les effets. »
Les deux officiers anglais s’inclinèrent en signe d’approbation et d’un même mouvement de corps.
« Mon compagnon, le capitaine Servadac, reprit le comte, a été lui-même fort éprouvé de ce chef. Il remplissait une mission en sa qualité d’officier d’état-major sur la côte de l’Algérie…
– Une colonie française, je crois ? demanda le major Oliphant en fermant à demi les yeux.
– Tout ce qu’il y a de plus français, répondit d’un ton sec le capitaine Servadac.
– C’était vers l’embouchure du Chéliff, continua flegmatiquement le comte Timascheff. Là, pendant cette nuit funeste, une partie du continent africain s’est subitement transformée en île, et le reste semble avoir complètement disparu de la surface du globe.
– Ah ! fit le brigadier Murphy, qui accueillit la nouvelle par cette seule interjection.
– Mais vous, monsieur le comte, demanda le major Oliphant, puis-je savoir où vous étiez pendant cette nuit funeste ?
– En mer, monsieur, à bord de ma goélette, et je considère comme un miracle que nous n’ayons pas été perdus, corps et biens.
– Nous ne pouvons que vous en féliciter, monsieur le comte », répondit le brigadier Murphy. Le comte Timascheff continua en ces termes :
« Le hasard m’ayant ramené vers la côte algérienne, je fus assez heureux pour retrouver sur la nouvelle île le capitaine Servadac, ainsi que son ordonnance Ben-Zouf.
– Ben ?… fit le major Oliphant.
– Zouf ! s’écria Hector Servadac, comme s’il eût fait : « ouf ! » pour se soulager.
– Le capitaine Servadac, reprit le comte Timascheff, ayant hâte de recueillir quelques nouvelles, s’embarqua à bord de la Dobryna, et, nous dirigeant vers l’ancien est, nous cherchâmes à reconnaître ce qui restait de la colonie algérienne… Il n’en restait rien. »
Le brigadier Murphy fit un petit mouvement des lèvres comme pour indiquer qu’une colonie, par cela même qu’elle était française, ne pouvait être bien solide. Sur quoi, Hector Servadac se leva à demi pour lui répondre, mais il parvint à se contenir.
« Messieurs, dit le comte Timascheff, le désastre a été immense. Sur toute cette portion orientale de la Méditerranée, nous n’avons plus retrouvé un seul vestige des anciennes terres, ni de l’Algérie ni de la Tunisie, sauf un point, un rocher qui émergeait près de Carthage, et qui contenait le tombeau du roi de France…
– Louis IX, je crois ? dit le brigadier.
– Plus connu sous le nom de saint Louis, monsieur ! » riposta le capitaine Servadac, auquel le brigadier Murphy voulut bien adresser un demi-sourire d’acquiescement.
Puis, le comte Timascheff raconta que la goélette avait descendu au sud jusqu’à la hauteur du golfe de Gabès, que la mer saharienne n’existait plus – ce que les deux Anglais semblèrent trouver tout naturel, puisque c’était une création française –, qu’une côte nouvelle, d’une étrange contexture, avait surgi en avant du littoral tripolitain, et qu’elle remontait au nord, en suivant le douzième méridien, à peu près jusqu’à la hauteur de Malte.
« Et cette île anglaise, se hâta d’ajouter le capitaine Servadac, Malte avec sa ville, sa Goulette, ses forts, ses soldats, ses officiers et son gouverneur est allée, elle aussi, rejoindre l’Algérie dans l’abîme. »
Le front des deux Anglais s’obscurcit un instant, mais presque aussitôt leur physionomie exprima le doute le mieux caractérisé à l’égard de ce que venait de dire l’officier français.
« Cet engloutissement absolu est assez difficile à admettre, fit observer le brigadier Murphy.
– Pourquoi ? demanda le capitaine Servadac.
– Malte est une île anglaise, répondit le major Oliphant, et, en cette qualité…
– Elle a disparu aussi bien que si elle eût été chinoise ! riposta le capitaine Servadac.
– Peut-être avez-vous fait erreur dans vos relèvements pendant le voyage de la goélette.
– Non, messieurs, dit le comte Timascheff, aucune erreur n’a été commise, et il faut bien se rendre à l’évidence. L’Angleterre a certainement une grande part dans le désastre. Non seulement l’île de Malte n’existe plus, mais un continent nouveau a complètement fermé le fond de la Méditerranée. Sans un étroit passage qui rompt en un seul point la ligne de son littoral, nous n’aurions jamais pu arriver jusqu’à vous. Il est donc malheureusement avéré que, s’il ne reste plus rien de Malte, il ne reste que bien peu de chose des îles Ioniennes, qui, depuis quelques années, sont précisément rentrées sous le protectorat anglais !
– Et je ne crois pas, ajouta le capitaine Servadac, que le lord haut commissaire, votre chef, qui y résidait, ait eu lieu de se féliciter du résultat de ce cataclysme !
– Le haut commissaire, notre chef ?… répondit le brigadier Murphy, qui eut l’air de ne pas comprendre ce qu’on lui disait.
– Pas plus que vous n’avez eu à vous féliciter, d’ailleurs, reprit le capitaine Servadac, de ce qui vous est resté de Corfou.
– Corfou ?… répondit le major Oliphant. Monsieur le capitaine a bien dit Corfou ?
– Oui ! Cor-fou », répéta Hector Servadac. Les deux Anglais, vraiment étonnés, restèrent un instant sans répondre, se demandant à qui en avait l’officier français, mais leur surprise fut encore plus grande, lorsque le comte Timascheff voulut savoir s’ils avaient reçu récemment des nouvelles de l’Angleterre, soit par des bâtiments anglais, soit par le câble sous-marin.
« Non, monsieur le comte, car ce câble est brisé, répondit le brigadier Murphy.
– Eh bien, messieurs, n’êtes-vous donc plus en communication avec le continent par les télégraphes italiens ?
– Italiens ? dit le major Oliphant. Vous voulez dire, sans doute, les télégraphes espagnols ?
– Italiens ou espagnols, repartit le capitaine Servadac, peu importe, messieurs, si vous avez reçu des nouvelles de la métropole.
– Aucune nouvelle, répondit le brigadier Murphy. Mais nous sommes sans inquiétude, et cela ne peut tarder…
– À moins qu’il n’y ait plus de métropole ! dit sérieusement le capitaine Servadac.
– Plus de métropole !
– Ce qui doit être, s’il n’y a plus d’Angleterre !
– Plus d’Angleterre ! »
Le brigadier Murphy et le major Oliphant s’étaient relevés mécaniquement, comme s’ils eussent été poussés par un ressort.
« Il me semble, dit le brigadier Murphy, qu’avant l’Angleterre, la France elle-même…
– La France doit être plus solide, puisqu’elle tient au continent ! répondit le capitaine Servadac, qui s’échauffait.
– Plus solide que l’Angleterre ?…
– L’Angleterre n’est qu’une île, après tout, et une île d’une contexture assez disloquée déjà, pour avoir pu s’anéantir tout entière ! »
Une scène allait avoir lieu. Les deux Anglais se dressaient déjà sur leurs ergots, et le capitaine Servadac était bien décidé à ne pas rompre d’une semelle.
Le comte Timascheff voulut calmer ces adversaires, qu’une simple question de nationalité enflammait, mais il ne put y réussir.
« Messieurs, dit froidement le capitaine Servadac, je crois que cette discussion gagnerait à se poursuivre en plein air. Vous êtes ici chez vous, et s’il vous plaît de sortir ?… »
Hector Servadac quitta la chambre et fut immédiatement suivi du comte Timascheff et des deux Anglais. Tous se réunirent sur un terre-plein qui formait la partie supérieure de l’îlot, dont le capitaine, dans sa pensée, faisait un terrain quasi neutre.
« Messieurs, dit alors le capitaine Servadac en s’adressant aux deux Anglais, si appauvrie que soit la France depuis qu’elle a perdu l’Algérie, elle est en mesure de répondre à toutes les provocations, de quelque part qu’elles lui viennent ! Or, moi, officier français, j’ai l’honneur de la représenter sur cet îlot au même titre que vous représentez l’Angleterre !
– Parfaitement, répondit le brigadier Murphy.
– Et je ne souffrirai pas…
– Ni moi, dit le major Oliphant.
– Et puisque nous sommes ici sur un terrain neutre…
– Neutre ? s’écria le brigadier Murphy. Vous êtes ici sur le sol anglais, monsieur !
– Anglais ?
– Oui, sur un sol que couvre le pavillon britannique ! »
Et le brigadier montrait le pavillon du Royaume-Uni qui flottait au plus haut sommet de l’îlot.
« Bah ! fit ironiquement le capitaine Servadac. Parce qu’il vous a plu de planter ce pavillon depuis la catastrophe…
– Il y était avant.
– Pavillon de protectorat, et non de possession, messieurs !
– De protectorat ? s’écrièrent les deux officiers.
– Messieurs, dit Hector Servadac en frappant du pied, cet îlot est tout ce qui reste maintenant du territoire d’une république représentative, sur lequel l’Angleterre n’a jamais eu qu’un droit de protection !
– Une république ! répliqua le brigadier Murphy, dont les yeux s’ouvrirent démesurément.
– Et encore, continua le capitaine Servadac, était-il singulièrement discutable, ce droit, dix fois perdu, dix fois recouvré, que vous vous êtes arrogé sur les îles Ioniennes !
– Les îles Ioniennes ! s’écria le major Oliphant.
– Et ici, à Corfou !…
– Corfou ? »
L’ébahissement des deux Anglais était tel, que le comte Timascheff, très réservé jusqu’alors, tout porté qu’il fût à prendre fait et cause pour l’officier d’état-major, crut devoir intervenir dans la discussion. Il allait donc s’adresser au brigadier Murphy, lorsque celui-ci, s’adressant d’un ton plus calme au capitaine Servadac :
« Monsieur, lui dit-il, je ne dois pas vous laisser plus longtemps dans une erreur, dont je ne puis deviner la cause. Vous êtes ici sur un sol qui est anglais par droit de conquête et de possession depuis 1704, droit qui nous a été confirmé par le traité d’Utrecht. Plusieurs fois, il est vrai, la France et l’Espagne ont tenté de le contester, en 1727, en 1779, en 1782, mais sans y réussir. Donc, vous êtes aussi bien en Angleterre sur cet îlot, quelque petit qu’il soit, que si vous étiez sur la place Trafalgar, à Londres.
– Nous ne sommes donc pas à Corfou, dans la capitale même des îles Ioniennes ? demanda le comte Timascheff, avec l’accent d’une profonde surprise.
– Non, messieurs, non, répondit le brigadier Murphy. Ici, vous êtes à Gibraltar. »
Gibraltar ! Ce mot éclata comme un coup de foudre aux oreilles du comte Timascheff et de l’officier d’état-major ! Ils croyaient être à Corfou, à l’extrémité orientale de la Méditerranée, et ils étaient à Gibraltar, à l’extrémité occidentale, et cela, bien que la Dobryna ne fût jamais revenue en arrière, pendant son voyage d’exploration !
Il y avait donc là un fait nouveau, dont il fallait déduire les conséquences. Le comte Timascheff allait le faire, lorsque des cris attirèrent son attention. Il se retourna, et, à sa grande surprise, il vit les hommes de la Dobryna aux prises avec les soldats anglais.
Quelle était la cause de cette altercation ? Tout simplement une discussion intervenue entre le matelot Panofka et le caporal Pim. Et pourquoi cette discussion ? Parce que le projectile lancé par le canon, après avoir brisé un des espars de la goélette, avait en même temps cassé la pipe de Panofka, – non sans lui avoir légèrement entamé le nez, qui était peut-être un peu long pour un nez russe.
Ainsi, tandis que le comte Timascheff et le capitaine Servadac avaient quelque peine à s’entendre avec les officiers anglais, voilà que les hommes de la Dobryna menaçaient d’en venir aux mains avec la garnison de l’îlot.
Naturellement, Hector Servadac prit parti pour Panofka et s’attira cette réponse du major Oliphant, que l’Angleterre n’était pas responsable de ses projectiles, que c’était la faute au matelot russe, que ce matelot était où il ne devait pas être pendant le passage du boulet, que d’ailleurs, s’il eût été camard, cela ne serait pas arrivé, etc.
Là-dessus, malgré toute sa réserve, le comte Timascheff de se fâcher, et, après un échange de paroles hautaines avec les deux officiers, il donna ordre à son équipage de se rembarquer immédiatement.
« Nous nous reverrons, messieurs, dit le capitaine Servadac aux deux Anglais.
– Quand il vous plaira ! » répondit le major Oliphant.
En vérité, devant ce nouveau phénomène, qui plaçait Gibraltar là où, géographiquement, aurait dû se trouver Corfou, le comte Timascheff et le capitaine Servadac ne devaient plus avoir qu’une pensée : regagner, l’un la Russie, l’autre la France. C’est pourquoi la Dobryna appareilla immédiatement, et, deux heures après, on ne voyait plus rien de ce qui restait de Gibraltar.
Chapitre XV
Dans lequel on discute pour arriver à découvrir une vérité dont on s’approche peut-être
Les premières heures de la navigation furent employées à discuter les conséquences du fait nouveau et inattendu qui venait de se révéler. S’ils ne devaient pas en déduire la vérité tout entière, du moins le comte, le capitaine et le lieutenant Procope allaient-ils pénétrer plus avant dans le mystère de leur étrange situation.
En effet, que savaient-ils maintenant, et d’une manière incontestable ? C’est que la Dobryna, partant de l’île Gourbi, c’est-à-dire du premier degré de longitude occidentale, n’avait été arrêtée par le nouveau littoral qu’au treizième degré de longitude orientale. C’était donc, en somme, un parcours de quinze degrés. En y ajoutant la longueur de ce détroit qui lui avait livré passage à travers le continent inconnu, soit trois degrés et demi environ, plus la distance qui séparait l’autre extrémité de ce détroit de Gibraltar, soit à peu près quatre degrés, plus enfin celle qui séparait Gibraltar de l’île Gourbi, soit sept degrés, cela faisait en tout vingt-neuf degrés.
Donc, partie de l’île Gourbi et revenue à son point de départ, après avoir suivi sensiblement le même parallèle, en d’autres termes, après avoir décrit une circonférence entière, la Dobryna avait approximativement franchi vingt-neuf degrés.
Or, en comptant quatre-vingts kilomètres par degré, c’était un total de deux mille trois cent vingt kilomètres.
Du moment qu’à la place de Corfou et des îles Ioniennes les navigateurs de la Dobryna avaient trouvé Gibraltar, c’est que tout le reste du globe terrestre, comprenant trois cent trente et un degrés, manquait absolument. Avant la catastrophe, pour aller de Malte à Gibraltar en suivant la direction de l’est, il aurait fallu traverser la seconde moitié orientale de la Méditerranée, le canal de Suez, la mer Rouge, l’océan Indien, la Sonde, le Pacifique, l’Atlantique. Au lieu de cet énorme parcours, un détroit nouveau de soixante kilomètres avait suffi à mettre la goélette à quatre-vingts lieues de Gibraltar.
Tels furent les calculs établis par le lieutenant Procope, et, en tenant compte des erreurs possibles, ils étaient suffisamment approximatifs pour servir de base à un ensemble de déductions.
« Ainsi donc, dit le capitaine Servadac, de ce que la Dobryna est revenue à son point de départ sans avoir changé de cap, il faudrait en conclure que le sphéroïde terrestre n’aurait plus qu’une circonférence de deux mille trois cent vingt kilomètres !
– Oui, répondit le lieutenant Procope, ce qui réduirait son diamètre à sept cent quarante kilomètres seulement, soit seize fois moindre qu’il n’était avant la catastrophe, puisqu’il mesurait douze mille sept cent quatre-vingt-douze kilomètres. Il est incontestable que nous venons de faire le tour de ce qui reste du monde !
– Voilà qui expliquerait plusieurs des singuliers phénomènes que nous avons observés jusqu’ici, dit le comte Timascheff. Ainsi, sur un sphéroïde réduit à ces dimensions, la pesanteur ne pouvait qu’être très amoindrie, et je comprends même que son mouvement de rotation sur son axe ait été accéléré de telle façon que l’intervalle de temps compris entre deux levers de soleil ne soit plus que de douze heures. Quant à la nouvelle orbite qu’il décrit autour du soleil… »
Le comte Timascheff s’arrêta, ne sachant trop comment rattacher ce phénomène à son système nouveau.
« Eh bien, monsieur le comte ? demanda le capitaine Servadac, quant à cette nouvelle orbite ?…
– Quelle est ton opinion à ce sujet, Procope ? répondit le comte en s’adressant au lieutenant.
– Père, répondit Procope, il n’y a pas deux manières d’expliquer le changement d’orbite, il n’y en a qu’une, une seule !
– Et c’est ?… demanda le capitaine Servadac avec une vivacité singulière, comme s’il eût pressenti ce qu’allait répondre le lieutenant.
– C’est, reprit Procope, d’admettre qu’un fragment s’est détaché de la terre, emportant une portion de l’atmosphère avec lui, et qu’il parcourt le monde solaire en suivant une orbite qui n’est plus l’orbite terrestre. »
Après cette explication si plausible, le comte Timascheff, le capitaine Servadac, le lieutenant Procope restèrent silencieux pendant quelques instants. Véritablement atterrés, ils réfléchissaient aux conséquences incalculables de ce nouvel état de choses. Si, réellement, un énorme bloc s’était détaché du globe terrestre, où allait-il ? Quelle valeur attribuer à l’excentricité de l’orbe elliptique qu’il suivait maintenant ? À quelle distance du soleil serait-il entraîné ? Quelle serait la durée de sa révolution autour du centre attractif ? S’en irait-il comme les comètes pendant des centaines de millions de lieues à travers l’espace, ou serait-il ramené bientôt vers la source de toute chaleur et de toute lumière ? Enfin, le plan de son orbite coïncidait-il avec celui de l’écliptique, et pouvait-on concevoir quelque espoir qu’une rencontre le réunît un jour au globe dont il s’était si violemment séparé ?
Ce fut le capitaine Servadac qui, le premier, rompit le silence en s’écriant comme malgré lui :
« Eh bien, non, mordioux ! Votre explication, lieutenant Procope, explique bien des choses, mais elle n’est pas admissible !
– Pourquoi donc, capitaine ? répondit le lieutenant. Elle me paraît répondre, au contraire, à toute objection.
– Non, en vérité, et il en est une, au moins, qui n’est pas détruite par votre hypothèse.
– Et laquelle ? demanda Procope.
– Voyons, reprit le capitaine Servadac, comprenons-nous bien. Vous persistez à croire qu’un morceau du globe, devenu maintenant ce nouvel astéroïde qui nous emporte, et comprenant une partie du bassin de la Méditerranée depuis Gibraltar jusqu’à Malte, court à travers le monde solaire ?
– Je persiste à le croire.
– Eh bien, alors, lieutenant, comment expliquez-vous le soulèvement de ce singulier continent qui encadre à présent cette mer, et la contexture spéciale de ses côtes ? Si nous étions emportés sur un morceau du globe, ce morceau eût certainement conservé son ancienne charpente granitique ou calcaire, et il n’offrirait pas, à sa surface, cette concrétion minérale dont la composition même nous échappe ! »
C’était là une sérieuse objection que le capitaine Servadac faisait à la théorie du lieutenant. En effet, on pouvait concevoir, à la rigueur, qu’un fragment se fût détaché du globe, entraînant avec lui une partie de l’atmosphère et une portion des eaux méditerranéennes ; on pouvait même admettre que ses mouvements de translation et de rotation ne fussent plus identiques à ceux de la terre ; mais pourquoi, au lieu des rivages fertiles qui bordaient la Méditerranée au sud, à l’ouest et à l’est, cette abrupte muraille, sans trace de végétation, et dont la nature même était inconnue ?
Le lieutenant Procope fut fort empêché de répondre à cette objection, et il dut se borner à dire que l’avenir, sans doute, réservait bien des solutions introuvables pour le moment. En tout cas, il ne croyait pas devoir renoncer à l’admission d’un système qui expliquait tant de choses inexplicables. Quant à la cause première, elle lui échappait encore. Devait-on admettre qu’une expansion des forces centrales avait pu détacher un pareil bloc du globe terrestre et le lancer dans l’espace ? c’était fort incertain. Dans ce problème si complexe, que d’inconnues encore à dégager.
« Après tout, dit le capitaine Servadac pour conclure, peu m’importe de graviter dans le monde solaire sur un nouvel astre, si la France y gravite avec nous !
– La France… et la Russie ! ajouta le comte Timascheff.
– Et la Russie ! » répondit l’officier d’état-major, qui s’empressa d’admettre la légitime réclamation du comte.
Et cependant, si ce n’était réellement qu’un morceau du globe qui se mouvait suivant une nouvelle orbite, et si ce morceau avait la forme sphéroïdale – ce qui lui assignait alors des dimensions très restreintes –, ne devait-on pas craindre qu’une partie de la France, et tout au moins la plus grande portion de l’empire russe, ne fussent restées à l’ancienne terre ? De même pour l’Angleterre, et, d’ailleurs, ce défaut de relation depuis six semaines entre Gibraltar et le Royaume-Uni semblait bien indiquer que les communications n’étaient plus possibles, ni par terre, ni par mer, ni par la poste, ni par le télégraphe. En effet, si l’île Gourbi, comme on devait le croire – à considérer l’égalité constante des jours et des nuits –, occupait l’équateur de l’astéroïde, les deux pôles Nord et Sud devaient être éloignés de l’île d’une distance égale à la demi-circonférence relevée pendant le voyage de la Dobryna, soit environ onze cent soixante kilomètres. Cela reportait le pôle Arctique à cinq cent quatre-vingts kilomètres au nord de l’île Gourbi, et le pôle Antarctique à cette même distance au sud. Or, lorsque ces points eurent été fixés sur la carte, il fut constant que le pôle Nord ne dépassait pas le littoral de la Provence, et que le pôle Sud tombait dans le désert africain, à la hauteur du vingt-neuvième parallèle.
Maintenant, le lieutenant Procope avait-il raison de persister dans ce nouveau système ? Un bloc avait-il été réellement arraché au globe terrestre ? Impossible de se prononcer. À l’avenir appartenait la solution du problème ; mais peut-être n’est-il pas téméraire d’admettre que s’il ne découvrait pas encore l’entière vérité, le lieutenant Procope avait fait un pas vers elle.
La Dobryna avait retrouvé un temps magnifique, au-delà de l’étroit pertuis qui unissait les deux extrémités de la Méditerranée dans les parages de Gibraltar. Le vent même la favorisait, et, sous la double action de la brise et de la vapeur, elle s’éleva rapidement dans le nord.
On dit le nord et non l’est, parce que le littoral espagnol avait totalement disparu, au moins dans la partie comprise autrefois entre Gibraltar et Alicante. Ni Malaga, ni Alméria, ni le cap de Gata, ni le cap de Palos, ni Carthagène n’occupaient la place que leur assignaient leurs coordonnées géographiques. La mer avait recouvert toute cette partie de la péninsule hispanique, et la goélette dut s’avancer jusqu’à la hauteur de Séville pour retrouver, non pas le rivage andalou, mais une falaise identique à celle qu’elle avait déjà relevée au-delà de Malte.
À partir de ce point, la mer mordait profondément le nouveau continent, en formant un angle aigu, dont Madrid aurait dû occuper le sommet. Puis, la côte, redescendant au sud, venait empiéter à son tour sur l’ancien bassin et s’allongeait comme une griffe menaçante au-dessus des Baléares.
Ce fut en s’écartant un peu de leur route afin de rechercher quelques traces de ce groupe d’îles importantes, que les explorateurs firent une trouvaille très inattendue.
On était au 21 février. Il était huit heures du matin, lorsqu’un des matelots, posté à l’avant de la goélette, cria :
« Une bouteille à la mer ! »
Cette bouteille pouvait contenir un document précieux, qui, peut-être, se rapporterait au nouvel état de choses.
Au cri du matelot, le comte Timascheff, Hector Servadac, le lieutenant, tous avaient couru vers le gaillard d’avant. La goélette manœuvra de manière à rejoindre l’objet signalé, qui fut bientôt repêché et hissé à bord.
Ce n’était pas une bouteille, mais un étui de cuir, du genre de ceux qui servent à serrer les lunettes de moyenne grandeur. Le couvercle en était soigneusement ajusté avec de la cire, et, si l’immersion de cet étui était récente, l’eau n’avait pas dû y pénétrer.
Le lieutenant Procope, en présence du comte Timascheff et de l’officier d’état-major, examina attentivement l’étui. Il ne portait aucune marque de fabrique. La cire, qui en rendait le couvercle adhérent, était intacte, et elle avait conservé l’empreinte d’un cachet sur lequel se lisaient ces deux initiales :
P. R.
Le cachet fut brisé, l’étui fut ouvert, et le lieutenant en retira un papier que l’eau de mer avait respecté. Ce n’était qu’une simple feuille quadrillée, détachée d’un agenda et portant ces mots, suivis de points d’interrogation et d’exclamation, – le tout d’une grosse écriture renversée :
« Gallia ? ? ?
« Ab sole, au 15 fév., dist. : 59 000 000 l. !
« Chemin parcouru de janv. à fév. : 32 000 000 l.
« Va bene ! All right ! Parfait ! ! ! »
« Qu’est-ce que cela veut dire ? demanda le comte Timascheff, après avoir tourné la feuille de papier en tous sens.
– Je n’en sais rien, répondit le capitaine Servadac ; mais, ce qui est certain, c’est que l’auteur de ce document, quel qu’il soit, vivait encore au 15 février, puisque le document mentionne cette date.
– Évidemment », répondit le comte Timascheff. Quant au document, il n’était pas signé. Rien ne marquait son lieu d’origine. On y trouvait des mots latins, italiens, anglais, français, – ces derniers en plus grand nombre que les autres.
« Ce ne peut être une mystification, dit le capitaine Servadac. Il est bien évident que ce document se rapporte au nouvel ordre cosmographique dont nous subissons les conséquences ! L’étui dans lequel il est renfermé a appartenu à quelque observateur, naviguant à bord d’un navire…
– Non, capitaine, répondit le lieutenant Procope, car cet observateur eût certainement mis le document dans une bouteille, où il aurait été plus à l’abri de l’humidité que dans un étui de cuir. Je croirais plutôt que quelque savant, demeuré seul sur un point épargné du littoral, et voulant faire connaître le résultat de ses observations, a utilisé cet étui, moins précieux pour lui, peut-être, que ne l’était une bouteille.
– Peu importe, après tout ! dit le comte Timascheff. En ce moment, il est plus utile d’expliquer ce que signifie ce singulier document que de chercher à deviner quel en est l’auteur. Procédons donc par ordre. Et, d’abord, qu’est-ce que cette Gallia ?
– Je ne connais aucune planète, grande ou petite, qui porte ce nom, répondit le capitaine Servadac.
– Capitaine, dit alors le lieutenant Procope, avant d’aller plus loin, permettez-moi de vous faire une question.
– Faites, lieutenant.
– N’êtes-vous pas d’avis que ce document semble justifier cette dernière hypothèse, d’après laquelle un fragment du globe terrestre aurait été projeté dans l’espace ?
– Oui… peut-être… répondit Hector Servadac… bien que l’objection tirée de la matière dont est fait notre astéroïde subsiste toujours !
– Et, dans ce cas, ajouta le comte Timascheff, le savant en question aurait donné le nom de Gallia au nouvel astre.
– Ce serait donc un savant français ? fit observer le lieutenant Procope.
– Cela est à supposer, répondit le capitaine Servadac. Remarquez que, sur dix-huit mots qui composent le document, il y a onze mots français contre trois mots latins, deux mots italiens et deux mots anglais. Cela prouverait aussi que ledit savant, ignorant en quelles mains tomberait son document, a voulu employer des mots de diverses langues pour accroître les chances d’être compris.
– Admettons que Gallia est le nom du nouvel astéroïde qui gravite dans l’espace, dit le comte Timascheff, et continuons.
« Ab sole, distance au 15 février, cinquante-neuf millions de lieues. »
– C’était effectivement la distance qui devait séparer Gallia du soleil à cette époque, répondit le lieutenant Procope, lorsqu’elle est venue couper l’orbite de Mars.
– Bien, répondit le comte Timascheff. Voilà un premier point du document qui s’accorde avec nos observations.
– Exactement, dit le lieutenant Procope.
– « Chemin parcouru de janvier à février », reprit le comte Timascheff en continuant sa lecture, « quatre-vingt-deux millions de lieues. »
– Il s’agit là, évidemment, répondit Hector Servadac, du chemin parcouru par Gallia sur sa nouvelle orbite.
– Oui, ajouta le lieutenant Procope, et, en vertu des lois de Kepler, la vitesse de Gallia, ou, ce qui revient au même, le chemin parcouru dans des temps égaux, a dû diminuer progressivement. Or, la plus haute température que nous ayons subie s’est précisément fait sentir à cette date du 15 janvier. Il est donc probable que, à cette date, Gallia était à son périhélie, c’est-à-dire à sa distance la plus rapprochée du soleil, et qu’elle marchait alors avec une vitesse double de celle de la terre, qui n’est que de vingt-huit mille huit cents lieues par heure.
– Très bien, répondit le capitaine Servadac, mais cela ne nous indique pas à quelle distance Gallia s’éloignera du soleil, pendant son aphélie, ni ce que nous pouvons espérer ou craindre pour l’avenir.
– Non, capitaine, répondit le lieutenant Procope ; mais, avec de bonnes observations, faites sur divers points de la trajectoire de Gallia, on parviendrait certainement à déterminer ses éléments, en lui appliquant les lois de la gravitation universelle…
– Et, par conséquent, la route qu’elle doit suivre dans le monde solaire, dit le capitaine Servadac.
– En effet, reprit le comte Timascheff, si Gallia est un astéroïde, il est, ainsi que tous les mobiles, soumis aux lois de la mécanique, et le soleil régit sa marche comme il régit celle des planètes. Dès l’instant que ce bloc s’est séparé de la terre, il a été saisi par les chaînes invisibles de l’attraction, et son orbite est maintenant fixée d’une manière immuable.
– À moins, répondit le lieutenant Procope, que quelque astre troublant ne vienne la modifier plus tard, cette orbite. Ah ! ce n’est qu’un bien petit mobile que Gallia, comparé aux autres mobiles du système solaire, et les planètes peuvent avoir sur lui une influence irrésistible.
– Il est certain, ajouta le capitaine Servadac, que Gallia peut faire de mauvaises rencontres en route et dévier du droit chemin. Après cela, messieurs, remarquez-le, nous raisonnons comme s’il était prouvé que nous sommes devenus des Galliens ! Eh ! qui nous dit que cette Gallia dont le document parle n’est pas tout simplement une cent soixante-dixième petite planète nouvellement découverte ?
– Non, répondit le lieutenant Procope, cela ne peut être. En effet, les planètes télescopiques ne se meuvent que dans une étroite zone comprise entre les orbites de Mars et de Jupiter. Conséquemment, elles ne s’approchent jamais du soleil aussi près que Gallia s’en est approchée à son périhélie. Et ce fait ne saurait être mis en doute, puisque le document est d’accord avec nos propres hypothèses.
– Malheureusement, dit le comte Timascheff, les instruments nous manquent pour faire des observations, et nous ne pourrons calculer les éléments de notre astéroïde.
– Qui sait ? répondit le capitaine Servadac. On finit par tout savoir, tôt ou tard !
– Quant aux derniers mots du document, reprit le comte Timascheff, « Va bene ! – All right ! – Parfait ! ! ! » ils ne signifient rien…
– Si ce n’est, répondit Hector Servadac, que l’auteur du document est enchanté de ce nouvel état de choses et trouve que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes impossibles. »
Chapitre XVI
Dans lequel on verra le capitaine Servadac tenir dans sa main tout ce qui reste d’un vaste continent
La Dobryna, cependant, après avoir contourné l’énorme promontoire qui lui barrait la route du nord, se dirigeait vers l’endroit où devait se projeter le cap de Creus.
Les explorateurs causaient, on pourrait dire jour et nuit, de ces étranges choses. Le nom de Gallia revenait fréquemment dans leurs discussions, et insensiblement, presque inconsciemment, il prenait pour eux la valeur d’un nom géographique, c’est-à-dire celui de l’astéroïde qui les emportait dans le monde solaire.
Mais ces discussions ne pouvaient leur faire oublier qu’ils s’occupaient d’opérer une reconnaissance, devenue indispensable, du littoral méditerranéen. Aussi la goélette suivait-elle toujours, en le rasant d’aussi près que possible, le nouveau cadre de ce bassin qui, très vraisemblablement, formait l’unique mer de Gallia.
La côte supérieure de l’énorme promontoire rejoignait l’endroit même qu’aurait dû occuper Barcelone sur le littoral ibérien ; mais ce littoral, aussi bien que l’importante ville, avait disparu, et, sans doute, il était enfoui sous ces eaux dont le ressac battait la nouvelle falaise un peu en arrière. Puis, cette falaise, s’infléchissant vers le nord-est, venait remordre sur la mer, précisément au cap de Creus.
Du cap de Creus, il ne restait plus rien.
Là commençait la frontière française, et l’on comprend ce que durent être les pensées du capitaine Servadac, quand il vit qu’un nouveau sol s’était substitué au sol de son pays. Une infranchissable barrière s’élevait en avant du littoral français, et elle n’en laissait plus rien voir. Dressée comme une muraille à pic, haute de plus de mille pieds, n’offrant pas une seule rampe accessible, aussi aride, aussi abrupte, aussi « neuve » qu’on l’avait vue à l’autre bout de la Méditerranée, elle se développait sur le parallèle même où auraient dû se dessiner ces rivages charmants de la France méridionale.
De si près que la goélette prolongeât cette côte, rien ne lui apparut de ce qui formait autrefois la lisière maritime du département des Pyrénées-Orientales, ni le cap Béarn, ni Port-Vendres, ni l’embouchure du Tech, ni l’étang de Saint-Nazaire, ni l’embouchure du Têt, ni l’étang de Salces. Sur la frontière du département de l’Aude, jadis si pittoresquement coupée d’étangs et d’îles, elle ne retrouva pas même un seul morceau de l’arrondissement de Narbonne. Du cap d’Agde, sur la frontière de l’Hérault, jusqu’au golfe d’Aigues-Mortes, il n’existait plus rien, ni de Cette, ni de Frontignan, rien de cet arc que l’arrondissement de Nîmes baignait autrefois dans la Méditerranée, rien des plaines de la Crau et de la Camargue, rien de ce capricieux estuaire des Bouches-du-Rhône. Martigues, disparue ! Marseille, anéantie ! C’était à croire qu’on ne rencontrerait même plus un seul des points du continent européen qui avaient porté le nom de France.
Hector Servadac, bien qu’il fût préparé à tout événement, se sentit comme atterré en présence de cette réalité. Il ne revoyait plus aucun vestige de ces rives dont les sites lui étaient tous familiers. Quelquefois, lorsqu’une courbure de la côte s’arrondissait vers le nord, il espérait retrouver un morceau du sol français qui aurait échappé au désastre ; mais, si loin que l’échancrure se prolongeât, rien ne reparaissait de ce qui avait été ce merveilleux rivage de la Provence. Lorsque le nouveau cadre n’en limitait pas l’ancienne lisière, c’étaient les eaux de cette étrange Méditerranée qui le recouvraient alors, et le capitaine Servadac en vint à se demander si tout ce qui restait de son pays ne se réduisait pas à cet étroit lambeau du territoire algérien, à cette île Gourbi, à laquelle il lui faudrait revenir !
« Et cependant, répétait-il au comte Timascheff, le continent de Gallia ne finit pas à cette côte inabordable ! Son pôle boréal est au-delà ! Qu’y a-t-il derrière cette muraille ? Il faut bien le savoir ! Si pourtant, malgré tous les phénomènes dont nous sommes témoins, c’est encore le globe terrestre que nous foulons du pied, si c’est toujours lui qui nous emporte en suivant une direction nouvelle dans le monde planétaire, si enfin la France, si la Russie sont là avec l’Europe entière, il faut le vérifier ! Ne trouverons-nous donc pas une grève pour débarquer sur cette côte ? N’y a-t-il aucun moyen d’escalader cette inaccessible falaise, et d’observer, ne fût-ce qu’une fois, la contrée qu’elle nous cache ? Débarquons, pour Dieu, débarquons ! »
Mais la Dobryna, rasant toujours la haute muraille, n’apercevait ni la plus petite crique où elle pût se réfugier, ni même un seul écueil sur lequel il eût été possible à son équipage de prendre pied. Le littoral était toujours formé d’une base accore, lisse, à pic, jusqu’à une hauteur de deux ou trois cents pieds, que couronnait tout un étrange enchevêtrement de lamelles cristallisées. Il était évident que cette nouvelle bordure, faite à la Méditerranée, présentait partout la même disposition des roches, et que ce cadre uniforme était sorti d’un moule unique.
La Dobryna, chauffant à tous feux, marcha rapidement vers l’est. Le temps se maintenait au beau. L’atmosphère, singulièrement refroidie déjà, était moins propre à se saturer de vapeurs. À peine quelques nuages, rayant l’azur du ciel, formaient-ils ça et là des cirrhus presque diaphanes. Pendant le jour, le disque amoindri du soleil projetait de pâles rayons qui ne donnaient plus aux objets qu’un relief incertain. Pendant la nuit, les étoiles brillaient avec un éclat extraordinaire, mais certaines planètes s’affaiblissaient dans l’éloignement. Il en était ainsi de Vénus, de Mars et de cet astre inconnu, qui, rangé dans l’ordre des planètes inférieures, précédait le soleil, tantôt à son coucher, tantôt à son lever. Quant à l’énorme Jupiter, au superbe Saturne, leur éclat augmentait au contraire, par ce motif que Gallia s’en rapprochait, et le lieutenant Procope montra, visible à l’œil, cet Uranus qui, autrefois, ne se laissait pas voir sans l’aide d’une lunette. Gallia gravitait donc, en s’éloignant de son centre attractif, à travers le monde planétaire.
Le 24 février, après avoir suivi la ligne sinueuse que formait, avant le cataclysme, la lisière du département du Var, après avoir vainement cherché trace des îles d’Hyères, de la presqu’île de Saint-Tropez, des îles de Lérins, du golfe de Cannes, du golfe Jouan, la Dobryna arriva à la hauteur du cap d’Antibes.
En cet endroit, à l’extrême surprise, mais aussi à l’extrême satisfaction des explorateurs, une étroite coupée fendait l’énorme falaise du haut en bas. À sa base, au niveau de la mer s’étendait une petite grève, sur laquelle un canot devait facilement atterrir.
« Enfin, nous pourrons débarquer ! » s’écria le capitaine Servadac, qui n’était plus maître de lui.
Il n’y avait, d’ailleurs, aucune instance à faire près du comte Timascheff pour l’entraîner sur le nouveau continent. Le lieutenant Procope et lui étaient aussi impatients que le capitaine Servadac de prendre terre. Peut-être en gravissant les talus de cette coupée, qui, de loin, ressemblait au lit raviné d’un torrent, parviendraient-ils à s’élever jusqu’à la crête de la falaise, et trouveraient-ils un large rayon de vue, qui, à défaut du territoire français, leur permettrait d’observer cette région bizarre.
À sept heures du matin, le comte, le capitaine et le lieutenant débarquaient sur la grève.
Pour la première fois, ils retrouvèrent quelques échantillons de l’ancien littoral. C’étaient ces calcaires agglutinés, de couleur jaunâtre, dont les rivages provençaux sont le plus généralement semés. Mais cette étroite grève – évidemment un morceau de l’ancien globe – mesurait à peine quelques mètres de superficie, et, sans s’y arrêter, les explorateurs s’élancèrent vers le ravin qu’ils voulaient franchir.
Ce ravin était à sec, et même il était facile de voir que jamais aucun torrent n’y avait précipité ses eaux tumultueuses. Les roches de son lit, aussi bien que celles qui formaient talus de chaque côté, présentaient cette même contexture lamelleuse observée jusqu’ici, et elles ne semblaient pas avoir été soumises encore aux effets de la désagrégation séculaire. Un géologue eût probablement déterminé leur véritable place dans l’échelle lithologique, mais ni le comte Timascheff, ni l’officier d’état-major, ni le lieutenant Procope ne purent en reconnaître la nature.
Cependant, si le ravin n’offrait aucune trace d’humidité ancienne ou récente, on pouvait déjà prévoir que, les conditions climatériques étant radicalement changées, il servirait un jour d’exutoire à des masses d’eau considérables.
En effet, déjà quelques plaques de neige étincelaient en maint endroit sur les pentes des talus, et elles devenaient plus larges, plus épaisses en tapissant les croupes élevées de la falaise. Très probablement, les crêtes, et peut-être toute la contrée au-delà de la muraille, disparaissaient sous la croûte blanche des glaciers.
« Voilà donc, fit observer le comte Timascheff, les premières traces d’eau douce que nous trouvons à la surface de Gallia.
– Oui, répondit le lieutenant Procope, et, sans doute, à une plus grande hauteur, non seulement la neige, mais les glaces se seront formées sous l’influence du froid qui s’accroît sans cesse. N’oublions pas que si Gallia a la forme sphéroïdale, nous sommes ici très près de ses régions arctiques, qui ne reçoivent que très obliquement les rayons solaires. Certainement, la nuit n’y doit jamais être complète, comme aux pôles terrestres, puisque le soleil ne quitte pas l’équateur, grâce à la faible inclinaison de l’axe de rotation, mais le froid y sera probablement excessif, surtout si Gallia s’éloigne du centre de chaleur à une distance considérable.
– Lieutenant, demanda le capitaine Servadac, ne pouvons-nous craindre que le froid ne devienne tel à la surface de Gallia, qu’aucun être vivant ne puisse le supporter ?
– Non, capitaine, répondit le lieutenant Procope. À quelque distance que nous nous éloignions du soleil, le froid ne dépassera jamais les limites assignées à la température des espaces sidéraux, c’est-à-dire ces régions du ciel où l’air manque absolument.
– Et ces limites sont ?…
– Environ soixante degrés centigrades, suivant les théories d’un Français, le savant physicien Fourier.
– Soixante degrés ! répondit le comte Timascheff, soixante degrés au-dessous de zéro ! Mais c’est là une température qui paraîtrait insoutenable même à des Russes.
– De tels froids, reprit le lieutenant Procope, ont été déjà supportés par les navigateurs anglais dans les mers polaires, et, si je ne me trompe, à l’île Melville, Parry a vu le thermomètre tomber à cinquante-six degrés centigrades au-dessous de zéro. »
Les explorateurs s’étaient arrêtés un instant pour reprendre haleine, car, ainsi qu’il arrive aux ascensionnistes, l’air, décomprimé peu à peu, rendait leur ascension plus pénible. En outre, sans avoir encore atteint une grande hauteur, – six à sept cents pieds à peine, – ils sentaient un abaissement très sensible dans la température. Très heureusement, les stries de la substance minérale, dont le lit du ravin était formé, facilitaient leur marche, et, une heure et demie environ après avoir quitté l’étroite grève, ils atteignaient la crête de la falaise.
Cette falaise dominait non seulement la mer au sud, mais au nord toute la nouvelle région, qui s’abaissait brusquement. Le capitaine Servadac ne put retenir un cri.
La France n’était plus là ! Des roches innombrables se succédaient jusqu’aux dernières limites de l’horizon. Toutes ces moraines, tapissées de neige ou revêtues de glace, se confondaient dans une étrange uniformité. C’était une énorme agglomération de matières qui avaient cristallisé sous la forme de prismes hexagonaux réguliers. Gallia ne paraissait être que le produit d’une formation minérale, unique et inconnue. Si la crête de la falaise, qui servait de cadre à la Méditerranée, n’offrait pas cette uniformité dans ses aiguilles supérieures, c’est qu’un phénomène quelconque – peut-être celui auquel on devait la présence des eaux de la mer – avait, au moment du cataclysme, modifié la contexture de ce cadre.
Quoi qu’il en soit, dans cette partie méridionale de Gallia, on ne voyait plus aucun vestige d’une terre européenne. Partout, la nouvelle substance avait remplacé l’ancien sol. Plus rien de ces campagnes accidentées de la Provence, ni ces jardins d’orangers et de citronniers dont l’humus rougeâtre s’étageait sur des assises de pierres sèches, ni ces bois d’oliviers au feuillage glauque, ni les grandes allées de poivriers, de micocouliers, de mimosas, de palmiers et d’eucalyptus, ni ces buissons de géraniums géants, plaqués ça et là de semelles du pape et surmontés de longs jets d’aloès, ni les roches oxydées du littoral, ni les montagnes d’arrière-plan avec leur sombre rideau de conifères.
Là, rien du règne végétal, puisque la moins exigeante des plantes polaires, le lichen des neiges lui-même, n’eût pu végéter sur ce sol pierreux ! Rien du règne animal, puisqu’aucun oiseau, ni les puffins, ni les pétrels, ni les guillemets des régions arctiques n’auraient trouvé de quoi y vivre un seul jour !
C’était le règne minéral dans toute son horrible aridité.
Le capitaine Servadac était en proie à une émotion à laquelle son caractère insouciant, semblait-il, aurait dû le soustraire. Immobile sur le sommet d’un roc glacé, il contemplait, les yeux humides, le nouveau territoire qui se développait sous ses yeux. Il se refusait à croire que la France eût jamais été là !
« Non ! s’écria-t-il, non ! Nos relèvements nous ont trompés ! Nous ne sommes pas arrivés à ce parallèle qui traverse les Alpes maritimes ! C’est plus en arrière que s’étend le territoire dont nous recherchons la trace ! Une muraille est sortie des flots, soit ; mais au-delà, nous reverrons les terres européennes ! Comte Timascheff, venez, venez ! Franchissons ce territoire de glaces, et cherchons encore, cherchons toujours !… »
En parlant ainsi, Hector Servadac avait fait une vingtaine de pas en avant, afin de trouver quelque sentier praticable au milieu des lamelles hexagonales de la falaise.
Soudain, il s’arrêta.
Son pied venait de heurter sous la neige un morceau de pierre taillée. Par sa forme, par sa couleur, ce morceau ne semblait pas appartenir au nouveau sol.
Le capitaine Servadac le ramassa.
C’était un fragment de marbre jauni, sur lequel on pouvait encore lire quelques lettres gravées, entre autres celles-ci :
Vil…
« Villa ! » s’écria le capitaine Servadac, en laissant retomber le morceau de marbre, qui se brisa en mille fragments.
De cette villa, sans doute quelque somptueuse habitation bâtie presque à l’extrémité du cap d’Antibes, dans le plus beau site du monde, de ce magnifique cap, jeté comme un rameau verdoyant entre le golfe de Jouan et le golfe de Nice, de ce splendide panorama couronné par les Alpes maritimes, qui s’étendait des pittoresques montagnes de l’Esterel, en passant devant Eza, Monaco, Roquebrune, Menton et Vintimille, jusqu’à la pointe italienne de la Bordighère, que restait-il à présent ? Pas même ce morceau de marbre, qui venait d’être réduit en poussière !
Le capitaine Servadac ne pouvait plus douter que le cap d’Antibes n’eût disparu dans les entrailles de ce nouveau continent. Il restait abîmé dans ses réflexions.
Le comte Timascheff, s’approchant alors, lui dit gravement :
« Capitaine, connaissez-vous la devise de la famille Hope ?
– Non, monsieur le comte, répondit Hector Servadac.
– Eh bien, la voici : Orbe fracto, spes illœsa !
– Elle dit le contraire de la désespérante parole de Dante !
– Oui, capitaine, et maintenant elle devra être la nôtre ! »
Chapitre XVII
Qui pourrait sans inconvénient être très justement intitulé : du même aux mêmes
Il ne restait plus aux navigateurs de la Dobryna qu’à revenir à l’île Gourbi. Cet étroit domaine était, vraisemblablement, la seule portion de l’ancien sol qui pût recevoir et nourrir ceux que le nouvel astre emportait dans le monde solaire.
« Et, après tout, se dit le capitaine Servadac, c’est presque un morceau de la France ! »
Ce projet de retour à l’île Gourbi fut donc discuté, et il allait être adopté, lorsque le lieutenant Procope fit observer que le nouveau périmètre de la Méditerranée n’était pas encore entièrement reconnu.
« Il nous reste à l’explorer dans le nord, dit-il, depuis ce point où se projetait autrefois le cap d’Antibes jusqu’à l’entrée du détroit qui s’ouvre sur les eaux de Gibraltar, et, dans le sud, depuis le golfe de Gabès jusqu’à ce même détroit. Nous avons bien suivi, au sud, la limite que dessinait l’ancienne côte africaine, mais non celle qui forme la nouvelle. Qui sait si toute issue nous est fermée au midi, et si quelque fertile oasis du désert africain n’a pas échappé à la catastrophe ? En outre, l’Italie, la Sicile, l’archipel des îles Baléares, les grandes îles de la Méditerranée ont peut-être résisté, et il serait convenable d’y conduire la Dobryna .
– Tes observations sont justes, Procope, répondit le comte Timascheff, et il me paraît indispensable, en effet, de compléter le levé hydrographique de ce nouveau bassin.
– Je me range à votre idée, ajouta le capitaine Servadac. Toute la question est de savoir s’il faut actuellement compléter notre exploration avant de revenir à l’île Gourbi.
– Je pense, répondit le lieutenant Procope, que nous devons utiliser la Dobryna pendant qu’elle peut servir encore.
– Que veux-tu dire, Procope, demanda le comte Timascheff.
– Je veux dire que la température va toujours décroissant, que Gallia suit une courbe qui l’éloigne de plus en plus du soleil, et sera bientôt soumise à des froids excessifs. La mer se congèlera alors, et la navigation ne sera plus possible. Or, vous savez quelles sont les difficultés d’un voyage à travers les champs de glace. Ne vaut-il pas donc mieux continuer cette exploration pendant que les eaux sont libres encore ?
– Tu as raison, Procope, répondit le comte Timascheff. Cherchons ce qui reste de l’ancien continent, et, si quelque morceau de l’Europe a été épargné, si quelques malheureux ont survécu, auxquels nous puissions venir en aide, il importe de le savoir avant de rentrer au lieu d’hivernage. »
C’était un sentiment généreux qui inspirait le comte Timascheff, puisque, dans ces circonstances, il pensait surtout à ses semblables. Et qui sait ? Songer aux autres, n’était-ce pas songer à soi ? Aucune différence de race, aucune distinction de nationalité ne pouvaient plus exister entre ceux que Gallia entraînait à travers l’espace infini. Ils étaient les représentants d’un même peuple, ou plutôt d’une même famille, car on pouvait craindre qu’ils ne fussent rares, les survivants de l’ancienne terre ! Mais, enfin, s’il en existait encore, tous devaient se rallier, réunir leurs efforts pour le salut commun, et, si tout espoir était perdu de jamais revenir au globe terrestre, tenter de refaire à cet astre nouveau une humanité nouvelle.
Le 25 février, la goélette quitta cette petite crique où elle avait momentanément trouvé un refuge. En longeant le littoral du nord, elle marcha vers l’est à toute vapeur. Le froid commençait à être vif, surtout par une brise aiguë. Le thermomètre se tenait en moyenne à deux degrés au-dessous de zéro. Très heureusement, la mer ne se prend qu’à une température inférieure à celle de l’eau douce, et elle ne présenta aucun obstacle à la navigation de la Dobryna. Mais il fallait se hâter.
Les nuits étaient belles. Les nuages semblaient déjà ne se former que plus difficilement dans les couches progressivement refroidies de l’atmosphère. Les constellations brillaient au firmament avec une incomparable pureté. Si le lieutenant Procope, en qualité de marin, devait regretter que la lune eût à jamais disparu de l’horizon, un astronome, occupé à scruter les mystères du monde sidéral, se serait félicité, au contraire, de cette propice obscurité des nuits galliennes.
Mais si les explorateurs de la Dobryna étaient privés de la lune, ils en avaient, du moins, la monnaie. À cette époque, une véritable grêle d’étoiles filantes sillonna l’atmosphère, – étoiles bien autrement nombreuses que celles dont les observateurs terrestres peuvent dresser la classification en août et en novembre. Et si, à s’en rapporter à M. Olmsted, une moyenne de trente-quatre mille astéroïdes de cette espèce a paru sur l’horizon de Boston en 1833, on pouvait ici hardiment décupler ce nombre.
Gallia, en effet, traversait cet anneau qui est à peu près concentrique à l’orbite de la terre et extérieur à elle. Ces corpuscules météoriques semblaient prendre pour point de départ Algol, l’une des étoiles de la constellation de Persée, et ils s’enflammaient avec une intensité que leur extraordinaire vitesse rendait merveilleuse, en se frottant à l’atmosphère de Gallia. Un bouquet d’artifices, formé de millions de fusées, le chef-d’œuvre d’un Ruggieri, n’eût pas même été comparable aux magnificences de ce météore. Les roches de la côte, en reflétant ces corpuscules à leur surface métallique, semblaient pointillées de lumière, et la mer éblouissait les regards, comme si elle eût été frappée de grêlons incandescents.
Mais ce spectacle ne dura que vingt-quatre heures à peine, tant la vitesse de Gallia était grande à s’éloigner du soleil.
Le 26 février, la Dobryna fut arrêtée dans sa marche vers l’ouest par une longue projection du littoral qui l’obligea à descendre jusqu’à l’extrémité de l’ancienne Corse, dont il ne restait pas trace. Là, le détroit de Bonifacio faisait place à une vaste mer, absolument déserte. Mais, le 27, un îlot fut signalé dans l’est, à quelques milles sous le vent de la goélette, et sa situation permettait de croire, à moins que son origine ne fût récente, qu’il appartenait à la pointe septentrionale de la Sardaigne.
La Dobryna s’approcha de cet îlot. Le canot fut mis à la mer. Quelques instants après, le comte Timascheff et le capitaine Servadac débarquaient sur un plateau verdoyant, qui ne mesurait pas un hectare de superficie. Quelques buissons de myrtes et de lentisques, que dominaient trois ou quatre vieux oliviers, le coupaient çà et là. Il semblait qu’il fût abandonné de toute créature vivante.
Les explorateurs allaient donc le quitter, lorsque des bêlements frappèrent leur oreille, et, presque aussitôt, ils aperçurent une chèvre qui bondissait entre les roches.
C’était un unique échantillon de ces chèvres domestiques, si bien nommées « vaches du pauvre », une jeune femelle à pelage noirâtre, à cornes petites et régulièrement arquées, qui, loin de s’enfuir à l’approche des visiteurs, courut au-devant d’eux, et par ses bonds, par ses cris, sembla les inviter à l’accompagner.
« Cette chèvre n’est pas seule sur cet îlot ! s’écria Hector Servadac. Suivons-la ! »
Ce qui fut fait, et, quelques centaines de pas plus loin, le capitaine Servadac et le comte Timascheff arrivaient près d’une sorte de terrier, à demi recouvert par un bouquet de lentisques.
Là, une enfant de sept à huit ans, figure illuminée de grands yeux noirs, tête ombragée d’une longue chevelure brune, jolie comme un de ces charmants êtres dont Murillo a fait des anges dans ses Assomptions, et pas trop effrayée, regardait à travers les branches.
Lorsqu’elle eut considéré pendant quelques instants les deux explorateurs, dont l’aspect lui parut rassurant sans doute, la petite fille se leva, courut à eux, et leur tendant les mains, d’un geste plein d’une subite confiance :
« Vous n’êtes pas méchants ? leur dit-elle d’une voix douce comme cette langue italienne qu’elle parlait. Vous ne me ferez pas de mal ? Il ne faut pas que j’aie peur ?
– Non, répondit le comte en italien. Nous ne sommes et nous ne voulons être pour toi que des amis ! »
Puis, après avoir considéré un instant la gentille fillette.
« Comment t’appelles-tu, mignonne ? lui demanda-t-il.
– Nina.
– Nina, peux-tu nous dire où nous sommes ?
– À Madalena, répondit la petite fille. C’est là que j’étais, quand tout a changé, et tout d’un coup ! »
Madalena était une île située près de Caprera, au nord de la Sardaigne, maintenant disparue dans l’immense désastre.
Quelques demandes, suivies de quelques réponses faites très intelligemment, apprirent au comte Timascheff que la petite Nina était seule sur l’îlot, qu’elle était sans parents, qu’elle gardait un troupeau de chèvres pour le compte d’un rentier, qu’au moment de la catastrophe, tout s’était subitement englouti autour d’elle sauf ce bout de terre, qu’elle et Marzy, sa favorite, avaient seules été sauvées, qu’elle avait eu grand peur, mais que bientôt rassurée, après avoir remercié le bon Dieu parce que la terre ne remuait plus, elle s’était arrangée pour vivre avec Marzy. Elle possédait heureusement quelques vivres qui avaient duré jusqu’alors, et elle avait toujours espéré qu’un bateau viendrait la reprendre. Puisque le bateau était là, elle ne demandait pas mieux de s’en aller, à la condition qu’on emmenât sa chèvre avec elle, et qu’on la ramenât à la ferme quand on le pourrait.
« Voilà un gentil habitant de plus sur Gallia », dit le capitaine Servadac après avoir embrassé la petite fille. Une demi-heure plus tard, Nina et Marzy étaient installées à bord de la goélette, où chacun, on le pense bien, leur fit le meilleur accueil. C’était d’un heureux augure la rencontre de cette enfant ! Les matelots russes, gens religieux, voulurent la considérer comme une sorte de bon ange, et plus d’un regarda, vraiment, si elle n’avait pas des ailes. Ils l’appelaient entre eux, dès le premier jour, « la petite Madone ».
La Dobryna, en quelques heures, eut perdu de vue Madalena et retrouva, en redescendant vers le sud-est, le nouveau littoral, qui avait été reporté à cinquante lieues en avant de l’ancien rivage italien. Un autre continent s’était donc substitué à la Péninsule, dont il ne restait plus aucun vestige. Toutefois, sur le parallèle de Rome, se creusait un vaste golfe, qui s’enfonçait bien au-delà de l’emplacement qu’aurait dû occuper la Ville éternelle. Puis, la nouvelle côte ne revenait mordre sur l’ancienne mer qu’à la hauteur des Calabres, pour se prolonger jusqu’à l’extrémité même de la botte. Mais plus de phare de Messine, plus de Sicile, pas même le sommet émergé de cet énorme Etna, qui se dressait, cependant, à une hauteur de trois mille trois cent cinquante mètres au-dessus du niveau de la mer.
Et soixante lieues plus au sud, la Dobryna revoyait l’entrée du détroit qui s’était si providentiellement offert à elle pendant la tempête, et dont l’amorce orientale s’ouvrait sur la mer de Gibraltar.
De ce point jusqu’au détroit de Gabès, le nouveau périmètre de la Méditerranée avait été déjà reconnu par les explorateurs. Le lieutenant Procope, justement avare de son temps, coupa donc en droite ligne jusqu’au parallèle, où il retrouva les rivages non explorés du continent.
On était au 3 mars.
De ce point, la côte, délimitant la Tunisie, traversait l’ancienne province de Constantine à la hauteur de l’oasis du Ziban. Puis, par un angle brusque, elle redescendait jusqu’au trente-deuxième parallèle et se relevait, en formant un golfe irrégulier, étrangement encadré dans l’énorme concrétion minérale. Alors, sur une longueur de cent cinquante lieues environ, elle courait à travers l’ancien Sahara algérien, de manière à se rapprocher, au sud de l’île Gourbi, par une pointe qui aurait pu servir de frontière naturelle au Maroc, si le Maroc eût encore existé.
Il fallut donc remonter au nord jusqu’à l’extrémité de cette pointe, afin de la doubler. Mais, en la doublant, les explorateurs furent témoins d’un phénomène volcanique, dont ils constatèrent, pour la première fois, l’apparition à la surface de Gallia.
Un mont ignivome terminait cette pointe et s’élevait à une hauteur de trois mille pieds. Il n’était pas éteint, car son cratère se couronnait encore de fumées, sinon de flammes.
« Gallia a donc un foyer intérieur ! s’écria le capitaine Servadac, lorsque le volcan eut été signalé par la vigie de la Dobryna.
– Pourquoi non, capitaine ? répondit le comte Timascheff. Puisque Gallia n’est qu’un fragment du globe terrestre, notre astéroïde ne peut-il avoir emporté avec lui une partie du feu central, comme il a emporté une partie de l’atmosphère, des mers et des continents ?
– Une bien faible partie ! répondit le capitaine Servadac, mais suffisante, après tout, pour sa population actuelle !
– À propos, capitaine, demanda le comte Timascheff, puisque notre voyage de circumnavigation doit nous ramener sur les atterrages de Gibraltar, croyez-vous qu’il y ait lieu de faire connaître aux Anglais le nouvel état de choses et les conséquences qu’il comporte ?
– À quoi bon ? répondit le capitaine Servadac. Ces Anglais savent où est située l’île Gourbi, et, s’il leur plaît, ils peuvent y venir. Ce ne sont point des malheureux, abandonnés sans ressource. Au contraire ! Ils ont de quoi se suffire, et pour longtemps. Cent vingt lieues, au plus, séparent leur îlot de notre île, et, une fois la mer prise par le froid, ils peuvent nous rejoindre quand ils le voudront. Nous n’avons pas eu précisément à nous louer de leur accueil, et, s’ils viennent ici, nous nous vengerons…
– Sans doute, en les accueillant mieux qu’ils ne l’ont fait ? demanda le comte Timascheff.
– Oui, monsieur le comte, répondit le capitaine Servadac, car, en vérité, il n’y a plus ici ni Français, ni Anglais, ni Russes…
– Oh ! fit le comte Timascheff en secouant la tête, un Anglais est Anglais partout et toujours !
– Eh ! répliqua Hector Servadac, c’est à la fois leur qualité et leur défaut ! »
Ainsi fut arrêtée la conduite à tenir à l’égard de la petite garnison de Gibraltar. D’ailleurs, lors même qu’on eût résolu de renouer quelques relations avec ces Anglais, cela n’eût pas été possible en ce moment, car la Dobryna n’aurait pu, sans risques, revenir en vue de leur îlot.
En effet, la température s’abaissait d’une manière continue. Le lieutenant Procope ne constatait pas sans inquiétude que la mer ne pouvait tarder à se prendre autour de la goélette. En outre, les soutes, épuisées par une marche à toute vapeur, se vidaient peu à peu, et le charbon devait bientôt manquer, si on ne le ménageait pas. Ces deux raisons, très graves à coup sûr, furent développées par le lieutenant, et, après discussion, il fut convenu que le voyage de circumnavigation serait interrompu à la hauteur de la pointe volcanique. La côte, au-delà, redescendait vers le sud et se perdait dans une mer sans limites. Engager la Dobryna, prête à manquer de combustible, à travers un océan prêt à se congeler, c’eût été une imprudence dont les conséquences pouvaient être extrêmement funestes. Il était probable, d’ailleurs, que sur toute cette portion de Gallia, autrefois occupée par le désert africain, on ne trouverait pas un autre sol que celui qui avait été observé jusqu’alors, – sol auquel l’eau et l’humus faisaient absolument défaut, et qu’aucun travail ne pourrait jamais fertiliser. Donc, nul inconvénient à suspendre l’exploration, quitte à la reprendre en des temps plus favorables.
Ainsi, ce jour-là, 5 mars, il fut décidé que la Dobryna ne remettrait pas le cap au nord et qu’elle retournerait à la terre du Gourbi, dont vingt lieues au plus la séparaient.
« Mon pauvre Ben-Zouf ! du le capitaine Servadac, qui avait bien souvent songé à son compagnon pendant ce voyage de cinq semaines. Pourvu qu’il ne lui soit rien arrivé de fâcheux ! »
Cette courte traversée de la pointe volcanique à l’île Gourbi ne devait être signalée que par un incident. Ce fut la rencontre d’une seconde notice du mystérieux savant, qui, ayant évidemment pu calculer les éléments de Gallia, la suivait, jour par jour, sur sa nouvelle orbite.
Un objet flottant fut signalé au lever du soleil. On le repêcha. Cette fois, c’était un petit baril de conserves qui remplaçait la bouteille traditionnelle, et, cette fois encore, un épais tampon de cire à cacheter, portant les même initiales que l’étui déjà repêché dans ces conditions, en maintenait la bonde hermétiquement fermée.
« Du même aux mêmes ! » dit le capitaine Servadac.
Le baril fut ouvert avec précaution, et on y trouva le document dont la teneur suit :
« Gallia ( ?)
« Ab sole, au 1er mars, dist. : 78 000 000 l. !
« Chemin parcouru de fév. à mars : 59 000 000 l. !
« Va bene ! All right ! Nil desperandum !
« Enchanté ! »
« Et ni adresse, ni signature ! s’écria le capitaine Servadac. On serait tenté de croire à une série de mystifications !
– Ce serait alors une mystification tirée à un grand nombre d’exemplaires ! répondit le comte Timascheff, car, puisque deux fois nous avons recueilli ce singulier document, c’est que son auteur a dû semer ses barils et ses étuis sur la mer !
– Mais quel est ce savant écervelé, qui ne songe même pas à donner son adresse !
– Son adresse ? C’est le fond du puits de l’astrologue ! répondit le comte Timascheff, en faisant allusion à la fable de La Fontaine.
– C’est bien possible ; mais où est le puits ? »
Cette demande du capitaine Servadac devait encore rester sans réponse. L’auteur du document résidait-il sur quelque îlot épargné, dont la Dobryna n’avait pas eu connaissance ? Était-il à bord d’un navire courant cette nouvelle Méditerranée, ainsi que l’avait fait la goélette ? on ne pouvait le dire.
« En tout cas, fît observer le lieutenant Procope, si le document est sérieux – et les chiffres qu’il porte tendent à le prouver –, il donne lieu à deux observations importantes. La première, c’est que la vitesse de translation de Gallia a diminué de vingt-trois millions de lieues, puisque le chemin parcouru par elle de janvier à février, et qui était de quatre-vingt-deux millions de lieues, n’est plus, de février à mars, que de cinquante-neuf millions. La seconde, c’est que la distance de Gallia au soleil, qui était de cinquante-neuf millions de lieues seulement au 15 février, est au 1er mars de soixante-dix-huit millions, soit un accroissement de dix-neuf millions de lieues. Donc, à mesure que Gallia s’éloigne du soleil, sa vitesse de translation sur son orbite diminue, ce qui est parfaitement conforme aux lois de la mécanique céleste.
– Et tu en conclus, Procope ? demanda le comte Timascheff.
– Que nous suivons, comme je l’ai déjà remarqué, une orbite elliptique, mais dont il nous est impossible de calculer l’excentricité.
– J’observe, en outre, reprit le comte Timascheff, que l’auteur du document se sert encore de ce nom de Gallia. Je propose donc de l’adopter définitivement pour le nouvel astre qui nous entraîne, et d’appeler cette mer « la mer Gallienne ».
– Oui, répondit le lieutenant Procope, et je l’inscrirai sous ce nom, lorsque j’établirai notre nouvelle carte.
– Quant à moi, ajouta le capitaine Servadac, je ferai une troisième remarque : c’est que ce brave homme de savant est de plus en plus enchanté de la situation, et, quoi qu’il arrive, je répéterai avec lui partout et toujours : Nil desperandum ! »
Quelques heures plus tard, la vigie de la Dobryna avait enfin connaissance de l’île Gourbi.
Chapitre XVIII
Qui traite de l’accueil fait au gouverneur général de l’île Gourbi et des événements qui se sont accomplis pendant son absence
La goélette avait quitté l’île le 31 janvier, et elle y revenait le 5 mars, après trente-cinq jours de traversée, – l’année terrestre ayant été bissextile. À ces trente-cinq jours répondaient soixante-dix jours galliens, puisque le soleil avait passé soixante-dix fois au méridien de l’île.
Hector Servadac éprouva quelque émotion en s’approchant de cet unique fragment du sol algérien qui eût échappé au désastre. Plusieurs fois, pendant cette longue absence, il s’était demandé s’il le retrouverait à cette place, et avec lui son fidèle Ben-Zouf. Ce doute, il pouvait être fondé à l’éprouver au milieu de tant de phénomènes cosmiques qui avaient si profondément modifié la surface de Gallia.
Mais, les craintes de l’officier d’état-major ne se réalisèrent pas. L’île Gourbi était là, et même – détail assez bizarre –, avant d’atteindre le port du Chéliff, Hector Servadac put constater qu’un nuage d’un aspect tout particulier se développait à une centaine de pieds au-dessus du sol de son domaine. Lorsque la goélette ne fut plus qu’à quelques encablures de la côte, ce nuage apparut comme une masse épaisse qui s’abaissait et s’élevait automatiquement dans l’atmosphère. Le capitaine Servadac reconnut alors que ce n’était point là une agglomération de vapeurs réduites à l’état vésiculaire, mais une agglomération d’oiseaux, pressés dans l’air comme les bandes de harengs le sont dans l’eau. De cette énorme nuée s’échappaient des cris assourdissants, auxquels répondaient, d’ailleurs, de fréquentes détonations.
La Dobryna signala son arrivée par un coup de canon et vint mouiller dans le petit port du Chéliff.
À ce moment, un homme, le fusil à la main, accourut, et d’un bond il s’élança sur les premières roches.
C’était Ben-Zouf.
Ben-Zouf resta d’abord immobile, les yeux fixés à quinze pas, « autant que la conformation de l’homme le permet », comme disent les sergents instructeurs, et avec toutes les marques extérieures de respect. Mais le brave soldat ne put y tenir, et, se précipitant à la rencontre de son capitaine qui venait de débarquer, il lui baisa les mains avec attendrissement.
Toutefois, au lieu de ces phrases si naturelles :
« Quel bonheur de vous revoir ! Que j’ai été inquiet ! Que votre absence a été longue ! »
Ben-Zouf s’écriait :
« Ah ! les gueux ! les bandits ! Ah ! vous faites bien d’arriver, mon capitaine ! Les voleurs ! les pirates ! les misérables bédouins !
– Et à qui en as-tu, Ben-Zouf ? demanda Hector Servadac, auquel ces exclamations bizarres donnèrent à penser qu’une bande d’Arabes pillards avait envahi son domaine.
– Eh ! c’est à ces satanés oiseaux que j’en ai ! s’écria Ben-Zouf. Voilà un mois que j’use ma poudre contre eux ! Mais plus j’en tue, plus il en revient ! Ah ! si on les laissait faire, ces Kabyles à becs et à plumes, nous n’aurions bientôt plus un grain de blé sur l’île ! »
Le comte Timascheff et le lieutenant Procope, qui venaient de rejoindre le capitaine Servadac, purent constater avec lui que Ben-Zouf n’exagérait rien. Les récoltes, rapidement mûries par les grandes chaleurs de janvier, au moment où Gallia passait à son périhélie, étaient maintenant exposées aux déprédations de quelques milliers d’oiseaux. Ce qui restait de la moisson était fort menacé par ces voraces volatiles. Il convient de dire, en effet, « ce qui restait de la moisson », car Ben-Zouf n’avait pas chômé pendant le voyage de la Dobryna, et l’on voyait de nombreuses meules d’épis qui s’élevaient sur la plaine en partie dépouillée.
Quant à ces bandes d’oiseaux, c’étaient tous ceux que Gallia avait emportés avec elle, lorsqu’elle se sépara du globe terrestre. Et il était naturel qu’ils eussent cherché refuge à l’île Gourbi, puisque là seulement ils trouvaient des champs, des prairies, de l’eau douce, – preuve qu’aucune autre partie de l’astéroïde ne pouvait assurer leur nourriture. Mais aussi, c’était aux dépens des habitants de l’île qu’ils prétendaient vivre, – prétention à laquelle il faudrait s’opposer par tous les moyens possibles.
« Nous aviserons, dit Hector Servadac.
– Ah çà ! mon capitaine, demanda Ben-Zouf, et les camarades d’Afrique, que sont-ils devenus ?
– Les camarades d’Afrique sont toujours en Afrique, répondit Hector Servadac.
– Les braves camarades !
– Seulement l’Afrique n’est plus là ! ajouta le capitaine Servadac.
– Plus d’Afrique ! Mais la France ?
– La France ! Elle est bien loin de nous, Ben-Zouf !
– Et Montmartre ? »
C’était le cri du cœur ! En quelques mots, le capitaine Servadac expliqua à son ordonnance ce qui était arrivé, et comme quoi Montmartre, et avec Montmartre Paris, et avec Paris la France, et avec la France l’Europe, et avec l’Europe le globe terrestre étaient à plus de quatre-vingts millions de lieues de l’île Gourbi. Conséquemment, l’espérance d’y jamais retourner devait être à peu près abandonnée.
« Allons donc ! s’écria l’ordonnance. Plus souvent ! Laurent, dit Ben-Zouf, de Montmartre, ne pas revoir Montmartre ! Des bêtises, mon capitaine, sauf votre respect, des bêtises ! »
Et Ben-Zouf secouait la tête en homme qu’il serait absolument impossible de convaincre.
« Bien, mon brave, répondit le capitaine Servadac. Espère tant que tu voudras ! Il ne faut jamais désespérer. C’est même la devise de notre correspondant anonyme. Mais commençons par nous installer sur l’île Gourbi, comme si nous devions y demeurer toujours. »
Tout en causant, Hector Servadac, précédant le comte Timascheff et le lieutenant Procope, s’était rendu au gourbi, relevé maintenant par les soins de Ben-Zouf. Le poste était aussi en bon état, et Galette et Zéphyr y étaient pourvus de bonne litière. Là, dans cette modeste cabane, Hector Servadac offrit l’hospitalité à ses hôtes, ainsi qu’à la petite Nina, que sa chèvre avait accompagnée. Pendant la route, l’ordonnance avait cru pouvoir disposer, en faveur de Nina et de Marzy, de deux gros baisers que ces êtres caressants lui avaient rendus de bon cœur.
Puis, un conseil fut tenu dans le gourbi, sur ce qu’il convenait de faire tout d’abord.
La question la plus grave était celle du logement pour l’avenir. Comment s’installerait-on sur l’île, de manière à braver les froids terribles que Gallia allait subir dans les espaces interplanétaires, et pendant un temps dont on ne pouvait calculer la durée ? Ce temps, en effet, dépendait de l’excentricité qu’avait l’orbite parcourue par l’astéroïde, et bien des années s’écouleraient peut-être avant qu’il revînt vers le soleil. Or, le combustible n’était pas abondant. Pas de charbon, peu d’arbres, et la perspective que rien ne pousserait pendant toute la période de ces froids redoutables. Que faire ? Comment parer à ces redoutables éventualités ? Il y avait donc nécessité d’imaginer quelque expédient, et cela dans le plus bref délai.
L’alimentation de la colonie n’offrait pas de difficultés immédiates. Pour la boisson, il n’y avait certainement rien à craindre. Quelques ruisseaux coulaient à travers les plaines, et l’eau emplissait les citernes. De plus, avant peu, le froid aurait déterminé la congélation de la mer Gallienne, et la glace fournirait un liquide potable en abondance, car bientôt elle ne renfermerait plus une seule molécule de sel.
Quant à la nourriture proprement dite, c’est-à-dire à la substance azotée nécessaire à l’alimentation de l’homme, elle était assurée pour longtemps. D’une part, les céréales, prêtes à êtres engrangées, de l’autre, les troupeaux disséminés sur l’île formeraient une très abondante réserve. Évidemment, pendant la période des froids, le sol resterait improductif, et la récolte des fourrages, destinés à la nourriture des animaux domestiques, ne pourrait pas être renouvelée. Il y aurait donc quelques mesures à prendre, et si l’on arrivait à calculer la durée du mouvement de translation de Gallia autour du centre attractif, il conviendrait de limiter proportionnellement à la période hivernale le nombre des animaux à conserver.
Quant à la population actuelle de Gallia, elle comprenait, sans compter les treize Anglais de Gibraltar, dont il ne fallait pas s’inquiéter pour le moment, huit Russes, deux Français et une petite Italienne. C’étaient donc onze habitants que devait nourrir l’île Gourbi.
Mais, après que ce chiffre eut été établi par Hector Servadac, ne voilà-t-il pas Ben-Zouf de s’écrier :
« Ah ! mais non, mon capitaine. Fâché de vous contredire ! Cela ne fait pas le compte !
– Que veux-tu dire ?
– Je veux dire que nous sommes vingt-deux habitants !
– Sur l’île ?
– Sur l’île.
– T’expliqueras-tu, Ben-Zouf ?
– C’est que je n’ai pas encore eu le temps de vous prévenir, mon capitaine. Pendant votre absence, il nous est venu du monde à dîner !
– Du monde à dîner !
– Oui, oui… Mais, au fait, venez, ajouta Ben-Zouf, vous aussi, messieurs les Russes. Vous voyez que les travaux de la moisson sont très avancés, et ce ne sont pas mes deux bras qui auraient pu suffire à tant d’ouvrage !
– En effet, dit le lieutenant Procope.
– Venez donc. Ce n’est pas loin. Deux kilomètres seulement. Prenons nos fusils !
– Pour nous défendre ?… demanda le capitaine Servadac.
– Non contre les hommes, répondit Ben-Zouf, mais contre ces maudits oiseaux ! »
Et, fort intrigués, le capitaine Servadac, le comte Timascheff et le lieutenant Procope suivirent l’ordonnance, laissant la petite Nina et sa chèvre au gourbi.
Chemin faisant, le capitaine Servadac et ses compagnons dirigèrent une mousquetade nourrie contre le nuage d’oiseaux qui se développait au-dessus de leur tête. Il y avait là plusieurs milliers de canards sauvages, de pilets, de bécassines, d’alouettes, de corbeaux, d’hirondelles, etc., auxquels se mêlaient des oiseaux de mer, macreuses, mauves et goélands, et du gibier de plume, cailles, perdrix, bécasses, etc. Chaque coup de fusil portait, et les volatiles tombaient par douzaines. Ce n’était pas une chasse, mais une extermination de bandes pillardes.
Au lieu de suivre le rivage nord de l’île, Ben-Zouf coupa obliquement à travers la plaine. Après dix minutes de marche, grâce à leur légèreté spécifique, le capitaine Servadac et ses compagnons avaient franchi les deux kilomètres annoncés par Ben-Zouf. Ils étaient arrivés alors près d’un vaste fourré de sycomores et d’eucalyptus, pittoresquement massés au pied d’un monticule. Là, tous s’arrêtèrent.
« Ah ! les gueux ! les bandits ! les bédouins ! s’écria Ben-Zouf, en frappant le sol du pied.
– Parles-tu encore des oiseaux ? demanda le capitaine Servadac.
– Eh ! non, mon capitaine ! Je parle de ces satanés fainéants qui ont encore abandonné leur travail ! Voyez plutôt ! »
Et Ben-Zouf montrait divers outils, tels que faucilles, râteaux, faux, épars sur le sol.
« Ah çà, maître Ben-Zouf, me diras-tu enfin de quoi ou de qui il s’agit ? demanda le capitaine Servadac, que l’impatience commençait à gagner.
– Chut, mon capitaine, écoutez, écoutez ! répondit Ben-Zouf. Je ne me trompais pas. »
Et, en prêtant l’oreille, Hector Servadac et ses deux compagnons purent entendre une voix qui chantait, une guitare qui grinçait, des castagnettes qui cliquetaient avec une mesure parfaite.
« Des Espagnols ! s’écria le capitaine Servadac.
– Et qui voulez-vous que ce soit ? répondit Ben-Zouf. Ces gens-là « castagneteraient » à la bouche d’un canon !
– Mais comment se fait-il ?…
– Écoutez encore ! C’est maintenant le tour du vieux. Une autre voix, qui ne chantait pas, celle-là, faisait entendre les plus violentes objurgations. Le capitaine Servadac, en sa qualité de Gascon, comprenait suffisamment l’espagnol, et pendant que la chanson disait :
Tu sandunga y cigarro,
Y una cana de Jerez,
Mi jamelgo y un trabuco,
Que mas gloria puede haver[5]
l’autre voix, agrémentée d’un accent dur, répétait :
« Mon argent ! mon argent ! Me paierez-vous enfin ce que vous me devez, misérables majos ! »
Et la chanson de continuer :
Para Alcarrazas, Chiclana,
Para trigo, Trebujena,
Y para ninas bonitas,
San Lucar de Barrameda[6].
« Oui, vous me paierez mon dû, coquins ! reprit la voix au milieu du cliquetis des castagnettes, vous me le paierez, au nom du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ! au nom de Jésus-Christ et de Mahomet lui-même !
– Eh ! de par le diable, c’est un juif ! s’écria le capitaine Servadac.
– Un juif, ça ne serait rien, répondit Ben-Zouf ; j’en ai connu qui ne boudaient pas quand il s’agissait de bien faire ; mais celui-là, c’est un juif allemand, et du plus vilain côté de l’Allemagne : c’est un renégat de tous les pays et de toutes les religions. »
Mais, au moment où les deux Français et les deux Russes allaient pénétrer dans le fourré, un curieux spectacle les arrêta sur la lisière. Les Espagnols venaient de commencer un véritable fandango national. Or, en raison de ce qu’ils étaient diminués de poids, comme tous les objets placés à la surface de Gallia, ils montaient dans l’air à une hauteur de trente à quarante pieds. Rien de plus comique, en vérité, que des danseurs apparaissant ainsi au-dessus des arbres. Ils étaient là quatre musculeux majos, qui enlevaient avec eux un vieil homme, entraîné malgré lui à ces hauteurs anormales. On le voyait paraître et disparaître, comme il arriva de Sancho Pança lorsqu’il fut si gaillardement berné par les joyeux drapiers de Ségovie.
Hector Servadac, le comte Timascheff, Procope et Ben-Zouf s’enfoncèrent alors à travers le fourré et atteignirent une petite clairière. Là, un joueur de guitare et un joueur de castagnettes, mollement étendus, se tordaient de rire en excitant les danseurs.
À la vue du capitaine Servadac et de ses compagnons, les instrumentistes s’arrêtèrent soudain, et les danseurs, ramenant leur victime, retombèrent doucement sur le sol.
Mais aussitôt le renégat, époumoné, hors de lui, se précipita vers l’officier d’état-major, et, s’exprimant en français, cette fois, quoique avec un fort accent tudesque :
« Ah ! monsieur le gouverneur général ! s’écria-t-il, les coquins veulent me voler mon bien ! Mais, au nom de l’Éternel, vous me ferez rendre justice ! »
Cependant, le capitaine Servadac regardait Ben-Zouf, comme pour lui demander ce que signifiaient cette qualification honorifique dont on le gratifiait, et l’ordonnance, d’un mouvement de tête, semblait dire :
« Eh ! oui, mon capitaine, c’est bien vous qui êtes le gouverneur général ! J’ai arrangé cela ! »
Le capitaine Servadac fit alors signe au renégat de se taire, et celui-ci, courbant humblement la tête, croisa ses bras sur sa poitrine.
On put alors l’examiner à l’aise.
C’était un homme de cinquante ans qui paraissait en avoir soixante. Petit, malingre, les yeux vifs mais faux, le nez busqué, la barbiche jaunâtre, la chevelure inculte, les pieds grands, les mains longues et crochues, il offrait ce type si connu du juif allemand, reconnaissable entre tous. C’était l’usurier souple d’échine, plat de cœur, rogneur d’écus et tondeur d’œufs. L’argent devait attirer un pareil être comme l’aimant attire le fer, et, si ce Schylock fût parvenu à se faire payer de son débiteur, il en eût certainement revendu la chair au détail. D’ailleurs, quoiqu’il fût juif d’origine, il se faisait mahométan dans les provinces mahométanes, lorsque son profit l’exigeait, chrétien au besoin en face d’un catholique, et il se fût fait païen pour gagner davantage.
Ce juif se nommait Isac Hakhabut, et il était de Cologne, c’est-à-dire Prussien d’abord, Allemand ensuite. Seulement, ainsi qu’il l’apprit au capitaine Servadac, il voyageait pour son commerce pendant la plus grande partie de l’année. Son vrai métier, c’était celui de marchand caboteur de la Méditerranée. Son magasin – une tartane de deux cents tonneaux, véritable épicerie flottante – transportait sur le littoral mille articles variés, depuis les allumettes chimiques jusqu’aux enluminures de Francfort et d’Épinal.
Isac Hakhabut, en effet, n’avait pas d’autre domicile que sa tartane la Hansa. Ne possédant ni femme ni enfants, il vivait à bord. Un patron et trois hommes d’équipage suffisaient à la manœuvre de ce léger bâtiment qui faisait le petit cabotage sur les côtes d’Algérie, de Tunisie, d’Égypte, de Turquie, de Grèce, et dans toutes les Échelles du Levant. Là, Isac Hakhabut, toujours bien approvisionné de café, de sucre, de riz, de tabac, d’étoffes, de poudre, etc., vendait, échangeait, brocantait, et, en fin de compte, gagnait beaucoup d’argent.
La Hansa se trouvait précisément à Ceuta, à l’extrémité de la pointe marocaine, lorsque se produisit la catastrophe. Le patron et ses trois hommes, qui n’étaient pas à leur bord dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, avaient disparu en même temps que tant d’autres de leurs semblables. Mais on se souvient que les dernières roches de Ceuta, faisant face à Gibraltar, avaient été épargnées – si ce mot peut être employé en cette circonstance –, et, avec elles, une dizaine d’Espagnols qui ne soupçonnaient en aucune façon ce qui venait de se passer.
Ces Espagnols, majos andalous, insouciants par nature, fainéants par goût, aussi prompts à jouer de la navaja que de la guitare, cultivateurs de profession, avaient pour chef un certain Negrete, qui était le plus instruit de la bande, uniquement parce qu’il avait un peu plus couru le monde. Lorsqu’ils se virent seuls et abandonnés sur les roches de Ceuta, leur embarras fut grand. La Hansa était bien là, avec son propriétaire, et ils n’étaient pas hommes à se gêner d’en prendre possession pour se rapatrier, mais il n’y avait pas un marin parmi eux. Cependant, ils ne pouvaient demeurer éternellement sur ce roc, et, lorsque leurs provisions furent épuisées, ils obligèrent Hakhabut à les recevoir à son bord.
Sur ces entrefaites, Negrete reçut la visite des deux officiers anglais de Gibraltar, – visite dont il a été fait mention. Ce qui fut dit entre les Anglais et les Espagnols, Isac l’ignorait. Quoi qu’il en soit, ce fut à la suite de cette visite que Negrete obligea Hakhabut de mettre à la voile, pour le transporter, lui et les siens, au point le plus rapproché de la côte marocaine. – Isac, forcé d’obéir, mais habitué à faire argent de tout, stipula que les Espagnols lui paieraient leur passage, à quoi ceux-ci consentirent d’autant plus volontiers qu’ils étaient bien décidés à ne pas débourser un réal.
La Hansa partit le 3 février. Avec ces vents régnants de l’ouest, la manœuvre de la tartane était facile. Elle consistait uniquement à se laisser aller vent arrière. Les marins improvisés n’eurent donc qu’à hisser les voiles pour marcher, sans le savoir, vers l’unique point du globe terrestre qui pût leur offrir refuge.
Et voilà comment Ben-Zouf, un beau matin, vit poindre à l’horizon un navire qui ne ressemblait pas à la Dobryna et que le vent vint tout tranquillement pousser au port du Chéliff, sur l’ancienne rive droite du fleuve.
Ce fut Ben-Zouf qui acheva de raconter l’histoire d’Isac, et il ajouta que la cargaison de la Hansa, très complète alors, serait fort utile aux habitants de l’île. Sans doute on s’entendrait difficilement avec Isac Hakhabut, mais, les circonstances étant données, il n’y aurait évidemment aucune indélicatesse à réquisitionner ses marchandises pour le bien commun, puisqu’il ne pourrait plus les vendre.
« Quant aux difficultés qui existaient alors entre le propriétaire de la Hansa et ses passagers, ajouta Ben-Zouf, il avait été convenu qu’elles seraient réglées à l’amiable par Son Excellence le gouverneur général, « alors en tournée d’inspection ».
Hector Servadac ne put s’empêcher de sourire aux explications données par Ben-Zouf. Puis, il promit à Isac Hakhabut que justice lui serait rendue, – ce qui mit un terme à l’interminable émission des « Dieu d’Israël, d’Abraham et de Jacob ».
« Mais, dit le comte Timascheff, lorsque Isac se fut retiré, comment pourront-ils payer, ces gens-là ?
– Oh ! ils ont de l’argent, répondit Ben-Zouf.
– Des Espagnols ? dit le comte Timascheff. C’est invraisemblable.
– Ils en ont, reprit Ben-Zouf, je l’ai vu de mes yeux, et même c’est de l’argent anglais !
– Ah ! fit le capitaine Servadac, qui se rappela la visite des officiers anglais à Ceuta. Enfin, n’importe. Nous réglerons cette affaire-là plus tard. – Savez-vous, comte Timascheff, que Gallia possède maintenant plusieurs échantillons des populations de notre vieille Europe !
– En effet, capitaine, répondit le comte Timascheff, il y a, sur ce fragment de notre ancien globe, des nationaux de France, de Russie, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre, d’Allemagne. Quant à celle-ci, il faut convenir qu’elle est assez mal représentée par ce renégat !
– Ne nous montrons pas trop difficiles ! » répondit le capitaine Servadac.
Chapitre XIX
Dans lequel le capitaine Servadac est reconnu gouverneur général de Gallia à l’unanimité des voix, y compris la sienne
Les Espagnols venus à bord de la Hansa étaient au nombre de dix, en comptant un jeune garçon de douze ans, nommé Pablo, sauvé avec eux. Ils firent un respectueux accueil à celui que Ben-Zouf leur avait annoncé comme le gouverneur général de la province, et, après son départ de la clairière, ils reprirent leurs travaux.
Pendant ce temps, le capitaine Servadac et ses compagnons, suivis à distance respectueuse par Isac Hakhabut, se dirigeaient vers la partie du littoral à laquelle avait atterri la Hansa.
La situation était bien connue désormais. De l’ancienne terre, il ne restait que l’île Gourbi, plus quatre îlots : Gibraltar, occupé par les Anglais, Ceuta, abandonné par les Espagnols, Madalena, où la petite Italienne avait été recueillie, et le tombeau de saint Louis, sur la rive tunisienne. Autour de ces points respectés, s’étendait la mer Gallienne, comprenant environ la moitié de l’ancienne Méditerranée, et à laquelle des falaises rocheuses, de substance et d’origine inconnues, faisaient un cadre infranchissable.
Deux de ces points seulement étaient habités, le rocher de Gibraltar, qu’occupaient treize Anglais, approvisionnés pour de longues années encore, et l’île Gourbi, comptant vingt-deux habitants, qu’elle devait nourrir de ses seules productions. Peut-être existait-il, en outre, sur quelque îlot ignoré, un dernier survivant de l’ancienne terre, le mystérieux auteur des notices recueillies pendant le voyage de la Dobryna . C’était donc une population de trente-six âmes que possédait le nouvel astéroïde.
En admettant que tout ce petit monde fût un jour réuni sur l’île Gourbi, cette île, avec ses trois cent cinquante hectares de bon sol, actuellement cultivés, bien aménagés, bien ensemencés, pouvait amplement lui suffire. Toute la question se réduisait à savoir vers quelle époque ledit sol redeviendrait productif, en d’autres termes, après quel laps de temps Gallia, délivrée des froids de l’espace sidéral, recouvrerait, en se rapprochant du soleil, sa puissance végétative.
Deux problèmes s’offraient donc à l’esprit des Galliens : 1° Leur astre suivait-il une courbe qui dût les ramener un jour vers le centre de lumière, c’est-à-dire une courbe elliptique ? 2° Si telle était cette courbe, quelle était sa valeur, c’est-à-dire dans quel temps Gallia, ayant franchi son point aphélie, reviendrait-elle vers le soleil ?
Malheureusement, dans les circonstances actuelles, les Galliens, dépourvus de tous moyens d’observation, ne pouvaient, en aucune façon, résoudre ces problèmes.
Il fallait donc compter seulement sur les ressources présentement acquises, savoir : les provisions de la Dobryna, sucre, vin, eau-de-vie, conserves, etc., qui pouvaient durer deux mois, et dont le comte Timascheff faisait abandon au profit de tous, l’importante cargaison de la Hansa, qu’Isac Hakhabut serait forcé, tôt ou tard, soit de bonne, soit de mauvaise grâce, de livrer à la consommation générale, et enfin les produits végétaux et animaux de l’île, qui, convenablement ménagés, assureraient à la population sa nourriture pendant de longues années.
Le capitaine Servadac, le comte Timascheff, le lieutenant Procope et Ben-Zouf causaient naturellement de ces importantes choses en se dirigeant vers la mer. Et, tout d’abord, le comte Timascheff, s’adressant à l’officier d’état-major, lui dit :
« Capitaine, vous avez été présenté à ces braves gens comme gouverneur de l’île, et je pense que vous devez conserver cette situation. Vous êtes Français, nous sommes ici sur ce qui reste d’une colonie française, et, puisqu’à toute réunion d’hommes il faut un chef, moi et les miens, nous vous reconnaîtrons comme tel.
– Ma foi, monsieur le comte, répondit sans hésiter le capitaine Servadac, j’accepte la situation, et, avec elle, toute la responsabilité qu’elle impose. Laissez-moi croire, d’ailleurs, que nous nous entendrons parfaitement, et que nous ferons de notre mieux dans l’intérêt commun. Mordioux ! il me semble que le plus difficile est fait, et je compte bien que nous saurons nous tirer d’affaire, si nous sommes à jamais séparés de nos semblables ! »
Ce disant, Hector Servadac tendit la main au comte Timascheff. Celui-ci la prit et inclina légèrement la tête. C’était la première poignée de main qu’eussent échangée ces deux hommes, depuis qu’ils s’étaient retrouvés en face l’un de l’autre. D’ailleurs aucune allusion quelconque à leur rivalité passée n’avait été et ne devait jamais être faite.
« Avant tout, dit le capitaine Servadac, il est une question assez importante à résoudre. Devons-nous faire connaître, telle qu’elle est, la situation à ces Espagnols ?
– Ah ! mais non, mon gouverneur ! répondit vivement Ben-Zouf, qui partit comme un mousquet. Ces gens-là sont déjà assez mollasses de leur naturel ! S’ils venaient à savoir ce qui en est, ils se désespéreraient, et on n’en pourrait plus rien faire !
– D’ailleurs, ajouta le lieutenant Procope, ils sont fort ignorants, j’imagine, et je pense qu’ils ne comprendraient absolument rien à tout ce qu’on pourrait leur dire au point de vue cosmographique !
– Bah ! reprit le capitaine Servadac, s’ils comprenaient, cela ne les tracasserait guère ! Les Espagnols sont des êtres tant soit peu fatalistes, comme le sont les Orientaux, et ceux-là ne sont point gens à s’impressionner outre mesure ! Un air de guitare, un peu de fandango et de castagnettes, et ils n’y songeront plus ! Qu’en pensez-vous, comte Timascheff ?
– Je pense, répondit le comte Timascheff, qu’il vaut mieux dire la vérité, ainsi que je l’ai dite à mes compagnons de la Dobryna.
– C’est aussi mon avis, répondit le capitaine Servadac, et je ne crois pas que nous devions cacher la situation à ceux qui doivent en partager les dangers. Si ignorants que soient probablement ces Espagnols, ils ont nécessairement observé certaines modifications apportées aux phénomènes physiques, telles que raccourcissement des jours, le changement de marche du soleil, la diminution de la pesanteur. Donc, apprenons-leur qu’ils sont maintenant entraînés dans l’espace, et loin de la terre, dont il ne reste plus que cette île.
– Eh bien, voilà qui est convenu ! répondit Ben-Zouf.
Disons tout ! Pas de cachotteries ! Mais je veux me payer la vue d’Isac quand il apprendra qu’il se trouve à quelques centaines de millions de lieues de son vieux globe, où un usurier de sa trempe a dû laisser plus d’un débiteur ! Cours après, mon bonhomme ! »
Isac Hakhabut était à cinquante pas en arrière, et, par conséquent, il ne pouvait rien entendre de ce qui se disait. Il marchait, à demi courbé, geignant, implorant tous les dieux à la fois ; mais, par instants, ses deux petits yeux vifs lançaient des éclairs, et ses lèvres se serraient jusqu’à réduire sa bouche à ne plus être qu’un étroit rictus.
Lui aussi avait bien observé les nouveaux phénomènes physiques, et, plus d’une fois, il s’était entretenu à ce sujet avec Ben-Zouf, qu’il cherchait à amadouer. Mais Ben-Zouf professait une antipathie visible pour ce descendant dégradé d’Abraham. Il n’avait donc répondu que par des plaisanteries aux instances d’Hakhabut. Ainsi, il lui répétait qu’un être de sa sorte avait tout à gagner au système actuel, qu’au lieu de vivre cent ans, comme fait tout fils d’Israël qui se respecte, il en vivrait deux cents au moins, mais que, vu la diminution du poids de toute chose à la surface de la terre, le fardeau de ses vieilles années ne lui paraîtrait pas trop lourd ! Il ajoutait que si la lune s’était envolée, cela devait être indifférent à un avare de sa trempe, attendu qu’il n’était pas probable qu’il eût prêté dessus ! Il lui affirmait que si le soleil se couchait du côté où il avait l’habitude de se lever, c’est que probablement on lui avait changé son lit de place. Enfin, mille balivernes de ce genre. Et quand Isac Hakhabut le pressait davantage :
« Attends le gouverneur général, vieux, répondait-il invariablement. C’est un malin ! Il t’expliquera tout cela !
– Et il protégera mes marchandises ?
– Comment donc, Nephtali ! Il les confisquerait plutôt que de les laisser piller ! »
Et c’était sous le bénéfice de ces peu consolantes réponses, que le juif, auquel Ben-Zouf prodiguait successivement toute sorte de noms Israélites, guettait chaque jour l’arrivée du gouverneur.
Cependant, Hector Servadac et ses compagnons étaient arrivés au littoral. Là, vers la moitié de l’hypoténuse que formait ce côté de l’île, était mouillée la Hansa. Insuffisamment garantie par quelques roches, très exposée dans cette situation, un vent d’ouest un peu fort risquait certainement de mettre cette tartane à la côte, où elle se démolirait en quelques instants. Évidemment, elle ne pouvait rester à ce mouillage, et il faudrait plus tôt que plus tard la conduire à l’embouchure du Chéliff, près de la goélette russe.
En revoyant sa tartane, Isac recommença la série de ses doléances, avec tant de cris et de grimaces, que le capitaine Servadac dut lui enjoindre de se taire. Puis, laissant le comte Timascheff et Ben-Zouf sur le rivage, le lieutenant Procope et lui s’embarquèrent dans le canot de la Hansa et accostèrent la boutique flottante.
La tartane était en parfait état, et, par conséquent, sa cargaison ne devait avoir aucunement souffert. C’est ce qu’il fut facile de constater. Il y avait là dans la cale de la Hansa, des pains de sucre par centaines, des caisses de thé, des sacs de café, des boucauts de tabac, des pipes d’eau-de-vie, des tonneaux de vin, des barils de harengs secs, des rouleaux d’étoffes, des pièces de coton, des vêtements de laine, un assortiment de bottes à tous pieds et de bonnets à toutes têtes, des outils, des ustensiles de ménage, des articles de faïencerie et de poterie, des rames de papier, des bouteilles d’encre, des paquets d’allumettes, des centaines de kilos de sel, de poivre et autres condiments, un stock de gros fromages de Hollande, et jusqu’à une collection d’almanachs du Double-Liégeois, – le tout atteignant une valeur de plus de cent mille francs. La tartane, quelques jours avant la catastrophe, avait précisément renouvelé sa cargaison à Marseille, dans le but de l’écouler depuis Ceuta jusqu’à la régence de Tripoli, c’est-à-dire partout où Isac Hakhabut, retors et madré, trouvait à faire des marchés d’or.
« Une riche mine pour nous, que cette superbe cargaison ! dit le capitaine Servadac.
– Si le propriétaire la laisse exploiter, répondit le lieutenant Procope en hochant la tête.
– Eh ! lieutenant, que voulez-vous qu’Isac fasse de ces richesses ? Lorsqu’il saura qu’il n’y a plus ni Marocains, ni Français, ni Arabes à rançonner, il faudra bien qu’il s’exécute !
– Je n’en sais rien ! Mais, en tout cas, il voudra être payé de sa marchandise… quand même !
– Eh bien, nous le paierons, lieutenant, nous le paierons en traites sur notre ancien monde !
– Après tout, capitaine, reprit le lieutenant Procope, vous aurez bien le droit d’exercer des réquisitions…
– Non, lieutenant. Précisément parce que cet homme est Allemand, j’aime mieux agir avec lui d’une façon moins allemande. D’ailleurs, je vous le répète, bientôt il aura besoin de nous plus que nous n’aurons besoin de lui ! Lorsqu’il saura qu’il est sur un nouveau globe et probablement sans espoir de retour à l’ancien, il fera meilleur marché de ses richesses !
– Quoi qu’il en soit, répondit le lieutenant Procope, on ne peut laisser la tartane à ce mouillage. Elle s’y perdrait au premier mauvais temps, et même elle ne résisterait pas à la pression des glaces, lorsque la mer se congèlera, – ce qui ne saurait tarder beaucoup.
– Bien, lieutenant. Vous et votre équipage, vous la conduirez au port du Chéliff.
– Dès demain, capitaine, répondit le lieutenant Procope, car le temps presse. »
L’inventaire de la Hansa étant terminé, le capitaine Servadac et le lieutenant débarquèrent. Il fut alors convenu que toute la petite colonie se réunirait au poste du gourbi, et qu’en passant on prendrait les Espagnols. Isac Hakhabut fut invité à suivre le gouverneur, et il obéit, non sans jeter un regard craintif sur sa tartane.
Une heure après, les vingt-deux habitants de l’île étaient réunis dans la grande chambre du poste. Là, pour la première fois, le jeune Pablo faisait connaissance avec la petite Nina, qui parut très contente de trouver en lui un compagnon de son âge.
Le capitaine Servadac prit la parole, et il dit, de manière à être compris du juif et des Espagnols, qu’il allait leur faire connaître la situation grave dans laquelle ils se trouvaient. Il ajouta, d’ailleurs, qu’il comptait sur leur dévouement, sur leur courage, et que tous maintenant devaient travailler dans l’intérêt commun.
Les Espagnols écoutaient tranquillement et ne pouvaient répondre, ignorant encore ce qu’on attendait d’eux. Cependant, Negrete crut devoir faire une observation, et s’adressant au capitaine Servadac :
« Monsieur le gouverneur, dit-il, mes compagnons et moi, avant de nous engager, nous voudrions savoir à quelle époque il vous sera possible de nous reconduire en Espagne.
– Les reconduire en Espagne, monsieur le gouverneur général ! s’écria Isac en bon français. Non, tant qu’ils ne m’auront pas payé leurs dettes ! Ces coquins m’ont promis vingt réaux par personne pour leur passage à bord de la Hansa. Ils sont dix. C’est donc deux cents réaux[7] qu’ils me doivent, et j’en prends à témoin…
– Te tairas-tu, Mardochée ! cria Ben-Zouf.
– Vous serez payé, dit le capitaine Servadac.
– Et ce ne sera que justice, répondit Isac Hakhabut. À chacun son salaire, et si le seigneur russe veut me prêter deux ou trois de ses matelots pour conduire ma tartane à Alger, à mon tour je les paierai… oui… je les paierai… pourvu qu’ils ne me demandent pas trop cher !
– Alger ! s’écria de nouveau Ben-Zouf, qui ne pouvait se contenir, mais sache donc…
– Laisse-moi apprendre à ces braves gens, Ben-Zouf, ce qu’ils ignorent ! » dit le capitaine Servadac.
Puis, reprenant en espagnol :
« Écoutez-moi, mes amis, dit-il. Un phénomène que nous n’avons pu expliquer jusqu’ici nous a séparés de l’Espagne, de l’Italie, de la France, en un mot de toute l’Europe ! Des autres continents, il ne reste rien que cette île où vous avez trouvé refuge. Nous ne sommes plus sur la terre, mais vraisemblablement sur un fragment du globe, qui nous emporte avec lui, et il est impossible de prévoir si nous reverrons jamais notre ancien monde ! »
Les Espagnols avaient-ils compris l’explication donnée par le capitaine Servadac ? C’était au moins douteux. Cependant, Negrete le pria de répéter ce qu’il venait de dire.
Hector Servadac le fit de son mieux, et, employant des images familières à ces Espagnols ignorants, il réussit à leur faire comprendre la situation telle qu’elle était. Quoi qu’il en soit, à la suite d’un court entretien que Negrete et ses compagnons eurent entre eux, ils semblèrent tous prendre la chose avec une parfaite insouciance.
Quant à Isac Hakhabut, après avoir entendu le capitaine Servadac, il ne prononça pas un mot ; mais ses lèvres se pincèrent comme s’il eût voulu dissimuler un sourire.
Hector Servadac, se retournant alors, lui demanda si, après ce qu’il venait d’entendre, il songeait encore à reprendre la mer et à conduire sa tartane au port d’Alger, dont il n’existait plus un vestige.
Isac Hakhabut sourit cette fois, mais, cependant, de manière à n’être point vu des Espagnols. Puis, s’adressant en russe pour être compris seulement du comte Timascheff et de ses hommes :
« Tout ça, ce n’est pas vrai, dit-il, et Son Excellence le gouverneur général veut rire ! »
Sur quoi, le comte Timascheff tourna le dos à cet affreux bonhomme avec un dégoût peu dissimulé.
Isac Hakhabut, revenant alors au capitaine Servadac, lui dit en français :
« Ces contes-là sont bons pour des Espagnols ! Ça les tiendra. Mais pour moi, c’est autre chose ! »
Puis, s’approchant de la petite Nina, il ajouta en italien :
« N’est-ce pas que tout cela n’est pas vrai, petiote ? »
Et il quitta le poste en haussant les épaules.
« Ah çà ! Il sait donc toutes les langues, cet animal ? dit Ben-Zouf.
– Oui, Ben-Zouf, répondit le capitaine Servadac ; mais qu’il s’exprime en français, en russe, en espagnol, en italien ou en allemand, c’est toujours argent qu’il parle ! »
Chapitre XX
Qui tend à prouver qu’en regardant bien, on finit toujours par apercevoir un feu à l’horizon
Le lendemain, 6 mars, sans plus se préoccuper de savoir ce que croyait ou ce que ne croyait pas Isac Hakhabut, le capitaine Servadac donna ordre de conduire la Hansa au port du Chéliff. D’ailleurs, le juif ne fit aucune observation, car ce déplacement de la tartane sauvegardait ses intérêts. Mais il espérait bien débaucher secrètement deux ou trois matelots de la goélette, afin de gagner Alger ou tout autre port de la côte.
Les travaux furent immédiatement entrepris en vue d’un prochain hivernage. Ces travaux étaient, d’ailleurs, facilités par la plus grande force musculaire que les travailleurs pouvaient développer. Ils étaient faits à ces phénomènes de moindre attraction, comme aussi à cette décompression de l’air, qui avait activé leur respiration, et ils ne s’en apercevaient même plus.
Les Espagnols, aussi bien que les Russes, se mirent donc à la besogne avec ardeur. On commença par approprier aux besoins de la petite colonie le poste, qui, jusqu’à nouvel ordre, devait servir de logement commun. C’est là que vinrent demeurer les Espagnols, les Russes restant sur leur goélette, et le juif à bord de sa tartane.
Mais navires ou maisons de pierres ne pouvaient être que des habitations provisoires. Il faudrait, avant que l’hiver arrivât, trouver de plus sûrs abris contre les froids des espaces interplanétaires, abris qui fussent chauds par eux-mêmes, puisque la température n’y saurait être élevée, faute de combustible.
Des silos, sortes d’excavations profondément creusées dans le sol, pouvaient seuls offrir un refuge suffisant aux habitants de l’île Gourbi. Lorsque la surface de Gallia serait couverte d’une épaisse couche de glace, substance qui est mauvaise conductrice de la chaleur, on pouvait espérer que la température intérieure de ces silos se fixerait à un degré supportable. Le capitaine Servadac et ses compagnons mèneraient là une véritable existence de troglodytes, mais ils n’avaient pas le choix du logement.
Très heureusement, ils ne se trouvaient pas dans les mêmes conditions que les explorateurs ou les baleiniers des océans polaires. À ces hiverneurs, le plus souvent, le sol ferme manque sous le pied. Ils vivent à la surface de la mer glacée et ne peuvent chercher dans ses profondeurs un refuge contre le froid. Ou ils restent sur leurs navires, ou ils élèvent des habitations de bois et de neige, et, dans tous les cas, ils sont mal garantis contre les grands abaissements de la température.
Ici, au contraire, sur Gallia, le sol était solide, et, lors même qu’ils devraient se creuser une demeure à quelques centaines de pieds au-dessous, les Galliens pouvaient espérer d’y braver les plus rigoureuses chutes de la colonne thermométrique.
Les travaux furent donc immédiatement commencés. Pelles, pioches, pics, outils de diverses sortes, on le sait, ne manquaient pas au gourbi, et, sous la conduite du contremaître Ben-Zouf, majos espagnols et matelots russes se mirent lestement à la besogne.
Mais une déconvenue attendait les travailleurs et l’ingénieur Servadac qui les dirigeait.
L’endroit choisi pour y creuser le silo était situé sur la droite du poste, dans un lieu où le sol formait une légère intumescence. Pendant le premier jour, le déblaiement des terres se fit sans difficulté ; mais, arrivés à une profondeur de huit pieds, les travailleurs se heurtèrent contre une substance si dure, que leurs outils ne purent l’entamer.
Hector Servadac et le comte Timascheff, prévenus par Ben-Zouf, reconnurent dans cette substance la matière inconnue qui composait aussi bien le littoral de la mer Gallienne que son sous-sol marin. Il était évident qu’elle formait aussi la charpente de Gallia. Or, les moyens manquaient pour la creuser assez profondément. La poudre ordinaire n’eût peut-être pas suffi à désagréger cette substruction, plus résistante que du granit, et sans doute il aurait fallu employer la dynamite pour la faire voler en éclats.
« Mordioux ! quel est donc ce minéral ? s’écria le capitaine Servadac, et comment un morceau de notre vieux globe peut-il être formé de cette matière, à laquelle nous ne pouvons donner un nom !
– C’est absolument inexplicable, répondit le comte Timascheff ; mais, si nous ne parvenons pas à creuser notre demeure dans ce sol, c’est la mort à bref délai ! »
En effet, si les chiffres fournis par le document étaient justes, et si la distance de Gallia au soleil s’était progressivement accrue, suivant les lois de la mécanique, Gallia devait en être maintenant à cent millions de lieues environ, distance presque égale à trois fois celle qui sépare la terre de l’astre radieux, lorsqu’elle passe à son aphélie. On conçoit donc combien la chaleur en même temps que la lumière solaire en devaient être amoindries. Il est vrai que, par suite de la disposition de l’axe de Gallia, qui faisait un angle de quatre-vingt-dix degrés avec le plan de son orbite, le soleil ne s’écartait jamais de son équateur, et que l’île Gourbi, traversée par le parallèle zéro, bénéficiait de cette situation. Sous cette zone, l’été était pour elle à l’état permanent, mais son éloignement du soleil ne pouvait être compensé, et sa température allait toujours s’abaissant. Déjà, la glace s’était formée entre les roches, au grand émoi de la petite fille, et la mer ne tarderait pas à se congeler tout entière.
Or, avec des froids qui, plus tard, pouvaient dépasser soixante degrés centigrades, c’était, faute d’une demeure convenable, la mort à bref délai. Cependant, le thermomètre se maintenait encore à une moyenne de six degrés au-dessous de zéro, et le poêle, installé dans le poste, dévorait le bois disponible tout en ne donnant qu’une médiocre chaleur. On ne pouvait donc compter sur ce genre de combustible, et il fallait trouver une autre installation qui fût à l’abri de ces abaissements de température, car, avant peu, on verrait se geler le mercure et peut-être l’alcool des thermomètres !
Quant à la Dobryna et à la Hansa, on l’a dit, ces deux bâtiments étaient insuffisants contre des froids déjà si vifs. On ne pouvait donc pas songer à les habiter. Qui sait, d’ailleurs, ce que deviendraient ces navires, lorsque les glaces s’accumuleraient autour d’eux en masses énormes ?
Si le capitaine Servadac, le comte Timascheff, le lieutenant Procope eussent été hommes à se décourager, l’occasion était belle ! En effet, qu’auraient-ils pu imaginer, puisque l’étrange dureté des assises du sol s’opposait à ce qu’ils parvinssent à y creuser un silo ?
Cependant, les circonstances devenaient très pressantes. La dimension apparente du disque solaire se réduisait de plus en plus par l’éloignement. Lorsqu’il passait au zénith, ses rayons perpendiculaires émettaient encore une certaine chaleur ; mais, pendant la nuit, le froid se faisait déjà sentir très vivement.
Le capitaine Servadac et le comte Timascheff, montés sur Zéphyr et Galette, parcoururent entièrement l’île pour chercher quelque retraite habitable. Les deux chevaux volaient au-dessus des obstacles comme s’ils avaient eu des ailes. Vaine exploration ! En divers points, des sondages furent pratiqués, qui rencontrèrent invariablement la dure charpente à quelques pieds seulement au-dessous de la surface du sol. Il fallut renoncer à se loger sous terre.
Il fut donc décidé que, faute d’un silo, les Galliens habiteraient le poste, et qu’on le défendrait autant qu’il serait possible contre les froids extérieurs. Ordre fut donné d’amasser tout le bois, sec ou vert, que produisait l’île, et d’abattre les arbres dont la plaine était couverte. Il n’y avait pas à hésiter. L’abattage fut commencé sans retard.
Et pourtant – le capitaine Servadac et ses compagnons le savaient bien – cela ne pouvait suffire ! Ce combustible s’épuiserait promptement. L’officier d’état-major, inquiet au plus haut point, sans en rien laisser paraître, parcourait l’île en répétant :
« Une idée ! une idée ! »
Puis, s’adressant, un jour, à Ben-Zouf :
« Mordioux ! Est-ce que tu n’as pas une idée, toi ?
– Non, mon capitaine », répondit l’ordonnance. Et il ajouta : « Ah ! si nous étions seulement à Montmartre ! C’est là qu’il y a de belles carrières toutes faites !
– Mais, imbécile ! répliqua le capitaine Servadac, si nous étions à Montmartre, je n’aurais pas besoin de tes carrières ! »
Cependant, la nature allait procurer aux colons précisément l’indispensable abri qu’il leur fallait pour lutter contre les froids de l’espace. Voici dans quelles circonstances il leur fut signalé.
Le 10 mars, le lieutenant Procope et le capitaine Servadac avaient été explorer la pointe sud-ouest de l’île. Tout en marchant, ils causaient de ces terribles éventualités que leur réservait l’avenir ! Ils discutaient avec une certaine animation, n’étant point du même avis sur la manière de parer à ces éventualités. L’un persistait à chercher jusque dans l’impossible la demeure introuvable, l’autre s’ingéniait à imaginer un nouveau mode de chauffage pour la demeure déjà occupée. Le lieutenant Procope tenait pour cette dernière combinaison, et il déduisait ses motifs, lorsqu’il s’arrêta soudain au milieu de son argumentation. Il était, à ce moment, tourné vers le sud, et le capitaine Servadac le vit passer sa main sur ses yeux, comme pour les éclaircir, puis regarder de nouveau avec une attention extrême.
« Non ! Je ne me trompe pas ! C’est bien une lueur que j’aperçois là-bas !
– Une lueur ?
– Oui, dans cette direction !
– En effet », répondit le capitaine Servadac, qui venait, aussi lui, d’apercevoir le point signalé par le lieutenant.
Le fait n’était plus douteux. Une lueur apparaissait au-dessus de l’horizon du sud et se montrait sous la forme d’un gros point vif, qui devint plus lumineux à mesure que l’obscurité se fit.
« Serait-ce un navire ? demanda le capitaine Servadac.
– Il faudrait que ce fût un navire en flammes, répondit le lieutenant Procope, car aucun fanal ne pourrait être visible à cette distance, ni, en tout cas, à cette hauteur !
– D’ailleurs, ajouta le capitaine Servadac, ce feu ne bouge pas, et il semble même qu’une sorte de réverbération commence à s’établir dans les brumes du soir. »
Les deux observateurs regardèrent avec une extrême attention pendant quelques instants encore. Puis, une révélation se fit soudain dans l’esprit de l’officier d’état-major.
« Le volcan ! s’écria-t-il, c’est le volcan que nous avons doublé au retour de la Dobryna ! »
Et, comme inspiré :
« Lieutenant Procope, là est la demeure que nous cherchons ! ajouta-t-il. Là est une habitation dont la nature fait tous les frais de chauffage ! Oui ! cette inépuisable et ardente lave que déverse la montagne, nous saurons bien l’employer à tous nos besoins. Ah ! lieutenant, le Ciel ne nous abandonne pas ! Venez ! venez ! Demain, il faut que nous soyons là, sur ce littoral, et, s’il le faut, nous irons chercher la chaleur, c’est-à-dire la vie, jusque dans les entrailles de Gallia ! »
Pendant que le capitaine Servadac parlait avec cette enthousiaste conviction, le lieutenant Procope cherchait à rappeler ses souvenirs. Tout d’abord l’existence du volcan dans cette direction lui parut certaine. Il se rappela qu’au retour de la Dobryna, alors qu’elle prolongeait la côte méridionale de la mer Gallienne, un long promontoire lui barra le passage et l’obligea à remonter jusqu’à l’ancienne latitude d’Oran. Là, elle dut contourner une haute montagne rocheuse, dont le sommet était empanaché de fumée. À cette fumée avait évidemment succédé une projection de flammes ou de laves incandescentes, et c’était cette projection qui illuminait actuellement l’horizon méridional et se reflétait sur les nuages.
« Vous avez raison, capitaine, dit le lieutenant Procope. Oui ! c’est bien le volcan, et nous l’explorerons dès demain ! »
Hector Servadac et le lieutenant Procope revinrent rapidement au gourbi, et, là, ils ne firent d’abord connaître leurs projets d’expédition qu’au comte Timascheff.
« Je vous accompagnerai, répondit le comte, et la Dobryna est à votre disposition.
– Je pense, dit alors le lieutenant Procope, que la goélette peut rester au port du Chéliff. Sa chaloupe à vapeur sera suffisante, par ce beau temps, pour une traversée de huit lieues au plus.
– Fais donc comme tu l’entendras, Procope », répondit le comte Timascheff.
Ainsi que plusieurs de ces luxueuses goélettes de plaisance, la Dobryna possédait une chaloupe à vapeur de grande vitesse, dont l’hélice était mise en mouvement par une puissante petite chaudière, du système Oriolle. Le lieutenant Procope, ignorant quelle était la nature des atterrages qu’il allait parcourir, avait raison de préférer cette légère embarcation à la goélette, car elle lui permettrait de visiter sans danger les moindres criques du littoral.
C’est pourquoi le lendemain, 11 mars, la chaloupe à vapeur était chargée de ce charbon, dont il restait encore une dizaine de tonnes à bord de la Dobryna. Puis, montée par le capitaine, le comte et le lieutenant, elle quittait le port du Chéliff, à la grande surprise de Ben-Zouf, qui n’avait même pas été mis dans le secret. Mais enfin, l’ordonnance demeurait sur l’île Gourbi avec les pleins pouvoirs du gouverneur général, – ce dont il n’était pas peu fier.
Les trente kilomètres qui séparaient l’île de la pointe sur laquelle se dressait le volcan furent franchis par la rapide embarcation en moins de trois heures. La cime du haut promontoire apparut alors tout en feu. L’éruption semblait être considérable. L’oxygène de l’atmosphère emportée par Gallia s’était-il donc récemment combiné avec les matières éruptives de ses entrailles pour produire cette intense déflagration, ou, ce qui était plus probable, ce volcan, comme ceux de la lune, ne s’alimentait-il pas à une source d’oxygène qui lui était propre ?
La chaloupe à vapeur longea la côte, cherchant un point convenable de débarquement. Après une demi-heure d’exploration, elle trouva enfin une sorte d’enrochement semi-circulaire, formant une petite crique, qui pourrait plus tard offrir un mouillage sûr à la goélette et à la tartane, si les circonstances permettaient de les y conduire.
La chaloupe fut amarrée, et ses passagers débarquèrent sur une partie de la côte opposée à celle dont le torrent lavique suivait les pentes pour se rendre à la mer. Mais, en s’approchant, le capitaine Servadac et ses compagnons reconnurent avec une extrême satisfaction combien la température de l’atmosphère s’élevait sensiblement. Peut-être les espérances de l’officier seraient-elles réalisables ! Peut-être, s’il se rencontrait dans cet énorme massif quelque excavation habitable, les Galliens échapperaient-ils au plus grand danger dont ils fussent menacés.
Les voilà donc, cherchant, furetant, contournant les angles de la montagne, gravissant ses talus les plus raides, escaladant ses larges assises, sautant d’une roche à l’autre comme ces lestes isards, dont ils avaient maintenant l’extraordinaire légèreté spécifique, mais sans jamais fouler du pied d’autre matière que cette substance aux prismes hexagonaux, qui semblait former l’unique minéral de l’astéroïde.
Leurs recherches ne devaient pas être vaines.
Derrière un grand pan de roches, dont le sommet se projetait comme un pyramidion vers le ciel, une sorte d’étroite galerie, ou plutôt un sombre boyau creusé dans le flanc de la montagne, s’ouvrit devant eux. Ils en franchirent aussitôt l’orifice, qui était situé à vingt mètres environ au-dessus du niveau de la mer.
Le capitaine Servadac et ses deux compagnons s’avancèrent en rampant au milieu d’une obscurité profonde, tâtant les parois de l’obscur tunnel, sondant les dépressions du sol. Aux grondements qui s’accroissaient, ils comprenaient bien que la cheminée centrale ne pouvait être éloignée. Toute leur crainte était de se voir subitement arrêtés dans leur exploration par une paroi terminale qu’il leur serait impossible de franchir.
Mais le capitaine Servadac avait une confiance inébranlable qui se communiquait au comte Timascheff et au lieutenant Procope.
« Allons ! allons ! criait-il. C’est dans les circonstances exceptionnelles qu’il faut recourir aux moyens exceptionnels ! Le feu est allumé, la cheminée n’est pas loin ! La nature fournit le combustible ! Mordioux ! nous nous chaufferons à bon compte. »
La température alors était là au moins de quinze degrés au-dessus de zéro. Lorsque les explorateurs appuyaient la main sur les parois de la sinueuse galerie, ils les sentaient brûlantes. Il semblait que cette matière rocheuse, dont le mont était formé, eût le pouvoir de conduire la chaleur, comme si elle eût été métallique.
« Vous le voyez bien, répétait Hector Servadac, il y a un véritable calorifère là-dedans ! »
Enfin, une lueur énorme illumina le sombre boyau, et une vaste caverne apparut, qui resplendissait de lumière. La température y était fort élevée, mais supportable.
À quel phénomène cette excavation creusée dans l’épais massif devait-elle cet éclat et cette température ? Tout simplement à un torrent de laves qui se précipitait devant sa baie, largement ouverte sur la mer ! On eût dit les nappes du Niagara central, tendues à la célèbre grotte des Vents. Seulement, ici, ce n’était pas un rideau liquide, c’était un rideau de flammes qui se déroulait devant la vaste baie de la caverne.
« Ah ! Ciel secourable ! s’écria le capitaine Servadac, je ne t’en demandais pas tant ! »
Chapitre XXI
Où l’on verra quelle charmante surprise la nature fait, un beau soir, aux habitants de Gallia
C’était, en effet, une merveilleuse habitation, toute chauffée, tout éclairée, que cette caverne, où le petit monde de Gallia trouverait aisément place. Et non seulement Hector Servadac et « ses sujets », comme disait volontiers Ben-Zouf, pourraient s’y loger confortablement, mais les deux chevaux du capitaine et un nombre assez considérable d’animaux domestiques auraient là un abri contre le froid jusqu’à la fin de l’hiver gallien, – si cet hiver devait jamais avoir un terme.
Cette énorme excavation – cela fut aussitôt reconnu – n’était, à vrai dire, que l’épanouissement formé par une vingtaine de boyaux qui, après s’être ramifiés à l’intérieur du massif, venaient y aboutir. L’air chaud s’y propageait à une température remarquablement élevée. On eût dit vraiment que la chaleur transsudait à travers les pores minéraux du mont. Donc, sous ces épaisses voûtes, à l’abri de toutes les intempéries d’un climat polaire, bravant les froids de l’espace, si bas qu’ils pussent descendre, tous les êtres animés du nouvel astre devaient trouver un refuge assuré, – tant que le volcan se maintiendrait en activité. Mais, ainsi que le fit justement observer le comte Timascheff, aucun autre mont ignivome n’avait été signalé pendant le voyage de la Dobryna sur le périmètre de la nouvelle mer, et si cette unique bouche servait d’exutoire aux feux intérieurs de Gallia, l’éruption pouvait évidemment durer pendant des siècles.
Il s’agissait donc de ne perdre ni un jour, ni même une heure. Pendant que la Dobryna pouvait naviguer encore, il fallait retourner à l’île Gourbi, en « déménager » lestement, transporter sans retard à leur nouveau domicile hommes et animaux, y emmagasiner céréales et fourrages, et s’installer définitivement sur la Terre-Chaude, – nom très justifié, qui fut donné à cette portion volcanique du promontoire.
La chaloupe revint le jour même à l’île Gourbi, et, dès le lendemain, les travaux furent commencés.
C’était d’un grand hivernage qu’il s’agissait alors, et à toutes les éventualités duquel il fallait parer. Oui, grand, long, interminable peut-être, bien autrement menaçant que ces six mois de nuit et d’hiver que bravent les navigateurs des mers arctiques ! Qui pouvait prévoir, en effet, le moment auquel Gallia serait délivrée de ses liens de glace ? Qui pouvait dire si elle suivait dans son mouvement de translation une courbe rentrante, et si une orbe elliptique la ramènerait jamais vers le soleil ?
Le capitaine Servadac apprit à ses compagnons l’heureuse découverte qu’il venait de faire. Le nom de « Terre-Chaude » fut accueilli par les bravos de Nina et des Espagnols surtout. La Providence, qui faisait si bien les choses, fut remerciée comme elle méritait de l’être.
Pendant les trois jours qui suivirent, la Dobryna fit trois voyages. Chargée jusqu’à la hauteur des bastingages, elle transporta d’abord la récolte des fourrages et des céréales, qui fut déposée dans les profonds réduits destinés à servir de magasins. Le 15 mars, les étables rocheuses reçurent ceux des animaux domestiques, taureaux, vaches, moutons et porcs, une cinquantaine environ, dont on voulait conserver l’espèce. Les autres, que le froid allait bientôt détruire, devaient être abattus en aussi grande quantité que possible, la conservation indéfinie des viandes étant facile sous ces climats rigoureux. Les Galliens auraient donc là une énorme réserve. Avenir rassurant, au moins pour la population actuelle de Gallia !
Quant à la question des boissons, elle était extrêmement facile à résoudre. Il faudrait évidemment se contenter d’eau douce ; mais cette eau ne manquerait jamais, ni pendant l’été, grâce aux ruisseaux et aux citernes de l’île Gourbi, ni pendant l’hiver, puisque le froid se chargeait de la produire par la congélation de l’eau de mer.
Tandis que l’on travaillait ainsi à l’île, le capitaine Servadac, le comte Timascheff et le lieutenant Procope s’occupaient d’aménager cette demeure de la Terre-Chaude. Il fallait se hâter, car déjà la glace résistait, même en plein midi, aux rayons perpendiculaires du soleil. Or il convenait, pour les transports, d’utiliser la mer tandis qu’elle était encore libre, plutôt que de la traverser péniblement sur sa surface solidifiée.
Cet aménagement des diverses excavations, ouvertes dans le massif du volcan, fut conduit avec une grande ingéniosité. De nouvelles explorations avaient amené la découverte de nouvelles galeries. Ce mont ressemblait à une vaste ruche, dans laquelle abondaient les alvéoles. Les abeilles – on veut dire les colons – trouveraient aisément à s’y loger, et dans de très suffisantes conditions de confort. Cette disposition fit même donner à cette demeure, et en l’honneur de la fillette, le nom de Nina-Ruche.
Tout d’abord, le premier soin du capitaine Servadac et de ses compagnons fut d’employer au mieux des nécessités quotidiennes cette chaleur volcanique que la nature leur prodiguait gratuitement. En ouvrant aux filets de laves incandescentes des pentes nouvelles, ils les dérivèrent jusqu’aux endroits où ils devaient être utilisés. Ainsi la cuisine de la Dobryna, ayant été installée dans un réduit convenablement approprié à cet usage, fut désormais chauffée à la lave, et Mochel, le maître coq de la goélette, eut bientôt la main faite à ce nouveau genre de foyer de chaleur.
« Hein ! disait Ben-Zouf, quel progrès, si, dans l’ancien monde, chaque maison avait pour calorifère un petit volcan qui ne coûterait pas un centime d’entretien ! »
La grande caverne, cette excavation principale vers laquelle rayonnaient les galeries du massif, fut destinée à devenir la salle commune, et on la meubla avec les principaux meubles du gourbi et de la Dobryna. Les voiles de la goélette avaient été déverguées et emportées à Nina-Ruche, où elles pouvaient être employées à divers usages. La bibliothèque du bord, bien fournie de livres français et russes, trouva naturellement sa place dans la grande salle. Table, lampes, chaises en complétaient l’ameublement, et les parois furent ornées des cartes de la Dobryna .
On a dit que le rideau de feu, qui masquait la baie antérieure de la principale excavation, la chauffait et l’éclairait à la fois. Cette cataracte de laves se précipitait dans un petit bassin encadré d’une bordure de récifs, et qui ne semblait avoir aucune communication avec la mer. C’était évidemment l’ouverture d’un précipice très profond, dont les eaux seraient sans doute maintenues à l’état liquide par les matières éruptives, même lorsque le froid aurait glacé toute la mer Gallienne. Une seconde excavation, située au fond, à gauche de la salle commune, devint la chambre spéciale du capitaine Servadac et du comte Timascheff. Le lieutenant Procope et Ben-Zouf occupaient ensemble une sorte de retrait, évidé dans la roche, qui s’ouvrait à droite, et on trouva même un réduit en arrière, dont on fit une véritable chambrette pour la petite Nina. Quant aux matelots russes et aux Espagnols, ils établirent leurs couches dans les galeries qui aboutissaient à la grande salle, et que la chaleur de la cheminée centrale rendait parfaitement habitables. Le tout constituait Nina-Ruche. La petite colonie, ainsi casée, pouvait donc attendre sans crainte le long et rude hiver qui allait la séquestrer dans le massif de la Terre-Chaude. Elle y devait impunément supporter une température qui, au cas où Gallia se verrait entraînée jusqu’à l’orbite de Jupiter, ne serait plus que la vingt-cinquième partie de la température terrestre.
Mais, pendant les préparatifs de déménagement, et au milieu de cette activité fébrile qui dévora même les Espagnols, que devenait Isac Hakhabut, demeuré au mouillage de l’île Gourbi ?
Isac Hakhabut, toujours incrédule, sourd à toutes les preuves que, par humanité, on avait accumulées pour vaincre sa méfiance, était resté à bord de sa tartane, veillant sur sa marchandise comme un avare sur son trésor, grommelant, gémissant, regardant à l’horizon, mais en vain, si quelque navire ne se présenterait pas en vue de l’île Gourbi. On était, d’ailleurs, débarrassé de sa vilaine figure à Nina-Ruche, et on ne s’en plaignait pas. – Isac avait formellement déclaré qu’il ne livrerait sa marchandise que contre argent ayant cours. Aussi, le capitaine Servadac avait-il défendu, en même temps qu’on lui prît quoi que ce soit, qu’on lui achetât quoi que ce fût. On verrait bien si cet entêté céderait devant la nécessité qui le presserait bientôt, et devant la réalité dont il serait convaincu avant peu.
Il était bien évident, du reste, qu’Isac Hakhabut n’admettait en aucune façon la situation redoutable, acceptée par les autres, faite à la petite colonie. Il se croyait toujours sur le sphéroïde terrestre dont un cataclysme avait modifié quelques portions seulement, et il comptait que, tôt ou tard, les moyens lui seraient donnés de quitter l’île Gourbi pour aller reprendre son commerce sur le littoral méditerranéen. Avec sa défiance de tout et tous, il s’imaginait que quelque trame avait été ourdie contre lui pour le dépouiller de son bien. Aussi, ne voulant pas être joué, il repoussait l’hypothèse de cet énorme bloc, détaché de la terre et emporté dans l’espace, et, ne voulant pas être dépouillé, il veillait nuit et jour. Mais, en somme, puisque jusqu’ici tout concluait à l’existence d’un nouvel astre pérégrinant dans le monde solaire – astre habité seulement par les Anglais de Gibraltar et les colons de l’île Gourbi –, Isac Hakhabut avait beau promener sur la ligne d’horizon sa vieille lunette rapiécée comme un tuyau de poêle, il ne voyait aucun navire apparaître, ni aucun trafiquant accourir pour échanger son or contre les richesses de la Hansa.
Cependant, Isac n’avait pas été sans connaître les projets d’hivernage qui allaient être mis à exécution. Tout d’abord, suivant son invariable habitude, il refusa d’y croire. Mais lorsqu’il vit la Dobryna faire de fréquents voyages au sud, emportant les récoltes et les animaux domestiques, il fut bien obligé d’admettre que le capitaine Servadac et ses compagnons se préparaient à quitter l’île Gourbi.
Qu’allait-il donc devenir, ce malheureux Hakhabut, si, en fin de compte, tout ce qu’il refusait de croire était vrai ? Comment ! il ne serait plus sur la Méditerranée, mais sur la mer Gallienne ! Il ne reverrait plus jamais sa bonne patrie allemande ! Il ne trafiquerait plus avec ses faciles dupes de Tripoli et de Tunis ? Mais c’était sa ruine !
Alors, on le vit quitter plus souvent sa tartane et se mêler aux divers groupes de Russes et d’Espagnols, qui ne lui ménageaient pas les quolibets. Il essaya encore d’amadouer Ben-Zouf en lui offrant quelques prises de tabac, que l’ordonnance refusait « par ordre ».
« Non, vieux Zabulon ! lui disait-il. Pas une seule prise ! C’est la consigne ! Tu mangeras ta cargaison, tu la boiras, tu la priseras tout entière et tout seul, Sardanapale ! »
Isac Hakhabut, voyant enfin qu’il ne pouvait rien obtenir des « saints », se rapprocha du « Dieu », et, un jour, il se décida à demander lui-même, au capitaine Servadac, si tout cela était bien vrai, estimant qu’un officier français ne voudrait pas tromper un pauvre homme comme lui.
« Eh ! oui, mordioux ! oui ! tout cela est vrai, répondit Hector Servadac, impatienté de tant d’obstination, et vous n’avez que le temps de vous réfugier à Nina-Ruche !
– Que l’Éternel et Mahomet me soient en aide ! murmura Isac, faisant cette double invocation en véritable renégat qu’il était.
– Voulez-vous trois ou quatre hommes pour conduire la Hansa au nouveau mouillage de la Terre-Chaude ? lui demanda le capitaine Servadac.
– Je voudrais aller à Alger, répondit Isac Hakhabut.
– Je vous répète qu’Alger n’existe plus !
– Par Allah, est-ce possible !
– Pour la dernière fois, voulez-vous nous suivre avec votre tartane à la Terre-Chaude, où nous allons hiverner ?
– Miséricorde ! C’en est fait de mon bien !
– Vous ne le voulez pas ? Eh bien, nous conduirons la Hansa, malgré vous et sans vous, en lieu sûr !
– Malgré moi, monsieur le gouverneur ?
– Oui, car je ne veux pas que, par votre stupide entêtement, toute cette précieuse cargaison soit anéantie sans profit pour personne !
– Mais c’est ma ruine !
– Ce serait bien plus sûrement votre ruine, si nous vous laissions faire ! répondit Hector Servadac en haussant les épaules. – Et, maintenant, allez au diable ! »
Isac Hakhabut retourna vers sa tartane, levant les bras au ciel et protestant contre l’incroyable rapacité des hommes « de la mauvaise race ».
Le 20 mars, les travaux de l’île Gourbi étaient terminés. Il ne restait plus qu’à partir. Le thermomètre était descendu, en moyenne, à huit degrés au-dessous de zéro. L’eau de la citerne n’offrait plus une seule molécule liquide. Il fut donc convenu que, le lendemain, tous s’embarqueraient sur la Dobryna et quitteraient l’île, pour se réfugier à Nina-Ruche. On convint également d’y conduire la tartane, malgré toutes les protestations de son propriétaire. Le lieutenant Procope avait déclaré que si la Hansa restait mouillée au port du Chéliff, elle ne saurait résister à la pression des glaces et serait immanquablement brisée. À la crique de la Terre-Chaude, mieux protégée, elle serait plus en sûreté, et, en tout cas, s’y trouvât-elle en perdition, sa cargaison, du moins, pourrait être sauvée.
C’est pourquoi, quelques instants après que la goélette eut levé l’ancre, la Hansa appareilla aussi, malgré les cris et objurgations d’Isac Hakhabut. Quatre matelots russes s’y étaient embarqués par ordre du lieutenant, et, sa grande antenne déployée, le bateau-boutique, comme disait Ben-Zouf, quitta l’île Gourbi et se dirigea vers le sud.
Ce que furent les invectives du renégat pendant la traversée, et avec quelle insistance il répéta qu’on agissait malgré lui, qu’il n’avait besoin de personne, qu’il n’avait réclamé aucune aide, cela ne peut se dire. Il pleurait, il se lamentait, il geignait – au moins des lèvres –, car il ne pouvait empêcher ses petits yeux gris de lancer certains éclairs à travers ses fausses larmes. Puis, trois heures après, lorsqu’il fut bien amarré dans la crique de la Terre-Chaude, quand il vit en sûreté son bien et lui, quelqu’un qui se fût approché aurait été frappé de la satisfaction non équivoque de son regard, et, en prêtant l’oreille, il l’eût entendu murmurer ces paroles :
« Pour rien, cette fois ! Les imbéciles ! les idiots ! ils m’ont conduit pour rien ! »
Tout l’homme était dans ces mots. Pour rien ! On lui avait rendu service « pour rien » !
L’île Gourbi était maintenant et définitivement abandonnée des hommes. Il ne restait plus rien sur ce dernier lambeau d’une colonie française, à part les animaux de poil et de plume qui avaient échappé aux traqueurs, et que le froid allait bientôt anéantir. Les oiseaux, après avoir essayé de trouver au loin quelque continent plus propice, étaient revenus à l’île, – preuve incontestable qu’il n’existait ailleurs aucune terre qui les pût nourrir.
Ce jour-là, le capitaine Servadac et ses compagnons prirent solennellement possession de leur nouveau domicile. L’aménagement intérieur de Nina-Ruche plut à tous, et chacun se félicita d’être si confortablement et surtout si chaudement logé. Seul, Isac Hakhabut ne partagea pas la satisfaction commune. Il ne voulut même pas pénétrer dans les galeries du massif et resta à bord de sa tartane.
« Il craint sans doute, dit Ben-Zouf, qu’on ne lui fasse payer son loyer ! Mais bah ! Avant peu, il sera forcé dans son gîte, ce vieux renard, et le froid le chassera hors de son trou ! »
Le soir, on pendit la crémaillère, et un bon repas, dont les mets furent cuits au feu volcanique, rassembla tout ce petit monde dans la grande salle. Plusieurs toasts, dont la cave de la Dobryna fournit les éléments en vins de France, furent portés au gouverneur général et à son « conseil d’administration ». Ben-Zouf, naturellement, en prit pour lui une bonne part.
Ce fut très gai. Les Espagnols se signalèrent par leur entrain. L’un prit sa guitare, l’autre ses castagnettes, et tous de chanter en chœur. À son tour, Ben-Zouf fit entendre le célèbre « refrain du zouave », si connu dans l’armée française, mais dont le charme ne peut être apprécié que de ceux qui l’ont entendu exécuter par un virtuose tel que l’ordonnance du capitaine Servadac :
Misti goth dar dar tire lyre :
Flic ! floc ! flac ! lirette, lira !
Far la rira,
Tour tala rire,
Tour la Ribaud,
Ricandeau,
Sans repos, répit, répit repos, ris pot, ripette !
Si vous attrapez mon refrain,
Fameux vous êtes.
Puis un bal fut improvisé, – le premier, sans doute, qui eût été donné sur Gallia. Les matelots russes essayèrent quelques danses de leur pays, que le public goûta fort, même après les merveilleux fandangos des Espagnols. Un pas, très connu à l’Élysée-Montmartre, fut même exécuté par Ben-Zouf avec autant d’élégance que de vigueur, et valut à l’aimable chorégraphe les sincères compliments de Negrete.
Il était neuf heures, lorsque se termina cette fête d’inauguration. On sentit alors le besoin de prendre l’air, car, les danses et la température aidant, il faisait vraiment chaud dans la grande salle.
Ben-Zouf, précédant ses amis, s’engagea dans la galerie principale qui aboutissait au littoral de la Terre-Chaude. Le capitaine Servadac, le comte Timascheff et le lieutenant Procope les suivaient d’un pas plus modéré, lorsque des cris qui retentirent au-dehors les firent hâter leur marche. Cependant, ce n’étaient point des exclamations provoquées par la terreur, mais bien des bravos, des hurrahs, qui éclataient comme une mousquetade dans cette atmosphère sèche et pure.
Le capitaine Servadac et ses deux compagnons, arrivés à l’orifice de la galerie, aperçurent tout leur monde groupé, sur les roches. Ben-Zouf, la main dirigée vers le ciel, était dans l’attitude de l’extase.
« Ah ! monsieur le gouverneur général ! Ah ! Monseigneur ! s’écria l’ordonnance avec un accent de joie qu’on ne saurait rendre.
– Eh bien ? qu’y a-t-il ? demanda le capitaine Servadac.
– La lune ! » répondit Ben-Zouf.
Et, en effet, la lune sortait des brumes de la nuit et apparaissait pour la première fois sur l’horizon de Gallia !
Chapitre XXII
Qui se termine par une petite expérience assez curieuse de physique amusante
La lune ! Si c’était la lune, pourquoi avait-elle disparu ? Et si elle reparaissait, d’où venait-elle ? Jusqu’alors, aucun satellite n’avait accompagné Gallia dans son mouvement de translation autour du soleil. L’infidèle Diane venait-elle donc d’abandonner la terre pour passer au service du nouvel astre ?
« Non ! c’est impossible, dit le lieutenant Procope. La terre est à plusieurs millions de lieues de nous, et la lune n’a pas discontinué de graviter autour d’elle !
– Eh ! nous n’en savons rien, fit observer Hector Servadac. Pourquoi la lune ne serait-elle pas tombée depuis peu dans le centre d’attraction de Gallia, et devenue son satellite ?
– Elle se serait déjà montrée sur notre horizon, dit le comte Timascheff, et nous n’aurions pas attendu trois mois avant de la revoir.
– Ma foi ! répondit le capitaine Servadac, tout ce qui nous arrive est si étrange !
– Monsieur Servadac, reprit le lieutenant Procope, l’hypothèse que l’attraction de Gallia ait été assez forte pour enlever à la terre son satellite est absolument inadmissible !
– Bon, lieutenant ! répondit le capitaine Servadac. Et qui vous dit que le même phénomène qui nous a arrachés au globe terrestre n’a pas, du même coup, dévoyé la lune ? Errante alors dans le monde solaire, elle serait venue s’attacher à nous…
– Non, capitaine, non, répondit le lieutenant Procope, et pour une raison sans réplique !
– Et quelle est cette raison ?
– C’est que la masse de Gallia étant évidemment inférieure à celle du satellite terrestre, c’est Gallia qui serait devenue sa lune, et non lui qui fût devenu la sienne.
– Je vous accorde cela, lieutenant, reprit Hector Servadac. Mais qui prouve que nous ne sommes pas lune de lune, et que, le satellite terrestre ayant été lancé sur une orbite nouvelle, nous ne l’accompagnons pas dans le monde interplanétaire ?
– Tenez-vous beaucoup à ce que je réfute cette nouvelle hypothèse ? demanda le lieutenant Procope.
– Non, répondit en souriant le capitaine Servadac, car, en vérité, si notre astéroïde n’était qu’un sous-satellite, il n’emploierait pas trois mois à faire le demi-tour de la lune, et celle-ci nous serait déjà apparue plusieurs fois depuis la catastrophe ! »
Pendant cette discussion, le satellite de Gallia, quel qu’il fût, montait rapidement sur l’horizon, – ce qui justifiait déjà le dernier argument du capitaine Servadac. On put donc l’observer avec attention. Les lunettes furent apportées, et bientôt il fut constant que ce n’était pas là l’ancienne Phœbé des nuits terrestres.
En effet, bien que ce satellite parût plus rapproché de Gallia que la lune ne l’est de la terre, il semblait être beaucoup plus petit, et il ne présentait en surface que la dixième partie du satellite terrestre. Ce n’était donc qu’une réduction de lune, qui réfléchissait assez faiblement la lumière du soleil et n’eût pas éteint les étoiles de huitième grandeur. Elle s’était levée dans l’ouest, précisément en opposition avec l’astre radieux, et elle devait être pleine en ce moment. Quant à la confondre avec la lune, ce n’était pas possible. Le capitaine Servadac dut convenir qu’on n’y voyait ni mers, ni rainures, ni cratères, ni montagnes, ni aucun de ces détails qui se dessinent si nettement sur les cartes sélénographiques. Ce n’était plus cette douce figure de la sœur d’Apollon qui, fraîche et jeune selon les uns, vieille et ridée suivant les autres, contemple tranquillement depuis tant de siècles les mortels sublunaires.
Donc, c’était une lune spéciale, et, ainsi que le fit observer le comte Timascheff, très probablement quelque astéroïde que Gallia avait capté en traversant la zone des planètes télescopiques. Maintenant, s’agissait-il de l’une des cent soixante-neuf petites planètes cataloguées à cette époque, ou de quelque autre dont les astronomes n’avaient pas encore connaissance ? peut-être le saurait-on plus tard. Il y a tel de ces astéroïdes, à dimensions extrêmement réduites, dont un bon marcheur ferait aisément le tour en vingt-quatre heures. Leur masse, dans ce cas, est donc très inférieure à la masse de Gallia, dont la puissance attractive avait parfaitement pu s’exercer sur un de ces microcosmes en miniature.
La première nuit passée à Nina-Ruche s’écoula sans aucun incident. Le lendemain, la vie commune fut organisée définitivement. « Monseigneur le gouverneur », ainsi que disait emphatiquement Ben-Zouf, n’entendait pas que l’on restât à rien faire. Par-dessus tout, en effet, le capitaine Servadac redoutait l’oisiveté et ses mauvaises conséquences. Les occupations journalières furent donc réglées avec le plus grand soin, et le travail ne manquait pas. Le soin des animaux domestiques constituait une assez grosse besogne. La préparation des conserves alimentaires, la pêche, tandis que la mer était libre encore, l’aménagement des galeries qu’il fallut évider en de certains endroits pour les rendre plus praticables, mille détails enfin qui se renouvelaient sans cesse, ne laissèrent pas un instant les bras oisifs.
Il convient d’ajouter que la plus complète entente régnait dans la petite colonie. Russes et Espagnols s’accordaient parfaitement et commençaient à employer quelques mots de ce français, qui était la langue officielle de Gallia. Pablo et Nina étaient devenus les élèves du capitaine Servadac, qui les instruisait. Quant à les amuser, c’était l’affaire de Ben-Zouf. L’ordonnance leur apprenait non seulement sa langue, mais le parisien, qui est encore plus distingué. Puis il leur promettait de les conduire un jour dans une ville, « bâtie au pied d’une montagne », qui n’avait pas sa pareille au monde et dont il faisait des descriptions enchanteresses. On devine de quelle ville l’enthousiaste professeur voulait parler.
Une question d’étiquette fut également réglée à cette époque.
On se souvient que Ben-Zouf avait présenté son capitaine comme le gouverneur général de la colonie. Mais, ne se contentant pas de lui donner ce titre, il le qualifiait de « Monseigneur » à tout propos. Cela finit par agacer particulièrement Hector Servadac, qui enjoignit à son ordonnance de ne plus lui donner cette appellation honorifique.
« Cependant, Monseigneur ?… répondait invariablement Ben-Zouf.
– Te tairas-tu, animal !
– Oui, Monseigneur ! »
Enfin, le capitaine Servadac, ne sachant plus comment se faire obéir, dit un jour à Ben-Zouf :
« Veux-tu enfin renoncer à m’appeler Monseigneur !
– Comme il vous plaira, Monseigneur, répondit Ben-Zouf.
– Mais, entêté, sais-tu bien ce que tu fais en m’appelant ainsi ?
– Non, Monseigneur.
– Ignores-tu ce que veut dire ce mot, que tu emploies sans même le comprendre ?
– Non, Monseigneur !
– Eh bien, cela veut dire : « Mon vieux » en latin, et tu manques au respect dû à ton supérieur, quand tu l’appelles mon vieux ! »
Et, ma foi, depuis cette petite leçon, l’honorifique qualification disparut du vocabulaire de Ben-Zouf.
Cependant, les grands froids n’étaient pas arrivés avec la dernière quinzaine de mars, et, par conséquent, Hector Servadac et ses compagnons ne se séquestrèrent pas encore. Quelques excursions furent même organisées le long du littoral et à la surface de ce nouveau continent. On l’explora dans un rayon de cinq ou six kilomètres autour de la Terre-Chaude. C’était toujours l’horrible désert rocheux, sans trace de végétation. Quelques filets d’eau congelée, ça et là des plaques de neige, provenant des vapeurs condensées dans l’atmosphère, indiquaient l’apparition de l’élément liquide à sa surface. Mais que de siècles, sans doute, se passeraient avant qu’un fleuve eût pu creuser son lit dans ce sol pierreux et rouler ses eaux jusqu’à la mer ! Quant à cette concrétion homogène, à laquelle les Galliens avaient donné le nom de Terre-Chaude, était-ce un continent, était-ce une île, s’étendait-elle ou non jusqu’au pôle austral ? on ne pouvait le dire, et une expédition à travers ces cristallisations métalliques devait être considérée comme impossible.
Du reste, le capitaine Servadac et le comte Timascheff purent se former une idée générale de cette contrée, en l’observant un jour du sommet du volcan. Ce mont se dessinait à l’extrémité du promontoire de la Terre-Chaude, et il mesurait environ neuf cents à mille mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer. C’était un énorme bloc, assez régulièrement construit, qui affectait la forme d’un cône tronqué. À la troncature même s’évasait l’étroit cratère par lequel s’épanchaient les matières éruptives que couronnait incessamment un immense panache de vapeurs.
Ce volcan, transporté sur l’ancienne terre, n’eût pas été gravi sans difficultés, sans fatigues. Ses pentes très raides, ses déclivités fort glissantes ne se fussent aucunement prêtées aux efforts des ascensionnistes les plus déterminés. En tout cas, cette expédition eût exigé une grande dépense de forces, et son but n’aurait pas été atteint sans peine. Ici, au contraire, grâce à la sérieuse diminution de la pesanteur et à l’accroissement de la puissance musculaire qui en était la conséquence, Hector Servadac et le comte Timascheff accomplirent des prodiges de souplesse et de vigueur. Un chamois n’eût pas été plus agile à s’élancer d’une roche à l’autre, un oiseau n’aurait pas couru plus légèrement sur ces étroites arêtes qui côtoyaient l’abîme. À peine mirent-ils une heure à s’élever des trois mille pieds qui séparaient du sol la cime de la montagne. Lorsqu’ils arrivèrent sur les bords du cratère, ils n’étaient pas plus fatigués que s’ils eussent marché pendant un kilomètre et demi en suivant une ligne horizontale. Décidément, si l’habitabilité de Gallia présentait certains inconvénients, elle offrait aussi quelques avantages.
De la cime du mont, les deux explorateurs, la lunette aux yeux, purent reconnaître que l’aspect de l’astéroïde restait sensiblement le même. Au nord s’étendait l’immense mer Gallienne, unie comme une glace, car il ne faisait pas plus de vent que si les gaz de l’air eussent été solidifiés par les froids de la haute atmosphère. Un petit point, légèrement estompé dans la brume, marquait la place occupée par l’île Gourbi. À l’est et à l’ouest se développait la plaine liquide, déserte comme toujours.
Vers le sud, au-delà des limites de l’horizon, allait se perdre la Terre-Chaude. Ce bout de continent semblait former un vaste triangle dont le volcan formait le sommet, sans qu’on pût en apercevoir la base. Vu de cette hauteur, qui aurait dû en niveler toutes les aspérités, le sol de ce territoire inconnu ne paraissait pas être praticable. Ces millions de lamelles hexagonales qui le hérissaient l’eussent rendu absolument impropre à la marche d’un piéton.
« Un ballon ou des ailes ! dit le capitaine Servadac, voilà ce qu’il nous faudrait pour explorer ce nouveau territoire ! Mordioux ! Nous sommes emportés sur un véritable produit chimique, aussi curieux, à coup sûr, que ceux qu’on expose sous la vitrine des muséums !
– Vous remarquez, capitaine, dit le comte Timascheff, combien la convexité de Gallia s’accuse rapidement à nos regards, et, par conséquent, combien est relativement courte la distance qui nous sépare de l’horizon ?
– Oui, comte Timascheff, répondit Hector Servadac. C’est l’effet, plus agrandi, que j’avais déjà observé du haut des falaises de l’île. Pour un observateur placé à une hauteur de mille mètres sur notre ancienne terre, l’horizon ne se fermerait qu’à une distance plus considérable.
– C’est un bien petit globe que Gallia, si on le compare au sphéroïde terrestre ! répondit le comte Timascheff.
– Sans doute, mais il est plus que suffisant pour la population qui l’habite ! Remarquez, d’ailleurs, que sa partie fertile se réduit actuellement aux trois cent cinquante hectares cultivés de l’île Gourbi.
– Oui, capitaine, partie fertile pendant deux ou trois mois d’été, et infertile pendant des milliers d’années d’hiver peut-être !
– Que voulez-vous ? répondit le capitaine Servadac en souriant. On ne nous a pas consultés avant de nous embarquer sur Gallia, et le mieux est d’être philosophes !
– Non seulement philosophes, capitaine, mais reconnaissants aussi envers Celui dont la main a allumé les laves de ce volcan ! Sans cet épanchement des feux de Gallia, nous étions condamnés à périr par le froid.
– Et j’ai le ferme espoir, comte Timascheff, que ces feux ne s’éteindront pas avant la fin…
– Quelle fin, capitaine ?
– Celle que Dieu voudra ! Lui sait, et il n’y a que Lui qui sache ! »
Le capitaine Servadac et le comte Timascheff, après avoir jeté un dernier regard sur le continent et la mer, songèrent à redescendre. Mais, auparavant, ils voulurent observer le cratère du volcan. Ils remarquèrent, tout d’abord, que l’éruption s’accomplissait avec un calme assez singulier. Elle n’était pas accompagnée de ces fracas désordonnés, de ces tonnerres assourdissants, qui signalent ordinairement les projections de matières volcaniques. Ce calme relatif ne pouvait échapper à l’attention des explorateurs. Il n’y avait même pas bouillonnement de laves. Ces substances liquides, portées à l’état incandescent, s’élevaient dans le cratère par un mouvement continu, et elles s’épanchaient tranquillement, comme le trop-plein d’un paisible lac qui s’enfuit par son déversoir. Que l’on permette cette comparaison : le cratère ne ressemblait point à une bouilloire, soumise à un feu ardent, et dont l’eau s’échappe avec violence ; c’était plutôt une cuvette, emplie jusqu’aux bords, qui se déversait sans effort et presque sans bruit. Aussi, point d’autres matières éruptives que ces laves, point de jets de pierres ignées à travers les volutes fuligineuses qui couronnaient la cime du mont, point de cendres mêlées à ces fumées, – ce qui expliquait pourquoi la base de la montagne n’était pas semée de ces pierres ponces, de ces obsidiennes et autres minéraux d’origine plutonienne, qui parsèment le sol aux approches des volcans. Il ne se voyait pas non plus un seul bloc erratique, puisque aucun glacier n’avait pu se former encore.
Cette particularité, ainsi que le fit observer le capitaine Servadac, était de bon augure et permettait de croire à l’infinie continuation de l’éruption volcanique. La violence, dans l’ordre moral comme dans l’ordre physique, est exclusive de la durée. Les orages les plus terribles, aussi bien que les emportements les plus excessifs, ne se prolongent jamais. Ici, cette eau de feu coulait avec tant de régularité, s’épanchait avec tant de calme, que la source qui l’alimentait semblait devoir être intarissable. En présence des chutes du Niagara, dont les eaux d’amont glissent si paisiblement sur le trapp de leur lit, la pensée ne vient pas qu’elles puissent s’arrêter jamais dans leur course. Au sommet de ce volcan, l’effet était le même, et la raison eût refusé d’admettre que ces laves ne dussent pas éternellement déborder de leur cratère.
Ce jour-là, un changement se produisit dans l’état physique de l’un des éléments de Gallia ; mais il faut constater qu’il fut l’œuvre des colons eux-mêmes.
En effet, toute la colonie étant installée à Terre-Chaude, après l’entier déménagement de l’île Gourbi, il parut convenable de provoquer la solidification de la surface de la mer Gallienne. Les communications avec l’île seraient alors possibles sur les eaux glacées, et les chasseurs verraient par là même s’agrandir leur terrain de chasse. Donc, ce jour-là, le capitaine Servadac, le comte Timascheff et le lieutenant Procope réunirent toute la population sur un rocher qui dominait la mer à l’extrémité même du promontoire.
Malgré l’abaissement de la température, la mer était liquide encore. Cette circonstance était due à son absolue immobilité, car pas un souffle d’air n’en troublait la surface. Dans ces conditions, on le sait, l’eau peut, sans se congeler, supporter un certain nombre de degrés au-dessous de zéro. Un simple choc, il est vrai, suffit à la faire prendre subitement.
La petite Nina et son ami Pablo n’avaient eu garde de manquer au rendez-vous.
« Mignonne, dit le capitaine Servadac, saurais-tu bien lancer un morceau de glace dans la mer ?
– Oh oui ! répondit la petite fille, mais mon ami Pablo le jetterait bien plus loin que moi.
– Essaie tout de même », reprit Hector Servadac, en mettant un petit fragment de glace dans la main de Nina.
Puis, il ajouta :
« Regarde bien, Pablo ! Tu vas voir quelle petite fée est notre petite Nina ! »
Nina balança deux ou trois fois sa main et lança le morceau de glace, qui tomba dans l’eau calme… Aussitôt une sorte d’immense grésillement se fit entendre, qui se propagea jusqu’au-delà des limites de l’horizon.
La mer Gallienne venait de se solidifier sur sa surface tout entière !
Chapitre XXIII
Qui traite d’un événement de haute importance, lequel met en émoi toute la colonie Gallienne
Au 23 mars, trois heures après le coucher du soleil, la lune se leva sur l’horizon opposé, et les Galliens purent voir qu’elle entrait déjà dans son dernier quartier.
Ainsi, en quatre jours, le satellite de Gallia était passé de syzygie en quadrature, ce qui lui assignait une période de visibilité d’une semaine environ, et, par conséquent, des lunaisons de quinze à seize jours. Donc, pour Gallia, les mois lunaires avaient diminué de moitié comme les jours solaires.
Trois jours plus tard, le 26, la lune entrait en conjonction avec le soleil et disparaissait dans son irradiation.
« Reviendra-t-elle ? » dit Ben-Zouf, qui, pour avoir le premier signalé ce satellite, s’y intéressait de tout cœur.
Et vraiment, après tant de phénomènes cosmiques, dont la cause échappait encore aux Galliens, l’observation du brave Ben-Zouf n’était pas absolument oiseuse.
Le 26, le temps étant très pur, l’atmosphère très sèche, le thermomètre tomba à douze degrés centigrades.
À quelle distance Gallia se trouvait-elle alors du soleil ? Quel chemin avait-elle parcouru sur son orbite depuis la date indiquée au dernier document trouvé en mer ? Aucun des habitants de la Terre-Chaude n’eût pu le dire. La diminution apparente du disque solaire ne pouvait plus servir de base à un calcul, même approximatif. Il était à regretter que le savant anonyme n’eût pas adressé de nouvelles notices donnant le résultat de ses dernières observations. Le capitaine Servadac regrettait tout particulièrement que cette correspondance singulière avec un de ses compatriotes – il s’obstinait à le regarder comme tel – n’eût pas eu de suites.
« Après cela, dit-il à ses compagnons, il est bien possible que notre astronome ait continué à nous écrire… par étuis ou par barils, mais que ni les uns ni les autres ne soient arrivés à l’île Gourbi ou à la Terre-Chaude ! Et maintenant que la mer est prise, adieu tout espoir de recevoir la moindre lettre de cet original ! »
En effet, on le sait, la mer était entièrement congelée. Cette substitution de l’état solide à l’état liquide s’était opérée par un temps magnifique, et à un moment où pas un souffle d’air ne troublait les eaux galliennes. Aussi, leur surface solidifiée était-elle absolument unie, comme eût été celle d’un lac ou d’un bassin du Club des patineurs. Pas une intumescence, pas une boursouflure, pas une crevasse ! C’était une glace pure, sans une érosion, sans un seul défaut, qui s’étendait par-delà les limites de l’horizon.
Quelle différence avec l’aspect que présentent ordinairement les mers polaires aux abords de la banquise ! Là, tout n’est qu’icebergs, hummocks, glaçons accumulés les uns sur les autres et exposés aux plus capricieuses ruptures d’équilibre. Les ice-fields ne sont, à vrai dire, qu’une agglomération de morceaux de glace irrégulièrement ajustés, d’éboulis que le froid maintient dans les positions les plus bizarres, de montagnes à base fragile, qui dominent les plus hautes mâtures des baleiniers.
Rien n’est stable sur ces océans arctiques ou antarctiques, rien n’est immuable, la banquise n’est pas coulée en bronze, et un coup de vent, une modification de la température, y produisent des changements à vue d’un effet saisissant. Ce n’est donc qu’une succession de féeriques décors. Ici, au contraire, la mer Gallienne était définitivement fixée, et plus nettement encore qu’à l’époque où elle offrait une surface sensible à la brise. L’immense plaine blanche était plus unie que les plateaux du Sahara ou les steppes de la Russie, et pour longtemps sans doute. Sur les eaux emprisonnées de la mer, cette cuirasse, s’épaississant avec l’aggravation des froids, garderait sa rigidité jusqu’au dégel… si le dégel devait jamais se produire !
Les Russes étaient habitués aux phénomènes de congélation des mers du Nord, qui offrent l’aspect d’un champ irrégulièrement cristallisé. Ils ne considérèrent donc pas sans surprise cette mer Gallienne, plane comme un lac, – ni sans satisfaction, non plus, car le champ de glace, parfaitement poli, se prêtait merveilleusement aux exercices du patinage. La Dobryna possédait un assortiment de patins, qui furent mis à la disposition des amateurs. Les amateurs affluèrent. Les Russes donnèrent des leçons aux Espagnols, et bientôt, pendant ces beaux jours, par ces froids vifs mais supportables en l’absence de tout vent, il n’y eut pas un Gallien qui ne s’exerçât à décrire les courbes les plus élégantes. La petite Nina et le jeune Pablo firent merveille et recueillirent force bravos. Le capitaine Servadac, adroit à tout exercice de gymnastique, devint bientôt l’égal de son professeur le comte Timascheff. Ben-Zouf, lui-même, accomplit des prodiges, ayant d’ailleurs plus d’une fois patiné déjà sur l’immense bassin de la place Montmartre, « une mer, quoi ! »
Ce genre d’exercice, très hygiénique par lui-même, devint en même temps une utile distraction pour les habitants de la Terre-Chaude. Le cas échéant, il pouvait aussi être un moyen de rapide locomotion. Et en effet, le lieutenant Procope, l’un des meilleurs patineurs de Gallia, fit plus d’une fois le trajet de la Terre-Chaude à l’île Gourbi, c’est-à-dire une dizaine de lieues, dans l’espace de deux heures.
« Voilà qui remplacera à la surface de Gallia les chemins de fer de l’ancien monde, disait le capitaine Servadac. Au surplus, le patin n’est pas autre chose qu’un rail mobile, fixé au pied du voyageur ! »
Cependant, la température s’abaissait progressivement, et la moyenne du thermomètre était de quinze à seize degrés centigrades au-dessous de zéro. En même temps que la chaleur, la lumière diminuait aussi, comme si le disque solaire eût été indéfiniment masqué par la lune dans une éclipse partielle. Une sorte de demi-teinte se répandait sur tous les objets et ne laissait pas d’impressionner tristement le regard. C’étaient là des causes d’une sorte d’assombrissement moral, contre lesquelles il convenait de réagir. Comment, aussi, ces exilés du globe terrestre n’auraient-ils pas songé à la solitude qui s’était faite autour d’eux, si étroitement mêlés jusqu’alors au mouvement humain ? Comment auraient-ils oublié que la terre, gravitant déjà à des millions de lieues de Gallia, s’en éloignait toujours ? Pouvaient-ils supposer qu’ils la reverraient jamais, puisque ce bloc, détaché d’elle, s’enfonçait de plus en plus dans les espaces interplanétaires ? Rien ne prouvait même qu’il n’abandonnerait pas un jour ces espaces, qui sont soumis au pouvoir de l’astre radieux, pour courir le monde sidéral et se mouvoir dans le centre d’attraction de quelque nouveau soleil.
Le comte Timascheff, le capitaine Servadac et le lieutenant Procope étaient évidemment les seuls de la colonie gallienne qui pussent songer à ces éventualités. Toutefois, leurs compagnons, sans pénétrer aussi profondément les secrets et les menaces de l’avenir, subissaient, et comme à leur insu, les effets d’une situation sans précédent dans les annales du monde. Il fallut donc s’ingénier à les distraire, soit en les occupant, soit en les amusant, et l’exercice du patinage fit une heureuse diversion aux monotones travaux de chaque jour.
Lorsqu’on a dit que tous les habitants de la Terre-Chaude prenaient plus ou moins part à ce salutaire exercice, c’était, bien entendu, en exceptant Isac Hakhabut.
En effet, malgré la rigueur de la température, Hakhabut n’avait pas reparu depuis son arrivée de l’île Gourbi. Le capitaine Servadac, ayant rigoureusement défendu de communiquer avec lui, personne n’était allé le voir à la Hansa. Mais une petite fumée, qui s’échappait par le tuyau de la cabine, indiquait que le propriétaire de la tartane demeurait toujours à son bord. Cela devait lui coûter, sans doute, de brûler de son combustible, si peu que ce fût, lorsqu’il aurait pu profiter gratuitement de la chaleur volcanique de Nina-Ruche. Mais il préférait ce surcroît de dépense à l’obligation où il eût été d’abandonner la Hansa pour partager la vie commune. En son absence, qui donc eût veillé sur la précieuse cargaison ?
Du reste, la tartane et la goélette avaient été disposées de manière à supporter les fatigues d’un long hivernage. Le lieutenant Procope y avait donné tous ses soins. Solidement affourchées dans la crique, prises maintenant dans leur carapace glacée, elles étaient toutes deux immobiles. Mais on avait eu la précaution, ainsi que le font les hiverneurs des mers arctiques, de tailler la glace en biseau sous leur coque. De cette façon, la masse durcie des eaux se rejoignait sous la quille et ne venait plus exercer sa puissante pression contre les flancs des deux embarcations, avec le risque de les écraser. Si le niveau de l’ice-field s’élevait, la goélette et la tartane s’exhausseraient d’autant ; mais, avec le dégel, on pouvait espérer qu’elles retrouveraient la ligne de flottaison convenable à leur élément naturel.
La mer Gallienne était donc maintenant congelée sur toute son étendue, et, dans sa dernière visite à l’île Gourbi, le lieutenant Procope avait pu constater que le champ de glace se développait à perte de vue dans le nord, l’est et l’ouest.
Un seul endroit de ce vaste bassin avait résisté au phénomène de solidification. C’était, au bas de la caverne centrale, cette espèce d’étang sur lequel se déversait la nappe de laves incandescentes. Là, l’eau demeurait absolument libre dans son cadre de roches, et les glaçons, qui tendaient à se former sous l’action du froid, étaient aussitôt dévorés par le feu. L’eau sifflait et se volatilisait au contact des laves, et un bouillonnement continu tenait ses molécules dans une sorte d’ébullition permanente. Cette petite portion de mer, toujours liquide, aurait dû permettre aux pêcheurs d’exercer leur art avec quelque succès. Mais, comme le disait Ben-Zouf, « les poissons y étaient déjà trop cuits pour mordre ! »
Pendant les premiers jours d’avril, le temps changea, le ciel se couvrit sans provoquer, cependant, aucun relèvement de la température. C’est que la baisse thermométrique ne tenait pas à un état particulier de l’atmosphère, ni au plus ou moins de vapeurs dont elle était saturée. En effet, il n’en était plus de Gallia comme des contrées polaires du globe, nécessairement soumises à l’influence atmosphérique, et dont les hivers éprouvent certaines intermittences sous l’influence des vents qui sautent d’un point du compas à l’autre. Le froid du nouveau sphéroïde ne pouvait causer d’importantes variations thermométriques. Il n’était dû, en somme, qu’à son éloignement de la source de toute lumière et de toute chaleur, et il irait croissant jusqu’à ce qu’il eût atteint la limite assignée par Fourier aux températures de l’espace.
Ce fut une véritable tempête qui se déclara à cette époque, tempête sans pluie ni neige, mais pendant laquelle le vent se déchaîna avec une incomparable violence. En se précipitant à travers la nappe de feu qui fermait extérieurement la baie de la salle commune, il y produisait les plus étranges effets. Il fallut se garer sévèrement des laves qu’il repoussait à l’intérieur. Mais il n’était pas à craindre qu’il les éteignît. Au contraire, en les saturant d’oxygène, cet ouragan en activait l’incandescence, comme eût fait un immense ventilateur. Quelquefois, tant sa poussée était violente, le rideau liquide se crevait un instant, et un courant froid pénétrait dans la grande salle, mais la déchirure se refermait presque aussitôt, et ce renouvellement de l’air intérieur était plutôt avantageux que nuisible.
Le 4 avril, la lune, nouvellement acquise, avait commencé à se détacher de l’irradiation solaire sous la forme d’un croissant délié. Elle reparaissait donc après une absence de huit jours environ, ainsi que sa révolution, déjà observée, avait pu le faire prévoir. Les craintes, plus ou moins justifiées, que l’on avait eues de ne pas la revoir, ne se réalisèrent donc pas, à l’extrême satisfaction de Ben-Zouf, et le nouveau satellite sembla décidé à faire régulièrement son service bi-mensuel autour de Gallia.
On se souvient que, par suite de la disparition de toute autre terre cultivée, les oiseaux, emportés dans l’atmosphère gallienne, s’étaient réfugiés à l’île Gourbi. Là, ce sol cultivé avait amplement suffi à leur nourriture pendant les beaux jours, et c’était par milliers que, venus de tous les points de l’astéroïde, on les avait vus s’abattre sur l’île.
Mais, avec l’arrivée des grands froids, les champs n’avaient pas tardé à se revêtir de neige, et la neige, bientôt transformée en glace compacte, ne laissait plus la possibilité aux becs les plus solidement emmanchés de pénétrer jusqu’au sol. De là, émigration générale des oiseaux, qui, par instinct, se jetèrent en masse sur la Terre-Chaude.
Ce continent, il est vrai, n’avait aucune nourriture à leur offrir, mais il était habité. Au lieu de fuir la présence de l’homme, les oiseaux s’empressaient alors à la rechercher. Tous les détritus, jetés journellement en dehors des galeries, disparaissaient instantanément, mais il s’en fallait de beaucoup qu’ils suffissent à alimenter ces milliers d’individus de toute espèce. Bientôt même, poussés autant par le froid que par la faim, quelques centaines de volatiles se hasardèrent dans l’étroit tunnel et élirent domicile à l’intérieur de Nina-Ruche.
Il fallut donc recommencer à leur donner la chasse, car la position n’eût plus été tenable. Ce fut une diversion aux occupations quotidiennes, et les chasseurs de la petite colonie ne chômèrent pas. Le nombre de ces oiseaux était si considérable, que ce fut bientôt comme un envahissement. Ils étaient si affamés, et, par conséquent, si rapaces, qu’ils enlevaient des bribes de viande ou des miettes de pain jusque dans les mains des convives de la grande salle. On les poursuivait à coups de pierres, à coups de bâton, à coups de fusil même. Mais ce ne fut qu’après une suite de combats acharnés que l’on parvint à se débarrasser en partie de ces incommodes visiteurs, après que quelques couples eurent été conservés pour le renouvellement de l’espèce.
Ben-Zouf était le grand ordonnateur de ces chasses. Comme il se démenait, comme il criait ! De quelles invectives soldatesques il accablait les malheureux volatiles ! Combien on en mangea, pendant quelques jours, de ceux qui se distinguaient par leurs qualités comestibles, tels que canards sauvages, pilets, perdrix, bécasses, bécassines, etc. ! Il est même à supposer que les chasseurs les tuaient avec une préférence marquée.
Enfin, l’ordre commença à se rétablir dans Nina-Ruche. On ne compta plus enfin qu’une centaine d’intrus, qui nichèrent dans les trous de roche et qu’il n’était pas facile de déloger. Aussi, arriva-t-il que ces intrus finirent par se considérer comme locataires du lieu et n’en laissèrent-ils aucun autre s’y introduire. Il y eut donc comme une trêve des partis qui luttaient pour l’indépendance de leur domicile, et, par tacite transaction, on laissa ces entêtés faire la police de l’habitation. Et comme ils la faisaient ! Le malheureux oiseau, égaré dans les galeries, sans droit ni privilège, était vite chassé ou occis par ses impitoyables congénères.
Un jour, le 15 avril, des cris retentirent vers l’orifice de la galerie principale. C’était Nina qui appelait à son secours.
Pablo reconnut sa voix, et, devançant Ben-Zouf, il se hâta d’accourir à l’aide de sa petite amie.
« Viens ! viens ! criait Nina. Ils veulent me le tuer ! »
Pablo, se précipitant, aperçut une demi-douzaine de gros goélands qui étaient aux prises avec la petite fille. Armé d’un bâton, il se jeta dans la mêlée et parvint à chasser ces rapaces oiseaux de mer, non sans avoir reçu quelques bons coups de bec.
« Qu’as-tu donc, Nina ? demanda-t-il.
– Tiens, Pablo ! » répondit la petite fille, en montrant un oiseau qu’elle serrait contre sa poitrine.
Ben-Zouf, qui arrivait en ce moment, prit l’oiseau des mains de la petite fille et s’écria :
« C’est un pigeon ! »
C’était, en effet, un pigeon, et même un échantillon de l’espèce des pigeons voyageurs, car il avait les ailes légèrement échancrées et tronquées vers leur extrémité.
« Ah ! fit soudain Ben-Zouf. De par tous les saints de Montmartre, il a un sac au cou ! »
Quelques instants après, le pigeon était entre les mains du capitaine Servadac, et ses compagnons, réunis autour de lui dans la grande salle, le regardaient avidement.
« Voilà des nouvelles de notre savant qui nous arrivent ! s’écria le capitaine Servadac. La mer n’étant plus libre, il emploie les oiseaux pour porter ses lettres ! Ah ! puisse-t-il, cette fois, avoir donné sa signature et surtout son adresse ! »
Le petit sac avait été en partie déchiré pendant la lutte du pigeon contre les goélands. Il fut ouvert, et on y trouva une courte notice, laconiquement rédigée et dont voici les termes :
« Gallia.
« Chemin parcouru du 1er mars au 1er avril : 39 700 000 L.
« Distance du soleil : 110 000 000 L. !
« Capté Nérina en passant.
« Vivres vont manquer, et… »
Le reste de la dépêche, déchiré par les coups de bec des goélands, n’était plus lisible.
« Ah ! malchance maudite ! s’écria le capitaine Servadac. La signature était là, évidemment, et la date, et le lieu d’origine de la notice ! Elle est toute en français, cette fois, et c’est bien un Français qui l’a écrite ! Et ne pouvoir secourir cet infortuné ! »
Le comte Timascheff et le lieutenant Procope retournèrent sur le lieu du combat, espérant retrouver, sur quelque lambeau arraché, un nom, une signature, un indice qui pût les mettre sur la voie !… Leurs recherches furent inutiles.
« Ne saurons-nous donc jamais où se trouve ce dernier survivant de la terre ?… s’écria le capitaine Servadac.
– Ah ! fit soudain la petite Nina. Mon ami Zouf, vois donc ! »
Et, ce disant, elle montrait à Ben-Zouf le pigeon, qu’elle avait soigneusement gardé entre ses deux mains.
Sur l’aile gauche de l’oiseau, on distinguait très nettement l’empreinte d’un timbre humide, et ce timbre portait en exergue ce seul mot, qui disait ce qu’il importait surtout de savoir :
« Formentera. »
Chapitre XXIV
Dans lequel le capitaine Servadac et le lieutenant Procope apprennent enfin le mot de cette énigme cosmographique
« FORMENTERA ! » s’écrièrent presque à la fois le comte Timascheff et le capitaine Servadac.
Ce nom était celui d’une petite île du groupe des Baléares, situé dans la Méditerranée. Il indiquait d’une façon précise le point qu’occupait alors l’auteur des documents. Mais que faisait là ce Français, et, s’il y était, vivait-il encore ?
C’était évidemment de Formentera même que ce savant avait lancé les diverses notices, dans lesquelles il indiquait les positions successives de ce fragment du globe terrestre qu’il nommait Gallia.
En tout cas, le document, apporté par le pigeon, prouvait qu’à la date du 1er avril, soit quinze jours auparavant, il était encore à son poste. Mais, entre cette dépêche et les documents antérieurs, il existait cette différence importante que tout indice de satisfaction y manquait. Plus de « Va bene », d’« all right », de « nil desperandum ! » En outre, la dépêche, uniquement rédigée en français, contenait un appel suprême, puisque les vivres allaient manquer à Formentera.
Ces observations furent faites en quelques mots par le capitaine Servadac. Puis :
« Mes amis, ajouta-t-il, nous allons immédiatement courir au secours de cet infortuné…
– Ou de ces infortunés, ajouta le comte Timascheff. – Capitaine, je suis prêt à partir avec vous.
– Il est évident, dit alors le lieutenant Procope, que la Dobryna a passé près de Formentera, lorsque nous avons exploré l’emplacement des anciennes Baléares. Si donc nous n’avons eu connaissance d’aucune terre, c’est que, comme à Gibraltar, comme à Ceuta, il ne reste plus qu’un étroit îlot de tout cet archipel.
– Si petit qu’il soit, cet îlot, nous le retrouverons ! répondit le capitaine Servadac. – Lieutenant Procope, quelle distance sépare la Terre-Chaude de Formentera ?
– Cent vingt lieues environ, capitaine. Vous demanderai-je comment vous comptez faire ce trajet ?
– À pied, évidemment, répondit Hector Servadac, puisque la mer n’est plus libre, mais sur nos patins ! N’est-ce pas, comte Timascheff ?
– Partons, capitaine, dit le comte, que les questions d’humanité ne trouvaient jamais ni indifférent ni irrésolu.
– Père, dit vivement le lieutenant Procope, je voudrais te faire une observation, non pour t’empêcher d’accomplir un devoir, mais, au contraire, pour te mettre à même de l’accomplir plus sûrement.
– Parle, Procope.
– Le capitaine Servadac et toi, vous allez partir. Or, le froid est devenu excessif, le thermomètre est à vingt-deux degrés au-dessous de zéro, et il règne une violente brise du sud qui rend cette température insoutenable. En admettant que vous fassiez vingt lieues par jour, il vous faudra six jours pour atteindre Formentera. En outre, des vivres sont nécessaires, non seulement pour vous, mais pour ceux ou celui que vous allez secourir…
– Nous irons le sac au dos, comme deux soldats, répondit vivement le capitaine Servadac, qui ne voulait voir que les difficultés, non les impossibilités d’un pareil voyage.
– Soit, répondit froidement le lieutenant Procope. Mais il faudra nécessairement, à plusieurs reprises, vous reposer en route. Or, le champ de glace est uni, et vous n’aurez pas la ressource de pouvoir tailler une hutte dans un glaçon, à la manière des Esquimaux.
– Nous courrons jour et nuit, lieutenant Procope, répondit Hector Servadac, et, au lieu de six jours, nous n’en mettrons que trois, que deux à atteindre Formentera !
– Soit encore, capitaine Servadac. J’admets que vous arriviez dans ce délai de deux jours, – ce qui est matériellement impossible. Que ferez-vous de ceux que vous trouverez sur l’îlot, succombant au froid et à la faim ? Si vous les emportez mourants avec vous, ce sont des morts que vous ramènerez à la Terre-Chaude ! »
Les paroles du lieutenant Procope produisirent une impression profonde. Les impossibilités d’un voyage fait dans de telles conditions apparurent clairement aux yeux de tous. Il était évident que le capitaine Servadac et le comte Timascheff, sans abri sur cet immense ice-field, au cas où il surviendrait quelque chasse-neige qui les envelopperait dans ses tourbillons, tomberaient pour ne plus se relever.
Hector Servadac, entraîné par un vif sentiment de générosité, par la pensée du devoir à accomplir, voulait résister à l’évidence. Il s’entêtait contre la froide raison du lieutenant Procope. D’autre part, son fidèle Ben-Zouf n’était pas éloigné de le soutenir, se déclarant prêt à faire signer sa feuille de route avec celle de son capitaine, si le comte Timascheff hésitait à partir.
« Eh bien, comte ? demanda Hector Servadac.
– Je ferai ce que vous ferez, capitaine.
– Nous ne pouvons pas abandonner nos semblables, sans vivres, sans abri peut-être !…
– Nous ne le pouvons pas », répondit le comte Timascheff. Puis, se retournant vers Procope :
« S’il n’existe pas d’autre moyen d’atteindre Formentera que celui que tu repousses, lui dit-il, c’est celui-là que nous emploierons, Procope, et Dieu nous viendra en aide ! »
Le lieutenant, absorbé dans sa pensée, ne répondit pas à la demande du comte Timascheff.
« Ah ! si nous avions seulement un traîneau ! s’écria Ben-Zouf.
– Un traîneau serait facile à construire, répondit le comte Timascheff, mais où trouver des chiens ou des rennes pour le traîner ?
– N’avons-nous pas nos deux chevaux, que l’on pourrait ferrer à glace ? s’écria Ben-Zouf.
– Ils ne supporteraient pas cette température excessive et tomberaient en route ! répondit le comte.
– N’importe, dit alors le capitaine Servadac. Il n’y a pas à hésiter. Faisons le traîneau…
– Il est fait, dit le lieutenant Procope.
– Eh bien, attelons-y…
– Non, capitaine. Nous avons un moteur plus sûr et plus rapide que vos deux chevaux, qui ne résisteraient pas aux fatigues de ce voyage.
– Et c’est ?… demanda le comte Timascheff.
– Le vent », répondit le lieutenant Procope. Le vent, en effet ! Les Américains ont su merveilleusement l’utiliser pour leurs traîneaux à voile. Ces traîneaux rivalisent maintenant avec les express des rail-ways dans les vastes prairies de l’Union, et ont obtenu des vitesses de cinquante mètres à la seconde, soit cent quatre-vingts kilomètres à l’heure. Or, le vent, en ce moment, soufflait du sud en grande brise. Il pouvait donc imprimer à ce genre de véhicule une vitesse de douze à quinze lieues à l’heure. Il était donc possible, entre deux levers de soleil sur l’horizon de Gallia, d’atteindre les Baléares, ou, du moins, le seul îlot de l’archipel qui eût survécu à l’immense désastre. Le moteur était prêt à agir. Bien. Mais Procope avait ajouté que le traîneau était aussi prêt à partir. En effet, le youyou de la Dobryna, long d’une douzaine de pieds, et pouvant contenir cinq à six personnes, n’était-ce pas un traîneau tout fait ? Ne suffisait-il pas de lui ajouter deux fausses quilles en fer, qui, soutenant ses flancs, formeraient deux patins sur lesquels il glisserait ? Et quel temps fallait-il au mécanicien de la goélette pour ajuster ces deux quilles ? Quelques heures au plus. Alors, sur cet ice-field si parfaitement uni, sans un obstacle, sans une bosse, sans même une éraillure, la légère embarcation, enlevée par sa voile et courant vent arrière, ne filerait-elle pas avec une incomparable vitesse ? De plus, ce youyou pourrait être recouvert d’une sorte de toit en planche, doublé de forte toile.
Il abriterait ainsi ceux qui le dirigeraient à l’aller et ceux qu’il ramènerait au retour. Garni de fourrures, de provisions diverses, de cordiaux, d’un petit fourneau portatif alimenté à l’esprit-de-vin, il serait dans les plus favorables conditions pour atteindre l’îlot et rapatrier les survivants de Formentera.
On ne pouvait rien imaginer de mieux et de plus pratique. Une seule objection était à faire.
Le vent était bon pour pointer au nord, mais quand il faudrait revenir au sud…
« N’importe, s’écria le capitaine Servadac, ne pensons qu’à arriver ! Ensuite, nous songerons à revenir ! »
D’ailleurs, ce youyou, s’il ne pouvait courir au plus près comme fait une embarcation soutenue contre la dérive par son gouvernail, arriverait peut-être à biaiser avec le vent dans une certaine mesure. Ses quilles de fer, mordant la surface glacée, devaient lui assurer au moins l’allure du largue. Il était donc possible, si le vent ne changeait pas au retour, qu’il pût louvoyer pour ainsi dire et gagner dans le sud. Cela, on le verrait plus tard.
Le mécanicien de la Dobryna, aidé de quelques matelots, se mit aussitôt à l’œuvre. Vers la fin de la journée, le youyou, muni d’une double armature de fer recourbée à l’avant, protégé par un léger toit en forme de roufle, pourvu d’une sorte de godille métallique qui devait le maintenir tant soit peu contre les embardées, garni de provisions, d’ustensiles et de couvertures, était prêt à partir.
Mais, alors, le lieutenant Procope demanda à remplacer le comte Timascheff près du capitaine Servadac. D’une part, le youyou ne devait pas prendre plus de deux passagers, pour le cas où il aurait à ramener plusieurs personnes, et, d’autre part, la manœuvre de la voile aussi bien que la direction à suivre exigeaient la main et les connaissances d’un marin.
Le comte Timascheff insista, cependant, mais, le capitaine Servadac l’ayant instamment prié de le remplacer auprès de ses compagnons, il dut se rendre. Le voyage était plein de périls, en somme. Les passagers du youyou allaient être exposés à mille dangers. Il suffisait d’une tempête un peu violente pour que le fragile véhicule ne pût résister, et, si le capitaine Servadac ne devait pas revenir, le comte Timascheff pouvait seul être le chef naturel de la petite colonie… Il consentit donc à rester.
Quant à céder sa place, le capitaine Servadac ne l’eût pas voulu. C’était, à n’en pas douter, un Français qui réclamait secours et assistance, c’était donc à lui, officier français, de l’assister et de le secourir.
Le 16 avril, au soleil levant, le capitaine Servadac et le lieutenant Procope s’embarquèrent dans le youyou. Ils dirent adieu à leurs compagnons, dont l’émotion fut grande à les voir prêts à se lancer sur l’immense plaine blanche par un froid qui dépassait vingt-cinq degrés centigrades. Ben-Zouf avait le cœur gros. Les matelots russes et les Espagnols voulurent tous serrer la main du capitaine et du lieutenant. Le comte Timascheff étreignit sur sa poitrine le courageux officier et embrassa son fidèle Procope. Un bon baiser de la petite Nina, dont les grands yeux avaient peine à retenir de grosses larmes, termina cette touchante scène d’adieux. Puis, sous sa voile déployée, le youyou, emporté comme par une immense aile, disparut en quelques minutes au-delà de l’horizon.
La voilure du youyou se composait d’une brigantine et d’un foc. Celui-ci fut « traversé » de manière à porter vent arrière. La vitesse du léger véhicule fut donc excessive, et ses passagers ne l’estimèrent pas à moins de douze lieues à l’heure. Une ouverture ménagée à l’arrière du roufle permettait au lieutenant Procope de passer sa tête bien encapuchonnée, sans trop s’exposer au froid, et, au moyen de la boussole, il pouvait se diriger en droite ligne sur Formentera.
L’allure du youyou était d’une douceur extrême. Il n’éprouvait même pas ce désagréable frémissement, dont les trains ne sont pas exempts sur les chemins de fer les mieux établis. Moins pesant à la surface de Gallia qu’il ne l’eût été à la surface de la terre, il glissait sans éprouver ni roulis ni tangage, et dix fois plus vite qu’il ne l’avait jamais fait dans son élément naturel. Le capitaine Servadac et le lieutenant Procope se croyaient parfois enlevés dans l’air, comme si un aérostat les eût promenés au-dessus de l’ice-field. Mais ils ne quittaient point ce champ glacé, dont la couche supérieure se pulvérisait sous l’armature métallique du youyou, et ils laissaient derrière eux tout un nuage de poussière neigeuse.
Il fut alors aisé de reconnaître que l’aspect de cette mer congelée était partout le même. Pas un être vivant n’animait cette vaste solitude. L’effet était particulièrement triste. Cependant il s’en dégageait une sorte de poésie qui impressionna, chacun suivant son caractère, les deux compagnons de route. Le lieutenant Procope observait en savant, le capitaine Servadac en artiste, ouvert à toute émotion nouvelle. Quand le soleil vint à se coucher, lorsque ses rayons, frappant obliquement le youyou, projetèrent sur sa gauche l’ombre démesurée de ses voiles, lorsqu’enfin la nuit eut brusquement remplacé le jour, ils se rapprochèrent l’un de l’autre, mus par une involontaire attraction, et leurs mains se pressèrent silencieusement.
La nuit fut entièrement obscure, car la lune était nouvelle depuis la veille, mais les constellations brillaient d’un admirable éclat sur le ciel assombri. À défaut de boussole, le lieutenant Procope eût pu certainement se guider sur la nouvelle Polaire, qui resplendissait près de l’horizon. On comprend bien que, quelle que fût la distance qui séparait actuellement Gallia du soleil, cette distance était absolument insignifiante par rapport à l’incommensurable éloignement des étoiles.
Quant à cette distance de Gallia, elle était déjà considérable. La dernière notice l’établissait nettement. C’est à quoi pensait le lieutenant Procope, tandis que le capitaine Servadac, suivant un autre courant d’idées, ne songeait qu’à celui ou à ceux de ses compatriotes auxquels il portait secours.
La vitesse de Gallia le long de son orbite avait diminué de vingt millions de lieues du 1er mars au 1er avril, conformément à la seconde loi de Kepler. En même temps, sa distance au soleil s’était accrue de trente-deux millions de lieues. Elle se trouvait donc à peu près au milieu de la zone parcourue par les planètes télescopiques qui circulent entre les orbites de Mars et de Jupiter. C’est ce que prouvait, d’ailleurs, la prise de ce satellite qui, suivant la notice, était Nérina, l’un des derniers astéroïdes récemment découverts. Ainsi donc, Gallia s’éloignait toujours de son centre attractif, suivant une loi parfaitement déterminée. Or, ne pouvait-on espérer que l’auteur des documents arriverait à calculer cette orbite et à trouver mathématiquement l’époque à laquelle Gallia serait à son aphélie, si toutefois elle suivait un orbe elliptique ? Ce point marquerait alors son éloignement maximum, et, à compter de cet instant, elle tendrait à se rapprocher de l’astre radieux. On connaîtrait alors exactement la durée de l’année solaire et le nombre des jours galliens.
Le lieutenant Procope réfléchissait à tous ces inquiétants problèmes, lorsque le retour du jour le surprit brusquement. Le capitaine Servadac et lui tinrent alors conseil. Après calcul, estimant à cent lieues, au moins, la route qu’ils avaient parcourues en droite ligne depuis leur départ, ils résolurent de diminuer la vitesse du youyou. Les voiles furent donc en partie serrées, et, malgré le froid excessif, les deux explorateurs examinèrent la plaine blanche avec la plus scrupuleuse attention.
Elle était absolument déserte. Pas une surélévation de roches n’en altérait la superbe uniformité.
« Ne sommes-nous pas un peu trop dans l’ouest de Formentera ? dit le capitaine Servadac, après avoir consulté la carte.
– C’est probable, répondit le lieutenant Procope, car, ainsi que je l’eusse fait en mer, je me suis tenu au vent de l’île. Nous n’avons plus maintenant qu’à laisser porter.
– Faites donc, lieutenant, répondit le capitaine Servadac, et ne perdons pas un instant ! »
Le youyou fut manœuvré de manière à présenter le cap au nord-est. Hector Servadac, bravant la bise aiguë, se tenait debout à l’avant. Tout ce qu’il avait de force se concentrait dans son regard. Il ne cherchait pas à apercevoir dans l’air une fumée qui pût trahir la retraite de l’infortuné savant, auquel, très probablement, le combustible manquait comme les vivres. Non ! c’était le sommet de quelque îlot émergeant de l’ice-field, qu’il essayait de découvrir sur la ligne de l’horizon.
Soudain l’œil du capitaine Servadac s’anima, et sa main se tendit vers un point de l’espace.
« Là ! là ! » s’écria-t-il.
Et il montrait une sorte de construction en charpente qui faisait saillie sur la ligne circulaire tracée entre le ciel et le champ de glace.
Le lieutenant Procope avait saisi sa lunette.
« Oui ! répondit-il, là !… là !… C’est un pylône qui servait à quelque opération géodésique ! »
Le doute n’était plus possible ! La voile fut éventée, et le youyou, qui ne se trouvait pas à plus de six kilomètres du point signalé, s’enleva avec une prodigieuse vitesse.
Le capitaine Servadac et le lieutenant Procope, dominés par l’émotion, n’auraient pu prononcer une seule parole. Le pylône grandissait rapidement à leurs yeux, et bientôt ils virent un amas de roches basses que ce pylône dominait, et dont l’agglomération faisait tache sur le tapis blanc de l’ice-field.
Ainsi que l’avait pressenti le capitaine Servadac, aucune fumée ne s’élevait de l’îlot. Or, par ce froid intense, il ne fallait plus se faire d’illusion. C’était, sans doute, un tombeau vers lequel le youyou courait à toutes voiles.
Dix minutes après, un kilomètre environ avant d’arriver, le lieutenant Procope serra sa brigantine, car l’élan du youyou devait suffire à le porter jusqu’aux roches.
Alors, une émotion, plus vive encore, serra au cœur le capitaine Servadac.
Au sommet du pylône, le vent tordait un lambeau d’étamine bleue… C’était tout ce qui restait du pavillon de la France !
Le youyou vint heurter les premières roches. L’îlot n’avait pas un demi-kilomètre de tour. De Formentera, de l’archipel des Baléares, il n’existait pas d’autres vestiges.
Au pied du pylône s’élevait une misérable cabane de bois, dont les volets étaient hermétiquement fermés.
S’élancer sur les roches, escalader les pierres glissantes, atteindre la cabane, le capitaine Servadac et le lieutenant Procope ne mirent à cela que la durée d’un éclair.
Hector Servadac heurta du poing la porte de la cabane, qui était barrée intérieurement.
Il appela. Pas de réponse.
« À moi, lieutenant ! » dit le capitaine Servadac.
Et tous deux, appuyant vigoureusement de l’épaule, firent sauter la porte à demi vermoulue.
Dans l’unique chambre de la cabane, l’obscurité était complète, le silence absolu.
Ou le dernier habitant de cette chambre l’avait abandonnée, ou il y était, mais mort.
Les volets furent repoussés et le jour se fit.
Dans l’âtre froid de la cheminée, il n’y avait rien, si ce n’est la cendre d’un feu éteint. Dans un coin, un lit. Sur ce lit, un corps étendu.
Le capitaine Servadac s’approcha, et un cri s’échappa de sa poitrine.
« Mort de froid ! Mort de faim ! »
Le lieutenant Procope se pencha sur le corps de l’infortuné.
« Il vit ! » s’écria-t-il.
Et, ouvrant un flacon que remplissait un énergique cordial, il en introduisit quelques gouttes entre les lèvres du mourant.
Un léger soupir se fit entendre, et il fut presque aussitôt suivi de ces quelques mots, dits d’une voix faible :
« Gallia ?
– Oui !.. oui !.. Gallia !.. répondit le capitaine Servadac, et c’est…
– C’est ma comète, à moi, ma comète ! »
Puis, ce mot prononcé, le moribond retomba dans un profond engourdissement, tandis que le capitaine Servadac se disait :
« Mais je connais ce savant ! Où l’ai-je donc rencontré déjà ? »
Le soigner, le sauver de la mort, dans cette cabane où toute ressource manquait, il n’y fallait pas songer. La décision d’Hector Servadac et du lieutenant Procope fut rapidement prise. En quelques instants, le moribond, ses quelques instruments de physique et d’astronomie, ses vêtements, ses papiers, ses livres et une vieille porte qui lui servait de tableau noir pour ses calculs, eurent été transportés dans le youyou. Le vent, qui avait heureusement tourné de trois quarts, était presque favorable. On en profita, on mit à la voile, et le seul roc qui restât des îles Baléares fut abandonné.
Le 19 avril, trente-six heures après, sans que le savant eût ouvert les yeux ou dit une parole, il était déposé dans la grande salle de Nina-Ruche, et les colons accueillaient par des hurrahs les deux hardis compagnons, dont ils avaient attendu si impatiemment le retour.
DEUXIÈME PARTIE
Chapitre I
Dans lequel on présente sans cérémonie le trente-sixième habitant du sphéroïde gallien
Le trente-sixième habitant de Gallia venait enfin d’apparaître sur la Terre-Chaude. Les seuls mots, à peu près incompréhensibles, qu’il eût encore prononcés, étaient ceux-ci.
« C’est ma comète, à moi ! C’est ma comète ! »
Que signifiait cette réponse ? Voulait-elle dire que ce fait, inexplicable jusqu’ici, la projection dans l’espace d’un énorme fragment détaché de la terre, était dû au choc d’une comète ? Y avait-il donc eu rencontre sur l’orbite terrestre ? Ce nom de Gallia, auquel des deux astéroïdes le solitaire de Formentera l’avait-il donné, à l’astre chevelu ou au bloc lancé à travers le monde solaire ? Cette question ne pouvait être résolue que par le savant qui venait de réclamer si énergiquement « sa comète » !
En tout cas, ce moribond était incontestablement l’auteur des notices recueillies pendant le voyage d’exploration de la Dobryna, l’astronome qui avait rédigé le document apporté à la Terre-Chaude par le pigeon voyageur. Lui seul avait pu jeter étuis et barils à la mer et donner la liberté à cet oiseau que son instinct devait diriger vers l’unique territoire habitable et habité du nouvel astre. Ce savant – il l’était à n’en pas douter – connaissait donc quelques-uns des éléments de Gallia. Il avait pu mesurer son éloignement progressif du soleil, calculer la diminution de sa vitesse tangentielle. Mais – et c’était la question la plus importante –, avait-il calculé la nature de son orbite, et reconnu si c’était une hyperbole, une parabole ou une ellipse que suivait l’astéroïde ? Avait-il déterminé cette courbe par l’observation successive de trois positions de Gallia ? Savait-il enfin si le nouvel astre se trouvait dans les conditions voulues pour revenir à la terre, et dans quel laps de temps il y reviendrait ?
Voilà tout d’abord les questions que le comte Timascheff s’adressa à lui-même et qu’il posa ensuite au capitaine Servadac et au lieutenant Procope. Ceux-ci ne purent lui répondre. Ces diverses hypothèses, ils les avaient envisagées, discutées pendant leur voyage de retour, mais sans parvenir à les résoudre. Et malheureusement, le seul homme qui pût vraisemblablement posséder la solution de ce problème, il était à craindre qu’ils ne l’eussent ramené qu’à l’état de cadavre ! S’il en était ainsi, il faudrait renoncer à tout espoir de jamais connaître l’avenir réservé au monde gallien !
Il fallait donc, avant toutes choses, ranimer ce corps d’astronome qui ne donnait plus aucun signe d’existence. La pharmacie de la Dobryna, bien pourvue de médicaments, ne pouvait être mieux utilisée qu’à obtenir cet important résultat. C’est ce qui fut immédiatement fait, après cette encourageante observation de Ben-Zouf :
« À l’ouvrage, mon capitaine ! On ne se figure pas combien ces savants, ça a la vie dure ! »
On commença donc à traiter le moribond, à l’extérieur, par des massages si vigoureux qu’ils eussent détérioré un vivant, et, à l’intérieur, par des cordiaux si réconfortants qu’ils auraient ressuscité un mort.
C’était Ben-Zouf, relayé par Negrete, qu’on avait chargé de l’extérieur, et l’on peut être assuré que ces deux solides masseurs firent consciencieusement leur besogne.
Pendant ce temps, Hector Servadac se demandait vainement quel était ce Français, qu’il venait de recueillir à l’îlot de Formentera, et dans quelles circonstances il avait dû se trouver en rapport avec lui.
Il aurait cependant bien dû le reconnaître ; mais il ne l’avait vu que dans cet âge qu’on appelle, non sans raison, l’âge ingrat, car il l’est au moral aussi bien qu’au physique.
En effet, le savant, qui reposait actuellement dans la grande salle de Nina-Ruche, n’était ni plus ni moins que l’ancien professeur de physique d’Hector Servadac au lycée Charlemagne.
Ce professeur se nommait Palmyrin Rosette. C’était un véritable savant, très fort en toutes sciences mathématiques. Après sa première année d’élémentaires, Hector Servadac avait quitté le lycée Charlemagne pour entrer à Saint-Cyr, et, depuis lors, son professeur et lui, ne s’étant plus rencontrés, s’étaient ou plutôt avaient cru s’être oubliés.
L’élève Servadac, on le sait, n’avait jamais mordu avec grand appétit aux études scolaires. Mais, en revanche, que de mauvais tours il avait joués à ce malheureux Palmyrin Rosette, en compagnie de quelques autres indisciplinés de sa trempe !
Qui additionnait de quelques grains de sel l’eau distillée du laboratoire, ce qui provoquait les réactions chimiques les plus inattendues ? Qui enlevait une goutte de mercure de la cuvette du baromètre pour le mettre en contradiction flagrante avec l’état de l’atmosphère ? Qui échauffait le thermomètre, quelques instants avant que le professeur vînt le consulter ? Qui introduisait des insectes vivants entre l’oculaire et l’objectif des lunettes ? Qui détruisait l’isolement de la machine électrique, de manière qu’elle ne pouvait plus produire une seule étincelle ? Qui donc enfin, avait percé d’un trou invisible la plaque qui supportait la cloche de la machine pneumatique, de telle sorte que Palmyrin Rosette s’épuisait à pomper un air qui entrait toujours ?
C’étaient là les méfaits les plus ordinaires de l’élève Servadac et de sa trop joyeuse bande.
Et ces mauvais tours avaient d’autant plus de charmes pour les élèves, que le professeur en question était un rageur de premier ordre. De là, des colères rouges et des accès de rage qui mettaient « les grands » de Charlemagne en belle humeur.
Deux ans après l’époque à laquelle Hector Servadac quitta le lycée, Palmyrin Rosette, qui se sentait plus cosmographe que physicien, avait abandonné la carrière de l’enseignement pour se livrer spécialement aux études astronomiques. Il essaya d’entrer à l’Observatoire. Mais son caractère grincheux, si parfaitement établi dans le monde savant, lui en fit fermer obstinément les portes. Comme il possédait une certaine fortune, il se mit à faire de l’astronomie pour son propre compte, sans titre officiel, et il s’en donna à cœur joie de critiquer les systèmes des autres astronomes. Ce fut à lui, d’ailleurs, que l’on dut la découverte de trois des dernières planètes télescopiques, et le calcul des éléments de la trois cent vingt-cinquième comète du catalogue. Mais, ainsi qu’il a été dit, le professeur Rosette et l’élève Servadac ne s’étaient jamais retrouvés en présence l’un de l’autre avant cette rencontre fortuite sur l’îlot de Formentera. Or, après une douzaine d’années, rien de bien étonnant que le capitaine Servadac n’eût pas reconnu, surtout dans l’état où il était, son ancien professeur Palmyrin Rosette.
Lorsque Ben-Zouf et Negrete avaient retiré le savant des fourrures qui l’enveloppaient de la tête aux pieds, ils s’étaient trouvés en présence d’un petit homme de cinq pieds deux pouces, amaigri sans doute, mais naturellement maigre, très chauve, avec un de ces beaux crânes polis qui ressemblent au gros bout d’un œuf d’autruche, point de barbe, si ce n’est un poil qui n’avait pas été rasé depuis une semaine, un nez long et busqué, servant de support à une paire de ces formidables lunettes qui, chez certains myopes, semblent faire partie intégrante de leur individu.
Ce petit homme devait être extraordinairement nerveux. On aurait pu le comparer à l’une de ces bobines Rhumkorff, dont le fil enroulé eût été un nerf long de plusieurs hectomètres, et dans laquelle le courant nerveux aurait remplacé le courant électrique avec une intensité non moins grande. En un mot, dans la « bobine Rosette », la « nervosité », – que l’on accepte pour un instant ce mot barbare, – était emmagasinée à une très haute tension, comme l’électricité l’est dans la bobine Rhumkorff.
Cependant, si nerveux que fût le professeur, ce n’était pas une raison pour le laisser aller de vie à trépas. Dans un monde où l’on ne compte que trente-cinq habitants, la vie du trente-sixième n’est pas à dédaigner. Lorsque le moribond fut en partie dépouillé de ses vêtements, on put constater que son cœur battait encore, faiblement, mais enfin il battait. Il était donc possible qu’il reprît connaissance, grâce aux soins vigoureux qu’on lui prodiguait. Ben-Zouf frottait et refrottait ce corps sec comme un vieux sarment, à faire craindre qu’il ne prît feu, et, comme s’il eût astiqué son sabre pour une parade, il murmurait ce refrain si connu :
Au tripoli, fils de la gloire,
Tu dois l’éclat de ton acier.
Enfin, après vingt minutes d’un massage non interrompu, un soupir s’échappa des lèvres du moribond, puis deux, puis trois. Sa bouche, hermétiquement fermée jusqu’alors, se desserra. Ses yeux s’entrouvrirent, se refermèrent et s’ouvrirent tout à fait, mais inconscient encore du lieu et des circonstances où il se voyait. Quelques paroles furent prononcées, qu’on ne put saisir. La main droite de Palmyrin Rosette se tendit, se leva, se porta à son front comme si elle y eût cherché un objet qui ne s’y trouvait plus. Puis alors, ses traits se contractèrent, sa face rougit comme s’il fût revenu à la vie par un accès de colère, et il s’écria :
« Mes lunettes ! Où sont mes lunettes ? »
Ben-Zouf chercha les lunettes réclamées. On les retrouva. Ces lunettes monumentales étaient armées de véritables oculaires de télescopes en guise de verres. Pendant le massage, elles s’étaient détachées de ces tempes auxquelles elles semblaient vissées, comme si une tige eût traversé la tête du professeur d’une oreille à l’autre. Elles furent rajustées sur ce nez en bec d’aigle, leur assise naturelle, et alors un nouveau soupir fut poussé, qui se termina par un « brum ! brum ! » de bon augure.
Le capitaine Servadac s’était penché sur la figure de Palmyrin Rosette, qu’il regardait avec une extrême attention. En ce moment, celui-ci ouvrit les yeux, tout grands cette fois. Un vif regard perça l’épaisse lentille de ses lunettes, et d’une voix empreinte d’irritation :
« Élève Servadac, s’écria-t-il, cinq cents lignes pour demain ! »
Telles furent les paroles avec lesquelles Palmyrin Rosette salua le capitaine Servadac.
Mais, à cette bizarre entrée en conversation, évidemment provoquée par le souvenir subit de vieilles rancunes, Hector Servadac, bien qu’il crût positivement rêver, avait, lui aussi, reconnu son ancien professeur de physique du lycée Charlemagne.
« Monsieur Palmyrin Rosette ! s’écria-t-il. Mon ancien professeur ici même !… En chair et en os !
– En os seulement, répondit Ben-Zouf.
– Mordioux ! La rencontre est singulière !… » ajouta le capitaine Servadac stupéfait.
Cependant, Palmyrin Rosette était retombé dans une sorte de sommeil qu’il parut convenable de respecter.
« Soyez tranquille, mon capitaine, dit Ben-Zouf. Il vivra, j’en réponds. Ces petits hommes-là, c’est tout nerfs. J’en ai vu de plus secs que lui, et qui étaient revenus de plus loin !
– Et d’où étaient-ils revenus, Ben-Zouf ?
– D’Égypte, mon capitaine, dans une belle boîte peinturlurée !
– C’étaient des momies, imbécile !
– Comme vous dites, mon capitaine ! »
Quoi qu’il en soit, le professeur s’étant endormi, on le transporta dans un lit bien chaud, et force fut de remettre à son réveil les urgentes questions relatives à sa comète.
Pendant toute cette journée, le capitaine Servadac, le comte Timascheff, le lieutenant Procope – qui représentaient l’Académie des sciences de la petite colonie –, au lieu d’attendre patiemment au lendemain, ne purent se retenir d’échafauder les plus invraisemblables hypothèses. Quelle était au juste cette comète à laquelle Palmyrin Rosette avait donné le nom de Gallia ? Ce nom ne s’appliquait-il donc pas au fragment détaché du globe ? Les calculs de distances et de vitesses, relevés dans les notices, se rapportaient-ils à la comète Gallia, et non au nouveau sphéroïde, qui entraînait le capitaine Servadac et ses trente-cinq compagnons dans l’espace ? Ils n’étaient donc plus des Galliens, ces survivants de l’humanité terrestre ?
Voilà ce qu’il y avait lieu de se demander. Or, s’il en était ainsi, c’était l’écroulement de tout cet ensemble de déductions laborieuses, qui concluait à la projection d’un sphéroïde, arraché aux entrailles mêmes de la terre, et s’accordait avec les nouveaux phénomènes cosmiques.
« Eh bien, s’écria Hector Servadac, le professeur Rosette est là pour nous le dire, et il nous le dira ! »
Ramené à parler de Palmyrin Rosette, le capitaine Servadac le fit connaître à ses compagnons tel qu’il était, un homme difficile à vivre et avec lequel les rapports étaient généralement tendus. Il le leur donna pour un original absolument incorrigible, très entêté, très rageur, mais assez brave homme au fond. Le mieux serait de laisser passer sa mauvaise humeur, comme on laisse passer un orage, en se mettant à l’abri.
Lorsque le capitaine Servadac eut achevé sa petite digression biographique, le comte Timascheff prit la parole et dit :
« Soyez assuré, capitaine, que nous ferons tout pour vivre dans de bons termes avec le professeur Palmyrin Rosette. Je crois, d’ailleurs, qu’il nous rendra un grand service, en nous communiquant le résultat de ses observations. Mais il ne peut le faire qu’à une condition.
– Laquelle ? demanda Hector Servadac.
– C’est, répondit le comte Timascheff, qu’il soit bien l’auteur des documents que nous avons recueillis.
– En doutez-vous ?
– Non, capitaine. Toutes les possibilités seraient contre moi, et je n’ai parlé ainsi que pour épuiser la série des hypothèses défavorables.
– Eh ! qui donc aurait rédigé ces diverses notices, si ce n’était mon ancien professeur ? fit observer le capitaine Servadac.
– Peut-être quelque autre astronome abandonné sur un autre point de l’ancienne terre.
– Cela ne se peut, répondit le lieutenant Procope, puisque les documents nous ont seuls fait connaître ce nom de Gallia, et que ce nom a été prononcé tout d’abord par le professeur Rosette. »
À cette très juste observation, il n’y avait rien à répondre, et il n’était pas douteux que le solitaire de Formentera ne fût l’auteur des notices. Quant à ce qu’il faisait dans cette île, on l’apprendrait de sa bouche.
Au surplus, non seulement sa porte, mais aussi ses papiers avaient été rapportés avec lui, et il n’y avait rien d’indiscret à les consulter pendant son sommeil.
C’est ce qui fut fait.
L’écriture et les chiffres étaient bien de la main qui avait libellé les documents. La porte était encore couverte de signes algébriques, tracés à la craie, qu’on avait eu grand soin de respecter. Quant aux papiers, ils étaient principalement formés de feuilles volantes, zébrées de figures géométriques. Là se croisaient des hyperboles, ces courbes ouvertes, dont les deux branches sont infinies et s’écartent de plus en plus l’une de l’autre ; – des paraboles, courbes caractérisées par la forme rentrante, mais dont les branches s’éloignent également à l’infini ; – enfin des ellipses, courbes toujours fermées, si allongées qu’elles puissent être.
Le lieutenant Procope fit alors observer que ces diverses courbes se rapportaient précisément aux orbites cométaires, qui peuvent être paraboliques, hyperboliques, elliptiques, – ce qui signifiait, dans les deux premiers cas, que les comètes, observées de la terre, ne pouvaient jamais revenir sur l’horizon terrestre ; dans le troisième, qu’elles y réapparaissaient périodiquement dans des laps de temps plus ou moins considérables. Il était donc certain, à la seule inspection de ses papiers et de sa porte, que le professeur s’était livré à des calculs d’éléments cométaires ; mais on ne pouvait rien préjuger des diverses courbes successivement étudiées par lui, car, pour commencer leurs calculs, les astronomes supposent toujours aux comètes une orbite parabolique.
Enfin, de tout ceci, il résultait que Palmyrin Rosette, pendant son séjour à Formentera, avait calculé en tout ou partie les éléments d’une comète nouvelle, dont le nom ne figurait point au catalogue.
Ce calcul, l’avait-il fait avant ou depuis le cataclysme du 1er janvier ? on ne le saurait que par lui.
« Attendons, dit le comte Timascheff.
– J’attends, mais je bous ! répondit le capitaine Servadac, qui ne pouvait tenir en place. Je donnerais un mois de ma vie pour chaque heure de sommeil du professeur Rosette !
– Vous feriez peut-être un mauvais marché, capitaine, dit alors le lieutenant Procope.
– Quoi ! pour apprendre quel est l’avenir réservé à notre astéroïde…
– Je ne voudrais vous enlever aucune illusion, capitaine, répondit le lieutenant Procope ; mais, de ce que le professeur en sait long sur la comète Gallia, il ne s’ensuit pas qu’il puisse nous renseigner sur ce fragment qui nous emporte ! Y a-t-il même connexité entre l’apparition de la comète sur l’horizon terrestre et la projection dans l’espace d’un morceau du globe ?…
– Oui ! mordioux ! s’écria le capitaine Servadac. Il y a connexité évidente ! Il est clair comme le jour que…
– Que… ? dit le comte Timascheff, comme s’il eût attendu la réponse qu’allait faire son interlocuteur.
– Que la terre a été choquée par une comète, et que c’est à ce choc qu’est due la projection du bloc qui nous emporte ! »
Sur cette hypothèse, affirmativement énoncée par le capitaine Servadac, le comte Timascheff et le lieutenant Procope se regardèrent pendant quelques instants. Si improbable que fût la rencontre de la terre et d’une comète, elle n’était pas impossible. Un choc de cette nature, c’était l’explication donnée enfin à l’inexplicable phénomène, c’était cette introuvable cause dont les effets avaient été si extraordinaires.
« Vous pourriez avoir raison, capitaine, répondit le lieutenant Procope, après avoir envisagé la question sous cette nouvelle face. Il n’est pas inadmissible qu’un tel choc se produise et qu’il puisse détacher un fragment considérable de la terre. Si ce fait s’est accompli, l’énorme disque que nous avons entrevu dans la nuit, après la catastrophe, ne serait autre que la comète, qui a été déviée, sans doute, de son orbite normale, mais dont la vitesse était telle que la terre n’a pu la retenir dans son centre d’attraction.
– C’est la seule explication que nous ayons à donner de la présence de cet astre inconnu, répondit le capitaine Servadac.
– Voilà, dit alors le comte Timascheff, une nouvelle hypothèse qui semble fort plausible. Elle accorde nos propres observations avec celles du professeur Rosette. Ce serait dès lors à cet astre errant, dont nous avons subi le choc, qu’il aurait donné le nom de Gallia.
– Évidemment, comte Timascheff.
– Fort bien, capitaine, mais il y a cependant une chose que je ne m’explique pas.
– Laquelle ?
– C’est que ce savant se soit plus occupé de la comète que du bloc qui l’emportait, lui, dans l’espace !
– Ah ! comte Timascheff, répondit le capitaine Servadac, vous savez quels originaux sont quelquefois ces fanatiques de la science, et je vous donne le mien pour un fier original !
– D’ailleurs, fit observer le lieutenant Procope, il est fort possible que le calcul des éléments de Gallia ait été fait antérieurement au choc. Le professeur a pu voir venir la comète et l’observer avant la catastrophe. »
La remarque du lieutenant Procope était juste. Quoi qu’il en soit, l’hypothèse du capitaine fut adoptée en principe. Tout revenait donc à ceci : une comète, coupant l’écliptique, aurait heurté la terre dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, et le choc aurait séparé du globe terrestre un énorme fragment, qui, depuis lors, gravitait dans les espaces interplanétaires.
Si les membres de l’Académie des sciences de Gallia ne tenaient pas encore l’entière vérité, ils devaient en être bien près.
Palmyrin Rosette pouvait seul élucider tout à fait le problème !
Chapitre II
Dont le dernier mot apprend au lecteur ce que, sans doute, il avait déjà deviné
Ainsi s’acheva cette journée du 19 avril. Pendant que leurs chefs discutaient de cette façon, les colons vaquaient à leurs affaires habituelles. L’introduction inattendue du professeur sur la scène gallienne n’était pas pour les préoccuper à ce point. Les Espagnols, insouciants par nature, les Russes, confiants dans leur maître, s’inquiétaient peu des effets et des causes. Si Gallia devait revenir un jour à la terre ou s’ils devaient y vivre, c’est-à-dire y mourir, ils ne se préoccupaient guère de l’apprendre ! Aussi, pendant la nuit qui vint, ne perdirent-ils pas une heure de sommeil et reposèrent-ils comme des philosophes que rien ne peut émouvoir.
Ben-Zouf, métamorphosé en infirmier, ne quitta pas le chevet du professeur Rosette. Il en avait fait sa chose. Il s’était engagé à le remettre sur pied. Son honneur était en jeu. Aussi, comme il le dorlotait ! À la moindre occasion, quelles puissantes gouttes de cordial il lui administrait ! Comme il comptait ses soupirs ! Comme il guettait les paroles qui s’échappaient de ses lèvres ! La vérité oblige à dire que le nom de Gallia revenait souvent dans le sommeil agité de Palmyrin Rosette, les intonations variant de l’inquiétude à la colère. Le professeur rêvait-il donc qu’on voulait lui voler sa comète, qu’on lui contestait la découverte de Gallia, qu’on le chicanait sur la priorité de ses observations et de ses calculs ? c’était vraisemblable. Palmyrin Rosette était de ces gens qui ragent, même en dormant.
Mais, si attentif que fût le garde-malade, il ne surprit rien, dans ces paroles incohérentes, qui fût de nature à résoudre le grand problème. D’autre part, le professeur dormit toute la nuit, et ses soupirs, légers au début, se changèrent bientôt en ronflements sonores, du meilleur augure !
Lorsque le soleil se leva sur l’horizon occidental de Gallia, Palmyrin Rosette reposait encore, et Ben-Zouf jugea cependant convenable de respecter son sommeil. D’ailleurs, à ce moment, l’attention de l’ordonnance fut détournée par un incident.
Plusieurs coups retentirent à la grosse porte qui fermait l’orifice de la galerie principale de Nina-Ruche. Cette porte servait, sinon à se défendre contre les visites importunes, du moins contre le froid du dehors.
Ben-Zouf allait quitter un instant son malade ; mais, après réflexion, il se dit qu’il avait mal entendu, sans doute. Il n’était pas portier, après tout, et, d’ailleurs, il y en avait d’autres moins occupés que lui pour tirer le cordon. Il ne bougea donc pas.
Tout le monde dormait encore d’un profond sommeil à Nina-Ruche. Le bruit se répéta. Il était évidemment produit par un être animé, au moyen d’un instrument contondant.
« Nom d’un Kabyle, c’est trop fort ! se dit Ben-Zouf. Ah çà ! qu’est-ce que cela peut être ? »
Et il se dirigea à travers la galerie principale.
Arrivé près de la porte :
« Qui est là ? demanda-t-il d’une voix accentuée, qui n’avait rien d’absolument aimable.
– Moi, fut-il répondu d’un ton doucereux.
– Qui, vous ?
– Isac Hakhabut.
– Et qu’est-ce que tu veux, Astaroth ?
– Que vous m’ouvriez, monsieur Ben-Zouf.
– Que viens-tu faire ici ? Vendre ta marchandise ?
– Vous savez bien qu’on ne veut pas me la payer !
– Eh bien, va au diable !
– Monsieur Ben-Zouf, reprit Isac avec un humble accent de supplication, je voudrais parler à Son Excellence le gouverneur général.
– Il dort.
– J’attendrai qu’il soit réveillé !
– Eh bien, attends où tu es, Abimélech ! »
Ben-Zouf allait s’en aller sans plus de façon, lorsque arriva le capitaine Servadac, que le bruit venait d’éveiller.
« Qu’y a-t-il, Ben-Zouf ?
– Rien ou à peu près. C’est ce chien d’Hakhabut qui demande à vous parler, mon capitaine.
– Eh bien, ouvre, répondit Hector Servadac. Il faut savoir ce qui l’amène aujourd’hui.
– Son intérêt, pardieu !
– Ouvre, te dis-je ! »
Ben-Zouf obéit. Aussitôt Isac Hakhabut, enveloppé de sa vieille houppelande, se précipita vivement dans la galerie. Le capitaine Servadac revint vers la salle centrale, et Isac le suivit en le poursuivant des qualifications les plus honorifiques.
« Que voulez-vous ? demanda le capitaine Servadac, en regardant bien en face Isac Hakhabut.
– Ah ! monsieur le gouverneur, s’écria celui-ci, est-ce que vous ne savez rien de nouveau depuis quelques heures ?
– Ce sont des nouvelles que vous venez chercher ici ?
– Sans doute, monsieur le gouverneur, et j’espère que vous voudrez bien m’apprendre…
– Je ne vous apprendrai rien, maître Isac, parce que je ne sais rien.
– Cependant un nouveau personnage est arrivé dans la journée d’hier à la Terre-Chaude ?…
– Ah ! vous savez déjà ?
– Oui, monsieur le gouverneur ! De ma pauvre tartane j’ai vu le youyou partir pour un grand voyage, puis revenir ! Et il m’a semblé qu’on en débarquait avec précaution…
– Eh bien ?
– Eh bien, monsieur le gouverneur, n’est-il pas vrai que vous avez recueilli un étranger…
– Que vous connaissez ?
– Oh ! je ne dis pas cela, monsieur le gouverneur, mais enfin, j’aurais voulu… j’aurais désiré…
– Quoi ?
– Parler à cet étranger, car peut-être vient-il ?…
– D’où ?
– Des côtes septentrionales de la Méditerranée, et il est permis de croire qu’il apporte…
– Qu’il apporte ?…
– Des nouvelles d’Europe ! » dit Isac, en jetant un regard avide sur le capitaine Servadac.
Ainsi, l’obstiné en était là encore, après trois mois et demi de séjour sur Gallia ! Avec son tempérament, il lui était certes plus difficile qu’à tout autre de se dégager moralement des choses de la terre, bien qu’il le fût matériellement ! S’il avait été forcé de constater, à son grand regret, l’apparition de phénomènes anormaux, raccourcissement des jours et des nuits, la désorientation de deux points cardinaux par rapport au lever et au coucher du soleil, tout cela, dans son idée, se passait sur la terre ! Cette mer, c’était toujours la Méditerranée ! Si une partie de l’Afrique avait certainement disparu dans quelque cataclysme, l’Europe subsistait tout entière, à quelques centaines de lieues dans le nord ! Ses habitants y vivaient comme devant, et il pourrait encore trafiquer, acheter, vendre, en un mot commercer ! La Hansa ferait le cabotage du littoral européen, à défaut du littoral africain, et ne perdrait peut-être pas au change ! C’est pourquoi Isac Hakhabut était accouru sans retard pour apprendre à Nina-Ruche des nouvelles de l’Europe.
Chercher à désabuser Isac, à confondre son entêtement, c’était peine inutile. Le capitaine Servadac ne songea même pas à l’essayer. Il ne tenait pas, d’ailleurs, à renouer des relations avec ce renégat qui lui répugnait, et, devant sa requête, il se contenta de hausser les épaules.
Quelqu’un qui les haussait encore plus haut que lui, c’était Ben-Zouf. L’ordonnance avait entendu la demande formulée par Isac, et ce fut lui qui répondit aux instances d’Hakhabut, auquel le capitaine Servadac venait de tourner le dos.
« Ainsi, je ne me suis pas trompé ? reprit le trafiquant, dont l’œil s’allumait. Un étranger est arrivé hier ?
– Oui, répondit Ben-Zouf.
– Vivant ?
– On l’espère.
– Et puis-je savoir, monsieur Ben-Zouf, de quel endroit de l’Europe arrive ce voyageur ?
– Des îles Baléares, répondit Ben-Zouf, qui voulait voir où en viendrait Isac Hakhabut.
– Les îles Baléares ! s’écria celui-ci. Le joli point de la Méditerranée pour commercer ! Que j’y ai fait de bonnes affaires autrefois ! La Hansa était bien connue dans cet archipel !
– Trop connue !
– Mais ces îles ne sont pas à vingt-cinq lieues de la côte d’Espagne, et il est impossible que ce digne voyageur n’ait pas reçu et apporté des nouvelles d’Europe.
– Oui, Manassé, et il t’en donnera qui te feront plaisir !
– Vrai, monsieur Ben-Zouf ?
– Vrai.
– Je ne regarderais pas… reprit Isac en hésitant… non… certainement… bien que je ne sois qu’un pauvre homme… je ne regarderais pas à quelques réaux pour causer avec lui…
– Si ! tu y regarderais !
– Oui !… mais je les donnerais tout de même… à la condition de lui parler sans délai !
– Voilà ! répondit Ben-Zouf. Malheureusement, il est très fatigué, notre voyageur, et il dort.
– Mais en le réveillant…
– Hakhabut ! dit alors le capitaine Servadac, si vous vous avisez de réveiller qui que ce soit ici, je vous fais mettre à la porte.
– Monsieur le gouverneur, répondit Isac d’un ton plus humble, plus suppliant, je voudrais pourtant savoir…
– Et vous saurez, répliqua le capitaine Servadac. Je tiens même à ce que vous soyez présent, lorsque notre nouveau compagnon nous donnera des nouvelles de l’Europe !
– Et moi aussi, Ezéchiel, ajouta Ben-Zouf, car je veux voir la réjouissante figure que tu feras ! »
Isac Hakhabut ne devait pas longtemps attendre. En ce moment, Palmyrin Rosette appelait d’une voix impatiente.
À cet appel, tous de courir au lit du professeur, le capitaine Servadac, le comte Timascheff, le lieutenant Procope et Ben-Zouf, dont la main vigoureuse avait quelque peine à retenir Hakhabut.
Le professeur n’était qu’à demi éveillé, et, probablement sous l’influence de quelque rêve, il criait :
« Eh ! Joseph ! Le diable emporte l’animal ! Viendras-tu, Joseph ? »
Joseph était évidemment le domestique de Palmyrin Rosette ; mais il ne pouvait venir, par la raison, sans doute, qu’il habitait encore l’ancien monde. Le choc de Gallia avait eu pour résultat de séparer brusquement et à jamais, sans doute, le maître et le serviteur.
Cependant, le professeur s’éveillait peu à peu, tout en criant :
« Joseph ! Satané Joseph ! Où est ma porte ?
– Voilà ! dit alors Ben-Zouf, et votre porte est en sûreté ! »
Palmyrin Rosette ouvrit les yeux et regarda fixement l’ordonnance en fronçant le sourcil.
« Tu es Joseph ? dit-il.
– Pour vous servir, monsieur Palmyrin, répondit imperturbablement Ben-Zouf.
– Eh bien, Joseph, dit le professeur, mon café, et plus vite que cela !
– Le café demandé ! » répondit Ben-Zouf, qui courut à la cuisine.
Pendant ce temps, le capitaine Servadac avait aidé Palmyrin Rosette à se relever à demi.
« Cher professeur, vous avez donc reconnu votre ancien élève de Charlemagne ? lui dit-il.
– Oui, Servadac, oui ! répondit Palmyrin Rosette. J’espère que vous vous êtes corrigé depuis douze ans ?
– Tout à fait corrigé ! répondit en riant le capitaine Servadac.
– C’est bien ! c’est bien ! dit Palmyrin Rosette. Mais mon café ! Sans café pas d’idées nettes, et il faut des idées nettes aujourd’hui ! »
Fort heureusement, Ben-Zouf arriva, apportant le breuvage en question, – une énorme tasse pleine de café noir, bien chaud.
La tasse vidée, Palmyrin Rosette se leva, quitta son lit, entra dans la salle commune, regarda d’un œil distrait, et, finalement, se campa dans un fauteuil, le meilleur de ceux qu’avait fournis la Dobryna.
Alors, bien que son air fût encore rébarbatif, le professeur, d’un ton satisfait qui rappelait les « all right », les « va bene », les « nil desperandum » des notices, entra en matière par ces paroles :
« Eh bien, messieurs, que dites-vous de Gallia ? »
Le capitaine Servadac, avant toutes choses, allait demander ce que c’était que Gallia, lorsqu’il fut devancé par Isac Hakhabut.
À la vue d’Isac, les sourcils du professeur se froncèrent de nouveau, et, avec l’accent d’un homme auquel on manque d’égards :
« Qu’est-ce que cela ? s’écria-t-il, en repoussant Hakhabut de la main.
– Ne faites pas attention », répondit Ben-Zouf. Mais il n’était pas facile de retenir Isac, ni de l’empêcher de parler. Il revint donc obstinément à la charge, sans aucunement se soucier des personnes présentes.
« Monsieur, dit-il, au nom du Dieu d’Abraham, d’Israël et de Jacob, donnez-nous des nouvelles de l’Europe ! »
Palmyrin Rosette bondit de son fauteuil, comme s’il eût été mû par un ressort.
« Des nouvelles de l’Europe ! s’écria-t-il. Il veut avoir des nouvelles de l’Europe !
– Oui… oui… répondit Isac, qui s’accrochait au fauteuil du professeur pour mieux résister aux poussées de Ben-Zouf.
– Et pourquoi faire ? reprit Palmyrin Rosette.
– Pour y retourner !
– Y retourner ! – À quelle date sommes-nous aujourd’hui ? demanda le professeur en se retournant vers son ancien élève.
– Au 20 avril, répondit le capitaine Servadac.
– Eh bien, aujourd’hui 20 avril, reprit Palmyrin Rosette, dont le front sembla rayonner, aujourd’hui, l’Europe est à cent vingt-trois millions de lieues de nous ! »
Isac Hakhabut se laissa aller comme un homme auquel on viendrait d’arracher le cœur.
« Ah çà ! demanda Palmyrin Rosette, on ne sait donc rien ici ?
– Voici ce qu’on sait ! » répondit le capitaine Servadac.
Et, en quelques mots, il mit le professeur au courant de la situation. Il raconta tout ce qui s’était passé depuis la nuit du 31 décembre, comment la Dobryna avait entrepris un voyage d’exploration, comment elle avait découvert ce qui restait de l’ancien continent, c’est-à-dire quelques points de Tunis, de la Sardaigne, de Gibraltar, de Formentera, comment, à trois reprises, les documents anonymes étaient tombés entre les mains des explorateurs, comment enfin l’île Gourbi avait été abandonnée pour la Terre-Chaude, et l’ancien poste pour Nina-Ruche. Palmyrin Rosette avait écouté ce récit, non sans donner quelques signes d’impatience. Lorsque le capitaine Servadac eut achevé :
« Messieurs, demanda-t-il, où croyez-vous donc être en ce moment ?
– Sur un nouvel astéroïde qui gravite dans le monde solaire, répondit le capitaine Servadac.
– Et, suivant vous, ce nouvel astéroïde serait ?
– Un énorme fragment arraché au globe terrestre.
– Arraché ! Ah ! vraiment, arraché ! Un fragment du globe terrestre ! Et par qui, par quoi arraché ?…
– Par le choc d’une comète, à laquelle vous avez donné le nom de Gallia, cher professeur.
– Eh bien, non, messieurs, dit Palmyrin Rosette en se levant. C’est mieux que cela !
– Mieux que cela ? répondit vivement le lieutenant Procope.
– Oui, reprit le professeur, oui ! Il est bien vrai qu’une comète inconnue a heurté la terre dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, à deux heures quarante-sept minutes et trente-cinq secondes six dizièmes du matin, mais elle n’a fait que l’effleurer pour ainsi dire, en enlevant ces quelques parcelles que vous avez retrouvées pendant votre voyage d’exploration !
– Et alors, s’écria le capitaine Servadac, nous sommes ?…
– Sur l’astre que j’ai appelé Gallia, répondit Palmyrin Rosette d’un ton triomphant. Vous êtes sur ma comète ! »
Chapitre III
Quelques variations sur le vieux thème si connu des comètes du monde solaire et autres
Lorsque le professeur Palmyrin Rosette faisait une conférence sur la cométographie, voici comment, d’après les meilleurs astronomes, il définissait les comètes :
« Astres composés d’un point central qu’on appelle noyau, d’une nébulosité qu’on appelle chevelure, d’une traînée lumineuse qu’on appelle queue, – lesdits astres n’étant visibles pour les habitants de la terre que dans une partie de leur cours, grâce à la très grande excentricité de l’orbite qu’ils décrivent autour du soleil. »
Puis, Palmyrin Rosette ne manquait jamais d’ajouter que sa définition était rigoureusement exacte, – à cela près, toutefois, que ces astres pouvaient se passer soit de noyau, soit de queue, soit de chevelure, et n’en être pas moins des comètes.
Aussi avait-il soin d’ajouter, suivant Arago, que, pour mériter ce beau nom de comète, un astre devait : 1° être doué d’un mouvement propre ; 2° décrire une ellipse très allongée, et par conséquent s’en aller à une distance telle qu’il fût invisible du soleil et de la terre. La première condition remplie, l’astre ne pouvait plus être confondu avec une étoile, et la seconde empêchait qu’il ne pût être pris pour une planète. Or, ne pouvant appartenir à la classe des météores, n’étant point planète, n’étant point étoile, l’astre était nécessairement comète.
Le professeur Palmyrin Rosette, quand il professait ainsi dans son fauteuil de conférencier, ne se doutait guère qu’un jour il serait emporté par une comète à travers le monde solaire. Il avait toujours eu pour ces astres, chevelus ou non, une particulière prédilection. Peut-être pressentait-il ce que lui réservait l’avenir ? Aussi était-il très ferré en cométographie. Ce qu’il dut particulièrement regretter à Formentera, après le choc, ce fut sans doute de ne pas avoir un auditoire sous la main, car il eût immédiatement commencé une conférence sur les comètes et traité son sujet dans l’ordre suivant :
1° Quel est le nombre des comètes dans l’espace ?
2° Quelles sont les comètes périodiques, c’est-à-dire celles qui reviennent dans un temps déterminé, et les comètes non périodiques ?
3° Quelles sont les probabilités d’un choc entre la terre et l’une quelconque de ces comètes ?
4° Quelles seraient les conséquences du choc, suivant que la comète aurait un noyau dur ou non ?
Palmyrin Rosette, après avoir répondu à ces quatre questions, eût certainement satisfait les plus exigeants de ses auditeurs.
C’est ce qui va être fait pour lui dans ce chapitre.
Sur la première question : Quel est le nombre des comètes dans l’espace ?
Kepler a prétendu que les comètes sont aussi nombreuses dans le ciel que les poissons dans l’eau.
Arago, se fondant sur le nombre de ces astres qui gravitent entre Mercure et le soleil, a porté à dix-sept millions le chiffre de celles qui pérégrinent rien que dans les limites du monde solaire.
Lambert dit qu’il y en a cinq cents millions jusqu’à Saturne seulement, c’est-à-dire dans un rayon de trois cent soixante-quatre millions de lieues.
D’autres calculs ont même donné soixante-quatorze millions de milliards de comètes.
La vérité est qu’on ne sait rien du nombre de ces astres chevelus, qu’on ne les a pas comptés, qu’on ne les comptera jamais, mais qu’ils sont très nombreux. Pour continuer et même amplifier la comparaison imaginée par Kepler, un pêcheur, placé à la surface du soleil, ne pourrait pas jeter sa ligne dans l’espace sans accrocher l’une de ces comètes.
Et ce n’est pas tout. Bien d’autres courent l’univers, qui ont échappé à l’influence du soleil. Il en est de si vagabondes, de si déréglées, qu’elles quittent capricieusement un centre d’attraction pour entrer dans un autre. Elles changent de monde solaire avec une facilité déplorable, les unes apparaissant sur l’horizon terrestre, qu’on n’avait jamais vues encore, les autres disparaissant et qu’on ne doit plus revoir.
Mais, pour s’en tenir aux comètes qui appartiennent réellement au monde solaire, ont-elles, au moins, des orbites fixes, que rien ne peut changer, et qui, par conséquent, rendent impossible tout choc de ces corps, soit entre eux, soit avec la terre ? Eh bien ! non ! Ces orbites ne sont point à l’abri des influences étrangères. D’elliptiques, elles peuvent devenir paraboliques ou hyperboliques. Et, pour ne parler que de Jupiter, cet astre est le plus grand « dérangeur » d’orbites qui soit. Comme l’ont remarqué les astronomes, il semble toujours être sur la grande route des comètes, et exerce sur ces faibles astéroïdes une influence qui peut leur être funeste, mais qu’explique sa puissance attractive.
Tel est donc, en gros, le monde cométaire, qui compte par millions les astres dont il se compose.
Sur la seconde question : Quelles sont les comètes périodiques et les comètes non périodiques ?
En parcourant les annales astronomiques, on trouve environ cinq à six cents comètes qui ont été l’objet d’observations sérieuses à différentes époques. Mais, sur ce chiffre, il n’en est guère qu’une quarantaine dont les périodes de révolution soient exactement connues.
Ces quarante astres se divisent en comètes périodiques et en comètes non périodiques. Les premières reparaissent sur l’horizon terrestre, après un intervalle de temps plus ou moins long, mais presque régulier. Les secondes, dont le retour ne saurait être assigné, s’éloignent du soleil à des distances véritablement incommensurables.
Parmi les comètes périodiques, il en est dix qui sont dites « à courtes périodes » et dont les mouvements sont calculés avec une extrême précision. Ce sont les comètes de Halley, d’Encke, de Gambart, de Faye, de Brörsen, d’Arrest, de Tuttle, de Winecke, de Vico et de Tempel.
Il est bon de dire quelques mots de leur histoire, car l’une d’elles s’est précisément comportée à l’égard du globe terrestre comme venait de le faire la comète Gallia.
La comète de Halley est la plus anciennement connue. On suppose qu’elle a été vue en l’an 134 et l’an 52 avant Jésus-Christ, puis en les années 400, 855, 930, 1006, 1230, 1305, 1380, 1456, 1531, 1607, 1682, 1759 et 1835. Elle se meut d’orient en occident, c’est-à-dire en sens inverse du mouvement des planètes autour du soleil. Les intervalles qui séparent ses apparitions sont de soixante-quinze à soixante-seize ans, suivant qu’elle est plus ou moins troublée dans sa révolution par le voisinage de Jupiter et de Saturne, – retards qui peuvent dépasser six cents jours. L’illustre Herschell, installé au cap de Bonne-Espérance, lors de l’apparition de cette comète en 1835, et dans de meilleures conditions que les astronomes de l’hémisphère boréal, put la suivre jusqu’à la fin de mars 1836, époque à laquelle sa trop grande distance de la terre la rendit invisible. À son périhélie, la comète de Halley passe à vingt-deux millions de lieues du soleil, soit une distance moindre que celle de Vénus, – ce qui semblait s’être produit pour Gallia. À son aphélie, elle s’en éloigne de treize cents millions de lieues, c’est-à-dire au-delà de l’orbe de Neptune.
La comète d’Encke est celle qui accomplit sa révolution dans la période la plus courte, puisque cette période n’est en moyenne que de douze cent cinq jours, soit moins de trois ans et demi. Elle se meut en sens direct, d’occident en orient. Elle fut découverte le 26 novembre 1818, et, après calcul de ses éléments, on reconnut qu’elle s’identifiait avec la comète observée en 1805. Ainsi que les astronomes l’avaient prédit, on la revit en 1822, 1825, 1829, 1832, 1835, 1838, 1842, 1845, 1848, 1852, etc., et elle n’a jamais cessé de se montrer sur l’horizon terrestre aux époques déterminées. Son orbite est contenue dans celle de Jupiter. Elle ne s’éloigne donc pas du soleil de plus de cent cinquante-six millions de lieues, et elle s’en rapproche à treize millions, c’est-à-dire plus près que ne le fait Mercure. Observation importante : on a remarqué que le grand diamètre de l’orbite elliptique de cette comète diminue progressivement, et que, par conséquent, sa moyenne distance au soleil devient de plus en plus petite. Il est donc probable que la comète d’Encke finira par tomber sur l’astre radieux, qui l’absorbera, à moins qu’elle ne se soit volatilisée auparavant à sa trop grande chaleur.
La comète dite de Gambart ou de Biéla a été aperçue en 1772, 1789, 1795, 1805, mais c’est seulement le 28 février 1826 que ses éléments furent déterminés. Son mouvement est direct. Sa révolution dure deux mille quatre cent dix jours, environ sept ans. À son périhélie, elle passe à trente-deux millions sept cent dix mille lieues du soleil, c’est-à-dire un peu plus près que n’en passe la terre ; à son aphélie, à deux cent trente cinq millions trois cent soixante-dix mille lieues, soit au-delà de l’orbite de Jupiter. Un curieux phénomène s’est produit en 1846. La comète de Biéla a reparu en deux morceaux sur l’horizon terrestre. Elle s’était dédoublée en route, sans doute sous l’action d’une force intérieure. Les deux fragments voyageaient alors de conserve à soixante mille lieues l’un de l’autre ; mais, en 1852, cette distance était déjà de cinq cent mille lieues.
La comète de Faye a été signalée pour la première fois le 22 novembre 1843, accomplissant sa révolution en sens direct. Les éléments de son orbite furent calculés, et l’on prédit qu’elle reviendrait en 1850 et 1851, après sept ans et demi, ou deux mille sept cent dix-huit jours. La prédiction se réalisa : l’astre reparut à l’époque indiquée et aux époques ultérieures, après être passé à soixante-quatre millions six cent cinquante mille lieues du soleil, soit plus loin que Mars, et s’en être éloigné à deux cent vingt-six millions cinq cent soixante mille lieues, soit plus loin que Jupiter.
La comète de Brörsen, douée d’un mouvement direct, a été découverte le 26 février 1846. Elle accomplit sa révolution en cinq ans et demi, ou deux mille quarante-deux jours. Sa distance périhélique est de vingt-quatre millions six cent quatorze mille lieues ; sa distance aphélique est de deux cent seize millions de lieues.
Quant aux autres comètes à courte période, celle d’Arrest accomplit sa révolution en un peu plus de six ans et demi, et a passé en 1862 à onze millions de lieues seulement de Jupiter ; celle de Tuttle se meut en treize ans deux tiers, celle de Winecke en cinq ans et demi, celle de Tempel en un temps à peu près égal, et celle de Vico semble s’être égarée dans les espaces célestes. Mais ces astres n’ont point été l’objet d’observations aussi complètes que les cinq comètes précédemment citées.
Reste à énumérer maintenant les principales comètes « à longues périodes », dont quarante ont été étudiées avec plus ou moins de précision.
La comète de 1556, dite « comète de Charles Quint », attendue vers 1860, n’a pas été aperçue.
La comète de 1680, étudiée par Newton, et qui, d’après Whiston, aurait causé le déluge en s’approchant trop près de la terre, aurait été vue l’an 619 et l’an 43 avant Jésus-Christ, puis en 531 et en 1106. Sa révolution serait de six cent soixante-quinze ans, et, à son périhélie, elle passe si près du soleil qu’elle en reçoit une chaleur vingt-huit mille fois plus considérable que celle que reçoit la terre, soit deux mille fois la température du fer en fusion.
La comète de 1586 serait comparable pour la vivacité de son éclat à une étoile de première grandeur.
La comète de 1744 traînait plusieurs queues après elle, comme un de ces pachas qui gravitent autour du Grand Turc.
La comète de 1811, qui a donné son nom à l’année de son apparition, possédait un anneau mesurant cent soixante et onze lieues de diamètre, une nébulosité de quatre cent cinquante mille lieues, et une queue de quarante-cinq millions.
La comète de 1843, que l’on a cru devoir identifier avec celle de 1668, de 1494 et de 1317, fut observée par Cassini, mais les astronomes ne sont aucunement d’accord sur la durée de sa révolution. Elle ne passe qu’à douze mille lieues de l’astre radieux, avec une vitesse de quinze mille lieues par seconde. La chaleur qu’elle reçoit alors est égale à celle que quarante-sept mille soleils enverraient à la terre. Sa queue était visible même en plein jour, tant cette effroyable température en accroissait la densité.
La comète de Donati, qui brillait avec tant de splendeur au milieu des constellations boréales, a une masse évaluée à la sept centième partie de celle de la terre.
La comète de 1862, ornée d’aigrettes lumineuses, ressemblait à quelque fantaisiste coquillage.
Enfin, la comète de 1864, dans sa révolution, qui ne s’accomplit pas en moins de deux mille huit cents siècles, va se perdre pour ainsi dire dans l’espace infini.
Sur la troisième question : Quelles sont les probabilités d’un choc entre la terre et l’une quelconque de ces comètes ?
Si l’on trace sur le papier les orbites planétaires et les orbites cométaires, on voit qu’elles s’entrecroisent en maint endroit. Mais il n’en est pas ainsi dans l’espace. Les plans qui contiennent ces orbites sont inclinés sous des angles différents par rapport à l’écliptique, qui est le plan de l’orbite terrestre. Malgré cette « précaution » du Créateur, ne peut-il arriver, tant est grand le nombre de ces comètes, que l’une d’elles vienne heurter la terre ?
Voici ce que l’on peut répondre :
La terre, on le sait, ne sort jamais du plan de l’écliptique, et l’orbite qu’elle décrit autour du soleil est tout entière contenue dans ce plan.
Que faut-il donc pour que la terre soit heurtée par une comète ? Il faut :
1° que cette comète la rencontre dans le plan de l’écliptique ;
2° que le point que la comète traverse à ce moment précis soit le point même de la courbe que décrit la terre ;
3° que la distance qui sépare le centre des deux astres soit moindre que leur rayon.
Or, ces trois circonstances peuvent-elles se produire simultanément, et, par conséquent, amener le choc ?
Lorsqu’on demandait à Arago son avis à ce sujet, il répondait :
« Le calcul des probabilités fournit le moyen d’évaluer les chances d’une pareille rencontre, et il montre qu’à l’apparition d’une comète inconnue, il y a deux cent quatre-vingts millions à parier contre un qu’elle ne viendra pas choquer notre globe. »
Laplace ne rejetait pas la possibilité d’une pareille rencontre, et il en a décrit les conséquences dans son Exposition du système du monde.
Ces chances sont-elles suffisamment rassurantes ? Chacun en décidera suivant son tempérament. Il faut, d’ailleurs, observer que le calcul de l’illustre astronome repose sur deux éléments qui peuvent varier à l’infini. Il exige, en effet : 1° qu’à son périhélie la comète soit plus près du soleil que la terre ; 2° que le diamètre de cette comète soit égal au quart de celui de la terre.
Et encore ne s’agit-il, dans ce calcul, que de la rencontre du noyau cométaire avec le globe terrestre. Si l’on voulait chiffrer les chances d’une rencontre avec la nébulosité, il faudrait les décupler, soit deux cent quatre-vingt-un millions contre dix ou vingt-huit millions cent mille contre un.
Mais, en restant dans les termes du premier problème, Arago ajoute :
« Admettons un moment que la comète qui viendrait heurter la terre anéantirait l’espèce humaine tout entière ; alors le danger de mort qui résulterait pour chaque individu de l’apparition d’une comète inconnue serait exactement égal à la chance qu’il courrait, s’il n’y avait dans une urne qu’une seule boule blanche sur un total de deux cent quatre-vingt-un millions de boules, et que sa condamnation à mort fût la conséquence inévitable de la sortie de cette boule blanche au premier tirage ! »
De tout ceci, il résulte donc qu’il n’y a aucune impossibilité à ce que la terre soit choquée par une comète.
L’a-t-elle été autrefois ?
Non, répondent les astronomes, parce que « de ce que la terre tourne autour d’un axe invariable, dit Arago, on peut conclure avec certitude qu’elle n’a pas été rencontrée par une comète. En effet, à la suite de cet ancien choc, un axe instantané de rotation eût remplacé l’axe principal, et les latitudes terrestres se trouveraient soumises à des variations continuelles que les observations n’ont pas signalées. La constance des latitudes terrestres prouve donc que, depuis l’origine, notre globe n’a pas été heurté par une comète… Donc aussi, comme quelques savants l’ont fait, on ne peut attribuer au choc d’une comète la dépression de cent mètres au-dessous du niveau de l’Océan, formée par la mer Caspienne. »
Il n’y a donc pas eu choc dans le passé, cela paraît certain, mais a-t-il pu s’en produire un ?
Ici se place naturellement l’incident Gambart.
En 1832, la réapparition de la comète Gambart provoqua dans le monde un effet de terreur certain. Une assez bizarre coïncidence cosmographique fait que l’orbite de cette comète coupe presque celle de la terre. Or, le 29 octobre, avant minuit, la comète devait passer très près de l’un des points de l’orbite terrestre. La terre y serait-elle au même moment ? Si elle y était, il y aurait rencontre, car, suivant les observations d’Olbers, la longueur du rayon de la comète étant égale à cinq rayons terrestres, une portion de l’orbite terrestre était noyée dans la nébulosité.
Très heureusement, la terre n’arriva à ce point de l’écliptique qu’un mois plus tard, le 30 novembre, et comme elle est animée d’une vitesse de translation de six cent soixante-quatorze mille lieues par jour, lorsqu’elle y passa, la comète était déjà à plus de vingt millions de lieues d’elle.
Très bien ; mais si la terre fût arrivée à ce point de son orbite un mois plus tôt ou la comète un mois plus tard, la rencontre avait lieu. Or, ce fait pouvait-il arriver ?
Évidemment, car si l’on ne doit pas admettre que quelque perturbation modifie la marche du sphéroïde terrestre, nul n’oserait prétendre que la marche d’une comète ne puisse être retardée, – ces astres étant soumis à tant d’influences redoutables sur leur route.
Donc, si le choc ne s’est pas produit dans le passé, il est certain qu’il pouvait se produire.
D’ailleurs, ladite comète Gambart, en 1805, avait déjà passé dix fois plus près de la terre, à deux millions de lieues seulement. Mais, comme on l’ignorait, ce passage ne provoqua aucune panique. Il n’en fut pas tout à fait de même pour la comète de 1843, car on craignit que le globe terrestre ne fût tout au moins englobé dans sa queue, ce qui pouvait vicier son atmosphère.
Sur la quatrième question : Étant donné qu’une collision peut se produire entre la terre et une comète, quels seraient les effets de cette collision ?
Ils seront différents, selon que la comète heurtante aura ou n’aura pas de noyau.
En effet, de ces astres vagabonds, les uns sont à noyau, comme certains fruits, les autres en sont dépourvus.
Quand le noyau manque aux comètes, celles-ci sont formées d’une nébulosité si ténue, qu’on a pu, à travers leur masse, apercevoir des étoiles de dixième grandeur. De là, des changements de forme que subissent fréquemment ces astres et la difficulté de les reconnaître. La même matière subtile entre dans la composition de leur queue. C’est comme une évaporation d’elle-même qui se fait sous l’influence de la chaleur solaire. La preuve, c’est que cette queue ne commence à se développer, soit comme un long plumeau, soit comme un éventail à plusieurs branches, que dès que les comètes ne sont plus qu’à trente millions de lieues du soleil, distance inférieure à celle qui sépare celui-ci de la terre. D’ailleurs, il arrive souvent que certaines comètes, faites évidemment d’une matière plus dense, plus résistante, plus réfractaire à l’action des hautes températures, ne présentent aucun appendice de ce genre.
Dans le cas où la rencontre s’effectuerait entre le sphéroïde terrestre et une comète sans noyau, il n’y aurait pas choc dans la véritable acception du mot. L’astronome Faye a dit que la toile d’araignée opposerait peut-être plus d’obstacle à la balle d’un fusil qu’une nébulosité cométaire. Si la matière qui compose la queue ou la chevelure n’est pas insalubre, il n’y a rien à redouter. Mais ce que l’on pourrait craindre serait ceci : ou que les vapeurs des appendices fussent incandescentes, et dans ce cas elles brûleraient tout à la surface du globe, ou qu’elles introduisissent dans l’atmosphère des éléments gazeux impropres à la vie. Cependant, il paraît difficile que cette dernière éventualité se réalise. En effet, selon Babinet, l’atmosphère terrestre, si ténue qu’elle soit à ses limites supérieures, possède encore une densité très considérable par rapport à celle des nébulosités ou appendices cométaires, et elle ne se laisserait pas pénétrer. Telle est, en effet, la ténuité de ces vapeurs, que Newton a pu affirmer que si une comète sans noyau, d’un rayon de trois cent soixante-cinq millions de lieues, était portée au degré de condensation de l’atmosphère terrestre, elle tiendrait tout entière dans un dé de vingt cinq millimètres de diamètre.
Donc, pour les cas de comètes à simple nébulosité, peu de danger à craindre en cas de rencontre. Mais qu’arriverait-il si l’astre chevelu était formé d’un noyau dur ?
Et d’abord, existe-t-il de ces noyaux ? On répondra qu’il doit en exister, lorsque la comète a atteint un degré de concentration suffisant pour être passée de l’état gazeux à l’état solide. Dans ce cas, lorsqu’elle s’interpose entre une étoile et un observateur placé sur la terre, il y a occultation de l’étoile.
Or, il paraît que quatre cent quatre-vingt ans avant Jésus-Christ, au temps de Xerxès, suivant Anaxagore, le soleil fut éclipsé par une comète. De même, quelques jours avant la mort d’Auguste, Dion observa une éclipse de ce genre, éclipse qui ne pouvait être due à l’interposition de la lune, puisque la lune, ce jour-là, se trouvait en opposition.
Il faut dire cependant que les cométographes récusent ce double témoignage, et ils n’ont peut-être pas tort. Mais deux observations plus récentes ne permettent pas de mettre en doute l’existence des noyaux cométaires. En effet, les comètes de 1774 et de 1828 produisirent l’occultation d’étoiles de huitième grandeur. Il est également admis, après observations directes, que les comètes de 1402, 1532, 1744, ont des noyaux durs. Pour la comète de 1843, le fait est d’autant plus certain qu’on pouvait apercevoir l’astre en plein midi, près du soleil, et sans l’aide d’aucun instrument.
Non seulement les noyaux durs existent dans certaines comètes, mais on les a même mesurés. C’est ainsi que l’on connaît des diamètres réels, depuis onze et douze lieues pour les comètes de 1798 et 1805 (Gambart), jusqu’à trois mille deux cents lieues pour celle de 1845. Cette dernière aurait donc un noyau plus gros que le globe terrestre, si bien qu’en cas de rencontre, l’avantage resterait peut-être à la comète.
Quant aux quelques nébulosités les plus remarquables qui ont été mesurées, on trouve qu’elles varient entre sept mille deux cents et quatre cent cinquante mille lieues.
Pour conclure, il faut dire avec Arago :
Il existe ou peut exister :
1° Des comètes sans noyau ;
2° Des comètes dont le noyau est peut-être diaphane ;
3° Des comètes plus brillantes que les planètes, ayant un noyau probablement solide et opaque.
Et maintenant, avant de rechercher quelles seraient les conséquences d’une rencontre de la terre et l’un de ces astres, il est à propos de remarquer que, même au cas où il n’y aurait pas choc direct, les phénomènes les plus graves pourraient se produire.
En effet, le passage à petite distance d’une comète, si sa masse est suffisamment considérable, ne serait pas sans danger. Avec une masse inférieure, rien à craindre. C’est ainsi que la comète de 1770, qui s’est approchée de la terre à six cent mille lieues, n’a pas fait varier d’une seconde la durée de l’année terrestre, tandis que l’action de la terre avait retardé de deux jours la révolution de la comète.
Mais, au cas où les masses des deux corps seraient égales, si la comète passait à cinquante-cinq mille lieues seulement de la terre, elle augmenterait la durée de l’année terrestre de seize heures cinq minutes et changerait de deux degrés l’obliquité de l’écliptique. Peut-être aussi capterait-elle la lune en passant.
Enfin quelles seraient les conséquences d’un choc ? On va les connaître.
Ou la comète, effleurant seulement le globe terrestre, y laisserait un morceau d’elle-même, ou elle en arracherait quelques parcelles – et c’est le cas de Gallia –, ou bien elle s’y appliquerait de manière à former à sa surface un continent nouveau.
Dans tous ces cas, la vitesse tangentielle de translation de la terre pourrait être subitement anéantie. Alors, êtres, arbres, maisons seraient projetés avec cette vitesse de huit lieues par seconde dont ils étaient animés avant le choc. Les mers s’élanceraient hors de leurs bassins naturels pour tout anéantir. Les parties centrales du globe, qui sont encore liquides, l’éventrant par contrecoup, tendraient à s’échapper au-dehors. L’axe de la terre étant changé, un nouvel équateur se substituerait à l’ancien. Enfin la vitesse du globe pourrait être absolument enrayée, et, par conséquent, la force attractive du soleil n’étant plus contrebalancée, la terre tomberait vers lui en ligne droite, pour s’y absorber après une chute de soixante-quatre jours et demi.
Et même, par application de la théorie de Tyndall, que la chaleur n’est qu’un mode du mouvement, la vitesse du globe, subitement interrompue, se transformerait mécaniquement en chaleur. La terre, alors, sous l’action d’une température portée à des millions de degrés, se volatiliserait en quelques secondes.
Mais, et pour finir ce rapide résumé, il y a deux cent quatre-vingt-un millions de chances contre une qu’une collision entre la terre et une comète ne s’effectuera pas.
« Sans doute, ainsi que le dit plus tard Palmyrin Rosette, sans doute, mais nous avons tiré la boule blanche. »
Chapitre IV
Dans lequel on verra Palmyrin Rosette tellement enchanté de son sort que cela donne beaucoup à réfléchir
« La comète ! » tels étaient les derniers mots prononcés par le professeur. Puis il avait regardé ses auditeurs en fronçant le sourcil, comme si l’un d’eux eût eu la pensée de lui contester ses droits de propriété sur Gallia. Peut-être même se demandait-il à quel titre ces intrus, rangés autour de lui, s’étaient installés sur son domaine.
Cependant, le capitaine Servadac, le comte Timascheff et le lieutenant Procope étaient restés silencieux. Ils tenaient enfin la vérité, dont ils avaient pu s’approcher de si près. On se rappelle quelles furent les hypothèses successivement admises après discussions : d’abord, changement de l’axe de rotation de la terre et modification de deux points cardinaux ; puis, fragment détaché du sphéroïde terrestre et emporté dans l’espace ; enfin comète inconnue qui, après avoir effleuré la terre, en avait enlevé quelques parcelles et les entraînait peut-être jusque dans le monde sidéral.
Le passé, on le connaissait. Le présent, on le voyait. Que serait l’avenir ? Cet original de savant l’avait-il pressenti ? Hector Servadac et ses compagnons hésitaient à le lui demander.
Palmyrin Rosette, ayant pris son grand air de professeur, semblait maintenant attendre que les étrangers, assemblés dans la salle commune, lui fussent présentés.
Hector Servadac procéda à la cérémonie, pour ne pas indisposer le susceptible et rébarbatif astronome.
« Monsieur le comte Timascheff, dit-il en présentant son compagnon.
– Soyez le bienvenu, monsieur le comte, répondit Palmyrin Rosette, avec toute la condescendance d’un maître de maison qui se sait chez lui.
– Monsieur le professeur, dit le comte Timascheff, ce n’est pas précisément de mon plein gré que je suis venu sur votre comète, mais je ne dois pas moins vous remercier de m’y recevoir si hospitalièrement. »
Hector Servadac, sentant l’ironie de la réponse, sourit légèrement et dit :
« Le lieutenant Procope, commandant la goélette Dobryna, sur laquelle nous avons fait le tour du monde gallien.
– Le tour ?… s’écria vivement le professeur.
– Exactement le tour », répondit le capitaine Servadac. Puis il continua :
« Ben-Zouf, mon ordon…
– Aide de camp du gouverneur général de Gallia », se hâta d’ajouter Ben-Zouf, qui ne voulait pas laisser contester cette double qualité ni à lui ni à son capitaine.
Furent présentés successivement les matelots russes, les Espagnols, le jeune Pablo et la petite Nina, que le professeur regarda par-dessous ses formidables lunettes, comme un bourru qui n’aime pas les enfants.
Quant à Isac Hakhabut, il s’avança en disant :
« Monsieur l’astronome, une question, une seule, mais à laquelle j’attache une grande importance… Quand pouvons-nous espérer revenir ?…
– Eh ! répondit le professeur, qui parle de revenir ! C’est à peine si nous sommes partis ! »
Les présentations étant faites, Hector Servadac pria Palmyrin Rosette de raconter son histoire. Cette histoire peut se résumer en quelques lignes.
Le gouvernement français, ayant voulu vérifier la mesure de l’arc relevé sur le méridien de Paris, nomma à cet effet une commission scientifique, dont, vu son insociabilité, ne fit pas partie Palmyrin Rosette. Le professeur, évincé et furieux, résolut donc de travailler pour son propre compte. Prétendant que les premières opérations géodésiques étaient entachées d’inexactitudes, il résolut de vérifier à nouveau les mesures de l’extrême réseau qui avait relié Formentera au littoral espagnol par un triangle dont l’un des côtés mesurait quarante lieues. C’était le travail qu’Arago et Biot avaient fait avant lui avec une remarquable perfection.
Palmyrin Rosette quitta donc Paris. Il se rendit aux Baléares, il plaça son observatoire sur la plus haute cime de l’île et s’installa pour y vivre en ermite avec son domestique Joseph, tandis qu’un de ses anciens préparateurs, qu’il avait engagé à cet usage, s’occupait d’établir sur un des sommets de la côte d’Espagne un réverbère qui pût être visé par les lunettes de Formentera. Quelques livres, des instruments d’observation, des vivres pour deux mois, composaient tout son matériel, sans compter une lunette astronomique dont Palmyrin Rosette ne se séparait jamais et qui semblait faire partie de lui-même. C’est que l’ancien professeur de Charlemagne avait la passion de fouiller les profondeurs du ciel et l’espoir d’y faire encore quelque découverte qui immortaliserait son nom. C’était sa marotte.
Le travail de Palmyrin Rosette exigeait avant tout une extrême patience. Chaque nuit, il devait guetter le fanal que son préparateur tenait allumé sur le littoral espagnol, afin de fixer le sommet de son triangle, et il n’avait pas oublié que, dans ces conditions, soixante et un jours s’étaient écoulés avant qu’Arago et Biot eussent pu atteindre ce but. Malheureusement, on l’a dit, un épais brouillard, d’une extraordinaire intensité, enveloppait non seulement cette partie de l’Europe, mais le globe tout entier.
Or, précisément, sur ces parages des îles Baléares, à plusieurs reprises, des trouées se firent à l’amas des brumes. Il s’agissait donc de veiller avec le plus grand soin, – ce qui n’empêchait pas Palmyrin Rosette de jeter un regard interrogateur sur le firmament, car il s’occupait alors de réviser la carte de cette partie du ciel où se dessine la constellation des Gémeaux.
Cette constellation, à l’œil nu, présente au plus six étoiles ; mais, avec un télescope de vingt-sept centimètres d’ouverture, on en relève plus de six mille. Palmyrin Rosette ne possédait point un réflecteur de cette force, et, faute de mieux, il n’avait que sa lunette astronomique.
Cependant, un certain jour, cherchant à jauger les profondeurs célestes dans la constellation des Gémeaux, il crut reconnaître un point brillant que ne portait aucune carte. C’était sans doute une étoile non cataloguée. Mais, en l’observant avec attention pendant quelques nuits, le professeur vit que l’astre en question se déplaçait très rapidement par rapport aux autres fixes. Était-ce une nouvelle petite planète que le dieu des astronomes lui envoyait ? Tenait-il enfin une découverte ?
Palmyrin Rosette redoubla d’attention, et la vitesse de déplacement de l’astre lui apprit qu’il s’agissait là d’une comète. Bientôt, d’ailleurs, la nébulosité fut visible, puis la queue se développa, lorsque la comète ne fut plus qu’à trente millions de lieues du soleil.
Il faut bien l’avouer, à partir de ce moment, le grand triangle fut absolument négligé. Très certainement, chaque nuit, le préparateur de Palmyrin Rosette allumait consciencieusement son fanal sur la rive espagnole, mais très certainement aussi, Palmyrin Rosette ne regardait plus dans cette direction. Il n’avait plus d’objectif ni d’oculaire que pour le nouvel astre chevelu qu’il voulait étudier et nommer. Il vivait uniquement dans ce coin du ciel que les Gémeaux circonscrivent.
Lorsque l’on veut calculer les éléments d’une comète, on commence toujours par lui supposer une orbite parabolique. C’est la meilleure manière de procéder. En effet, les comètes se montrent généralement dans le voisinage de leur périhélie, c’est-à-dire à leur plus courte distance du soleil, qui occupe un des foyers de l’orbite. Or, entre l’ellipse et la parabole, dont le foyer est commun, la différence n’est pas sensible dans cette portion de leurs courbes, car la parabole n’est qu’une ellipse à axe infini.
Palmyrin Rosette basa donc ses calculs sur l’hypothèse d’une courbe parabolique, et il eut raison dans ce cas.
De même que pour déterminer un cercle il est nécessaire de connaître trois points de sa circonférence, de même pour déterminer les éléments d’une comète il faut avoir observé successivement trois positions différentes. On peut alors tracer la route que l’astre suivra dans l’espace et établir ce qu’on appelle « ses éphémérides ».
Palmyrin Rosette ne se contenta pas de trois positions. Profitant de ce qu’une chance exceptionnelle déchirait le brouillard à son zénith, il en releva dix, vingt, trente, en ascension droite et en déclinaison, et obtint avec une grande justesse les cinq éléments de la nouvelle comète, qui s’avançait avec une effrayante rapidité.
Il eut ainsi :
1° L’inclinaison de l’orbite cométaire sur l’écliptique, c’est-à-dire sur le plan qui contient la courbe de translation de la terre autour du soleil. Ordinairement, l’angle que ces plans font entre eux est assez considérable, – ce qui, on le sait, diminue les chances de rencontre. Mais, dans le cas actuel, les deux plans coïncidaient.
2° La fixation du nœud ascendant de la comète, c’est-à-dire sa longitude sur l’écliptique, autrement dit encore le point où l’astre chevelu coupait l’orbite terrestre.
Ces deux premiers éléments obtenus, la position du plan de l’orbite cométaire dans l’espace était fixée.
3° La direction du grand axe de l’orbite. Elle fut obtenue en calculant quelle était la longitude du périhélie de la comète, et Palmyrin Rosette eut ainsi la situation de la courbe parabolique dans le plan déjà déterminé.
4° La distance périhélie de la comète, c’est-à-dire la distance qui la séparerait du soleil quand elle passerait au point le plus rapproché, – calcul qui, en fin de compte, donna exactement la forme de l’orbite parabolique, puisqu’elle avait nécessairement le soleil à son foyer.
5° Enfin, le sens du mouvement de la comète. Ce mouvement était rétrograde par rapport à celui des planètes, c’est-à-dire qu’elle se mouvait d’orient[8] en occident.
Ces cinq éléments étant connus, Palmyrin Rosette calcula la date à laquelle la comète passerait à son périhélie. Puis, à son extrême joie, ayant constaté que c’était une comète inconnue, il lui donna le nom de Gallia, non sans avoir hésité entre Palmyra et Rosetta, et il se mit à rédiger son rapport.
On se demandera si le professeur avait reconnu qu’une collision était possible entre la terre et Gallia.
Parfaitement, collision non seulement possible, mais certaine.
Dire qu’il en fut enchanté, ce serait rester au-dessous du vrai. Ce fut du délire astronomique. Oui ! la terre serait heurtée dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, et le choc serait d’autant plus terrible que les deux astres marchaient en sens inverse !
Un autre, effrayé, eût immédiatement quitté Formentera. Lui resta à son poste. Non seulement il n’abandonna pas son île, mais il ne dit rien de sa découverte. Les journaux lui avaient appris que d’épaisses brumes rendaient toute observation impossible sur les deux continents, et, comme aucun observatoire n’avait signalé cette nouvelle comète, il était fondé à croire que lui seul l’avait découverte dans l’espace.
Cela était, en effet, et cette circonstance épargna au reste de la terre l’immense panique dont ses habitants eussent été pris, s’ils avaient connu le danger qui les menaçait.
Ainsi, Palmyrin Rosette fut le seul à savoir qu’une rencontre aurait lieu entre la terre et cette comète que le ciel des Baléares lui avait laissé voir, tandis que, partout ailleurs, elle se dérobait aux regards des astronomes.
Le professeur demeura donc à Formentera, et avec d’autant plus d’obstination que, d’après ses calculs, l’astre chevelu devait frapper la terre dans le sud de l’Algérie. Or, il voulait être là, car, la comète étant une comète à noyau dur, « cela serait fort curieux ! »
Le choc se produisit avec tous les effets que l’on connaît. Mais il arriva ceci : c’est que Palmyrin Rosette fut instantanément séparé de son domestique Joseph ! Et, lorsqu’il revint d’un assez long évanouissement, il se trouva seul sur un îlot. C’était tout ce qui restait de l’archipel des Baléares.
Telle fut l’histoire racontée par le professeur, avec nombre d’interjections et de froncements de sourcils que ne justifiait aucunement l’attitude complaisante de ses auditeurs. Il finit en disant :
« Des modifications importantes s’étaient produites : déplacement des points cardinaux, diminution de l’intensité de la pesanteur. Mais je ne fus pas induit comme vous, messieurs, à croire que j’étais encore sur le sphéroïde terrestre ! Non ! La terre continuait à graviter dans l’espace, accompagnée de sa lune qui ne l’avait point abandonnée, et suivait son orbite normale que n’avait pas dérangée le choc. Elle n’avait été, d’ailleurs, qu’effleurée pour ainsi dire par la comète, et n’y avait perdu que ces quelques portions insignifiantes que vous avez retrouvées. Tout s’est donc passé pour le mieux, et nous n’avons pas à nous plaindre. En effet, ou nous pouvions être écrasés au heurt de la comète, ou celle-ci pouvait rester fixée à la terre, et, dans ces deux cas, nous n’aurions pas l’avantage de pérégriner maintenant à travers le monde solaire. »
Palmyrin Rosette disait toutes ces choses avec une telle satisfaction, qu’il n’y avait pas à tenter de le contredire. Seul, le maladroit Ben-Zouf se hasarda à émettre cette opinion, « que si, au lieu de frapper un point de l’Afrique, la comète se fût heurtée à la butte Montmartre, très certainement cette butte eût résisté, et alors…
– Montmartre ! s’écria Palmyrin Rosette ! mais la butte Montmartre eût été réduite en poussière, comme une vulgaire taupinière qu’elle est !
– Taupinière ! s’écria à son tour Ben-Zouf, blessé au vif. Mais ma butte eût accroché votre bribe de comète au vol et s’en fût coiffée comme d’un simple képi ! »
Hector Servadac, pour couper court à cette inopportune discussion, imposa silence à Ben-Zouf, en expliquant au professeur quelles singulières idées son soldat avait sur la solidité de la butte Montmartre.
L’incident fut donc vidé, « par ordre », mais l’ordonnance ne devait jamais pardonner à Palmyrin Rosette la façon méprisante dont celui-ci avait parlé de sa butte natale !
Cependant, si Palmyrin Rosette, après le choc, avait pu continuer ses observations astronomiques, et quels en étaient les résultats en ce qui concernait l’avenir de la comète ? voilà ce qu’il était important de connaître.
Le lieutenant Procope, avec tous les ménagements que comportait le tempérament rébarbatif du professeur, posa cette double question relative à la route que Gallia suivait maintenant dans l’espace et à la durée de sa révolution autour du soleil.
« Oui, monsieur, dit Palmyrin Rosette, j’avais déterminé la route de ma comète avant le choc, mais j’ai dû recommencer mes calculs.
– Et pourquoi, monsieur le professeur ? demanda le lieutenant Procope, assez étonné de la réponse.
– Parce que si l’orbite terrestre n’avait pas été modifiée par la rencontre, il n’en était pas ainsi de l’orbite gallienne.
– Cette orbite a été changée par le choc ?
– J’ose absolument l’affirmer, répondit Palmyrin Rosette, attendu que mes observations, postérieures à la collision, ont été faites avec une précision extrême.
– Et vous aviez obtenu les éléments de la nouvelle orbite ? demanda vivement le lieutenant Procope.
– Oui, répondit sans hésiter Palmyrin Rosette.
– Mais alors vous savez ?…
– Ce que je sais, monsieur, le voici : c’est que Gallia a choqué la terre en passant à son nœud ascendant, à deux heures quarante-sept minutes trente-cinq secondes six dixièmes du matin, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier ; que le 10 janvier elle a coupé l’orbite de Vénus, qu’elle a passé à son périhélie au 15 janvier, qu’elle a recoupé l’orbite de Vénus, franchi son nœud descendant au 1er février, croisé l’orbite de Mars au 13 février, pénétré dans la zone des planètes télescopiques le 10 mars, pris Nérina pour satellite…
– Circonstances que nous connaissons tous, cher professeur, dit Hector Servadac, puisque nous avons eu la chance de recueillir vos notices. Seulement, elles ne portaient ni signature ni lieu d’origine.
– Eh ! pouvait-on douter qu’elles ne fussent de moi, s’écria superbement le professeur, de moi qui les avais jetées par centaines à la mer, de moi, Palmyrin Rosette !
– On ne le pouvait pas ! » répondit gravement le comte Timascheff.
Cependant, aucune réponse n’avait été faite touchant l’avenir de Gallia. Il semblait même que Palmyrin Rosette voulût éviter de répondre directement. Le lieutenant Procope allait donc réitérer sa demande, et plus catégoriquement ; mais Hector Servadac, pensant qu’il valait mieux ne pas presser cet original, lui dit :
« Ah çà ! cher professeur, nous expliquerez-vous comment il se fait que, dans une rencontre aussi formidable, nous n’ayons pas été plus maltraités ?
– Cela est très explicable.
– Et pensez-vous que, sauf l’enlèvement de quelques lieues carrées de territoire, la terre n’ait pas plus souffert, et, entre autres choses, que son axe de rotation n’ait pas été changé subitement ?
– Je le pense, capitaine Servadac, répondit Palmyrin Rosette, et voici mes raisons. La terre marchait alors avec une vitesse de vingt-huit mille huit cent lieues à l’heure, Gallia avec une vitesse de cinquante-sept mille lieues à l’heure. C’est comme si un train, faisant environ quatre-vingt-six mille lieues à l’heure, se précipitait sur un obstacle. Ce qu’a dû être le choc, messieurs, vous pouvez en juger. La comète, dont le noyau est d’une substance extrêmement dure, a fait ce que fait une balle, tirée de près, à travers un carreau de vitre : elle a traversé la terre sans rien briser.
– En effet, répondit Hector Servadac, les choses ont pu certainement se passer ainsi…
– Ont dû… reprit le professeur, toujours affirmatif, et d’autant mieux que le globe terrestre n’a été que très obliquement touché. Mais si Gallia y fût tombée normalement, elle y aurait profondément pénétré, en causant les plus graves désastres, et elle eût même écrasé la butte Montmartre, si cette butte se fût trouvée sur son passage !
– Monsieur !… s’écria Ben-Zouf, directement attaqué et sans provocation, cette fois.
– Silence, Ben-Zouf », dit le capitaine Servadac. En ce moment, Isac Hakhabut, convaincu peut-être de la réalité des faits, s’approcha de Palmyrin Rosette, et d’un ton qui dénotait une extrême inquiétude.
« Monsieur le professeur, demanda-t-il, reviendra-t-on à la terre, et quand y reviendra-t-on ?
– Vous êtes donc bien pressé ? répondit Palmyrin Rosette.
– Ce qu’Isac vous demande, monsieur, dit alors le lieutenant Procope, je désirerais le formuler plus scientifiquement.
– Faites.
– Vous dites que l’ancienne orbite de Gallia a été modifiée ?
– Incontestablement.
– La nouvelle orbite, la nouvelle courbe que suit la comète est-elle hyperbolique, ce qui l’entraînerait à des distances infinies dans le monde sidéral et sans aucun espoir de retour ?
– Non ! répondit Palmyrin Rosette.
– Cette orbite serait donc devenue elliptique ?
– Elliptique.
– Et son plan coïnciderait toujours avec celui de l’orbite terrestre ?
– Absolument.
– Gallia serait donc une comète périodique ?
– Oui, et à courte période, puisque sa révolution autour du soleil, en tenant compte des perturbations que lui feront subir Jupiter, Saturne et Mars, s’accomplira exactement en deux ans.
– Mais alors, s’écria le lieutenant Procope, toutes les chances seraient pour que, deux ans après le choc, elle retrouvât la terre au point même où elle l’a déjà rencontrée ?
– En effet, monsieur, cela est à craindre !
– À craindre ! s’écria le capitaine Servadac.
– Oui, messieurs, répondit Palmyrin Rosette en frappant du pied. Nous sommes bien où nous sommes, et, si cela ne dépendait que de moi, Gallia ne reviendrait jamais à la terre ! »
Chapitre V
Dans lequel l’élève Servadac est assez malmené par le professeur Palmyrin Rosette
Ainsi donc, pour ces chercheurs, pour ces inventeurs d’hypothèses, tout était clair à présent, tout était expliqué. Ils se trouvaient emportés sur une comète, gravitant dans le monde solaire. Après le choc, c’était la terre, fuyant dans l’espace, que le capitaine Servadac avait entrevue derrière l’épaisse couche de nuages. C’était le globe terrestre qui avait provoqué cette importante et unique marée dont la mer Gallienne avait subi l’influence.
Mais enfin cette comète devait revenir à la terre, – du moins le professeur l’affirmait. Toutefois, ses calculs étaient-ils assez précis pour que ce retour fût mathématiquement assuré ? On conviendra que les Galliens devaient conserver bien des doutes à cet égard.
Les jours suivants furent employés à l’installation du nouveau venu. C’était, heureusement, l’un de ces hommes, peu difficiles aux choses de la vie, qui s’accommodent de tout. Vivant jour et nuit dans les cieux, parmi les étoiles, courant après les astres vagabonds de l’espace, les questions de logement et de nourriture – son café à part –, le préoccupaient assez peu. Il n’eut pas même l’air de remarquer cette ingéniosité que les colons avaient déployée dans les aménagements de Nina-Ruche.
Le capitaine Servadac voulait offrir la meilleure chambre de toutes à son ancien professeur. Mais celui-ci, se souciant peu de partager la vie commune, refusa net. Ce qu’il lui fallait, c’était une sorte d’observatoire, bien exposé, bien isolé, et dans lequel il pourrait se livrer tranquillement à ses observations astronomiques.
Hector Servadac et le lieutenant Procope s’occupèrent donc de lui trouver le logement en question. Ils eurent la main assez heureuse. Dans les flancs du massif volcanique, à cent pieds environ au-dessus de la grotte centrale, ils découvrirent une sorte d’étroit réduit, suffisant à contenir l’observateur et ses instruments. Il y avait place pour un lit, quelques meubles, table, fauteuil, armoire, sans compter la fameuse lunette, qui fut disposée de manière à se manœuvrer facilement. Un simple filet de lave, dérivé de la grande chute, suffit à chauffer ledit observatoire.
C’est là que s’installa le professeur, mangeant les aliments qu’on lui apportait à heure fixe, dormant peu, calculant le jour, observant la nuit, en un mot se mêlant le moins possible à la vie commune. Le mieux, après tout, son originalité étant admise, était de le laisser faire à sa guise.
Le froid était devenu très vif. La colonne thermométrique n’accusait plus en moyenne que trente degrés centigrades au-dessous de zéro. Elle n’oscillait pas dans le tube de verre comme elle eût fait sous des climats capricieux, mais elle baissait lentement, progressivement. Cette baisse se continuerait ainsi jusqu’à ce qu’elle eût atteint la limite extrême des froids de l’espace, et la température ne remonterait que lorsque Gallia se rapprocherait du soleil en suivant sa trajectoire elliptique.
Si la colonne mercurielle n’oscillait pas dans le tube du thermomètre, cela tenait à ce qu’aucun souffle de vent ne troublait l’atmosphère gallienne. Les colons se trouvaient dans des conditions climatériques toutes particulières. Pas une molécule d’air ne se déplaçait. Tout ce qui était liquide ou fluide à la surface de la comète semblait être gelé. Donc, pas un orage, pas une averse, pas une vapeur, ni au zénith, ni à l’horizon. Jamais de ces brouillards humides ni de ces brumes sèches qui envahissent les régions polaires du sphéroïde terrestre. Le ciel conservait une invariable et inaltérable sérénité, tout imprégné, le jour, de rayons solaires, la nuit, de rayons stellaires, sans que les uns parussent être plus chauds que les autres.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que cette excessive température était parfaitement supportable en plein air. En effet, ce que les hiverneurs des contrées arctiques ne peuvent impunément éprouver, ce qui dessèche leurs poumons et les rend impropres aux fonctions vitales, c’est l’air froid violemment déplacé, c’est la bise aiguë, ce sont les brumes malsaines, les terribles chasse-neige. Là est la cause de toutes les affections qui tuent les navigateurs polaires. Mais, pendant les périodes de calme, lorsque l’atmosphère n’est pas troublée, fussent-ils à l’île Melville comme Parry, ou au-delà du quatre-vingt-unième degré comme Kane, plus loin encore hors des limites atteintes par le courageux Hall et les explorateurs du Polaris, ils savent braver les froids, quelque intenses qu’ils puissent être. À la condition d’être bien vêtus, bien nourris, ils affrontent les plus extrêmes températures en l’absence de tout vent, et ils l’ont fait, même lorsque l’alcool des thermomètres tombait à soixante degrés au-dessous de zéro.
Les colons de la Terre-Chaude étaient donc dans les meilleures conditions pour supporter les froids de l’espace. Les fourrures de la goélette, les peaux préparées ne leur manquaient pas. La nourriture était abondante et saine. Enfin le calme de l’atmosphère permettait d’aller et de venir impunément, malgré les excessifs abaissements de la température.
D’ailleurs, le gouverneur général de Gallia tenait la main à ce que tous les colons fussent chaudement vêtus et abondamment nourris. D’hygiéniques exercices étaient prescrits et exécutés quotidiennement. Nul ne pouvait se soustraire au programme de la vie commune. Ni le jeune Pablo ni la petite Nina n’étaient exemptés de la règle. Bien emmitouflés de fourrures, ces deux êtres charmants avaient l’air de gracieux Esquimaux, lorsqu’ils patinaient ensemble devant le littoral de la Terre-Chaude. Pablo était toujours empressé près de sa compagne. Il l’aidait dans ses jeux, il la soutenait lorsqu’elle se sentait trop fatiguée. Tout cela était bien de leur âge.
Et que devenait Isac Hakhabut ?
Après son assez maussade présentation à Palmyrin Rosette, Isac Hakhabut était revenu tout penaud à sa tartane. Un changement venait de se faire dans les idées d’Isac. – Avec les détails si précis donnés par le professeur, il ne pouvait plus douter, il ne doutait plus. Il se savait emporté dans l’espace par une vagabonde comète, à des millions de lieues de ce globe terrestre, sur lequel il avait fait tant et de si bonnes affaires !
À se voir ainsi, lui trente-sixième sur Gallia, il semble que cette situation, si en dehors des prévisions humaines, aurait dû modifier ses idées et son caractère, qu’il aurait dû faire un retour sur lui-même, revenir à de meilleurs sentiments envers ces quelques semblables que Dieu lui avait fait la grâce de laisser près de lui, et ne plus les considérer comme matière utilisable à son profit seulement.
Il n’en fut rien. Si Isac Hakhabut eût changé, il n’aurait pas été le spécimen accompli de ce que peut devenir l’homme qui ne pense qu’à lui-même. Au contraire, il s’endurcit à plaisir et ne songea plus qu’à ceci : exploiter la situation jusqu’au bout. Il connaissait assez le capitaine Servadac pour être assuré qu’il ne lui serait fait aucun tort ; il savait que son bien était sous la sauvegarde d’un officier français, et qu’à moins d’un cas de force majeure, rien ne serait tenté contre lui. Or, ce cas de force majeure ne semblait pas devoir se produire, et voici comment Isac Hakhabut entendait exploiter la situation.
Les chances de retour à la terre, si peu assurées qu’elles fussent, méritaient cependant qu’il en fût tenu compte, d’une part. De l’autre, l’or et l’argent, anglais ou russes, ne manquaient pas dans la petite colonie, mais ce métal n’avait de valeur que s’il reprenait circulation sur l’ancienne terre. Il s’agissait d’absorber peu à peu toute la richesse monétaire de Gallia. L’intérêt d’Isac Hakhabut était donc celui-ci : vendre ses marchandises avant le retour, car, par leur rareté même, elles avaient plus de valeur sur Gallia qu’elles n’en auraient sur la terre, mais attendre que, par suite des besoins de la colonie, la demande fût de beaucoup supérieure à l’offre. De là, une hausse certaine et un lucre non moins certain. Donc, vendre, mais attendre pour mieux vendre.
Voilà à quoi réfléchissait Isac Hakhabut dans son étroite cabine de la Hansa. En tout cas, on était débarrassé de sa méchante figure, et il ne fallait pas s’en plaindre.
Pendant ce mois d’avril, le chemin parcouru par Gallia fut de trente-neuf millions de lieues, et, le mois achevé, elle se trouvait à cent dix millions de lieues du soleil. L’orbite elliptique de la comète, comprenant ses éphémérides, avait été très exactement dessinée par le professeur. Vingt-quatre divisions inégales étaient portées sur cette courbe et y représentaient les vingt-quatre mois de l’année gallienne. Ces divisions indiquaient le chemin parcouru mensuellement. Les douze premiers segments, marqués sur la courbe, diminuaient progressivement de longueur jusqu’au point aphélie, conformément à l’une des trois lois de Kepler ; puis, ce point passé, ils allaient s’accroissant à mesure qu’ils se rapprochaient du périhélie.
Le professeur communiqua un jour – c’était le 12 mai – son travail au capitaine Servadac, au comte Timascheff et au lieutenant Procope. Ceux-ci l’examinèrent avec un intérêt facile à comprendre. Toute la trajectoire de Gallia se développait à leurs yeux, et ils pouvaient voir qu’elle s’étendait un peu au-delà de l’orbite de Jupiter. Les chemins parcourus chaque mois et les distances au soleil y étaient exprimés en chiffres. Rien n’était plus clair, et si Palmyrin Rosette ne s’était pas trompé, si Gallia accomplissait exactement en deux années sa révolution, elle retrouverait la terre au point où elle l’avait heurtée, puisque, dans ce même laps de temps, deux révolutions terrestres se seraient mathématiquement accomplies. Mais quelles seraient alors les conséquences du nouveau choc ? on ne voulait pas seulement y penser !
En tout cas, si l’exactitude du travail de Palmyrin Rosette pouvait être suspectée, il fallait se garder d’en laisser rien paraître.
« Ainsi donc, dit Hector Servadac, pendant le mois de mai, Gallia ne décrira que trente millions quatre cent mille lieues et sera reportée à cent trente-neuf millions de lieues du soleil ?
– Exactement, répondit le professeur.
– Nous avons donc quitté la zone des planètes télescopiques ? ajouta le comte Timascheff.
– Jugez-en vous-même, monsieur, répliqua Palmyrin Rosette, puisque j’ai tracé la zone de ces planètes !
– Et la comète sera à son aphélie, demanda Hector Servadac, juste un an après avoir passé à son périhélie ?
– Juste.
– Au 15 janvier prochain ?
– Évidemment, au 15 janvier… Ah ! mais non ! s’écria le professeur. Pourquoi dites-vous 15 janvier, capitaine Servadac ?
– Parce que du 15 janvier au 15 janvier, cela fait un an, je suppose, autrement dit douze mois !…
– Douze mois terrestres, oui ! répondit le professeur, mais non douze mois galliens ! »
Le lieutenant Procope, à cette proposition inattendue, ne put s’empêcher de sourire.
« Vous souriez, monsieur, dit vivement Palmyrin Rosette. Et pourquoi souriez-vous ?
– Oh ! simplement, monsieur le professeur, parce que je vois que vous voulez réformer le calendrier terrestre.
– Je ne veux rien, monsieur, si ce n’est être logique !
– Soyons logiques, cher professeur ! s’écria le capitaine Servadac, soyons logiques !
– Est-il admis, demanda Palmyrin Rosette d’un ton assez sec, que Gallia reviendra à son périhélie deux ans après y avoir passé ?
– C’est admis.
– Ce laps de deux ans, qui constitue une révolution complète autour du soleil, constitue-t-il l’année gallienne ?
– Parfaitement.
– Cette année doit-elle, comme toute année quelconque, être divisée en douze mois ?
– Si vous le voulez, cher professeur.
– Ce n’est pas : si je le veux…
– Eh bien, oui ! en douze mois ! répondit Hector Servadac.
– Et de combien de jours ces mois seront-ils formés ?
– De soixante jours, puisque les jours ont diminué de moitié.
– Capitaine Servadac, dit le professeur d’un ton sévère, réfléchissez à ce que vous dites…
– Mais il me semble que je rentre dans votre système, répondit Hector Servadac.
– En aucune façon.
– Expliquez-nous alors…
– Mais rien n’est plus simple ! répliqua Palmyrin Rosette, qui haussa dédaigneusement les épaules. Chaque mois gallien doit-il comprendre deux mois terrestres ?
– Sans doute, puisque l’année gallienne doit durer deux ans.
– Deux mois font-ils bien soixante jours sur terre ?
– Oui, soixante jours.
– Et par conséquent ?… demanda le comte Timascheff, en s’adressant à Palmyrin Rosette.
– Par conséquent, si deux mois comprennent soixante jours terrestres, cela fait cent vingt jours galliens, puisque la durée du jour à la surface de Gallia n’est plus que douze heures. Est-ce compris ?
– Parfaitement compris, monsieur, répondit le comte Timascheff. Mais ne craignez-vous pas que ce nouveau calendrier ne soit un peu trouble…
– Trouble ! s’écria le professeur ! Depuis le 1er janvier, je ne compte pas autrement !
– Ainsi, demanda le capitaine Servadac, nos mois auront maintenant au moins cent vingt jours.
– Quel mal y voyez-vous ?
– Aucun, mon cher professeur. Donc, aujourd’hui, au lieu d’être en mai, nous ne sommes qu’en mars ?
– En mars, messieurs, au deux cent soixante-sixième jour de l’année gallienne, qui correspond au cent trente-troisième de l’année terrestre. C’est donc aujourd’hui le 12 mars gallien, et quand soixante jours galliens se seront écoulés en plus…
– Nous serons au 72 mars ! s’écria Hector Servadac ! Bravo ! Soyons logiques ! »
Palmyrin Rosette eut l’air de se demander si son ancien élève ne se moquait pas tant soit peu de lui ; mais, l’heure étant avancée, les trois visiteurs quittèrent l’observatoire.
Le professeur avait donc fondé le calendrier gallien. Toutefois, il convient d’avouer qu’il fut le seul à s’en servir, et que personne ne le comprenait, lorsqu’il parlait du 47 avril ou du 118 mai.
Cependant, le mois de juin – ancien calendrier – était venu, durant lequel Gallia devait parcourir vingt-sept millions cinq cent mille lieues seulement et s’éloigner à cent cinquante-cinq millions de lieues du soleil. La température décroissait toujours, mais l’atmosphère restait aussi pure, aussi calme que par le passé. Tous les actes de l’existence s’accomplissaient sur Gallia avec une régularité, on pourrait dire une monotonie parfaite. Pour troubler cette monotonie, il ne fallait rien moins que cette personnalité bruyante, nerveuse, capricieuse, acariâtre même, de Palmyrin Rosette. Lorsqu’il daignait interrompre ses observations et descendre à la salle commune, sa visite provoquait toujours quelque scène nouvelle.
La discussion portait presque invariablement sur ce point que, quel que fût le danger d’une nouvelle rencontre avec la terre, le capitaine Servadac et ses compagnons étaient enchantés qu’elle dût se produire. Cela exaspérait le professeur, qui ne voulait pas entendre parler de retour et continuait ses études sur Gallia, comme s’il devait à jamais y demeurer.
Un jour – 27 juin –, Palmyrin Rosette arriva comme une bombe dans la salle commune. Là se trouvaient réunis le capitaine Servadac, le lieutenant Procope, le comte Timascheff et Ben-Zouf.
« Lieutenant Procope, s’écria-t-il, répondez sans ambages ni faux-fuyants à la question que je vais vous poser.
– Mais je n’ai pas l’habitude… répliqua le lieutenant Procope.
– C’est bien ! reprit Palmyrin Rosette, qui semblait traiter le lieutenant de professeur à élève. Répondez à ceci : Avez-vous fait, oui ou non, le tour de Gallia avec votre goélette, et à peu près sur son équateur, autrement dit sur l’un de ses grands cercles ?
– Oui, monsieur, répondit le lieutenant, que le comte Timascheff avait, d’un signe, engagé à satisfaire le terrible Rosette.
– Bien, reprit ce dernier. Et, pendant ce voyage d’exploration, n’avez-vous pas relevé le chemin parcouru par la Dobryna ?
– Approximativement, répondit Procope, c’est-à-dire à l’aide du loch et de la boussole, et non par des hauteurs de soleil ou d’étoiles qu’il était impossible de calculer.
– Et qu’avez-vous trouvé ?…
– Que la circonférence de Gallia devait mesurer environ deux mille trois cents kilomètres, ce qui lui donnerait sept cent quarante kilomètres pour son double rayon.
– Oui… dit Palmyrin Rosette comme à part lui, ce diamètre serait, en somme, seize fois moindre que celui de la terre, qui est de douze mille sept cent quatre-vingt-douze kilomètres. »
Le capitaine Servadac et ses deux compagnons regardaient le professeur sans comprendre où il voulait en venir.
« Eh bien, reprit Palmyrin Rosette, pour compléter mes études sur Gallia, il me reste à savoir quels sont sa surface, son volume, sa masse, sa densité, et l’intensité de la pesanteur.
– En ce qui concerne la surface et le volume, répondit le lieutenant Procope, puisque nous connaissons le diamètre de Gallia, rien n’est plus facile.
– Ai-je dit que c’était difficile ? s’écria le professeur. Ces calculs-là, je les faisais en venant au monde !
– Oh ! oh ! fit Ben-Zouf, qui ne cherchait qu’une occasion d’être désagréable au contempteur de Montmartre.
– Élève Servadac, reprit Palmyrin Rosette, après avoir un instant regardé Ben-Zouf, prenez votre plume. Puisque vous connaissez la circonférence d’un grand cercle de Gallia, dites-moi quelle est sa surface ?
– Voici, monsieur Rosette, répondit Hector Servadac, décidé à se conduire en bon élève. Nous disons deux mille trois cent vingt-trois kilomètres, circonférence de Gallia, à multiplier par le diamètre sept cent quarante.
– Oui, et dépêchez-vous ! s’écria le professeur. Cela devrait déjà être fait ! Eh bien ?
– Eh bien, répondit Hector Servadac, je trouve au produit un million sept cent dix-neuf mille vingt kilomètres carrés, ce qui représente la surface de Gallia.
– Soit une surface deux cent quatre-vingt-dix sept fois moindre que celle de la terre, qui est de cinq cent dix millions de kilomètres carrés.
– Peuh ! » fit Ben-Zouf, en allongeant les lèvres d’un air assez méprisant pour la comète du professeur.
Un regard foudroyant de Palmyrin Rosette lui arriva en pleine figure.
« Eh bien, reprit le professeur qui s’animait, quel est le volume de Gallia maintenant ?
– Le volume ?… répondit Hector Servadac en hésitant.
– Élève Servadac, est-ce que vous ne sauriez plus calculer le volume d’une sphère dont vous connaissez la surface ?
– Si, monsieur Rosette… Mais vous ne me donnez pas même le temps de respirer !
– On ne respire pas en mathématiques, monsieur, on ne respire pas ! »
Il fallait aux interlocuteurs de Palmyrin Rosette tout leur sérieux pour ne pas éclater.
« En finirons-nous ? demanda le professeur. Le volume d’une sphère…
– Est égal au produit de la surface… répondit Hector Servadac en tâtonnant, multiplié…
– Par le tiers du rayon, monsieur ! s’écria Palmyrin Rosette. Par le tiers du rayon ! Est-ce fini ?
– À peu près ! Le tiers du rayon de Gallia étant de cent vingt-trois, trois, trois, trois, trois, trois…
– Trois, trois, trois, trois… répéta Ben-Zouf, en parcourant la gamme des sons.
– Silence ! cria le professeur, sérieusement irrité. Contentez-vous des deux premières décimales, et négligez les autres.
– Je néglige, répondit Hector Servadac.
– Eh bien ?
– Le produit de dix-sept cent dix-neuf mille vingt par cent vingt-trois trente-trois donne deux cent onze millions quatre cent trente-neuf mille quatre cent soixante kilomètres cubes.
– Voilà donc le volume de ma comète ! s’écria le professeur. C’est quelque chose, en vérité !
– Sans doute, fit observer le lieutenant Procope, mais ce volume est encore cinq mille cent soixante-six fois moindre que celui de la terre, qui contient en chiffres ronds…
– Un trillion quatre-vingt-deux milliards huit cent quarante et un millions de kilomètres cubes, je le sais, monsieur, répondit Palmyrin Rosette.
– Et, par conséquent, ajouta le lieutenant Procope, le volume de Gallia est encore très inférieur à celui de la lune, qui est le quarante-neuvième du volume de la terre.
– Eh ! qui vous parle de cela ? riposta le professeur, se regardant comme blessé dans son amour-propre.
– Donc, poursuivit impitoyablement le lieutenant Procope, Gallia, vue de terre, ne serait pas plus apparente qu’une étoile de septième grandeur, c’est-à-dire invisible à l’œil nu !
– Nom d’un bédouin ! s’écria Ben-Zouf. En voilà une jolie comète ! Et c’est là-dessus que nous sommes !
– Silence ! dit Palmyrin Rosette, hors de lui.
– Une noisette, un pois chiche, un grain de moutarde ! continua de dire Ben-Zouf, qui se vengeait.
– Tais-toi, Ben-Zouf, dit le capitaine Servadac.
– Une tête d’épingle, quoi ! Un rien de rien du tout !
– Mordioux ! te tairas-tu ? »
Ben-Zouf comprit que son capitaine allait se fâcher, et il quitta la salle, mais non sans éveiller par ses formidables éclats de rire tous les échos du massif volcanique. Il était temps qu’il partît. Palmyrin Rosette était sur le point d’éclater et eut besoin de quelque temps pour se remettre. C’est qu’il ne voulait pas plus que l’on s’attaquât à sa comète que Ben-Zouf à Montmartre. Chacun défendait son bien avec le même acharnement.
Enfin, le professeur recouvra la parole et, s’adressant à ses élèves, c’est-à-dire à ses auditeurs :
« Messieurs, dit-il, nous connaissons maintenant le diamètre, la circonférence, la surface et le volume de Gallia. C’est quelque chose, mais ce n’est pas tout. Je prétends obtenir, par mesure directe, sa masse et sa densité, et savoir quelle est l’intensité de la pesanteur à sa surface.
– Ce sera difficile, dit le comte Timascheff.
– N’importe. Je veux savoir ce que pèse ma comète, et je le saurai.
– Ce qui rendra la solution de ce problème moins aisée, fit observer le lieutenant Procope, c’est que nous ignorons quelle est la substance dont Gallia est formée.
– Ah ! vous ignorez quelle est cette matière ? répondit le professeur.
– Nous l’ignorons, dit le comte Timascheff, et si vous pouviez nous renseigner à cet égard…
– Eh ! messieurs, que m’importe ! fit Palmyrin Rosette… Je résoudrai bien sans cela mon problème.
– Quand vous voudrez, cher professeur, nous serons à vos ordres ! dit alors le capitaine Servadac.
– J’ai encore pour un mois d’observations et de calculs à faire, répondit Palmyrin Rosette d’un ton aigre, et vous voudrez bien attendre, sans doute, que j’aie fini !…
– Comment donc, monsieur le professeur ! répondit le comte Timascheff, nous attendrons tout le temps qu’il vous plaira !
– Et même davantage ! ajouta le capitaine Servadac, qui ne put retenir cette plaisanterie.
– Eh bien, rendez-vous dans un mois, répondit Palmyrin Rosette, au 62 avril prochain ! »
C’était le 31 juillet de l’année terrestre.
Chapitre VI
Dans lequel on verra que Palmyrin Rosette est fondé à trouver insuffisant le matériel de la colonie
Cependant, Gallia continuait à circuler dans les espaces interplanétaires sous l’influence attractive du soleil. Rien jusqu’alors n’avait gêné ses mouvements. La planète Nérina, qu’elle avait prise à son service en traversant la zone des astéroïdes, lui restait fidèle et accomplissait consciencieusement sa petite révolution bimensuelle. Il semblait que tout dût aller sans encombre pendant la durée de l’année gallienne.
Mais la grande préoccupation des habitants involontaires de Gallia était toujours celle-ci : reviendrait-on à la terre ? L’astronome ne s’était-il pas trompé dans ses calculs ? Avait-il bien déterminé la nouvelle orbite de la comète et la durée de sa révolution autour du soleil ?
Palmyrin Rosette était si ombrageux qu’on ne pouvait lui demander de revoir le résultat de ses observations.
Donc, Hector Servadac, le comte Timascheff et Procope ne laissaient pas d’être inquiets à cet égard. Quant aux autres colons, c’était bien le moindre de leurs soucis. Quelle résignation à leur sort ! Quelle philosophie pratique ! Les Espagnols surtout, pauvres gens en Espagne, n’avaient de leur vie été si heureux ! Negrete et ses compagnons ne s’étaient jamais trouvés dans de telles conditions de bien-être ! Et que leur importait la marche suivie par Gallia ? Pourquoi se seraient-ils préoccupés de savoir si le soleil la maintiendrait dans son cercle d’attraction ou si elle lui échapperait pour aller parcourir d’autres cieux ? Ils chantaient, ces indolents, et, pour des majos, quel temps mieux employé que celui qui se passe en chansons ?
Les deux êtres les plus heureux de la colonie, c’étaient, à n’en pas douter, le jeune Pablo et la petite Nina ! Quelles bonnes parties ils faisaient ensemble, en courant à travers les longues galeries de Nina-Ruche, en grimpant les roches du littoral ! Un jour, ils patinaient jusqu’à perte de vue sur la longue surface glacée de la mer. Un autre, ils s’amusaient à pêcher aux bords du petit lagon que la cascade de feu maintenait à l’état liquide. Cela n’empêchait pas les leçons que leur donnait Hector Servadac. Ils se faisaient parfaitement comprendre déjà, et, surtout, ils se comprenaient l’un l’autre !
Pourquoi ce jeune garçon, cette petite fille se seraient-ils préoccupés de l’avenir ? Pourquoi auraient-ils regretté le passé ?
Un jour, Pablo avait dit :
« Est-ce que tu as des parents, Nina ?
– Non, Pablo, répondit Nina, je suis toute seule. Et toi ?
– Je suis tout seul aussi, Nina. – Et que faisais-tu là-bas ?
– Je gardais mes chèvres, Pablo.
– Moi, répondit le jeune garçon, je courais nuit et jour devant l’attelage des diligences !
– Mais, maintenant, nous ne sommes plus seuls, Pablo.
– Non, Nina, pas du tout seuls !
– Le gouverneur est notre papa, et le comte et le lieutenant sont nos oncles.
– Et Ben-Zouf est notre camarade, reprit Pablo.
– Et tous les autres sont très gentils, ajouta Nina. On nous gâte, Pablo ! Eh bien, il ne faut pas nous laisser gâter. Il faut qu’ils soient contents de nous… toujours !
– Tu es si sage, Nina, qu’à côté de toi on est obligé de l’être aussi.
– Je suis ta sœur, et tu es mon frère, dit Nina gravement.
– Bien sûr », répondit Pablo. La grâce et la gentillesse de ces deux êtres les faisaient aimer de tous. On ne leur épargnait ni les bonnes paroles ni les bonnes caresses, dont la chèvre Marzy avait un peu sa part. Le capitaine Servadac et le comte Timascheff éprouvaient pour eux une sincère et paternelle affection. Pourquoi auraient-ils regretté, Pablo les brûlantes plaines de l’Andalousie, Nina les roches stériles de la Sardaigne ? Il leur semblait, en vérité, que ce monde avait toujours été le leur ! Juillet arriva. À cette époque, et pendant ce mois, Gallia n’avait que vingt-deux millions de lieues à parcourir le long de son orbite, sa distance du soleil équivalant à cent soixante-douze millions de lieues. Elle se trouvait donc éloignée de l’astre attractif quatre fois et demie plus que la terre, dont elle égalait à peu près la vitesse. En effet, la moyenne de la vitesse du globe terrestre en parcourant l’écliptique est environ de vingt et un millions de lieues par mois, soit vingt-huit mille huit cents lieues par heure. Le 62 avril gallien, un billet laconique fut adressé par le professeur au capitaine Servadac. Palmyrin Rosette comptait commencer ce jour même les opérations qui devaient lui permettre de calculer la masse, la densité de sa comète et l’intensité de la pesanteur à sa surface.
Hector Servadac, le comte Timascheff et Procope n’eurent garde de manquer au rendez-vous qui leur était donné. Cependant, les expériences qui allaient être faites ne pouvaient les intéresser au même degré que le professeur, et ils auraient bien préféré apprendre quelle était cette substance qui semblait uniquement composer la charpente gallienne.
Dès le matin, Palmyrin Rosette les avait rejoints dans la grande salle. Il ne semblait pas encore être de trop mauvaise humeur, mais la journée ne faisait que de commencer.
Tout le monde sait ce qu’on entend par l’intensité de la pesanteur. C’est la force attractive qu’exerce la terre sur un corps de masse égale à l’unité, et l’on se rappelle combien cette attraction s’était trouvée amoindrie sur Gallia, – phénomène qui avait naturellement accru les forces musculaires des Galliens. Mais dans quelle proportion, ils l’ignoraient.
Pour la masse, elle est formée par la quantité de matière qui constitue un corps, et cette masse est représentée par le poids même du corps. Quant à la densité, c’est la quantité de matière que contient un corps sous un volume donné.
Donc, première question à résoudre, quelle était l’intensité de la pesanteur à la surface de Gallia ?
Deuxième question, quelle était la quantité de matière contenue dans Gallia, c’est-à-dire quels étaient sa masse et, par suite, son poids ?
Troisième question, quelle était la quantité de matière que renfermait Gallia, son volume étant connu, autrement dit quelle était sa densité ?
« Messieurs, dit le professeur, c’est aujourd’hui que nous allons terminer l’étude des divers éléments qui constituent ma comète. Lorsque nous connaîtrons l’intensité de la pesanteur à sa surface, sa masse et sa densité par mesure directe, elle n’aura plus de secrets pour nous. Nous allons donc, en somme, peser Gallia ! »
Ben-Zouf, qui venait d’entrer dans la salle, entendit les dernières paroles de Palmyrin Rosette. Il sortit aussitôt sans mot dire et revint quelques instants après, disant d’un ton narquois :
« J’ai eu beau fouiller le magasin général, je n’ai point trouvé de balances, et, d’ailleurs, je ne sais vraiment pas où nous aurions pu les accrocher ! »
Et, en parlant ainsi, Ben-Zouf regardait au-dehors, comme s’il eût cherché un clou dans le ciel.
Un regard du professeur et un geste d’Hector Servadac firent taire le mauvais plaisant.
« Messieurs, reprit Palmyrin Rosette, il faut que je sache, tout d’abord, ce que pèse sur Gallia un kilogramme terrestre. Par suite de la moindre masse de Gallia, son attraction est moindre, et la conséquence de ce fait est que tout objet pèse moins à sa surface qu’il ne pèserait à la surface de la terre. Mais quelle est la différence des deux poids, voilà ce qu’il faut connaître.
– Rien de plus juste, répondit le lieutenant Procope, et des balances ordinaires – si nous en avions eu – n’auraient pu servir à cette opération, puisque leurs deux plateaux étant également soumis à l’attraction de Gallia, elles ne pourraient donner le rapport entre un poids gallien et un poids terrestre.
– En effet, ajouta le comte Timascheff, le kilogramme par exemple, dont vous vous serviriez, aurait autant perdu de son poids que l’objet qu’il servirait à peser, et…
– Messieurs, répondit Palmyrin Rosette, si vous dites cela pour mon instruction particulière, vous perdez votre temps, et je vous prie de me laisser continuer mon cours de physique. »
Le professeur professait plus que jamais ex cathedra.
« Avez-vous un peson et un poids d’un kilo ? demanda-t-il. Tout est là. Avec un peson, le poids est indiqué par une lame d’acier ou par un ressort qui agissent en raison de leur flexibilité ou de leur tension. L’attraction ne l’influence donc en aucune manière. En effet, si je suspends un poids d’un kilogramme terrestre à mon peson, l’aiguille marquera exactement ce que pèse ce kilogramme à la surface de Gallia. Je connaîtrai donc l’écart qui existe entre l’attraction de Gallia et l’attraction de la terre. Je réitère donc ma demande : Avez-vous un peson ? »
Les auditeurs de Palmyrin Rosette s’interrogèrent du regard. Puis, Hector Servadac se retourna vers Ben-Zouf, qui connaissait à fond tout le matériel de la colonie.
« Nous n’avons ni peson ni poids d’un kilo », dit-il.
Le professeur marqua la déconvenue qu’il éprouvait par un vigoureux coup de pied dont il frappa le sol.
« Mais, répondit Ben-Zouf, mais je crois savoir où il y a un peson, sinon un poids.
– Où ?
– À la tartane d’Hakhabut.
– Il fallait le dire tout de suite, imbécile ! répliqua le professeur en haussant les épaules.
– Et, surtout, il faut aller le chercher ! ajouta le capitaine Servadac.
– J’y vais, dit Ben-Zouf.
– Je t’accompagne, reprit Hector Servadac, car Hakhabut pourra bien faire quelque difficulté, lorsqu’il s’agira de prêter quoi que ce soit !
– Allons tous ensemble à la tartane, dit le comte Timascheff. Nous verrons comment Isac est installé à bord de la Hansa. »
Ceci convenu, tous allaient sortir, lorsque le professeur dit :
« Comte Timascheff, est-ce que l’un de vos hommes ne pourrait pas tailler dans cette substance rocheuse du massif un bloc mesurant exactement un décimètre cube ?
– Mon mécanicien le fera sans peine, répondit le comte Timascheff, mais à une condition : c’est qu’on lui fournisse un mètre pour obtenir des mesures exactes.
– Est-ce que vous n’auriez pas plus de mètre que de peson ? » s’écria Palmyrin Rosette.
Il n’y avait aucun mètre dans le magasin général. Ben-Zouf dut faire cet aveu pénible.
« Mais, ajouta-t-il, il est très possible qu’il s’en trouve un à bord de la Hansa.
– Partons donc ! » répondit Palmyrin Rosette, qui s’enfonça dans la grande galerie d’un pas rapide.
On le suivit. Quelques instants plus tard, Hector Servadac, le comte Timascheff, Procope et Ben-Zouf débouchaient sur les hautes roches qui dominaient le littoral. Ils descendirent jusqu’au rivage et se dirigèrent vers l’étroite crique où la Dobryna et la Hansa étaient emprisonnées dans leur croûte de glace.
Bien que la température fût extrêmement basse – trente-cinq degrés au-dessous de zéro –, bien vêtus, bien encapuchonnés, bien serrés dans leur houppelande de fourrures, le capitaine Servadac et ses compagnons pouvaient l’affronter sans trop d’inconvénient. Si leur barbe, leurs sourcils, leurs cils se couvrirent instantanément de petits cristaux, c’est que les vapeurs de leur respiration se congelaient à l’air froid. Leurs figures, hérissées d’aiguilles blanches, fines, aiguës comme des piquants de porc-épic, eussent été comiques à voir. La face du professeur, qui, dans sa petite personne, ressemblait à un ourson, était plus rébarbative encore.
Il était huit heures du matin. Le soleil marchait rapidement vers le zénith. Son disque, considérablement réduit par l’éloignement, offrait l’aspect de la pleine lune en culmination. Ses rayons arrivaient au sol, sans chaleur et singulièrement affaiblis dans leurs propriétés lumineuses. Toutes les roches du littoral au pied du massif et le massif volcanique lui-même montraient la blancheur immaculée des dernières neiges, tombées avant que les vapeurs eussent cessé de saturer l’atmosphère gallienne. En arrière, jusqu’au sommet du cône fumant qui dominait tout ce territoire, se développait l’immense tapis que ne souillait aucune tache. Sur le versant septentrional se déversait la cascade des laves. Là, les neiges avaient fait place aux torrents de feu qui serpentaient au caprice des pentes jusqu’à la baie de la caverne centrale, d’où ils tombaient perpendiculairement à la mer.
Au-dessus de la caverne, à cent cinquante pieds en l’air, se creusait une sorte de trou noir au-dessus duquel se bifurquait l’épanchement éruptif. De ce trou sortait le tuyau d’une lunette astronomique. C’était l’observatoire de Palmyrin Rosette.
La grève était toute blanche et se confondait avec la mer glacée. Aucune ligne de démarcation ne les séparait. Opposé à cette immense blancheur, le ciel paraissait être d’un bleu pâle. Sur cette grève étaient empreints les pas des colons, qui s’y promenaient journellement, soit qu’ils vinssent récolter la glace, dont la fusion produisait l’eau douce, soit qu’ils s’exerçassent au patinage. Les courbes des patins s’entre-croisaient à la surface de la croûte durcie, comme ces cercles que les insectes aquatiques dessinent à la surface des eaux.
Des empreintes de pas se dirigeaient aussi du littoral à la Hansa. C’étaient les dernières qu’eut laissées Isac Hakhabut avant la tombée des neiges. Les bourrelets qui limitaient ces empreintes avaient acquis la dureté du bronze sous l’influence de froids excessifs.
Un demi-kilomètre séparait les premières assises du massif de cette crique dans laquelle hivernaient les deux navires.
En arrivant à la crique, le lieutenant Procope fit observer combien la ligne de flottaison de la Hansa et de la Dobryna s’était progressivement surélevée. La tartane et la goélette dominaient maintenant la surface de la mer d’une vingtaine de pieds.
« Voilà un curieux phénomène ! dit le capitaine Servadac.
– Curieux et inquiétant, répondit le lieutenant Procope. Il est évident qu’il se fait sous la coque des navires, là où il y a peu de fond, un énorme travail de congélation. Peu à peu la croûte s’épaissit et soulève tout ce qu’elle supporte avec une force irrésistible.
– Mais ce travail aura une limite ? fit observer le comte Timascheff.
– Je ne sais, père, répondit le lieutenant Procope, car le froid n’a pas encore atteint son maximum.
– Je l’espère bien, s’écria le professeur. Ce ne serait pas la peine de s’en aller à deux cents millions de lieues du soleil pour n’y trouver qu’une température égale à celle des pôles terrestres !
– Vous êtes bien bon, monsieur le professeur, répondit le lieutenant Procope. Fort heureusement, les froids de l’espace ne dépassent pas soixante à soixante-dix degrés, ce qui est déjà fort acceptable.
– Bah ! dit Hector Servadac, du froid sans vent, c’est du froid sans rhume, et nous n’éternuerons même pas de tout l’hiver ! »
Cependant, le lieutenant Procope faisait part au comte Timascheff des craintes que lui inspirait la situation de la goélette. Grâce à la superposition des couches glacées, il n’était pas impossible que la Dobryna ne fût enlevée à une hauteur considérable. Dans ces conditions, à l’époque du dégel, quelque catastrophe serait à redouter, du genre de celles qui détruisent souvent les baleiniers hivernant dans les mers arctiques. Mais qu’y faire ?
On arriva près de la Hansa, enfermée dans sa carapace de glace. Des marches, nouvellement taillées par Isac Hakhabut, permettaient de monter à bord. Comment ferait-il, si sa tartane s’élevait à une centaine de pieds en l’air ? Cela le regardait.
Une légère fumée bleuâtre s’échappait du tuyau de cuivre qui sortait des neiges durcies, accumulées sur le pont de la Hansa. L’avare brûlait son combustible avec une extrême parcimonie, cela était évident, mais il devait peu souffrir du froid. En effet, les couches de glace qui enveloppaient la tartane, par cela même qu’elles conduisaient mal la chaleur, devaient conserver une température supportable à l’intérieur.
« Ohé ! Nabuchodonosor ! » cria Ben-Zouf.
Chapitre VII
Où l’on verra qu’Isac trouve une magnifique occasion de prêter son argent à plus de dix-huit cents pour cent
À la voix de Ben-Zouf, la porte du capot d’arrière s’ouvrit, et Isac Hakhabut se montra à mi-corps.
« Qui va là ? cria-t-il tout d’abord. Que me veut-on ? Il n’y a personne ! Je n’ai rien à prêter ni à vendre ! »
Telles furent les hospitalières paroles qui accueillirent les visiteurs.
« Tout beau, maître Hakhabut, répondit le capitaine Servadac d’une voix impérieuse. Est-ce que vous nous prenez pour des voleurs ?
– Ah ! c’est vous, monsieur le gouverneur général, dit celui-ci sans sortir de sa cabine.
– Lui-même, riposta Ben-Zouf, qui était monté sur le pont de la tartane. Tu dois te trouver honoré de sa visite ! Allons ! hors de cette niche ! »
Isac Hakhabut s’était décidé à se montrer tout entier par l’ouverture du capot, dont il tenait la porte à demi fermée, de manière à pouvoir la pousser rapidement en cas de danger.
« Que voulez-vous ? demanda-t-il.
– Causer un instant avec vous, maître Isac, répondit le capitaine ; mais, le froid étant un peu vif, vous ne nous refuserez pas un quart d’heure d’hospitalité dans votre cabine ?
– Quoi ! vous voulez entrer ? s’écria Isac, qui ne chercha pas à dissimuler à quel point cette visite lui semblait suspecte.
– Nous le voulons, répondit Hector Servadac en grimpant les marches, suivi de ses compagnons.
– Je n’ai rien à vous offrir, dit Isac d’une voix piteuse. Je ne suis qu’un pauvre homme !
– Voilà les litanies qui recommencent ! riposta Ben-Zouf. Allons, Elias, fais place ! »
Et Ben-Zouf, empoignant Hakhabut au collet, l’écarta sans plus de cérémonies. Puis il ouvrit la porte du capot. Au moment d’entrer :
« Écoutez bien ceci, Hakhabut, dit le capitaine Servadac, nous ne venons pas nous emparer de votre bien malgré vous. Je le répète, le jour où l’intérêt commun exigera que nous disposions de la cargaison de la tartane, je n’hésiterai pas à le faire, c’est-à-dire à vous exproprier pour cause d’utilité publique… en vous payant les marchandises aux prix courants d’Europe !
– Les prix courants d’Europe ! murmura Isac Hakhabut entre ses dents. Non, mais aux prix courants de Gallia, et c’est moi qui les établirai ! »
Cependant, Hector Servadac et ses compagnons étaient descendus dans la cabine de la Hansa. Ce n’était qu’un étroit logement, la plus grande place possible ayant été réservée à la cargaison. Un petit poêle de fonte, où deux morceaux de charbon essayaient de ne pas brûler, se dressait dans un coin, vis-à-vis du cadre qui servait de lit. Une armoire, dont la porte était soigneusement fermée à clef, occupait le fond de ce réduit. Quelques escabeaux, une table de sapin d’une propreté douteuse, et, en fait d’ustensiles de cuisine, le strict nécessaire. L’ameublement, on le voit, était peu confortable, mais digne du propriétaire de la Hansa.
Le premier soin de Ben-Zouf, une fois descendu dans la cabine, et après que le juif en eut refermé la porte, fut de jeter dans le poêle quelques morceaux de charbon, précaution que justifiait la basse température du lieu. De là récriminations et gémissements d’Isac Hakhabut, qui, plutôt que de prodiguer son combustible, eût brûlé ses propres os, s’il en avait eu de rechange. Mais on ne l’écouta pas. Ben-Zouf resta de garde près du poêle, dont il activa la combustion par une ventilation intelligente. Puis, les visiteurs, s’étant assis tant bien que mal, laissèrent au capitaine Servadac le soin de faire connaître le but de leur visite.
Isac Hakhabut, debout dans un coin, ses mains crochues soudées l’une sur l’autre, ressemblait à un patient auquel on lit sa sentence.
« Maître Isac, dit alors le capitaine Servadac, nous sommes venus ici tout simplement pour vous demander un service.
– Un service ?
– Dans notre intérêt commun.
– Mais je n’ai pas d’intérêt commun !…
– Écoutez donc, et ne vous plaignez pas, Hakhabut. Il n’est pas question de vous écorcher !
– Me demander un service, à moi ! un pauvre homme !… s’écria le juif en se lamentant.
– Voici ce dont il s’agit », répondit Hector Servadac, qui feignit de ne pas l’avoir entendu.
À la solennité de son préambule, il s’exposait à faire croire à Isac Hakhabut qu’on allait lui réclamer sa fortune entière.
« En un mot, maître Isac, reprit le capitaine Servadac, nous aurions besoin d’un peson ! Pouvez-vous nous prêter un peson ?
– Un peson ! s’écria Isac, comme si l’on eût demandé à lui emprunter plusieurs milliers de francs. Vous dites un peson ?…
– Oui ! un peson à peser ! répéta Palmyrin Rosette, que tant de formalités commençaient à impatienter outre mesure.
– N’avez-vous pas un peson ? reprit le lieutenant Procope.
– Il en a un, dit Ben-Zouf.
– En effet ! oui !… je crois… répondit Isac Hakhabut, qui ne voulait pas s’avancer.
– Eh bien, maître Isac, voulez-vous avoir l’extrême obligeance de nous prêter votre peson ?
– Prêter ! s’écria l’usurier. Monsieur le gouverneur, vous me demandez de prêter…
– Pour un jour ! répliqua le professeur, pour un jour, Isac ! On vous le rendra, votre peson !
– Mais c’est un instrument bien délicat, mon bon monsieur, répondit Isac Hakhabut. Le ressort peut se casser par ces grands froids !…
– Ah ! l’animal ! s’écria Palmyrin Rosette.
– Et puis, il s’agit peut-être de peser quelque chose de bien lourd !
– Crois-tu donc, Éphraïm, dit Ben-Zouf, que nous voulons peser une montagne ?
– Mieux qu’une montagne ! répondit Palmyrin Rosette. Nous allons peser Gallia !
– Miséricorde ! » s’écria Isac, dont les fausses doléances tendaient vers un but trop visible.
Le capitaine Servadac intervint de nouveau.
« Maître Hakhabut, dit-il, nous avons besoin d’un peson pour peser un poids d’un kilogramme tout au plus.
– Un kilogramme, Dieu du ciel.
– Et encore ce poids pèsera-t-il sensiblement moins, en conséquence de la moindre attraction de Gallia. Ainsi donc, vous n’avez rien à craindre pour votre peson.
– Sans doute… monsieur le gouverneur… répondit Isac, mais prêter… prêter !…
– Puisque vous ne voulez pas prêter, dit alors le comte Timascheff, voulez-vous vendre ?
– Vendre ! s’écria Isac Hakhabut, vendre mon peson ! Mais quand je l’aurai vendu, comment pourrai-je peser ma marchandise ! Je n’ai pas de balances ! Je n’ai que ce pauvre petit instrument bien délicat, bien juste, et l’on veut m’en dépouiller ! »
Ben-Zouf ne comprenait guère que son capitaine n’étranglât pas sur l’heure l’affreux bonhomme qui lui tenait tête. Mais Hector Servadac s’amusait, il faut bien en convenir, à épuiser vis-à-vis d’Isac, toutes les formes possibles de persuasion.
« Allons, maître Isac, dit-il sans se fâcher en aucune manière, je vois bien que vous ne consentirez pas à prêter ce peson.
– Hélas ! le puis-je, monsieur le gouverneur ?
– Ni à le vendre ?
– Le vendre ! Oh ! jamais !
– Eh bien, voulez-vous le louer ? »
Les yeux d’Isac Hakhabut s’allumèrent comme des braises.
« Vous répondriez de tout accident ? demanda-t-il assez vivement.
– Oui.
– Vous déposeriez entre mes mains un nantissement qui m’appartiendrait en cas de malheur ?
– Oui.
– Combien ?
– Cent francs pour un instrument qui en vaut vingt. Est-ce suffisant ?…
– À peine… monsieur le gouverneur… à peine, car enfin ce peson est le seul qu’il y ait dans notre nouveau monde ! – Mais enfin, ajouta-t-il, ces cent francs seraient en or ?
– En or.
– Et vous voudriez me louer ce peson qui m’est si nécessaire, vous voudriez me le louer pour un jour ?
– Pour un jour.
– Et le prix de la location ?
– Serait de vingt francs, répondit le comte Timascheff. Cela vous convient-il ?
– Hélas !… je ne suis pas le plus fort !… murmura Isac Hakhabut en joignant les mains. Il faut bien savoir se résigner ! »
Le marché était conclu, et bien évidemment à l’extrême satisfaction d’Isac. Vingt francs de location, cent francs de cautionnement, et le tout en or français ou russe ! Ah ! ce n’est pas Isac Hakhabut qui eût vendu son droit d’aînesse pour un plat de lentilles, ou bien ces lentilles auraient été des perles !
Le trafiquant, après avoir jeté un regard soupçonneux autour de lui, quitta la cabine pour aller chercher le peson.
« Quel homme ! dit le comte Timascheff.
– Oui, répondit Hector Servadac. Dans son genre, il est trop réussi. »
Presque aussitôt, Isac Hakhabut revint, rapportant l’instrument, précieusement serré sous son bras.
C’était un peson à ressort, muni d’un crochet auquel on suspendait l’objet à peser. Une aiguille, se mouvant sur un cercle gradué, marquait le poids. Ainsi donc, comme l’avait fait observer Palmyrin Rosette, les degrés indiqués par cet instrument étaient indépendants de la pesanteur, quelle qu’elle fût. Fait pour les pesages terrestres, il eût marqué sur terre un kilogramme pour tout objet pesant un kilogramme. Pour ce même objet, qu’indiquerait-il sur Gallia ? c’est ce que l’on verrait plus tard.
Cent vingt francs en or furent comptés à Isac, dont les mains se refermèrent sur le précieux métal comme le couvercle d’un coffret. Le peson fut remis à Ben-Zouf, et les visiteurs de la Hansa se disposèrent à quitter aussitôt la cabine.
Mais, à ce moment, le professeur se rappela qu’il lui manquait encore un objet indispensable pour ses opérations. Un peson ne lui servait à rien s’il ne pouvait y suspendre un bloc de cette matière gallienne dont les dimensions auraient été exactement mesurées, un bloc formant par exemple un décimètre cube.
« Eh ! ce n’est pas tout ! dit Palmyrin Rosette en s’arrêtant. Il faut aussi nous prêter… »
Isac Hakhabut tressaillit.
« Il faut aussi nous prêter un mètre et un poids d’un kilogramme !
– Ah ! pour cela, mon bon monsieur, répondit Isac, ce n’est pas possible, et je le regrette bien ! J’aurais été si heureux de pouvoir vous obliger ! »
Et cette fois Isac Hakhabut disait deux fois vrai en affirmant qu’il n’y avait à bord ni mètre, ni poids, et qu’il regrettait de n’en pas avoir ! Il eût encore fait là une excellente affaire.
Palmyrin Rosette, extrêmement contrarié, regardait ses compagnons comme s’il eût voulu les rendre responsables du fait ! Et il avait lieu d’être très désappointé, car, faute de cet engin de mesurage, il ne voyait pas comment il s’y prendrait pour obtenir un résultat satisfaisant.
« Il faudra bien pourtant que je m’en tire sans cela ! » murmura-t-il, en se grattant la tête.
Et il remonta vivement l’échelle du capot. Ses compagnons le suivirent. Mais ils n’étaient pas encore sur le pont de la tartane, qu’un son argentin se faisait entendre dans la cabine.
C’était Isac Hakhabut qui serrait précieusement son or dans un des tiroirs de l’armoire. Au bruit, le professeur s’était vivement retourné, et il se précipita vers l’échelle, que tous redescendirent, non moins précipitamment, sans rien comprendre aux allures de Palmyrin Rosette.
« Vous avez des pièces d’argent ! s’écria-t-il en saisissant Isac par la manche de sa vieille houppelande.
– Moi !… de l’argent !… répondit Isac Hakhabut, pâle comme s’il se fût trouvé en présence d’un voleur.
– Oui !… des pièces d’argent !… reprit le professeur avec une extrême vivacité !… Ce sont des pièces françaises ?… Des pièces de cinq francs ?…
– Oui… non… » répondit Isac, ne sachant plus ce qu’il disait.
Mais le professeur s’était penché vers le tiroir, qu’Isac Hakhabut essayait en vain de fermer. Le capitaine Servadac, le comte Timascheff, le lieutenant Procope, n’y comprenant rien, mais décidés à donner raison au professeur, laissaient la scène se dérouler sans y prendre part.
« Ces pièces françaises, il me les faut ! s’écria Palmyrin Rosette.
– Jamais ! s’écria à son tour le trafiquant, auquel il semblait qu’on voulût arracher les entrailles.
– Il me les faut, te dis-je, et je les aurai !
– On me tuera plutôt ! » hurla Isac Hakhabut.
Le capitaine Servadac jugea à propos d’intervenir alors.
« Mon cher professeur, dit-il en souriant, laissez-moi arranger cette affaire comme l’autre.
– Ah ! monsieur le gouverneur, s’écria Isac Hakhabut, tout défait, protégez-moi, protégez mon bien !
– Silence, maître Isac », répondit le capitaine Servadac.
Puis, se retournant vers Palmyrin Rosette :
« Vous avez besoin, lui demanda-t-il, d’un certain nombre de pièces de cinq francs pour vos opérations ?
– Oui, répondit le professeur, il m’en faut d’abord quarante !
– Deux cents francs ! murmura le banquier.
– Et, de plus, ajouta le professeur, dix pièces de deux francs et vingt pièces de cinquante centimes !
– Trente francs ! dit une voix plaintive.
– En tout, deux cent trente francs ? reprit Hector Servadac.
– Oui, deux cent trente francs, répondit Palmyrin Rosette.
– Bien », dit le capitaine Servadac. S’adressant alors au comte Timascheff :
« Monsieur le comte, dit-il, auriez-vous encore de quoi nantir Isac pour garantir l’emprunt forcé que je vais lui faire ?
– Ma bourse est à votre disposition, capitaine, répondit le comte Timascheff ; mais je n’ai sur moi que des roubles-papier…
– Pas de papier ! pas de papier ! s’écria Isac Hakhabut. Le papier n’a pas cours sur Gallia !
– Est-ce que l’argent en a davantage ? répondit froidement le comte Timascheff.
– Maître Isac, dit alors le capitaine Servadac, vos jérémiades m’ont trouvé jusqu’ici d’assez belle humeur. Mais croyez-moi, n’abusez pas plus longtemps de ma patience. De bonne ou de mauvaise grâce, vous allez nous remettre ces deux cent trente francs ?
– Au voleur ! » cria Isac.
Mais il ne put continuer, car la vigoureuse main de Ben-Zouf lui pressait déjà la gorge.
« Laisse-le, Ben-Zouf, dit le capitaine Servadac, laisse-le ! Il va s’exécuter de lui-même.
– Jamais !… jamais !…
– Quel intérêt demandez-vous, maître Isac, pour nous prêter ces deux cent trente francs ?
– Un prêt !… ce n’est qu’un prêt !… s’écria Isac Hakhabut, dont toute la face rayonna en un instant.
– Oui, un simple prêt… Quel intérêt exigez-vous ?
– Ah ! monsieur le gouverneur général ! répondit doucereusement le prêteur, l’argent est bien difficile à gagner, et, surtout, il est bien rare aujourd’hui sur Gallia…
– Trêve à ces ineptes observations… Que demandez-vous ? reprit Hector Servadac.
– Eh bien, monsieur le gouverneur… répondit Isac Hakhabut, il me semble que dix francs d’intérêt…
– Par jour ?…
– Sans doute… par jour !… »
Il n’avait pas achevé sa phrase, que le comte Timascheff jetait sur la table quelques roubles. Isac s’en saisit et se mit à compter les billets avec une remarquable prestesse. Bien que ce ne fût que « du papier », le nantissement devait satisfaire le plus rapace des usuriers. Les pièces françaises, réclamées par le professeur, lui furent immédiatement remises, et il les empocha avec une évidente satisfaction.
Quant à Isac, il venait tout simplement de placer ses fonds à plus de dix-huit cents pour cent. Décidément, s’il continuait à prêter à ce taux, il ferait encore plus rapidement fortune sur Gallia qu’il n’eût fait sur la terre.
Quelques instants après, le capitaine Servadac et ses compagnons avaient quitté la tartane et Palmyrin Rosette s’écriait :
« Messieurs, ce ne sont pas deux cent trente francs que j’emporte, c’est de quoi faire exactement un kilogramme et un mètre ! »
Chapitre VIII
Dans lequel le professeur et ses élèves jonglent avec les sextillions, les quintillions et autres multiples des milliards
Un quart d’heure plus tard, les visiteurs de la Hansa étaient réunis dans la salle commune, et les dernières paroles prononcées par le professeur allaient avoir leur explication.
Sur l’ordre du professeur, Ben-Zouf avait enlevé divers objets déposés sur la table, et fait place nette. Les pièces d’argent, empruntées au juif Hakhabut, furent déposées sur cette table, suivant leur valeur, deux piles de vingt pièces de cinq francs, une pile de dix pièces de deux francs, et une pile de vingt pièces de cinquante centimes.
« Messieurs, dit Palmyrin Rosette, très satisfait de lui-même, puisque vous n’avez pas eu la prévoyance, au moment du choc, de sauver un mètre et un poids d’un kilogramme de l’ancien matériel terrestre, j’ai dû songer au moyen de remplacer ces deux objets qui me sont indispensables pour calculer l’attraction, la masse et la densité de ma comète. »
Cette phrase de début était un peu longue, et telle que la fait tout orateur sûr de lui et de l’effet qu’il va produire sur ses auditeurs. Ni le capitaine Servadac, ni le comte Timascheff, ni le lieutenant Procope ne relevèrent le singulier reproche que leur adressait Palmyrin Rosette. Ils étaient faits à ses manières.
« Messieurs, reprit le professeur, je me suis assuré tout d’abord que ces diverses pièces étaient presque neuves et n’avaient été ni usées ni rognées par ce juif. Elles sont donc dans les conditions voulues pour assurer à mon opération toute l’exactitude désirable. Et, d’abord, je vais m’en servir pour obtenir très exactement la longueur du mètre terrestre. »
Hector Servadac et ses compagnons avaient compris la pensée du professeur avant même qu’il eût achevé de l’exprimer. Quant à Ben-Zouf, il regardait Palmyrin Rosette comme il eût regardé un prestidigitateur, s’apprêtant à faire des tours dans quelque échoppe de Montmartre.
Voici sur quoi le professeur basait sa première opération, dont l’idée lui était venue soudain, lorsqu’il entendit les pièces de monnaie résonner dans le tiroir d’Isac Hakhabut.
On sait que les pièces françaises sont décimales et forment toute la monnaie décimale qui peut exister entre un centime et cent francs, soit : 1° un, deux, cinq, dix centimes, en cuivre ; 2° vingt centimes, cinquante centimes, un franc, deux francs, cinq francs, en argent ; 3° cinq, dix, vingt, cinquante et cent francs, en or.
Donc, au-dessus du franc existent tous les multiples décimaux du franc ; au-dessous, toutes les coupures décimales du franc. Le franc est l’étalon.
Or – et c’est sur ce point que le professeur Palmyrin Rosette insista tout d’abord –, ces diverses pièces de monnaie sont exactement calibrées, et leur diamètre, rigoureusement déterminé par la loi, l’est aussi dans la fabrication. Ainsi, pour ne parler que des pièces de cinq francs, de deux francs et de cinquante centimes en argent, les premières ont un diamètre de trente-sept millimètres, les secondes un diamètre de vingt-sept millimètres, et les troisièmes un diamètre de dix-huit millimètres. N’était-il donc pas possible, en juxtaposant un certain nombre de ces pièces, de valeur différente, d’obtenir une longueur rigoureusement exacte, concordant avec les mille millimètres que contient le mètre terrestre ?
Cela se pouvait, et le professeur le savait, et c’est ce qui lui avait fait choisir dix pièces de cinq francs sur les vingt qu’il avait apportées, dix pièces de deux francs et vingt pièces de cinquante centimes.
En effet, ayant établi rapidement le calcul suivant sur un bout de papier, il le présenta à ses auditeurs :
10 pièces de 5 francs à 0m, 037 = 0m, 370
10 pièces 2 francs à 0m, 027 = 0m, 270
20 pièces 50 cent à 0m, 018 = 0m, 360
TOTAL = 1m, 000
« Très bien, cher professeur, dit Hector Servadac. Il ne nous reste plus maintenant qu’à juxtaposer ces quarante pièces de manière que la même ligne droite passe par leurs centres, et nous aurons exactement la longueur du mètre terrestre.
– Nom d’un Kabyle ! s’écria Ben-Zouf, c’est tout de même beau d’être savant !
– Il appelle cela être savant ! » répliqua Palmyrin Rosette, en haussant les épaules.
Les dix pièces de cinq francs furent étalées à plat sur la table et placées les unes près des autres, de manière que leurs centres fussent reliés par la même ligne droite, puis les dix pièces de deux francs, puis les vingt pièces de cinquante centimes. Une marque indiqua sur la table les deux extrémités de la ligne ainsi formée.
« Messieurs, dit alors le professeur, voici la longueur exacte du mètre terrestre. »
L’opération venait d’être faite avec une extrême précision. Ce mètre, au moyen d’un compas, fut divisé en dix parties égales, ce qui donna des décimètres. Une tringle ayant été coupée à cette longueur, on la remit au mécanicien de la Dobryna .
Celui-ci, homme très adroit, s’étant procuré un bloc de cette matière inconnue dont se composait le massif volcanique, n’eut plus qu’à le tailler, en donnant un décimètre carré à chacune de ses six faces, pour obtenir un cube parfait.
C’est ce qu’avait demandé Palmyrin Rosette.
Le mètre était obtenu. Restait donc à obtenir exactement un poids d’un kilogramme.
Cela était encore plus facile.
En effet, les pièces françaises ont non seulement un calibre rigoureusement déterminé, mais un poids rigoureusement calculé.
Et, pour ne parler que de la pièce de cinq francs, elle pèse exactement vingt-cinq grammes, soit le poids de cinq pièces d’un franc, qui pèsent chacune cinq grammes[9].
Il suffisait donc de grouper quarante pièces de cinq francs en argent pour avoir un poids d’un kilogramme.
C’est ce que le capitaine Servadac et ses compagnons avaient tout d’abord compris.
« Allons, allons, dit Ben-Zouf, je vois bien que, pour tout cela, il ne suffit pas d’être savant, il faut encore…
– Et quoi ? demanda Hector Servadac.
– Il faut encore être riche ! »
Et tous de rire à l’observation du brave Ben-Zouf. Enfin, quelques heures plus tard, le décimètre cube de pierre était taillé avec une précision très suffisante, et le mécanicien le mettait entre les mains du professeur.
Palmyrin Rosette, possédant un poids d’un kilogramme, un bloc d’un décimètre cube, et enfin un peson pour les peser successivement, était à même de calculer l’attraction, la masse et la densité de sa comète.
« Messieurs, dit-il, au cas où vous ne le sauriez pas – ou tout au moins où vous ne le sauriez plus –, je dois vous rappeler la célèbre loi de Newton, d’après laquelle l’attraction est en raison directe des masses et en raison inverse du carré des distances. Je vous prie de ne plus oublier ce principe. »
Comme il professait, le professeur ! Mais aussi, à quels élèves disciplinés il avait affaire !
« Voici, reprit-il, un groupe de quarante pièces de cinq francs, réunies dans ce sac. Ce groupe pèserait exactement un kilogramme sur la terre. Donc, si, étant sur la terre, je le suspendais au crochet de ce peson, l’aiguille marquerait un kilogramme. Est-ce clair ? »
En parlant ainsi, Palmyrin Rosette ne cessait de regarder fixement Ben-Zouf. En cela, il imitait Arago, lequel, pendant ses démonstrations, regardait toujours celui de ses auditeurs qui lui paraissait être le moins intelligent ; et lorsque cet auditeur lui semblait avoir compris, il était assuré de la clarté de sa démonstration.[10]
Ici, l’ordonnance du capitaine Servadac n’était pas inintelligent, tant s’en fallait, mais il était ignorant, et cela revenait au même.
Or, Ben-Zouf ayant paru convaincu, le professeur continua sa démonstration en ces termes :
« Eh bien, messieurs, ce groupe de quarante pièces, je vais le suspendre au crochet du peson, et, comme j’opère sur Gallia, nous allons savoir ce qu’il pèse sur Gallia. »
Le groupe fut attaché au crochet, l’aiguille du peson oscilla, s’arrêta et marqua sur le cercle gradué cent trente-trois grammes.
« Donc, reprit Palmyrin Rosette, ce qui pèse un kilogramme sur la terre ne pèse que cent trente-trois grammes sur Gallia, c’est-à-dire sept fois moins environ. Est-ce clair ? »
Ben-Zouf ayant fait un signe d’assentiment, le professeur reprit gravement sa démonstration.
« Et maintenant, vous comprenez que les résultats que je viens d’obtenir avec un peson auraient été nuls avec des balances ordinaires. En effet, les deux plateaux dans lesquels j’aurais mis, d’une part le groupe, de l’autre le poids d’un kilogramme, seraient restés en équilibre, puisque tous deux auraient été diminués d’une quantité précisément égale. Est-ce compris ?
– Même par moi, répondit Ben-Zouf.
– Si donc, reprit le professeur, la pesanteur est sept fois moindre ici que sur le globe terrestre, on doit en conclure que l’intensité de la pesanteur sur Gallia n’est que le septième de ce qu’elle est à la surface de la terre.
– Parfait ! répondit le capitaine Servadac, et nous voilà maintenant fixés sur ce point. Donc, cher professeur, passons à la masse.
– Non, à la densité d’abord, répondit Palmyrin Rosette.
– En effet, dit le lieutenant Procope, connaissant déjà le volume de Gallia, lorsque nous en connaîtrons la densité, la masse se déduira tout naturellement. »
Le raisonnement du lieutenant était juste, et il n’y avait plus qu’à procéder au calcul de la densité de Gallia.
C’est ce que fit le professeur. Il prit le bloc taillé dans le massif du volcan, bloc qui mesurait exactement un décimètre cube.
« Messieurs, dit-il, ce bloc est fait de cette matière inconnue que, pendant votre voyage de circumnavigation, vous avez partout rencontrée à la surface de Gallia. Il semble vraiment que ma comète ne soit composée que de cette substance. Le littoral, le mont volcanique, le territoire, au nord comme au midi, ne semble constitué que par ce minéral, auquel votre ignorance en géologie ne vous a pas permis de donner un nom.
– Oui, et nous voudrions bien savoir quelle est cette substance, dit Hector Servadac.
– Je crois donc, reprit Palmyrin Rosette, avoir le droit de raisonner comme si Gallia était entièrement et uniquement composée de cette matière jusque dans ses dernières profondeurs. Or, voici un décimètre cube de cette matière. Que pèserait-il sur la terre ? Il pèserait exactement le poids qu’il a sur Gallia, multiplié par sept, puisque, je le répète, l’attraction est sept fois moindre sur la comète que sur le globe terrestre. Avez-vous compris, vous qui me regardez avec vos yeux ronds ? »
Ceci s’adressait à Ben-Zouf.
« Non, répondit Ben-Zouf.
– Eh bien, je ne perdrai pas mon temps à vous faire comprendre. Ces messieurs ont compris, et cela suffit.
– Quel ours ! murmura Ben-Zouf.
– Pesons donc ce bloc, dit le professeur. C’est comme si je mettais la comète au crochet de mon peson. »
Le bloc fut suspendu au peson, et l’aiguille indiqua sur le cercle un kilogramme quatre cent trente grammes.
« Un kilogramme quatre cent trente grammes, multipliés par sept, s’écria Palmyrin Rosette, donnent à peu près dix kilogrammes. Donc, la densité de la terre étant cinq environ ; la densité de Gallia est double de celle de la terre, puisqu’elle vaut dix ! Sans cette circonstance, la pesanteur, au lieu d’être un septième de celle de la terre sur ma comète, n’eût été que d’un quinzième ! »
En prononçant ces paroles, le professeur pensait avoir le droit d’être fier. Si la terre l’emportait en volume, sa comète l’emportait en densité, et, vraiment, il n’eût pas troqué l’une pour l’autre.
Ainsi donc, à ce moment, le diamètre, la circonférence, la surface, le volume, la densité de Gallia et l’intensité de la pesanteur à sa surface étaient connus. Restait à calculer sa masse, autrement dit son poids.
Ce calcul fut rapidement établi. En effet, puisqu’un décimètre cube de la matière gallienne eût pesé dix kilogrammes dans un pesage terrestre, Gallia pesait autant de fois dix kilogrammes que son volume contenait de décimètres cubes. Or ce volume, on le sait, étant de deux cent onze millions quatre cent trente-trois mille quatre cent soixante kilomètres cubes, renfermait un nombre de décimètres représenté par vingt et un chiffre, soit deux cent onze quintillions quatre, cent trente-trois quadrillions quatre cent soixante trillions. Ce même nombre donnait donc en kilogrammes terrestres la masse ou le poids de Gallia.
Il était donc inférieur à celui du globe terrestre de quatre sextillions sept cent quatre-vingt-huit quintillions cinq cent soixante-six quatrillions cinq cent quarante trillions de kilogrammes.
« Mais que pèse donc la terre ? demanda Ben-Zouf, véritablement abasourdi par ces milliards de millions.
– Et d’abord sais-tu ce que c’est qu’un milliard ? lui demanda le capitaine Servadac.
– Vaguement, mon capitaine.
– Eh bien, sache donc que, depuis la naissance de Jésus-Christ, il ne s’est pas encore écoulé un milliard de minutes, et que si tu avais dû un milliard, en donnant un franc toutes les minutes depuis cette époque, tu n’aurais pas encore fini de payer !
– Un franc par minute ! s’écria Ben-Zouf ! Mais j’aurais été ruiné avant un quart d’heure ! – Enfin que pèse la terre ?
– Cinq mille huit cent soixante-quinze sextillions de kilogrammes, répondit le lieutenant Procope, un nombre formé de vingt-cinq chiffres.
– Et la lune ?
– Soixante-douze sextillions de kilogrammes.
– Seulement ! répondit Ben-Zouf. Et le soleil ?
– Deux nonillions, répondit le professeur, un nombre qui comprend trente et un chiffres.
– Deux nonillions ! s’écria Ben-Zouf, à quelques grammes près sans doute ? » Palmyrin Rosette commença à regarder Ben-Zouf de travers.
« Ainsi donc, dit le capitaine Servadac pour conclure, tout objet pèse sept fois moins à la surface de Gallia qu’à la surface de la terre.
– Oui, répondit le professeur, et, par suite, nos forces musculaires se trouvent sextuplées. Un fort de la halle, qui porte cent kilogrammes sur la terre, en porterait sept cents sur Gallia.
– Et voilà pourquoi nous sautons sept fois plus haut ! dit Ben-Zouf.
– Sans doute, répondit le lieutenant Procope, et si la masse de Gallia eût été moindre, Ben-Zouf, vous auriez sauté plus haut encore !
– Même par-dessus la butte Montmartre ! ajouta le professeur, en clignant de l’œil de manière à mettre Ben-Zouf hors de lui.
– Et sur les autres astres, quelle est donc l’intensité de la pesanteur ? demanda Hector Servadac.
– Vous l’avez oublié ! s’écria le professeur. Au fait, vous n’avez jamais été qu’un assez mauvais élève !
– Je l’avoue à ma honte ! répondit le capitaine Servadac.
– Eh bien ! la terre étant un, l’attraction sur la lune est de zéro seize, sur Jupiter deux quarante-cinq, sur Mars zéro cinquante, sur Mercure un quinze, sur Vénus zéro quatre-vingt-douze, presque égale à celle de la terre, sur le soleil deux quarante-cinq. Là, un kilogramme terrestre en pèse vingt-huit !
– Aussi, ajouta le lieutenant Procope, sur le soleil, un homme constitué comme nous le sommes ne se relèverait-il que difficilement s’il venait à tomber, et un boulet de canon n’irait-il pas à plus de quelques dizaines de mètres.
– Un bon champ de bataille pour les poltrons ! dit Ben-Zouf.
– Mais non, répliqua le capitaine Servadac, puisqu’ils seraient trop lourds pour se sauver !
– Eh bien, dit Ben-Zouf, puisque nous aurions été plus forts, puisque nous aurions sauté plus haut, je regrette que Gallia ne soit pas plus petite qu’elle ne l’est ! Il est vrai que c’eût été difficile ! »
Cette proposition ne pouvait que blesser l’amour-propre de Palmyrin Rosette, propriétaire de ladite Gallia. Aussi, admonestant Ben-Zouf :
« Voyez-vous cela ! s’écria-t-il. Est-ce que la tête de cet ignorant n’est pas assez légère déjà ! Qu’il y prenne garde, ou un coup de vent l’emportera quelque jour !
– Bon ! répondit Ben-Zouf, je la tiendrai à deux mains ! »
Palmyrin Rosette, voyant qu’il n’aurait pas le dernier mot avec l’entêté Ben-Zouf, allait se retirer, lorsque le capitaine Servadac l’arrêta d’un geste.
« Pardon, cher professeur, dit-il, une seule question. Est-ce que vous ne savez pas quelle est cette substance dont Gallia est faite ?
– Peut-être ! répondit Palmyrin Rosette. La nature de cette matière… sa densité qui vaut dix… J’oserais affirmer… Ah ! si cela est, j’ai de quoi confondre ce Ben-Zouf ! Qu’il ose donc comparer sa butte avec ma comète !
– Et qu’oseriez-vous affirmer ?… demanda le capitaine Servadac.
– Que cette substance, reprit le professeur en scandant chaque syllabe de sa phrase, que cette substance n’est rien moins qu’un tellurure…
– Peuh ! un tellurure… s’écria Ben-Zouf.
– Un tellurure d’or, corps composé qui se trouve fréquemment sur terre, et dans celui-ci, s’il y a soixante-dix pour cent de tellure, j’estime qu’il y a trente pour cent d’or !
– Trente pour cent ! s’écria Hector Servadac.
– Ce qui, en additionnant les pesanteurs spécifiques de ces deux corps, devient dix au total, – soit précisément le chiffre qui représente la densité de Gallia !
– Une comète en or ! répétait le capitaine Servadac.
– Le célèbre Maupertuis pensait que cela était fort possible, et Gallia lui donne raison !
– Mais alors, dit le comte Timascheff, si Gallia tombe sur le globe terrestre, elle va en changer toutes les conditions monétaires, puisqu’il n’y a actuellement que vingt-neuf milliards quatre cents millions d’or en circulation !
– En effet, répondit Palmyrin Rosette, et puisque ce bloc de tellurure d’or qui nous emporte pèse en poids terrestre deux cent onze quintillions quatre cent trente-trois quatrillions quatre cent soixante trillions de kilogrammes, c’est environ soixante et onze quintillions d’or qu’il apportera à la terre. Or, à trois mille cinq cents francs le kilogramme, cela fait en nombre rond deux cent quarante-six sextillions de francs, – un nombre composé de vingt-quatre chiffres.
– Et ce jour-là, répondit Hector Servadac, la valeur de l’or tombera à rien, et il méritera plus que jamais la qualification de « vil métal ! »
Le professeur n’avait pas entendu cette observation. Il était sorti majestueusement sur sa dernière réponse pour remonter à son observatoire.
« Mais, demanda alors Ben-Zouf, à quoi servent tous ces calculs que ce savant hargneux vient d’exécuter comme des tours de passe-passe ?
– À rien ! répondit le capitaine Servadac, et c’est précisément ce qui en fait le charme ! »
Chapitre IX
Dans lequel il sera uniquement question de Jupiter, surnommé le grand troubleur de comètes
En effet, Palmyrin Rosette n’avait fait que de l’art pour l’art. Il connaissait les éphémérides de la comète, sa marche dans les espaces interplanétaires, la durée de sa révolution autour du soleil. Le reste, masse, densité, attraction, et même la valeur métallique de Gallia, ne pouvait intéresser que lui et non ses compagnons, désireux surtout de retrouver la terre au point de son orbite et à la date indiquée.
On laissa donc le professeur à ses travaux de science pure.
Le lendemain était le 1er août, ou, pour emprunter le langage de Palmyrin Rosette, le 63 avril gallien. Pendant ce mois, la comète, qui allait faire seize millions cinq cent mille lieues, devait s’éloigner à cent quatre-vingt-dix sept millions de lieues du soleil. Il lui fallait parcourir encore quatre-vingt et un millions de lieues sur sa trajectoire, pour atteindre le point aphélie, au 15 janvier. À partir de ce point, elle tendrait à se rapprocher du soleil.
Mais alors Gallia s’avançait vers un monde merveilleux, qu’aucun œil humain n’avait encore pu contempler de si près !
Oui, le professeur avait raison de ne plus quitter son observatoire ! Jamais astronome – et un astronome est plus qu’un homme, puisqu’il vit en dehors du monde terrestre – ne s’était trouvé à une pareille fête des yeux ! Que ces nuits galliennes étaient belles ! Pas un souffle de vent, pas une vapeur n’en troublaient la sérénité ! Le livre du firmament était là, tout ouvert, et se laissait lire avec une netteté incomparable !
Ce monde splendide vers lequel marchait Gallia, c’était le monde de Jupiter, le plus important de ceux que le soleil retient sous sa puissance attractive. Depuis la rencontre de la terre et de la comète, sept mois s’étaient écoulés, et celle-ci avait rapidement marché vers la superbe planète, qui s’avançait au-devant d’elle. À cette date du 1er août, les deux astres n’étaient plus séparés que par une distance de soixante et un millions de lieues, et, jusqu’au 1er novembre, ils allaient progressivement se rapprocher l’un de l’autre.
N’y avait-il pas là un danger ? À circuler si près de Jupiter, Gallia ne risquait-elle pas gros jeu ? Le pouvoir attractif de la planète, dont la masse était si considérable par rapport à la sienne, ne pouvait-il pas exercer sur elle une désastreuse influence ? Certainement, en calculant la durée de la révolution de Gallia, le professeur avait tenu exactement compte des perturbations que devaient lui faire subir non seulement Jupiter, mais aussi Saturne et Mars. Mais s’il s’était trompé sur la valeur de ces perturbations, si sa comète éprouvait des retards plus importants qu’il ne pensait ! Si même le terrible Jupiter, cet éternel séducteur de comètes !…
Enfin, ainsi que l’expliqua le lieutenant Procope, si les calculs de l’astronome étaient erronés, un quadruple danger menaçait Gallia.
1° Ou Gallia, irrésistiblement attirée par Jupiter, tomberait à sa surface et s’y anéantirait.
2° Ou, captée seulement, elle passerait à l’état de satellite, peut-être même de sous-satellite.
3° Ou, déviée de sa trajectoire, elle suivrait une nouvelle orbite qui ne la ramènerait pas à l’écliptique.
4° Ou, retardée, si peu que ce fût, par l’astre troublant, elle arriverait trop tard sur l’écliptique pour y retrouver la terre.
On remarquera que, de ces quatre dangers, il suffisait qu’un seul se produisît pour que les Galliens perdissent toute chance de retour à leur globe natal.
Il faut maintenant observer que, de ces quatre éventualités, au cas où elles se produiraient, Palmyrin Rosette n’en devait redouter que deux. Que Gallia passât à l’état de lune ou de sous-lune du monde jovien, cela ne pouvait lui convenir, à cet aventureux astronome ; mais, après avoir manqué la rencontre avec la terre, continuer à graviter autour du soleil, ou même courir les espaces sidéraux à travers cette nébuleuse de la voie lactée dont semblent faire partie toutes les étoiles visibles, cela lui allait beaucoup. Que ses compagnons fussent irrésistiblement pris du désir de revenir au globe terrestre, où ils avaient laissé des familles, des amis, cela se concevait ; mais Palmyrin Rosette n’avait plus de famille, il n’avait pas d’amis, n’ayant jamais eu le temps de s’en faire. Avec le caractère qu’on lui connaît, comment y aurait-il réussi ? Donc, puisqu’il avait cette chance exceptionnelle d’être emporté dans l’espace sur un nouvel astre, il eût tout donné pour ne le quitter jamais.
Un mois se passa dans ces conditions, entre les craintes des Galliens et les espérances de Palmyrin Rosette. Au 1er septembre, la distance de Gallia à Jupiter n’était plus que de trente-huit millions de lieues, – précisément celle qui sépare la terre de son centre attractif. Au 15, cette distance n’était plus que de vingt-six millions de lieues. La planète grossissait au firmament, et Gallia semblait être attirée vers elle, comme si sa course elliptique se fût changée en chute rectiligne sous l’influence de Jupiter.
C’est une considérable planète, en effet, que celle qui menaçait alors de troubler Gallia ! Pierre d’achoppement, dangereuse en vérité ! On sait, depuis Newton, que l’attraction entre les corps s’exerce proportionnellement à leurs masses et en raison inverse du carré de leurs distances. Or, la masse de Jupiter était bien considérable, et la distance à laquelle en passerait Gallia serait relativement bien réduite !
En effet, le diamètre de ce géant est de trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix lieues, soit onze fois le diamètre terrestre, et sa circonférence mesure cent douze mille quatre cent quarante lieues. Son volume vaut quatorze cent quatorze fois celui de la terre, c’est-à-dire qu’il faudrait quatorze cent quatorze globes terrestres pour égaler sa grosseur. Sa masse est trois cent trente-huit fois plus considérable que celle du sphéroïde terrestre ; autrement dit, il pèse cent trente-huit fois plus, soit près de deux octillions de kilogrammes, – un nombre composé de vingt-huit chiffres. Si sa densité moyenne, déduite de sa masse et de son volume, n’équivaut pas au quart de celle de la terre et ne dépasse que d’un tiers la densité de l’eau, – d’où cette hypothèse que l’énorme planète est peut-être liquide, au moins à sa surface, – sa masse n’en était pas moins troublante pour Gallia.
Il convient d’ajouter, pour achever la description physique de Jupiter, qu’il accomplit sa révolution autour du soleil en onze ans dix mois dix-sept jours huit heures et quarante-deux minutes terrestres, – qu’il se meut avec une vitesse de treize kilomètres par seconde sur une orbite de douze cent quatorze millions de lieues, – que sa rotation sur son axe n’emploie que neuf heures et cinquante-cinq minutes, ce qui réduit singulièrement la durée de ses jours, – que, par suite, chacun de ses points à l’équateur se déplace vingt-sept fois plus vite que l’un des points équatoriaux de la terre, ce qui a donné à chacun de ses pôles une dépression de neuf cent quatre-vingt-quinze lieues, – que l’axe de la planète est presque perpendiculaire au plan de son orbite, d’où cette conséquence que les jours sont égaux aux nuits, et la variation des saisons peu sensible, le soleil restant presque invariablement dans le plan de l’équateur, – enfin que l’intensité de la lumière et de la chaleur reçues par la planète n’est que le vingt-cinquième de l’intensité à la surface de la terre, car Jupiter suit une trajectoire elliptique qui le met au minimum à cent quatre-vingt-huit millions de lieues du soleil, et au maximum à deux cent sept millions.
Il reste à parler des quatre lunes qui, tantôt réunies sur le même horizon, tantôt séparées, éclairent magnifiquement les nuits joviennes.
De ces quatre satellites, l’un se meut autour de Jupiter à une distance presque égale à celle qui sépare la lune de la terre. Un autre est un peu moins gros que l’astre des nuits. Mais tous accomplissent leur révolution avec une rapidité beaucoup plus grande que la lune, le premier en un jour dix-huit heures vingt-huit minutes, le second en trois jours treize heures quatorze minutes, le troisième en sept jours trois heures quarante-trois minutes, et le quatrième en seize jours seize heures trente-deux minutes. Le plus éloigné circule à une distance de quatre cent soixante-cinq mille cent trente lieues de la surface de la planète.
On sait que c’est par l’observation de ces satellites, dont les mouvements sont connus avec une absolue précision, que l’on a pour la première fois déterminé la vitesse de la lumière. Ils peuvent aussi servir à calculer les longitudes terrestres.
« On peut donc se représenter Jupiter, dit un jour le lieutenant Procope, comme une énorme montre, dont les satellites forment les aiguilles et qui mesure le temps avec une exactitude parfaite.
– Une montre un peu grosse pour mon gousset ! répondit Ben-Zouf.
– J’ajouterai, dit le lieutenant, que si nos montres ont au plus trois aiguilles, celle-là en a quatre…
– Prenons garde qu’elle n’en ait bientôt une cinquième ! » répliqua le capitaine Servadac en songeant au danger que courait Gallia de se changer en satellite du système jovien.
Comme on le pense bien, ce monde, qui grandissait chaque jour à leurs yeux, était l’unique objet d’entretien du capitaine Servadac et de ses compagnons. Ils ne pouvaient en détacher leurs regards, ils ne pouvaient parler d’autre chose.
Un jour, la conversation porta sur l’âge que ces diverses planètes, qui circulent autour du soleil, devaient avoir, et le lieutenant Procope ne put mieux répondre qu’en lisant ce passage des Récits de l’infini de Flammarion, dont il avait la traduction russe :
« Les plus éloignés (de ces astres) sont les plus vénérables et les plus avancés dans la voie du progrès. Neptune, situé à onze cents millions de lieues du soleil, est sorti de la nébuleuse solaire le premier, il y a des milliards de siècles. Uranus, qui gravite à sept cents millions de lieues du centre commun des orbites planétaires, est âgé de plusieurs centaines de millions de siècles. Jupiter, colosse planant à cent quatre-vingt-dix millions de lieues, est âgé de soixante-dix millions de siècles. Mars compte dix fois cent millions d’années dans son existence ; sa distance au soleil est de cinquante-six millions de lieues. La terre, à trente-sept millions de lieues du soleil, est sortie de son sein brûlant, il y a une centaine de millions d’années. Il n’y a peut-être que cinquante millions d’années que Vénus est sortie du soleil : elle gravite à vingt-six millions de lieues ; et dix millions d’années seulement que Mercure (distance : quatorze millions) est né de la même origine, tandis que la lune était enfantée par la terre. »
Telle était la théorie nouvelle, ce qui amena cette réflexion du capitaine Servadac, « qu’à tout prendre, mieux vaudrait être capté par Mercure que par Jupiter. On servirait alors un maître moins vieux, et probablement moins difficile à contenter ! »
Pendant la dernière quinzaine du mois de septembre, Gallia et Jupiter continuèrent à s’approcher l’un de l’autre. C’était au 1er de ce mois que la comète avait croisé l’orbite de la planète, et c’était au premier jour du mois suivant que les deux astres devaient être à leur plus courte distance. Il n’y avait pas à craindre un choc direct, puisque les plans des orbites de Jupiter et de Gallia ne coïncidaient pas, mais, cependant, ils étaient faiblement inclinés l’un à l’autre. En effet, le plan dans lequel se meut Jupiter ne fait qu’un angle de 1° 19’ avec l’écliptique, et l’on n’a pas oublié que l’écliptique et l’orbite de la comète, depuis la rencontre, étaient projetés dans le même plan.
Pendant ces quinze jours, pour un observateur plus désintéressé que ne l’étaient les Galliens, Jupiter eût été digne de toute admiration. Son disque, éclairé par les rayons solaires, les réverbérait avec une certaine intensité sur Gallia. Les objets, plus éclairés à sa surface, prenaient des teintes nouvelles. Nérina, elle-même, lorsqu’elle se trouvait en opposition avec Jupiter, et par conséquent en conjonction avec le soleil, se laissait vaguement apercevoir dans la nuit. Palmyrin Rosette, immuablement installé dans son observatoire, sa lunette braquée sur le merveilleux astre, semblait vouloir pénétrer les derniers mystères du monde jovien. Cette planète, qu’un astronome terrestre n’a jamais vue à moins de cent cinquante millions de lieues, allait s’approcher à treize millions seulement de l’enthousiaste professeur !
Quant au soleil, de la distance à laquelle Gallia gravitait alors, il n’apparaissait plus que sous la forme d’un disque, mesurant cinq minutes quarante-six secondes de diamètre.
Quelques jours avant que Jupiter et Gallia fussent arrivés à leur plus courte distance, les satellites de la planète étaient visibles à l’œil nu. On sait que, sans lunette, il est impossible d’apercevoir de la terre les lunes du monde jovien. Cependant, quelques privilégiés, doués d’une puissance de vision exceptionnelle, ont vu sans le secours d’aucun instrument les satellites de Jupiter. Entre autres, les annales scientifiques citent Moestlin, le professeur de Kepler, un chasseur sibérien, au dire de Wrangel, et d’après Bogulawski, directeur de l’observatoire de Breslau, un maître tailleur de cette ville. En admettant cette pénétration de vue dont ces mortels étaient doués, ils auraient eu des rivaux nombreux, s’ils eussent, à cette époque, habité la Terre-Chaude et les alvéoles de Nina-Ruche. Les satellites étaient visibles pour tous les yeux. On pouvait même observer que le premier était d’un blanc plus ou moins vif, le second légèrement bleuâtre, le troisième d’une blancheur immaculée, le quatrième tantôt orangé, tantôt rougeâtre. Il faut également ajouter que Jupiter, à cette distance, semblait être entièrement dépourvu de scintillation.
Si Palmyrin Rosette continuait d’observer la planète en astronome purement désintéressé, ses compagnons, eux, craignaient toujours un retard ou même une attraction qui se fût changée en chute. Les jours s’écoulaient, cependant, sans justifier ces dernières appréhensions. L’astre troublant n’aurait-il donc d’autre effet que de produire sur Gallia les perturbations indiquées par le calcul ? Si une chute directe n’était pas à redouter, en raison de l’impulsion initiale donnée à la comète, cette impulsion suffirait-elle à la maintenir dans les limites de ces perturbations, qui, tout compte fait, devaient lui permettre d’accomplir en deux ans sa révolution autour du soleil ?
C’était sans doute ce qu’observait Palmyrin Rosette, mais il eût été malaisé de lui arracher le secret de ses observations.
Quelquefois Hector Servadac et ses compagnons en causaient.
« Bah ! répondit le capitaine Servadac, si la durée de la révolution gallienne est modifiée, si Gallia éprouve des retards imprévus, mon ex-professeur ne pourra contenir sa satisfaction. Il sera trop heureux de nous narguer, et, sans l’interroger directement, nous saurons bien à quoi nous en tenir !
– Dieu veuille, après tout, dit le comte Timascheff, qu’il n’ait commis aucune erreur dans ses premiers calculs !
– Lui, Palmyrin Rosette, commettre une erreur ! répliqua Hector Servadac, cela me paraît invraisemblable. On ne peut lui refuser d’être un observateur du plus grand mérite. Je crois à l’exactitude de ses premiers calculs touchant la révolution de Gallia, comme je croirai à l’exactitude des seconds, s’il affirme que nous devons renoncer à tout espoir de revenir à la terre.
– Eh bien, mon capitaine, dit alors Ben-Zouf, voulez-vous que je vous apprenne ce qui me tracasse ?
– Apprends-nous ce qui te tracasse, Ben-Zouf.
– Votre savant passe tout son temps dans son observatoire, n’est-ce pas ? dit l’ordonnance du ton d’un homme qui a profondément réfléchi.
– Oui, sans doute, répondit Hector Servadac.
– Et, jour et nuit, reprit Ben-Zouf, son infernale lunette est braquée sur ce M. Jupiter qui veut nous avaler ?
– Oui. Après ?
– Êtes-vous bien sûr, mon capitaine, que votre ancien professeur ne l’attire pas peu à peu avec sa maudite lunette ?
– Ah ! pour cela, non ! répondit le capitaine Servadac en éclatant de rire.
– Suffit, mon capitaine, suffit ! dit Ben-Zouf, qui secoua la tête d’un air peu convaincu. Cela ne me paraît pas aussi sûr qu’à vous, et je me tiens à quatre pour…
– Pour ? demanda Hector Servadac.
– Pour ne pas lui démolir son instrument de malheur !
– Briser sa lunette, Ben-Zouf !
– En mille morceaux !
– Eh bien, essaie, et je te fais pendre !
– Oh ! pendre !
– Ne suis-je pas gouverneur général de Gallia ?
– Oui, mon capitaine ! » répondit le brave Ben-Zouf.
Et de fait, s’il eût été condamné, il se fût mis lui-même la corde au cou, plutôt que de dénier un instant le droit de vie et de mort à « Son Excellence » ! Au 1er octobre, la distance entre Jupiter et Gallia n’était plus que de dix-huit millions de lieues. La planète se trouvait donc éloignée de la comète cent quatre-vingts fois plus que la lune ne l’est de la terre dans son plus grand écart. Or, on sait que si Jupiter était ramené à la distance qui sépare la lune de la sphère terrestre, son disque présenterait un diamètre trente-quatre fois aussi grand que celui de la lune, soit, en surface, douze cents fois le disque lunaire. Aux yeux des observateurs de Gallia, il montrait donc alors un disque de grande superficie. On voyait distinctement les bandes à teintes variées qui le zébraient parallèlement à l’équateur, bandes grisâtres au nord et au sud, alternativement sombres ou lumineuses aux pôles, en laissant dans une lumière plus intense les bords mêmes de l’astre. Des taches, fort reconnaissables, altéraient ça et là la pureté de ces bandes transversales et variaient de forme et de grandeur.
Ces bandes et ces taches n’étaient-elles que le produit des troubles atmosphériques de Jupiter ? Leur présence, leur nature, leur déplacement devaient-ils s’expliquer par l’accumulation de vapeurs, par la formation de nuages emportés sur des courants aériens, qui, semblables aux alizés, se propageaient en sens inverse de la rotation de la planète sur son axe ? c’est ce que Palmyrin Rosette ne pouvait pas plus affirmer que ses collègues des observatoires terrestres. S’il revenait à la terre, il n’aurait même pas eu la consolation d’avoir surpris l’un des plus intéressants secrets du monde jovien.
Pendant la seconde semaine d’octobre, les craintes furent plus vives que jamais. Gallia arrivait en grande vitesse au point dangereux. Le comte Timascheff et le capitaine Servadac, généralement un peu réservés, sinon froids, l’un vis-à-vis de l’autre, se sentaient rapprochés par ce danger commun. Ils faisaient un incessant échange de leurs idées. Quand, parfois, ils considéraient la partie comme perdue, le retour à la terre comme impossible, ils se laissaient alors aller à scruter cet avenir qui les attendait dans le monde solaire, peut-être même dans le monde sidéral. Ils se résignaient d’avance à ce sort. Ils se voyaient transportés dans une humanité nouvelle et s’inspiraient de cette large philosophie qui, repoussant l’étroite conception d’un monde fait uniquement pour l’homme, embrasse toute l’étendue d’un univers habité.
Mais, au fond, lorsqu’ils regardaient bien en eux-mêmes, ils sentaient que tout espoir ne pouvait les abandonner, et qu’ils ne renonceraient pas à revoir la terre, tant qu’elle apparaîtrait sur l’horizon de Gallia, au milieu des milliers d’étoiles du firmament. D’ailleurs, s’ils échappaient aux dangers causés par le voisinage de Jupiter – le lieutenant Procope le leur avait souvent répété –, Gallia n’aurait plus rien à craindre, ni de Saturne, trop éloigné, ni de Mars, dont elle recouperait l’orbite en revenant vers le soleil. Aussi, quelle hâte ils avaient tous d’avoir, comme Guillaume Tell, « franchi le funeste passage » !
Au 15 octobre, les deux astres se trouvaient l’un de l’autre au plus court intervalle qui dût les séparer, s’il ne se produisait pas de perturbations nouvelles. La distance n’était que de treize millions de lieues. Alors, ou l’influence attractive de Jupiter l’emporterait, ou Gallia continuerait à suivre son orbite sans éprouver d’autres retards que ceux qui avaient été calculés…
Gallia passa.
Et on le vit bien, le lendemain, à l’épouvantable mauvaise humeur de Palmyrin Rosette. S’il triomphait comme calculateur, il était vaincu comme chercheur d’aventures ! Lui qui aurait dû être le plus satisfait des astronomes, il était le plus malheureux des Galliens !
Gallia, suivant son immuable trajectoire, continuait de graviter autour du soleil et, conséquemment, à marcher vers la terre.
Chapitre X
Dans lequel il sera nettement établi qu’il vaut mieux trafiquer sur la terre que sur Gallia
« Mordioux ! je crois que nous l’avons échappé belle ! » s’écria le capitaine Servadac, lorsque le désappointement du professeur lui eut démontré que tout péril s’était évanoui.
Puis, s’adressant à ses compagnons, non moins satisfaits que lui-même :
« Qu’est-ce que nous aurons fait, en somme ? Un simple voyage dans le monde solaire, un voyage de deux ans ! Mais on en fait sur terre qui durent davantage ! Donc, jusqu’ici, nous n’avons pas à nous plaindre, et, puisque tout marchera convenablement désormais, avant quinze mois nous aurons réintégré notre sphéroïde habituel.
– Et revu Montmartre », ajouta Ben-Zouf. En vérité, il était heureux que les Galliens eussent « paré cet abordage », comme eût dit un marin. En effet, même en admettant que, sous l’influence de Jupiter, la comète n’eût subi qu’un retard d’une heure, la terre se fût trouvée à près de cent mille lieues du point précis où elle devait la rencontrer. Dans quel laps de temps ces conditions se seraient-elles représentées de nouveau ? Des siècles, des millénaires, ne se seraient-ils pas écoulés avant qu’une seconde rencontre eût été possible ? Oui, sans doute. En outre, si Jupiter eût perturbé Gallia au point de changer ou le plan ou la forme de son orbite, c’était à jamais peut-être qu’elle eût continué de graviter, soit dans le monde solaire, soit dans les espaces sidéraux.
Au 1er novembre, la distance qui séparait Jupiter et Gallia se mesurait par dix-sept millions de lieues. Dans deux mois et demi, la comète passerait à son aphélie, c’est-à-dire à sa plus grande distance du soleil, et, à partir de ce point, elle tendrait à s’en rapprocher.
Les propriétés lumineuses et calorifiques de l’astre radieux semblaient singulièrement affaiblies alors. Un demi-jour seulement éclairait les objets à la surface de la comète. La lumière et la chaleur n’y étaient plus qu’un vingt cinquième de celles que le soleil envoyait à la terre. Mais l’astre attractif était toujours là. Gallia n’avait pas cessé d’être soumise à sa puissance. On s’en rapprocherait bientôt. On irait reprendre la vie en revenant vers ce centre flamboyant, dont la température n’est pas estimée à moins de cinq millions de degrés. Cette perspective prochaine eût ranimé les Galliens au moral et au physique, – s’ils eussent jamais été hommes à faiblir.
Et Isac Hakhabut ? – L’égoïste avait-il connu les appréhensions que le capitaine Servadac et ses compagnons avaient subies pendant ces deux derniers mois ?
Non, en aucune manière. Isac Hakhabut n’avait pas quitté la Hansa depuis l’emprunt qui s’était fait à son grand profit. Le lendemain même du jour où les opérations du professeur avaient été terminées, Ben-Zouf s’était empressé de lui rapporter sa monnaie d’argent et son peson. Le prix de location et l’intérêt se trouvaient déjà entre ses mains. Il n’avait eu qu’à rendre les roubles-papier qui lui servaient de nantissement, et ses relations avec les habitants de Nina-Ruche s’étaient terminées de la sorte.
Mais, en même temps, Ben-Zouf lui avait appris que tout le sol de Gallia était composé de bon or, – sans aucune valeur il est vrai, et qui, vu son abondance, n’en aurait pas davantage, lorsqu’il serait tombé sur la terre.
Isac avait naturellement pensé que Ben-Zouf se moquait de lui. Il n’avait pas ajouté foi à ces histoires, et plus que jamais il songeait à soutirer toute la substance monétaire de la colonie gallienne.
Donc, Nina-Ruche n’avait pas été honorée une seule fois de la visite du bon Hakhabut.
« Et c’est étonnant, faisait quelquefois observer Ben-Zouf, comme on s’habitue facilement à ne jamais le voir ! »
Or, à cette époque, Isac Hakhabut songea à renouer ses relations avec les Galliens. C’est que son intérêt l’exigeait. D’une part, certains stocks de ses marchandises commençaient à s’avarier. De l’autre, il était important pour lui qu’elles fussent échangées contre argent avant que la comète eût rejoint la terre. En effet, ces marchandises, revenues au globe terrestre, n’auraient plus qu’une valeur ordinaire. Sur le marché gallien, au contraire, elles devaient atteindre de hauts prix, vu leur rareté et vu l’obligation, – Isac le savait bien, – où chacun allait être de s’adresser à lui.
Précisément, vers cette époque, différents articles de première nécessité, huile, café, sucre, tabac, etc., allaient manquer au magasin général. Ben-Zouf l’avait fait observer à son capitaine. Celui-ci, fidèle à la règle de conduite qu’il s’était imposée vis-à-vis d’Isac Hakhabut, prit la résolution de réquisitionner les marchandises de la Hansa, – moyennant finances.
Cette concordance d’idées entre le vendeur et les acheteurs devait donc amener Isac à reprendre et même à établir des relations suivies avec les habitants de la Terre-Chaude. Grâce à ses marchés, qui se feraient nécessairement en hausse, Isac Hakhabut espérait bien avoir avant peu accaparé tout l’or et tout l’argent de la colonie.
« Seulement, se disait-il en méditant dans son étroite cabine, la valeur de ma cargaison est supérieure à celle de l’argent dont ces gens-là peuvent disposer. Or, quand j’aurai tout dans mon coffre, comment pourront-ils m’acheter le restant de mes marchandises ? »
Cette éventualité ne laissait pas d’inquiéter le digne homme. Toutefois il se souvint fort à propos qu’il n’était pas seulement commerçant, mais aussi prêteur, ou, pour dire le mot, usurier. Ne pouvait-il donc continuer sur Gallia ce lucratif métier qui lui réussissait si bien sur la terre ? La dernière opération qu’il eût faite en ce genre était bien pour l’allécher.
Or, Isac Hakhabut – esprit logique – fut amené peu à peu à faire le raisonnement suivant :
« Lorsque ces gens-là n’auront plus d’argent, j’aurai encore des marchandises, puisqu’elles se seront toujours tenues à de hauts prix. Qui m’empêchera de leur prêter alors, j’entends à ceux dont la signature me semblera bonne ? Eh ! eh ! pour avoir été signés sur Gallia, ces billets n’en seront pas moins bons sur la terre ! S’ils ne sont pas payés à l’échéance, je les ferai protester, et les huissiers iront de l’avant. L’Éternel ne défend pas aux hommes de faire valoir leur bien. Au contraire. Il y a là un capitaine Servadac et surtout un comte Timascheff qui me paraissent solvables et qui ne regarderont pas au taux de l’intérêt. Ah ! je ne suis pas fâché de prêter à ces gens-là quelque argent remboursable dans le vrai monde ! »
Sans le savoir, Isac Hakhabut allait imiter un procédé que les Gaulois employaient jadis. Ils prêtaient sur billets payables en l’autre vie. Pour eux, il est vrai, l’autre vie, c’était celle de l’éternité. Pour Isac, c’était la vie terrestre, à laquelle, avant quinze mois, la chance, bonne pour lui, mauvaise pour ses débiteurs, allait probablement le rendre.
En conséquence de tout ce qui vient d’être dit, de même que la terre et Gallia marchaient irrésistiblement l’une vers l’autre, de même Isac Hakhabut allait faire un pas vers le capitaine Servadac, qui se dirigeait, lui, vers le propriétaire de la tartane.
La rencontre eut lieu pendant la journée du 15 novembre, dans la cabine de la Hansa. Le prudent négociant s’était bien gardé d’offrir, puisqu’il savait qu’on viendrait demander.
« Maître Isac, dit le capitaine Servadac, qui entra en matière sans préambule ni finasseries d’aucune sorte, nous avons besoin de café, de tabac, d’huile et autres articles dont la Hansa est approvisionnée. Demain, Ben-Zouf et moi, nous viendrons acheter ce dont nous avons besoin.
– Miséricorde ! s’écria Isac, auquel cette exclamation échappait toujours, qu’elle fût justifiée ou non.
– J’ai dit, reprit le capitaine Servadac, que nous viendrions « acheter », vous entendez ? Acheter, j’imagine, c’est prendre livraison d’une marchandise contre un prix convenu. Par conséquent, vous n’avez que faire de commencer vos jérémiades.
– Ah ! monsieur le gouverneur, répondit Isac, dont la voix tremblotait comme celle d’un pauvre diable qui demande l’aumône, j’entends bien ! Je sais que vous ne laisseriez pas dépouiller un malheureux commerçant dont toute la fortune est si compromise !
– Elle n’est aucunement compromise, Isac, et je vous répète qu’on ne vous prendra rien sans payer.
– Sans payer… comptant ?
– Comptant.
– Vous comprenez, monsieur le gouverneur, reprit Isac Hakhabut, qu’il me serait impossible de faire crédit… »
Le capitaine Servadac, suivant son habitude et pour étudier ce type sous toutes ses faces, le laissait dire. Ce que voyant, l’autre continua de plus belle :
« Je crois… oui… je pense… qu’il y a à la Terre-Chaude des personnes très honorables… j’entends très solvables… monsieur le comte Timascheff… monsieur le gouverneur lui-même… »
Hector Servadac eut un instant l’envie de le payer d’un coup de pied quelque part.
« Mais vous comprenez… reprit doucereusement Isac Hakhabut, si je faisais crédit à l’un, je serais fort embarrassé… pour refuser à l’autre. Cela amènerait des scènes fâcheuses… et je pense qu’il vaut mieux… ne faire crédit à personne.
– C’est mon avis, répondit Hector Servadac.
– Ah ! reprit Isac, je suis tout à fait réjoui à la pensée que monsieur le gouverneur partage ma manière de voir. C’est là entendre le commerce comme il doit être entendu. Oserai-je demander à monsieur le gouverneur en quelle monnaie se feront les payements ?
– En or, en argent, en cuivre, et, cette monnaie une fois épuisée, en billets de banque…
– En papier ! s’écria Isac Hakhabut. Voilà bien ce que je redoutais !
– Vous n’avez donc pas confiance dans les Banques de France, d’Angleterre et de Russie ?
– Ah ! monsieur le gouverneur !… Il n’y a qu’un bon métal d’or et d’argent… qui ait une véritable valeur !
– Aussi, répondit le capitaine Servadac, qui se montrait tout à fait aimable, aussi vous ai-je dit, maître Isac, que vous seriez tout d’abord payé en or et en argent ayant cours sur la terre.
– En or !… en or !… s’écria vivement Isac. C’est encore la monnaie par excellence !
– Oui, en or surtout, maître Isac, car c’est précisément l’or qui est le plus abondant sur Gallia, l’or russe, l’or anglais, l’or français.
– Oh ! les bons ors ! » murmura Isac, que sa cupidité poussait à mettre « au pluriel » ce substantif, si apprécié dans tous les mondes !
Le capitaine Servadac allait se retirer.
« C’est donc convenu, maître Isac, dit-il, à demain. »
Isac Hakhabut alla vers lui.
« Monsieur le gouverneur, dit-il, me permettra-t-il de lui poser encore une dernière question ?
– Posez.
– Je serai libre, n’est-ce pas, d’assigner… à mes marchandises… le prix qui me conviendra ?
– Maître Hakhabut, répondit tranquillement le capitaine Servadac, ce serait mon droit de vous imposer un maximum, mais je répugne à ces procédés révolutionnaires. Vous assignerez à vos marchandises les prix habituels aux marchés européens, et pas d’autres.
– Miséricorde ! monsieur le gouverneur !… s’écria Isac, touché à son endroit sensible, mais c’est me priver d’un bénéfice légitime !… C’est contraire à toutes les règles commerciales… J’ai le droit de faire la loi sur le marché, puisque je détiens toutes les marchandises ! En bonne justice, vous ne pouvez vous y opposer, monsieur le gouverneur !… C’est véritablement me dépouiller de mon bien !
– Les prix d’Europe, répondit simplement le capitaine Servadac.
– Comment ! Voilà une situation à exploiter…
– C’est précisément ce que je veux vous empêcher de faire !
– Jamais pareille occasion ne se représentera…
– D’écorcher vos semblables, maître Isac. Eh bien, j’en suis fâché pour vous… Mais n’oubliez pas que, dans l’intérêt commun, j’aurais le droit de disposer de vos marchandises…
– Disposer de ce qui m’appartient légitimement aux yeux de l’Éternel !
– Oui… maître Isac… répondit le capitaine, mais je perdrais mon temps à vouloir vous faire comprendre cette vérité si simple ! Prenez donc le parti de m’obéir, et tenez-vous pour satisfait de vendre à un prix quelconque, lorsqu’on pourrait vous obliger à donner. »
Isac Hakhabut allait recommencer ses lamentations ; mais le capitaine Servadac y coupa court en se retirant sur ces derniers mots :
« Les prix d’Europe, maître Isac, les prix d’Europe ! »
Isac passa le reste du jour à invectiver le gouverneur et toute la colonie gallienne, qui prétendaient lui imposer « le maximum », comme aux mauvais temps des révolutions. Et il ne sembla se consoler dans une certaine mesure qu’après avoir fait cette réflexion, à laquelle il attachait évidemment un sens particulier :
« Allez, allez, gens de mauvaise race ! On les subira vos prix d’Europe ! Mais j’y gagnerai encore plus que vous ne pensez ! »
Le lendemain, 16 novembre, le capitaine Servadac, qui voulait surveiller l’exécution de ses ordres, Ben-Zouf et deux matelots russes, se rendirent à la tartane, dès le lever du jour.
« Eh bien, Éléazar, s’écria tout d’abord Ben-Zouf, comment cela va-t-il, vieux coquin ?
– Vous êtes bien bon, monsieur Ben-Zouf, répondit Isac.
– Nous venons donc faire avec toi un petit trafic de bonne amitié ?
– Oui… de bonne amitié… mais en payant…
– Aux prix d’Europe, se contenta d’ajouter le capitaine Servadac.
– Bon !… bon ! reprit Ben-Zouf. Tu n’attendras pas longtemps après ton décompte !
– Que vous faut-il ? demanda Isac Hakhabut.
– Pour aujourd’hui, répondit Ben-Zouf, il nous faut du café, du tabac et du sucre, une dizaine de kilos de chacun de ces articles. Mais fais attention à nous servir en bonne qualité, ou gare à tes vieux os ! Je m’y connais, étant aujourd’hui caporal d’ordinaire !
– Je vous croyais l’aide de camp de monsieur le gouverneur général ? dit Isac.
– Oui, Caïphe, dans les grandes cérémonies, mais caporal, quand il s’agit d’aller au marché. Allons, ne perdons pas notre temps !
– Vous dites, monsieur Ben-Zouf, dix kilos de café, dix kilos de sucre et dix kilos de tabac ? »
Et là-dessus, Isac Hakhabut quitta sa cabine, descendit dans la cale de la Hansa et en revint bientôt, apportant d’abord dix paquets de tabac de la régie de France, parfaitement entourés des bandes au timbre de l’État, et pesant chacun un kilogramme.
« Voilà dix kilogrammes de tabac, dit-il. À douze francs le kilogramme, cela fait cent vingt francs ! »
Ben-Zouf allait payer le prix régulier, lorsque le capitaine Servadac, l’arrêtant, dit :
« Un instant, Ben-Zouf. Il faut voir si les poids sont exacts.
– Vous avez raison, mon capitaine.
– À quoi bon ? répondit Isac Hakhabut. Vous voyez que l’enveloppe de ces paquets est intacte, et que le poids est indiqué sur les bandes.
– N’importe, maître Isac ! répondit le capitaine Servadac, d’un ton qui n’admettait pas de réplique.
– Allons, vieux, prends ton peson ! » dit Ben-Zouf.
Isac alla chercher le peson, et il suspendit au crochet un paquet de tabac d’un kilogramme.
« Mein Gott ! » s’écria-t-il tout d’un coup.
Et, en vérité, il y avait de quoi provoquer cette subite exclamation de sa part.
En vertu de la faiblesse de la pesanteur à la surface de Gallia, l’aiguille du peson ne marquait que cent trente-trois grammes pour le paquet pesant un kilogramme terrestre.
« Eh bien, maître Isac, répondit le capitaine, qui gardait imperturbablement son sérieux, vous voyez bien que j’avais raison en vous obligeant à peser ce paquet ?
– Mais, monsieur le gouverneur…
– Ajoutez ce qu’il faut de tabac pour parfaire un kilogramme.
– Mais, monsieur le gouverneur…
– Allons, ajoute !… dit Ben-Zouf.
– Mais, monsieur Ben-Zouf !… »
Et le malheureux Isac ne sortait pas de là ! Il avait bien compris ce phénomène de moindre attraction. Il voyait bien que tous « ces mécréants » allaient se rattraper, par la diminution du poids, du prix qu’il obligeait ses acheteurs à lui payer. Ah ! s’il avait eu des balances ordinaires, cela ne serait pas arrivé, ainsi que cela a été expliqué déjà dans une autre circonstance. Mais il n’en avait pas. Il essaya de réclamer encore, d’attendrir le capitaine Servadac. Celui-ci paraissait vouloir rester inflexible. Ce n’était ni sa faute ni celle de ses compagnons ; mais il avait la prétention que l’aiguille du peson indiquât un kilogramme, quand il payait un kilogramme.
Isac Hakhabut dut donc s’exécuter, non sans mêler ses gémissements aux éclats de rire de Ben-Zouf et des matelots russes. Que de plaisanteries, que de quolibets ! En fin de compte, pour un kilogramme de tabac, il dut en donner sept, et il en fut de même pour le sucre et pour le café.
« Va donc, Harpagon ! lui répétait Ben-Zouf, qui tenait lui-même le peson. Aimes-tu mieux que nous prenions sans payer ? »
L’opération se termina enfin. Isac Hakhabut avait fourni soixante-dix kilogrammes de tabac, autant de café et de sucre, et il n’avait reçu pour chaque article que le prix de dix kilogrammes.
Après tout, comme dit Ben-Zouf, « c’était la faute à Gallia ! Pourquoi maître Isac était-il venu trafiquer sur Gallia ? »
Mais alors, le capitaine Servadac, qui n’avait voulu que s’amuser d’Isac, et mû par le sentiment de justice qu’il avait toujours gardé vis-à-vis de lui, fit établir la balance exacte entre les prix et les poids. De telle sorte que, pour soixante-dix kilogrammes, Isac Hakhabut reçut exactement le prix de soixante-dix kilogrammes.
On conviendra, cependant, que la situation faite au capitaine Servadac et à ses compagnons aurait bien excusé cette manière un peu fantaisiste de traiter une opération commerciale.
D’ailleurs, comme en d’autres circonstances, Hector Servadac crut comprendre qu’Isac se faisait plus malheureux qu’il ne l’était réellement. Il y avait dans ses gémissements, dans ses récriminations quelque chose de louche. Cela se sentait.
Quoi qu’il en soit, tous quittèrent la Hansa, et Isac Hakhabut put entendre retentir au loin ce refrain militaire du joyeux Ben-Zouf :
J’aime le son Du clairon,
Du tambour, de la trompette,
Et ma joie est complète
Quand j’entends résonner le canon !
Chapitre XI
Dans lequel le monde savant de Gallia se lance, en idée, au milieu des infinis de l’espace
Un mois s’écoula. Gallia continuait à graviter, emportant son petit monde avec elle. Petit monde, en effet, mais peu accessible jusqu’alors à l’influence des passions humaines ! La cupidité, l’égoïsme n’y étaient représentés que par Hakhabut, ce triste échantillon de la race humaine, et c’était la seule tache que l’on pût relever à ce microcosme séparé de l’humanité.
Après tout, ces Galliens ne devaient se considérer que comme des passagers, faisant un voyage de circumnavigation dans le monde solaire. De là, cette pensée de s’installer à bord aussi confortablement que possible, mais temporairement. Ce tour du monde achevé, après deux ans d’absence, leur navire accosterait l’ancien sphéroïde, et si les calculs du professeur étaient d’une absolue justesse – mais il fallait qu’ils le fussent –, ils quitteraient la comète pour remettre le pied sur les continents terrestres.
Il est vrai que l’arrivée du navire Gallia à la terre, « son port d’attache », ne s’opérerait sans doute qu’au prix de difficultés extrêmes, de dangers vraiment terribles. Mais c’était une question à traiter plus tard et qui viendrait en son temps.
Le comte Timascheff, le capitaine Servadac, le lieutenant Procope se croyaient donc à peu près assurés de revoir leurs semblables dans un délai relativement court. Ils n’avaient donc point à se préoccuper d’amasser des réserves pour l’avenir, d’utiliser pour la saison chaude les portions fertiles de l’île Gourbi, de conserver les diverses espèces d’animaux, quadrupèdes et volatiles, qu’ils destinaient dans le principe à reconstituer le règne animal sur Gallia.
Mais que de fois, en causant, ils parlèrent de ce qu’ils auraient tenté pour rendre leur astéroïde habitable, s’il leur eût été impossible de le quitter un jour ! Que de projets à exécuter, que de travaux à accomplir pour assurer cette existence d’un petit groupe d’êtres, qu’un hiver de plus de vingt mois rendait si précaire !
C’était au 15 janvier prochain que la comète devait atteindre l’extrémité de son grand axe, c’est-à-dire son aphélie. Ce point dépassé, sa trajectoire la ramènerait vers le soleil avec une vitesse croissante. Neuf à dix mois s’écouleraient encore avant que la chaleur solaire eût rendu la mer libre et la terre féconde. Alors, c’eût été l’époque à laquelle la Dobryna et la Hansa auraient transporté hommes et animaux à l’île Gourbi. Les terres auraient été rapidement mises en état pour cette saison si courte, mais si chaude de l’été gallien. Semé en temps opportun, ce sol aurait produit en quelques mois les fourrages et céréales nécessaires à l’alimentation de tous. La fenaison, la moisson eussent été faites avant le retour de l’hiver. On aurait vécu sur l’île de la vie, large et saine, des chasseurs et des agriculteurs. Puis, l’hiver revenu, on aurait repris cette existence de troglodytes dans les alvéoles du mont ignivome. Les abeilles auraient essaimé vers Nina-Ruche pour y passer la dure et longue saison froide.
Oui, les colons seraient ainsi rentrés à leur chaude demeure ! Toutefois, n’auraient-ils pas tenté quelque lointaine exploration pour découvrir une mine de combustible, un gisement de charbon aisément exploitable ? N’auraient-ils pas cherché à se construire, sur l’île Gourbi même, une habitation plus confortable, plus appropriée aux besoins de la colonie et aux conditions climatériques de Gallia ?
Ils l’eussent fait, certainement. Ils auraient essayé, du moins, afin d’échapper à cette longue séquestration dans les cavernes de la Terre-Chaude, – séquestration plus regrettable encore au point de vue moral qu’au point de vue physique. Il fallait être un Palmyrin Rosette, un original absorbé dans ses chiffres, pour n’en pas sentir les graves inconvénients, pour vouloir demeurer sur Gallia dans ces conditions ad infinitum !
D’ailleurs, une éventualité terrible menaçait toujours les habitants de la Terre-Chaude. Pouvait-on affirmer qu’elle ne se présenterait pas dans l’avenir ? Pouvait-on même assurer qu’elle ne se produirait pas avant que le soleil eût restitué à la comète cette chaleur que son habitabilité exigeait ? La question était grave, et fut plus d’une fois traitée pour le présent, et non pour un avenir auquel les Galliens espéraient échapper par leur retour à la terre.
En effet, ne pouvait-il arriver que ce volcan qui chauffait toute la Terre-Chaude ne vînt à s’éteindre ? Les feux intérieurs de Gallia n’étaient-ils pas épuisables ? L’éruption finie, que deviendraient les habitants de Nina-Ruche ? Devraient-ils donc s’enfoncer jusque dans les entrailles de la comète pour y trouver une température supportable ? Et là, leur serait-il même possible de braver les froids de l’espace ?
Évidemment, dans un avenir aussi lointain qu’on voudra le supposer, le sort de Gallia devait être celui qui semble réservé à tous les mondes de l’univers. Ses feux internes s’éteindraient. Elle deviendrait un astre mort, comme l’est maintenant la lune, comme le sera la terre. Mais cet avenir n’était plus maintenant pour préoccuper les Galliens – ils le croyaient du moins –, et ils comptaient avoir quitté Gallia bien avant qu’elle fût devenue inhabitable.
Toutefois, l’éruption pouvait cesser d’un moment à l’autre, comme il arrive aux volcans terrestres, avant même que la comète se fût suffisamment rapprochée du soleil. Et, dans ce cas, où prendre cette lave qui distribuait si utilement la chaleur jusque dans les profondeurs du massif ? Quel combustible fournirait assez de calorique pour rendre à cette demeure la température moyenne qui devait permettre d’y supporter impunément des froids de soixante degrés au-dessous de zéro ?
Telle était cette grave question. Heureusement, aucune modification ne s’était jusqu’alors manifestée dans l’épanchement des matières éruptives. Le volcan fonctionnait avec une régularité et, on l’a dit, un calme de bon augure. Donc, à cet égard, il n’y avait à s’inquiéter ni de l’avenir, ni même du présent. C’était l’opinion du capitaine Servadac, toujours confiant d’ailleurs.
Au 15 décembre, Gallia se trouvait à deux cent seize millions de lieues du soleil, presque à l’extrémité du grand axe de son orbite. Elle ne gravitait plus qu’avec une vitesse mensuelle de onze à douze millions de lieues.
Un monde nouveau s’offrait alors aux regards des Galliens, et plus particulièrement à ceux de Palmyrin Rosette.
Après avoir observé Jupiter de plus près que jamais humain ne l’eût fait avant lui, le professeur se concentrait maintenant dans la contemplation de Saturne.
Toutefois, les circonstances de proximité n’étaient pas les mêmes. Treize millions de lieues seulement avaient séparé la comète du monde jovien, cent soixante-treize millions de lieues la sépareraient de la curieuse planète. Donc, pas de retards à craindre de ce chef, autres que ceux qui avaient été calculés, et, par conséquent, rien de grave à redouter.
Quoi qu’il en soit, Palmyrin Rosette allait pouvoir observer Saturne comme si, étant sur la terre, la planète se fût rapprochée de lui du demi-diamètre de son orbite.
Il était inutile de lui demander quelques détails sur Saturne. L’ex-professeur n’éprouvait plus le besoin de professer. On ne l’eût pas aisément fait quitter son observatoire, et il semblait que l’oculaire de sa lunette fût, nuit et jour, vissé à ses yeux.
Très heureusement, la bibliothèque de la Dobryna comptait quelques livres de cosmographie élémentaire, et, grâce au lieutenant Procope, ceux des Galliens que ces questions astronomiques intéressaient purent apprendre ce qu’était le monde de Saturne.
Tout d’abord, Ben-Zouf eut lieu d’être satisfait, quand on lui dit que si Gallia s’était éloignée du soleil à la distance où gravitait Saturne, il n’aurait plus aperçu la terre à l’œil nu. Or, on sait que l’ordonnance tenait particulièrement à ce que son globe terrestre fût toujours visible à ses yeux.
« Tant qu’on voit la terre, rien de perdu », répétait-il.
Et de fait, à la distance qui sépare Saturne du soleil, la terre eût été invisible, même aux meilleurs yeux.
Saturne, à cette époque, flottait dans l’espace à cent soixante-quinze millions de lieues de Gallia et, par conséquent, à trois cent soixante-quatre millions trois cent cinquante mille lieues du soleil. À cette distance, il ne recevait au plus que le centième de la lumière et de la chaleur que l’astre radieux envoyait à la terre.
Livre en main, on apprit que Saturne opère sa révolution autour du soleil en vingt-neuf ans et cent soixante-sept jours, parcourant, avec une vitesse de huit mille huit cent cinquante-huit lieues par heure, une orbite de deux milliards deux cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille lieues, « toujours en négligeant les centimes », comme disait Ben-Zouf. La circonférence de cette planète mesure à l’équateur quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingts lieues. Sa surface est de quarante milliards de kilomètres carrés, son volume de six cent soixante-six milliards de kilomètres cubes. En somme, Saturne est sept cent trente-cinq fois gros comme la terre, conséquemment plus petit que Jupiter. Quant à la masse de la planète, elle n’est que cent fois plus grande que celle du globe terrestre, ce qui lui assigne une densité moins forte que celle de l’eau. Elle tourne sur son axe en dix heures vingt-neuf minutes, ce qui compose son année de vingt-quatre mille six cent trente jours, et ses saisons, vu l’inclinaison considérable de l’axe sur le plan de l’orbite, durent sept ans terrestres chacune.
Mais ce qui doit donner aux Saturniens – s’il y en a – des nuits splendides, ce sont les huit lunes qui escortent leur planète. Elles ont des noms très mythologiques, Midas, Encelade, Téthys, Dione, Rhéa, Titan, Hyperion, Japet. Si la révolution de Midas ne dure que vingt-deux heures et demie, celle de Japet est de soixante-dix-neuf jours. Si Japet gravite à neuf cent dix mille lieues de la surface de Saturne, Midas circule à trente-quatre mille lieues seulement, presque trois fois plus près que la lune ne tourne autour de la terre. Elles doivent être splendides, ces nuits, bien que l’intensité de la lumière émanée du soleil soit relativement faible.
Ce qui rend plus belles encore les nuits de cette planète, c’est incontestablement le triple anneau qui s’enroule autour d’elle. Saturne semble être enchâssé dans une brillante monture. Un observateur, placé exactement sous cet anneau, qui passe alors par son zénith à cinq mille cent soixante-cinq lieues au-dessus de sa tête, n’aperçoit qu’une étroite bande, dont Herschell n’évalue la largeur qu’à cent lieues. C’est donc comme un fil lumineux qui serait tendu sur l’espace. Mais que l’observateur s’écarte de part ou d’autre, il voit alors trois anneaux concentriques se détacher peu à peu les uns des autres, le plus rapproché, obscur et diaphane, large de trois mille cent vingt-six lieues, l’anneau intermédiaire, large de sept mille trois cent quatre-vingt-huit lieues et plus brillant encore que la planète elle-même, enfin l’anneau extérieur, large de trois mille six cent soixante-dix-huit lieues et présentant aux regards une teinte grisâtre.
Tel est l’ensemble de cet appendice annulaire, qui se meut dans son propre plan en dix heures trente-deux minutes. De quelle matière est formé cet appendice, comment résiste-t-il à la désagrégation ? nul ne le sait ; mais, en le laissant subsister, il semble que le Créateur ait voulu apprendre aux humains de quelle manière se sont peu à peu formés les corps célestes. En effet, cet appendice est le reste de la nébuleuse qui, après s’être concentrée peu à peu, est devenue Saturne. Pour une raison inconnue, il s’est probablement solidifié lui-même, et, s’il venait à se briser, ou il tomberait en morceaux sur Saturne, ou ses morceaux feraient à la planète autant de nouveaux satellites.
Quoi qu’il en soit, pour les Saturniens habitant leur sphéroïde entre les quarante-cinquièmes degrés de latitude et l’équateur, ce triple anneau doit donner naissance aux phénomènes les plus curieux. Tantôt, il se dessine sur l’horizon comme une arche immense, rompue à sa clef de voûte par l’ombre que Saturne projette dans l’espace ; tantôt il apparaît dans son entier comme une demi-auréole. Très fréquemment, cet appendice éclipse le soleil, qui paraît et reparaît dans des temps mathématiques, à la grande joie, sans doute, des astronomes saturniens. Et si l’on ajoute à ce phénomène le lever, le coucher des huit lunes, les unes pleines, les autres en quadrature, ici des disques argentés, là des croissants aigus, l’aspect du ciel de Saturne, pendant la nuit, doit offrir un incomparable spectacle.
Les Galliens n’étaient pas à même d’observer toutes les magnificences de ce monde. Ils en étaient trop éloignés. Les astronomes terrestres, armés de leurs lunettes, s’en rapprochent mille fois plus, et les livres de la Dobryna en apprirent plus au capitaine Servadac et à ses compagnons que leurs propres yeux. Mais ils ne s’en plaignaient pas, – le voisinage de ces grands astres constituant des dangers trop graves pour leur infime comète !
Ils ne pouvaient pénétrer davantage dans le monde plus lointain d’Uranus ; mais, on l’a déjà mentionné, la planète principale de ce monde, quatre-vingt-deux fois grosse comme la terre, dont elle n’est visible que comme une étoile de sixième grandeur à sa plus courte distance, apparaissait alors très distinctement à l’œil nu. Toutefois, on ne voyait aucun de ces huit satellites qu’elle entraîne avec elle sur son orbe elliptique, qu’elle emploie quatre-vingt-quatre ans à décrire et qui l’éloigne en moyenne à sept cent vingt-neuf millions de lieues du soleil.
Quant à la dernière planète du système solaire – la dernière jusqu’au moment où quelque Le Verrier de l’avenir en découvrira une autre plus éloignée encore –, les Galliens ne pouvaient l’apercevoir. Palmyrin Rosette la vit, sans doute, dans le champ de sa lunette ; mais il ne fit à personne les honneurs de son observatoire, et on dut se contenter d’observer Neptune… dans les livres de cosmographie.
La distance moyenne de cette planète au soleil se mesure par un milliard cent quarante millions de lieues, et la durée de sa révolution est de cent soixante-cinq ans. Neptune parcourt donc son immense orbite de sept milliards cent soixante-dix millions de lieues avec une vitesse de vingt mille kilomètres à l’heure, sous la forme d’un sphéroïde, cent cinq fois plus considérable que celui de la terre, autour duquel circule un satellite à une distance de cent mille lieues.
Cette distance de douze cents millions de lieues environ, à laquelle gravite Neptune, paraît être la limite du système solaire. Et cependant, quelque grand que soit le diamètre de ce monde, il est insignifiant, si on le compare à celui du groupe sidéral auquel on rattache l’astre radieux.
Le soleil, en effet, semble faire partie de cette grande nébuleuse de la Voie lactée, au milieu de laquelle il ne brille que comme une modeste étoile de quatrième grandeur. Où donc aurait été Gallia, si elle eût échappé à l’attraction solaire ? À quel nouveau centre se fût-elle attachée en parcourant l’espace sidéral ? Peut-être à la plus rapprochée des étoiles de la Voie lactée.
Or, cette étoile, c’est Alpha de la constellation du Centaure, et la lumière, qui fait soixante-dix-sept mille lieues à la seconde, emploie trois ans et demi à lui venir du soleil. Quelle est donc cette distance ? Elle est telle que, pour la chiffrer, les astronomes ont dû prendre le milliard comme unité, et ils disent qu’Alpha est à huit mille « milliards » de lieues.
Connaît-on un grand nombre de ces distances stellaires ? Huit au plus ont été mesurées, et, parmi les principales étoiles auxquelles cette mesure a pu être appliquée, on cite Véga, placée à cinquante mille milliards de lieues, Sirius, à cinquante-deux mille deux cents milliards, la Polaire, à cent dix-sept mille six cents milliards, la Chèvre, à cent soixante-dix mille quatre cents milliards de lieues. Ce dernier nombre est déjà composé de quinze chiffres.
Et pour donner une idée de ces distances, en prenant pour base la vitesse de la lumière, d’après d’ingénieux savants on peut raisonner ainsi :
« Supposons un être doué d’une puissance de vision infinie, et mettons-le sur la Chèvre. S’il regarde vers la terre, il sera témoin des faits qui se sont accomplis il y a soixante-douze ans. S’il se transporte sur une étoile dix fois plus éloignée, il y verra les événements qui se sont produits il y a sept cent vingt ans. Plus loin encore, à une distance que la lumière emploie dix-huit cents ans à franchir, il assistera à cette grande scène de la mort du Christ. Plus loin encore, s’il faut au rayon lumineux six mille ans pour arriver à son œil, il pourra contempler les désolations du déluge universel. Plus loin enfin, puisque l’espace est infini, il verrait, suivant la tradition biblique, Dieu créant les mondes. En effet, tous les faits sont pour ainsi dire stéréotypés dans l’espace, et rien ne peut s’effacer de ce qui s’est une fois accompli dans l’univers céleste. »
Peut-être avait-il raison, l’aventureux Palmyrin Rosette, de vouloir courir ce monde sidéral, où tant de merveilles eussent charmé ses yeux. Si sa comète fût entrée successivement au service d’une étoile, puis d’une autre, quels systèmes stellaires si différents il aurait observés ! Gallia se serait déplacée avec ces étoiles dont la fixité n’est qu’apparente et qui se meuvent pourtant, – ainsi fait Arcturus, avec une vitesse de vingt-deux lieues par seconde. Le soleil lui-même marche à raison de soixante-deux millions de lieues annuellement, en se dirigeant vers la constellation d’Hercule. Mais telle est la distance de ces étoiles, que leurs positions respectives, malgré ce rapide déplacement, n’ont pu être encore modifiées pour les observateurs terrestres.
Cependant, ces déplacements séculaires doivent nécessairement altérer un jour la forme des constellations, car chaque étoile marche ou paraît marcher avec des vitesses inégales. Les astronomes ont pu indiquer les positions nouvelles que les astres prendront l’un par rapport à l’autre dans un grand nombre d’années. Les dessins de certaines constellations, tels qu’ils seront dans cinquante mille ans, ont été reproduits graphiquement. Ils offrent à l’œil, par exemple, au lieu du quadrilatère irrégulier de la grande Ourse, une longue croix projetée sur le ciel, et à la place du pentagone de la constellation d’Orion, un simple quadrilatère.
Mais ni les habitants actuels de Gallia, ni ceux du globe terrestre, n’auraient pu constater de leurs propres yeux ces dislocations successives. Ce n’est pas ce phénomène que Palmyrin Rosette eût été chercher dans le monde sidéral. Si quelque circonstance eût arraché la comète à son centre attractif pour l’asservir à d’autres astres, alors ses regards eussent été ravis par la contemplation de merveilles dont le système solaire ne peut donner aucune idée.
Au loin, en effet, les groupes planétaires ne sont pas toujours gouvernés par un soleil unique. Le système monarchique semble banni en certains points des deux. Un soleil, deux soleils, six soleils, dépendant les uns des autres, gravitent sous leurs influences réciproques. Ce sont des astres diversement colorés, rouges, jaunes, verts, oranges, indigos. Combien doivent être admirables ces contrastes de lumières qu’ils projettent à la surface de leurs planètes ! Et qui sait si Gallia n’eût pas vu se lever, sur son horizon, des jours faits successivement de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ?
Mais il ne devait pas lui être donné de graviter sous la puissance d’un nouveau centre, ni de se mêler aux amas d’étoiles que les puissants télescopes ont pu décomposer, ni de se perdre dans ces points stellaires qui sont partiellement résolus, ni enfin au milieu de ces compactes nébuleuses qui résistent aux plus puissants réflecteurs, – nébuleuses dont les astronomes connaissent plus de cinq mille, disséminées dans l’espace.
Non ! Gallia ne devait jamais quitter le monde solaire, ni perdre la terre de vue. Et, après avoir décrit un orbe de six cent trente millions de lieues environ, elle n’aurait fait cependant qu’un insignifiant voyage dans cet univers dont l’immensité est sans limites.
Chapitre XII
Comment on célébra le 1er janvier sur Gallia, et de quelle façon se termina ce jour de fête
Cependant, avec l’éloignement progressif de Gallia, le froid s’accroissait notablement. Déjà la température s’était abaissée au-delà de quarante-deux degrés au-dessous de glace. Dans ces conditions, les thermomètres à mercure n’auraient pu être utilisés, puisque le mercure se solidifie à quarante-deux degrés. Le thermomètre à alcool de la Dobryna fut donc mis en usage, et sa colonne tomba à cinquante-trois degrés au-dessous de glace.
En même temps, l’effet prévu par le lieutenant Procope s’était manifesté sur les bords de cette crique, dans laquelle les deux navires avaient été mis en état d’hivernage. Les couches glacées, par un mouvement lent, mais irrésistible, s’étaient épaissies sous la carène de la Hansa et de la Dobryna. Près du promontoire de roches qui les abritait, la goélette et la tartane, surélevées dans leur cuvette de glace, atteignaient déjà un niveau de cinquante pieds au-dessus de la mer Gallienne. La Dobryna, plus légère que la tartane, la dominait quelque peu. Aucune force humaine n’eût pu empêcher ce travail de surélévation de s’accomplir.
Le lieutenant Procope fut très inquiet du sort réservé à la goélette. Tous les objets qu’elle contenait avaient été enlevés. Il ne restait plus que la coque, la mâture et la machine ; mais cette coque, dans le cas de certaines éventualités, n’était-elle pas destinée à donner refuge à la petite colonie ? Si, au dégel, elle se brisait dans une chute impossible à prévenir, et si les Galliens étaient obligés de quitter la Terre-Chaude, quelle autre embarcation la pourrait remplacer ?
Ce ne serait pas, en tout cas, la tartane, menacée comme elle et destinée à subir le même sort. La Hansa, mal soudée dans sa carapace, s’inclinait déjà sous un angle inquiétant. Il y avait danger à y demeurer. Cependant, Isac n’entendait pas abandonner sa cargaison, qu’il voulait surveiller nuit et jour. Il sentait bien que sa vie était compromise, mais son bien encore plus, et cet Éternel qu’il invoquait à chaque phrase, il ne se gênait pas de le maudire pour toutes les épreuves dont il se voyait accablé.
Dans ces circonstances, le capitaine Servadac prit une résolution, et Isac dut se soumettre. Si l’existence d’Isac Hakhabut n’était pas précisément indispensable aux divers membres de la colonie gallienne, sa cargaison avait un prix incontestable. Il fallait donc avant tout la sauver d’un désastre très imminent. Le capitaine Servadac avait d’abord tenté d’inspirer à Isac Hakhabut des inquiétudes pour lui-même. Il n’y avait pas réussi. Isac ne voulait pas déloger.
« Libre à vous, avait alors répondu Hector Servadac, mais votre cargaison sera transportée dans les magasins de la Terre-Chaude. »
Les lamentations qu’Isac Hakhabut fit entendre, si attendrissantes qu’elles fussent, ne touchèrent personne, et le déménagement commença dans la journée du 20 décembre.
D’ailleurs, Isac pouvait venir s’installer à Nina-Ruche, et, comme devant, surveiller ses marchandises, vendre, trafiquer, aux prix et poids convenus. Aucun préjudice ne lui serait causé. Véritablement, si Ben-Zouf se fût permis de blâmer son capitaine, c’eût été de garder tant de ménagements envers ce déplorable trafiquant !
Au fond, Isac Hakhabut ne pouvait qu’approuver la résolution prise par le gouverneur général. Elle sauvegardait ses intérêts, elle mettait son bien en lieu sûr, et lui n’aurait rien à payer pour ce déchargement de la tartane, puisqu’il se faisait « contre sa volonté ».
Pendant plusieurs jours, les Russes et les Espagnols s’employèrent activement à ce travail. Chaudement vêtus, étroitement encapuchonnés, ils purent impunément braver cette basse température. Ils évitaient seulement de toucher à mains nues les objets de métal dont ils opéraient le transport. La peau de leurs doigts y fût restée, comme si ces objets eussent été rougis au feu, – car l’effet produit est absolument identique à celui d’une brûlure. La besogne se fit donc sans accident, et la cargaison de la Hansa fut enfin emmagasinée dans une des vastes galeries de Nina-Ruche.
Le lieutenant Procope ne se sentit rassuré que quand la chose eut été complètement faite.
Mais alors, Isac Hakhabut, n’ayant plus aucune raison de demeurer sur sa tartane, vint habiter la galerie même réservée à ses marchandises. Il faut convenir qu’il ne fut pas gênant. On ne le voyait que fort peu. Il couchait près de son bien, il se nourrissait de son bien. Une lampe à esprit-de-vin lui servait à ses préparations culinaires, plus que modestes. Les hôtes de Nina-Ruche n’avaient d’autres relations avec lui que lorsqu’il s’agissait, pour eux d’acheter, pour lui de vendre. Ce qui est certain, c’est que peu à peu tout l’or et l’argent de la petite colonie affluait vers un tiroir à triple secret, dont la clef ne quittait jamais Isac Hakhabut.
Le 1er janvier du calendrier terrestre approchait. Dans quelques jours, un an se serait écoulé depuis la rencontre du globe terrestre et de la comète, depuis ce choc qui avait séparé de leurs semblables trente-six êtres humains. En tout cas, pas un ne manquait jusqu’alors. Dans ces nouvelles conditions climatériques, leur santé était demeurée parfaite. Une température progressivement décroissante, mais sans revirements brusques, sans alternatives, on peut même ajouter sans courants d’air, ne leur avait pas même causé un rhume. Donc, rien de plus sain que le climat de la comète. Tout portait donc à croire que si les calculs du professeur étaient justes, si Gallia revenait à la terre, les Galliens y arriveraient au complet.
Bien que ce premier jour de l’an ne fût pas le jour du renouvellement de l’année gallienne, et qu’il commençât seulement la seconde moitié de sa révolution solaire, le capitaine Servadac voulut, non sans raison, qu’on le fêtât avec une certaine solennité.
« Il ne faut pas, dit-il au comte Timascheff et au lieutenant Procope, que nos compagnons se désintéressent des choses de la terre. Ils doivent retrouver un jour le globe terrestre, et, lors même que ce retour n’aurait pas dû se produire, il eût été utile de les rattacher à l’ancien monde, au moins par le souvenir. Là-bas, on fêtera le renouvellement de l’année, fêtons-le aussi sur la comète. Cette simultanéité de sentiments est chose bonne. Il ne faut pas oublier que l’on doit s’occuper de nous sur la terre. Des divers points du globe, on aperçoit Gallia graviter dans l’espace, sinon à l’œil nu, attendu sa petitesse et sa distance, du moins à l’aide des lunettes et des télescopes. Une sorte de lien scientifique nous rattache au globe terrestre, et Gallia fait toujours partie du monde solaire.
– Je vous approuve, capitaine, répondit le comte Timascheff. Il est absolument certain que les observatoires doivent être très occupés de la nouvelle comète. De Paris, de Pétersbourg, de Greenwich, de Cambridge, du Cap, de Melbourne, j’imagine que de puissantes lunettes sont souvent braquées sur notre astéroïde.
– Il doit être fort à la mode là-bas, reprit le capitaine Servadac, et je serais bien étonné si les revues, les journaux ne tenaient pas le public des deux continents au courant de tous les faits et gestes de Gallia. Songeons donc à ceux qui songent à nous, et, pendant ce 1er janvier terrestre, mettons-nous en communauté de sentiments avec eux.
– Vous pensez, dit alors le lieutenant Procope, que l’on s’occupe sur la terre de la comète qui l’a heurtée ? Je le crois comme vous, mais j’ajoute qu’on y est conduit par d’autres motifs que l’intérêt scientifique ou le sentiment de curiosité. Les observations auxquelles s’est livré notre astronome ont été faites sur la terre, évidemment, et avec une précision non moins grande. Les éphémérides de Gallia sont exactement établies depuis longtemps déjà. On connaît les éléments de la nouvelle comète. On sait quelle trajectoire elle parcourt dans l’espace, on a déterminé où et comment elle doit rencontrer la terre. À quel point précis de l’écliptique, à quelle seconde de temps, en quel endroit même, elle viendra de nouveau choquer le globe terrestre, tout cela est certainement calculé avec une précision mathématique. C’est donc la certitude de cette rencontre qui doit surtout préoccuper les esprits. Je vais plus loin, et j’ose affirmer que, sur terre, des précautions ont été prises pour atténuer les désastreux effets d’un nouveau choc, – si toutefois il était possible d’en prendre ! »
En parlant ainsi, le lieutenant Procope devait être dans la vérité, car il était dans la logique. Le retour de Gallia, parfaitement calculé, était bien pour primer toute autre préoccupation terrestre. On devait penser à Gallia, moins pour désirer que pour redouter son approche. Il est vrai que les Galliens, tout en voulant cette rencontre, ne pouvaient que s’inquiéter des conséquences d’un nouveau choc. Si sur terre, comme le croyait le lieutenant Procope, des mesures avaient été prises pour en atténuer les désastres, ne conviendrait-il pas d’agir ainsi sur Gallia ? c’est ce qu’il faudrait examiner plus tard.
Quoi qu’il en soit, il fut décidé que l’on célébrerait la fête du 1er janvier. Les Russes eux-mêmes devaient s’unir aux Français et aux Espagnols, bien que leur calendrier ne fixât pas à cette date le renouvellement de l’année terrestre.[11]
Noël arriva. L’anniversaire de la naissance du Christ fut religieusement fêté. Seul, Isac, ce jour-là, sembla se cacher plus obstinément encore dans son ténébreux réduit.
Pendant la dernière semaine de l’année, Ben-Zouf fut très affairé. Il s’agissait de combiner un programme attrayant. Les plaisirs ne pouvaient être bien variés sur Gallia. On décida donc que le grand jour commencerait par un déjeuner monstre et finirait par une grande promenade sur la glace, du côté de l’île Gourbi. On reviendrait aux flambeaux, c’est-à-dire, la nuit venue, à la lueur de torches qui seraient fabriquées au moyen d’ingrédients pris dans la cargaison de la Hansa.
« Si le déjeuner est remarquablement bon, se dit Ben-Zouf, la promenade sera remarquablement gaie, et il n’en faut pas davantage ! »
La composition du menu fut donc une grosse affaire. De là, de fréquents conciliabules entre l’ordonnance du capitaine Servadac et le cuisinier de la Dobryna, et, en somme, fusion intelligente des méthodes de la cuisine russe et de la cuisine française.
Le 31 décembre au soir, tout était prêt. Les mets froids, conserves de viandes, pâtés de gibier, galantines et autres, achetés à bon prix à Isac Hakhabut, figuraient déjà sur la grande table de la vaste salle. Les mets chauds devaient, le lendemain matin, se préparer sur les fourneaux à laves.
Ce soir-là, on agita une question relative à Palmyrin Rosette. Inviterait-on le professeur à prendre part au repas solennel ? Oui, sans doute, il convenait de l’inviter. Accepterait-il l’invitation ? C’était plus que douteux.
Néanmoins, l’invitation fut faite. Le capitaine Servadac en personne avait voulu monter à l’observatoire ; mais Palmyrin Rosette recevait si mal les importuns, qu’on préféra lui faire tenir un billet.
Ce fut le jeune Pablo qui se chargea de porter la lettre d’invitation, et il revint bientôt avec une réponse conçue en ces termes :
« Palmyrin Rosette n’a pas autre chose à dire que ceci : Aujourd’hui, c’est le 125 juin, et demain ce sera le 1er juillet, attendu que sur Gallia l’on doit compter suivant le calendrier gallien. »
C’était un refus, scientifiquement donné, mais c’était un refus.
Le 1er janvier, une heure après le lever du soleil, Français, Russes, Espagnols, et la petite Nina, qui représentait l’Italie, étaient attablés devant un déjeuner comme il ne s’en était jamais fait à la surface de Gallia. Pour la partie solide, Ben-Zouf et le cuisinier de la Dobryna s’étaient surpassés. Un certain plat de perdrix aux choux, dans lequel les choux avaient été remplacés par un « carry » capable de dissoudre les papilles de la langue et les muqueuses de l’estomac, fut la pièce triomphante. Quant aux vins, provenant des réserves de la Dobryna, ils étaient excellents. Vins de France, vins d’Espagne furent bus en l’honneur de leur pays d’origine, et la Russie ne se vit point oubliée, grâce à quelques flacons de kummel.
Ce fut, comme l’avait espéré Ben-Zouf, et très bon et très gai.
Au dessert, un toast, porté à la commune patrie, au vieux sphéroïde, au « retour à la terre », réunit de tels hurrahs, que Palmyrin Rosette dut les entendre des hauteurs de son observatoire.
Le déjeuner fini, il restait encore trois grandes heures de jour. Le soleil passait alors au zénith, – un soleil qui n’eût jamais distillé les crus de Bordeaux ou de Bourgogne que l’on venait de boire, car son disque illuminait vaguement l’espace et ne réchauffait pas.
Tous les convives se vêtirent chaudement des pieds à la tête pour une excursion qui devait durer jusqu’à la nuit. Ils allaient braver une rude température, mais impunément dans cet air si calme.
On quitta Nina-Ruche, les uns causant, les autres chantant. Sur la grève glacée, chacun chaussa ses patins et s’en alla à sa guise, ceux-là isolement, ceux-ci par groupes. Le comte Timascheff, le capitaine Servadac, le lieutenant Procope restaient plus volontiers ensemble. Negrete et les Espagnols erraient capricieusement sur l’immense plaine et se lançaient avec une incomparable vitesse jusqu’aux dernières limites de l’horizon. Devenus très forts à cet exercice du patinage, ils y déployaient avec une extrême ardeur la grâce qui leur est naturelle.
Les matelots de la Dobryna, suivant une coutume des pays du Nord, s’étaient tous placés en file. Une longue perche, fixée sous leur bras droit, les maintenait en ligne, et ils filaient ainsi à perte de vue, comme un train auquel les rails ne laissent décrire que des courbes de grand rayon.
Quant à Pablo et Nina, bras dessus bras dessous, jetant de petits cris de joie – deux oiseaux auxquels on donne la volée –, ils patinaient avec une grâce inexprimable, revenaient au groupe du capitaine Servadac, s’enfuyaient de nouveau. Ces jeunes êtres résumaient en eux toute la joie et peut-être toute l’espérance de la terre gallienne.
Il ne faut pas oublier Ben-Zouf, voltigeant de l’un à l’autre avec une intarissable belle humeur, tout au présent et insoucieux de l’avenir.
La troupe patineuse, emportée par son élan sur cette surface unie, alla vite et loin, – plus loin que la ligne circulaire sur laquelle se fermait l’horizon de la Terre-Chaude. Derrière elle disparurent les premières assises de roches, puis la crête blanche des falaises, puis la cime du volcan, empanaché de vapeurs fuligineuses. Quelquefois, on s’arrêtait pour reprendre haleine, – un instant seulement, car il fallait craindre de se refroidir. Puis, on repartait, en gagnant du côté de l’île Gourbi, mais sans prétendre à l’atteindre, car, la nuit venue, on devrait songer au retour.
Le soleil s’abaissait déjà vers l’est, ou plutôt – effet auquel les Galliens s’étaient déjà accoutumés – il semblait tomber rapidement. Ces couchers de l’astre radieux se faisaient dans des conditions particulières sur cet horizon rétréci. Nulle vapeur ne se colorait de ces admirables nuances que donnent les derniers rayons. L’œil même, à travers cette mer congelée, ne pouvait percevoir ce dernier jet de lumière verte qui s’élance à travers la surface liquide. Ici, le soleil, s’élargissant sous la réfraction, présentait un disque nettement arrêté à sa circonférence. Il disparaissait brusquement comme si quelque trappe se fût subitement ouverte dans le champ de glace, et la nuit se faisait aussitôt.
Avant la chute du jour, le capitaine Servadac rassembla tout son monde et recommanda à ses compagnons de se grouper autour de lui. On était allé « en tirailleurs », il fallait revenir en peloton serré, ne point s’égarer dans les ténèbres et rentrer ensemble à la Terre-Chaude. L’obscurité devait être profonde, car la lune, en conjonction avec le soleil, était perdue dans sa vague irradiation.
La nuit était venue. Les étoiles ne versaient plus au sol gallien que cette « pâle clarté » dont parle Corneille. Les torches furent alors allumées, et, pendant que les porteurs glissaient rapidement, leurs flammes, comme un fanion déployé à la brise, se rabattaient longuement en arrière, en s’avivant par la vitesse.
Une heure après, le haut littoral de la Terre-Chaude apparaissait confusément comme un énorme nuage noir à l’horizon. Il n’y avait pas à s’y tromper. Le volcan le dominait de haut et projetait dans l’ombre une lueur intense. La réverbération des laves incandescentes, se faisant sur le miroir de glaces, frappait le groupe des patineurs et laissait s’allonger derrière lui des ombres démesurées.
Ce fut ainsi pendant une demi-heure environ. On s’approchait rapidement du littoral, quand soudain un cri se fit entendre.
C’était Ben-Zouf qui avait poussé ce cri. Chacun enraya sa course, en mordant la glace de son patin d’acier.
Alors, à la lueur des torches qui étaient près de s’éteindre, on vit que Ben-Zouf tendait son bras vers le littoral.
Un cri, parti de toutes les bouches, répondit alors à celui que Ben-Zouf avait jeté !…
Le volcan venait de s’éteindre subitement. Les laves qui jusqu’alors débordaient du cône supérieur avaient cessé de se répandre. Il semblait qu’un souffle puissant eût passé sur le cratère.
Tous comprirent que la source de feu venait de se tarir. La matière éruptive avait-elle donc fait défaut ? La chaleur allait-elle à jamais manquer à la Terre-Chaude, et n’y aurait-il plus aucune possibilité de combattre les rigueurs de l’hiver gallien ? Était-ce donc la mort, et la mort par le froid ?
« En avant ! » cria le capitaine Servadac d’une voix forte.
Les torches venaient de s’éteindre. Tous s’élancèrent dans la profonde obscurité. Ils arrivèrent rapidement au littoral. Ils n’en gravirent pas sans peine les roches glacées. Ils se précipitèrent dans la galerie ouverte, puis dans la grande salle…
Ténèbres épaisses, température déjà basse. La nappe de feu ne fermait plus la grande baie, et, en se penchant au-dehors, le lieutenant Procope put voir que le lagon, maintenu liquide jusqu’alors sous la cataracte des laves, était solidifié par le froid.
Ainsi finit sur Gallia ce premier jour de l’année terrestre, si joyeusement commencé !
Chapitre XIII
Dans lequel le capitaine Servadac et ses compagnons font la seule chose qu’il y eut à faire
Les Galliens passèrent le reste de la nuit, c’est-à-dire les quelques heures qui précédaient le jour, dans d’inexprimables appréhensions. Palmyrin Rosette, chassé par le froid, avait dû quitter son observatoire et se réfugier dans les galeries de Nina-Ruche. C’était peut-être l’occasion ou jamais de lui demander s’il persévérait encore dans cette idée de courir le monde solaire sur son inhabitable comète ; mais il eût répondu affirmativement sans doute. S’il rageait et à quel point, cela ne saurait se dire.
En même temps que lui, Hector Servadac et ses compagnons avaient dû chercher asile dans les plus profondes galeries du massif. La grande salle, si largement ouverte à l’air extérieur, n’était plus tenable. L’humidité de ses parois se changeait déjà en cristaux, et, quand bien même on fût parvenu à boucher la vaste ouverture que fermait autrefois le rideau de laves, la température y eût été insoutenable.
Au fond des obscures galeries, une demi-chaleur se propageait encore. L’équilibre ne s’était pas établi entre le dedans et le dehors, mais cela ne pouvait tarder à se faire. On sentait que le calorique se retirait peu à peu. Le mont était comme un cadavre dont les extrémités se refroidissent pendant que le cœur résiste au froid de la mort.
« Eh bien, s’écria le capitaine Servadac, c’est au cœur même que nous irons demeurer ! »
Le lendemain il réunit ses compagnons et leur parla en ces termes :
« Mes amis, qu’est-ce qui nous menace ? Le froid, mais le froid seulement. Nous avons des vivres qui dureront plus que notre passage sur Gallia, et nos conserves sont assez abondantes pour que nous puissions nous passer de combustible. Or, que nous faut-il pour traverser ces quelques mois d’hiver ? Un peu de cette chaleur que la nature nous fournissait gratis ! Eh bien, cette chaleur, il est plus que probable qu’elle existe dans les entrailles de Gallia et c’est là que nous irons la chercher ! »
Ces confiantes paroles ranimèrent ces braves gens, dont quelques-uns faiblissaient déjà. Le comte Timascheff, le lieutenant Procope, Ben-Zouf serrèrent la main que leur tendait le capitaine, et ceux-là n’étaient pas près de se laisser abattre.
« Mordioux, Nina, dit Hector Servadac en regardant la petite fille, tu n’auras pas peur de descendre dans le volcan ?
– Non, mon capitaine, répondit résolument Nina, surtout si Pablo nous accompagne !
– Pablo nous accompagnera ! C’est un brave ! Il n’a peur de rien ! – N’est-ce pas, Pablo ?
– Je vous suivrai partout où vous irez, monsieur le gouverneur », répondit le jeune garçon.
Cela dit, il ne s’agissait plus que de se mettre à la besogne.
Il ne fallait pas songer à pénétrer dans le volcan en suivant le cratère supérieur. Par un tel abaissement de température, les pentes de la montagne n’eussent pas été praticables. Le pied n’aurait trouvé aucun point d’appui sur les déclivités glissantes. Donc, nécessité d’atteindre la cheminée centrale à travers le massif même, mais promptement, car un terrible froid commençait à envahir les coins les plus reculés de Nina-Ruche.
Le lieutenant Procope, après avoir bien examiné la disposition des galeries intérieures, leur orientation au sein même du massif, reconnut que l’un des étroits couloirs devait aboutir près de la cheminée centrale. Là, en effet, lorsque les laves s’élevaient sous la poussée des vapeurs, on sentait le calorique « suinter » pour ainsi dire à travers ses parois. Évidemment, la substance minérale, ce tellurure dont le mont se composait, était bon conducteur de la chaleur. Donc, en perçant cette galerie sur une longueur qui ne devait pas excéder sept à huit mètres, on rencontrerait l’ancien chemin des laves, et peut-être serait-il facile de le descendre.
On se mit immédiatement à la besogne. En cette occasion, les matelots russes, sous la direction de leur lieutenant, montrèrent beaucoup d’adresse. Le pic, la pioche ne suffirent pas à entamer cette dure substance. Il fallut forer des trous de mine, et, au moyen de la poudre, faire sauter la roche. Le travail n’en marcha que plus rapidement, et, en deux jours, il fut mené à bonne fin.
Pendant ce court laps de temps, les colons eurent à souffrir cruellement du froid.
« Si tout accès nous est interdit dans les profondeurs du massif, avait dit le comte Timascheff, aucun de nous ne pourra résister, et ce sera probablement la fin de la colonie gallienne !
– Comte Timascheff, répondit le capitaine Servadac, vous avez confiance en Celui qui peut tout ?
– Oui, capitaine, mais il peut vouloir aujourd’hui ce qu’il ne voulait pas hier. Il ne nous appartient pas de juger ses décrets. Sa main s’était ouverte… Elle semble se refermer…
– À demi seulement, répondit le capitaine Servadac. Ce n’est qu’une épreuve à laquelle il soumet notre courage ! Quelque chose me dit qu’il n’est pas vraisemblable que l’éruption du volcan ait cessé par suite d’une extinction complète des feux intérieurs de Gallia. Très probablement, cet arrêt dans l’épanchement extérieur ne sera que momentané. »
Le lieutenant Procope appuya l’opinion du capitaine Servadac. Une autre bouche éruptive s’était peut-être ouverte sur quelque autre point de la comète, et il était possible que les matières laviques eussent suivi cette voie nouvelle. Bien des causes pouvaient avoir modifié les circonstances auxquelles était due cette éruption, sans que les substances minérales eussent cessé de se combiner chimiquement avec l’oxygène dans les entrailles de Gallia. Mais de savoir si l’on pourrait atteindre ce milieu où la température permettrait de braver les froids de l’espace, c’est ce qui était impossible.
Pendant ces deux jours, Palmyrin Rosette ne prit aucunement part ni aux discussions ni aux travaux. Il allait et venait comme une âme en peine, une âme peu résignée. Lui-même, et quoi qu’on eût pu dire, il avait installé sa lunette dans la grande salle. Là, plusieurs fois, la nuit, le jour, il demeurait à observer le ciel jusqu’à ce qu’il fût littéralement gelé. Il rentrait alors, maugréant, maudissant la Terre-Chaude, répétant que son rocher de Formentera lui eût offert plus de ressources !
Le dernier coup de pic fut donné dans la journée du 4 janvier. On put entendre les pierres rouler à l’intérieur de la cheminée centrale. Le lieutenant Procope observa qu’elles ne tombaient pas perpendiculairement, mais qu’elles semblaient plutôt glisser sur les parois, en se heurtant à des saillies rocheuses. La cheminée centrale devait donc être inclinée, et, conséquemment, plus praticable à la descente.
Cette observation était juste.
Dès que l’orifice eut été assez agrandi pour donner passage à un homme, le lieutenant Procope et le capitaine Servadac, précédés de Ben-Zouf, qui portait une torche, s’engagèrent dans la cheminée centrale. Cette cheminée suivait une direction oblique, avec une pente de quarante-cinq degrés au plus. On pouvait donc descendre sans risquer une chute. D’ailleurs, les parois étaient striées par des érosions multiples, des excavations, des rebords de roches, et, sous la cendre qui les tapissait, le pied sentait un solide point d’appui. C’est que l’éruption était récente. En effet, elle n’avait pu se produire que lorsque la collision avait donné à Gallia une partie de l’atmosphère terrestre, et les parois n’étaient pas usées par les laves.
« Bon ! fit Ben-Zouf, un escalier maintenant ! Excusez du peu ! »
Le capitaine Servadac et ses compagnons commencèrent à descendre prudemment. Bien des marches, pour parler comme Ben-Zouf, manquaient à l’escalier. Ils employèrent près d’une demi-heure à atteindre une profondeur de cinq cents pieds, suivant une direction sud. Dans les parois de la cheminée centrale s’évidaient ça et là de larges excavations, dont aucune ne formait galerie. Ben-Zouf, secouant sa torche, les emplissait d’une vive clarté. Le fond de ces trous apparaissait, mais aucune ramification ne se faisait à l’intérieur, ainsi que cela existait à l’étage supérieur de Nina-Ruche.
Toutefois, les Galliens n’avaient pas le choix. Ils devaient accepter les moyens de salut, quels qu’ils fussent.
Or, les espérances du capitaine Servadac semblaient devoir se réaliser. À mesure qu’il pénétrait plus avant dans les substructions du massif, la température s’accroissait progressivement. Ce n’était pas une simple élévation de degrés, telle qu’elle se fait dans les mines terrestres. Une cause locale rendait cette élévation plus rapide. La source de chaleur se sentait dans les profondeurs du sol. Ce n’était pas une houillère, c’était bien un véritable volcan, qui était l’objet de cette exploration. Au fond de ce volcan, non éteint, comme on avait pu le craindre, les laves bouillonnaient encore. Si, pour une cause inconnue, elles ne montraient plus jusqu’à son cratère pour s’épancher au-dehors, du moins transmettaient-elles leur chaleur dans tout le soubassement du massif. Un thermomètre à mercure emporté par le lieutenant Procope, un baromètre anéroïde aux mains du capitaine Servadac, indiquaient, à la fois, et l’abaissement des couches galliennes au-dessous du niveau de la mer, et l’accroissement progressif de la température. À six cents pieds au-dessous du sol, la colonne mercurielle marquait six degrés au-dessus de zéro.
« Six degrés, dit le capitaine Servadac, ce n’est pas suffisant pour des gens que l’hiver doit séquestrer pendant plusieurs mois. Allons plus profondément encore, puisque l’aération se fait convenablement. »
En effet, par le vaste cratère de la montagne, par la grande baie ouverte à son flanc, l’air extérieur pénétrait à flots. Il était comme attiré dans ces profondeurs, et il se trouvait même en de meilleures conditions pour l’acte respiratoire. On pouvait donc impunément descendre jusqu’au point où se rencontrerait une température convenable.
Quatre cents pieds environ furent encore gagnés au-dessous du niveau de Nina-Ruche. Cela donnait une profondeur de deux cent cinquante mètres par rapport à la surface de la mer Gallienne. En cet endroit, le thermomètre marqua douze degrés centigrades au-dessus de zéro. Cette température était suffisante, pourvu que rien ne vînt la modifier.
Évidemment, les trois explorateurs auraient pu s’enfoncer davantage par cette oblique voie des laves. Mais à quoi bon ? Déjà, en prêtant l’oreille, ils entendaient certains ronflements sourds, – preuve qu’ils n’étaient pas éloignés du foyer central.
« Restons là, dit Ben-Zouf. Les frileux de la colonie iront plus bas, si cela leur convient ! Mais, nom d’un Kabyle ! pour ma part, je trouve qu’il fait déjà assez chaud. »
La question était maintenant de savoir si l’on pouvait s’installer tant bien que mal dans cette portion du massif ?
Hector Servadac et ses compagnons s’étaient assis sur une roche disposée en saillie, et de là, à la lueur de la torche qui fut ravivée, ils examinèrent l’endroit où ils venaient de s’arrêter.
La vérité oblige à dire que rien n’était moins confortable. La cheminée centrale, en s’élargissant, ne formait là qu’une sorte d’excavation assez profonde. Ce trou, il est vrai, pouvait contenir toute la colonie gallienne. Quant à l’aménager d’une façon à peu près convenable, c’était assez difficile. Au-dessus, au-dessous, il existait des anfractuosités de moindre importance qui suffiraient à l’emmagasinage des provisions, mais de chambres distinctes pour le capitaine Servadac et le comte Timascheff, il n’y fallait point compter. Un petit réduit, destiné à Nina, on le trouverait encore. Ce serait donc la vie commune de tous les instants. L’excavation principale servirait à la fois de salle à manger, de salon, de dortoir. Après avoir vécu à peu près comme des lapins dans leur terrier, les colons allaient s’enfouir sous terre, comme des taupes, et vivre comme elles, – moins leur long sommeil hivernal.
Cependant, il serait facile d’éclairer cette obscure excavation au moyen de lampes et de fanaux. L’huile ne manquait pas, car le magasin général en possédait encore plusieurs barils, ainsi qu’une certaine quantité d’esprit-de-vin, qui devait servir à la cuisson de quelques aliments.
Quant à la séquestration toute la durée de l’hiver gallien, elle ne serait évidemment pas absolue. Les colons, vêtus aussi chaudement que possible, pourraient faire de fréquentes apparitions, soit à Nina-Ruche, soit sur les roches du littoral. Il serait indispensable, d’ailleurs, de s’approvisionner de glaces qui par la fusion donneraient l’eau nécessaire à tous les besoins de la vie. Chacun, à tour de rôle, serait chargé de ce service assez pénible, puisqu’il s’agirait de remonter à une hauteur de neuf cents pieds et de redescendre d’autant avec un lourd fardeau.
Enfin, après minutieuse inspection, il fut décidé que la petite colonie se transporterait dans cette sombre cave, et qu’elle s’y installerait le moins mal possible. L’unique excavation servirait de demeure à tous. Mais, en somme, le capitaine Servadac et ses compagnons ne seraient pas plus mal partagés que les hiverneurs des régions arctiques. Là, en effet, soit à bord des baleiniers, soit dans les factoreries du Nord-Amérique, on ne multiplie ni les chambres, ni les cabines. On dispose simplement une vaste salle dans laquelle l’humidité pénètre moins facilement. On fait la chasse aux coins, qui sont autant de nids à condensation des vapeurs. Enfin, une chambre large, haute, est plus facile à aérer, à chauffer aussi, conséquemment plus saine. Dans les forts, c’est tout un étage qui est aménagé de la sorte ; dans les navires, c’est tout l’entrepont.
Voilà ce que le lieutenant Procope, familier avec les usages des mers polaires, expliqua en quelques mots, et ses compagnons se résignèrent à agir en hiverneurs, puisqu’ils étaient forcés d’hiverner.
Tous trois remontèrent à Nina-Ruche. Les colons furent instruits des résolutions prises, et ils les approuvèrent. On se mit aussitôt à la besogne, en commençant par débarrasser l’excavation des cendres encore chaudes qui en tapissaient les parois, et le déménagement du matériel de Nina-Ruche fut entrepris sans retard.
Il n’y avait pas une heure à perdre. On gelait littéralement, même dans les plus profondes galeries de l’ancienne demeure. Le zèle des travailleurs fut donc tout naturellement stimulé, et jamais déménagement, comprenant quelques meubles indispensables, couchettes, ustensiles divers, réserves provenant de la goélette, marchandises de la tartane, ne fut plus lestement opéré. Il faut remarquer, d’ailleurs, qu’il ne s’agissait que de descendre, et que, d’autre part, la moindre pesanteur des divers colis les rendait plus aisément transportables.
Palmyrin Rosette, quoi qu’il en eût, dut se réfugier aussi dans les profondeurs de Gallia, mais il ne permit pas qu’on y descendit sa lunette. Il est vrai qu’elle n’était pas faite pour ce sombre abîme, et elle resta sur son trépied dans la grande salle de Nina-Ruche.
Inutile de rapporter les interminables condoléances d’Isac Hakhabut. Toute sa phraséologie accoutumée y passa. Il n’y avait pas, dans tout l’univers, un négociant plus éprouvé que lui. Au milieu de quolibets, qui ne lui étaient jamais épargnés, il veilla soigneusement au déplacement de ses marchandises. Sur les ordres du capitaine Servadac, tout ce qui lui appartenait fut emmagasiné à part et dans le trou même qu’il allait habiter. De cette façon, il pourrait surveiller son bien et continuer son commerce.
En quelques jours, la nouvelle installation fut terminée. Quelques fanaux éclairaient de loin en loin l’oblique cheminée qui remontait vers Nina-Ruche. Cela ne manquait pas de pittoresque, et, dans un conte des Mille et une Nuits, c’eût été charmant. La grande excavation qui servait au logement de tous était éclairée par les lampes de la Dobryna . Le 10 janvier, chacun était casé dans ce sous-sol, et bien abrité, tout au moins, contre la température extérieure, qui dépassait soixante degrés au-dessous de zéro.
« Va bene ! comme dit notre petite Nina ! s’écria alors Ben-Zouf, toujours satisfait. Au lieu de demeurer au premier étage, nous demeurons dans la cave, voilà tout ! »
Et cependant, bien que ne laissant rien paraître de leurs préoccupations, le comte Timascheff, le capitaine Servadac, Procope n’étaient pas sans inquiétude pour l’avenir. Si la chaleur volcanique venait à manquer un jour, si quelque perturbation inattendue retardait Gallia dans sa révolution solaire, s’il fallait recommencer de nouveaux hivernages dans de telles conditions, trouverait-on dans le noyau de la comète le combustible qui avait manqué jusqu’alors ? La houille, résidu d’antiques forêts, enfouies aux époques géologiques et minéralisées sous l’action du temps, ne pouvait exister dans les entrailles de Gallia ! En serait-on donc réduit à utiliser ces matières éruptives que devaient receler les profondeurs du volcan, alors qu’il serait complètement éteint ?
« Mes amis, dit le capitaine Servadac, voyons venir, voyons venir ! Nous avons de longs mois devant nous pour réfléchir, causer, discuter ! Mordioux ! ce serait bien le diable s’il ne nous arrivait pas une idée !
– Oui, répondit le comte Timascheff, le cerveau se surexcite en présence des difficultés, et nous trouverons. D’ailleurs, il n’est pas probable que cette chaleur interne nous fasse défaut avant le retour de l’été gallien.
– Je ne le pense pas, répondit le lieutenant Procope. On entend toujours le bruit des bouillonnements intérieurs. Cette inflammation des substances volcaniques est probablement récente. Lorsque la comète circulait dans l’espace, avant sa rencontre avec la terre, elle ne possédait aucune atmosphère, et, par conséquent, l’oxygène ne s’est probablement introduit dans ses profondeurs que depuis cette collision. De là, une combinaison chimique dont le résultat a été l’éruption. Voilà ce que l’on peut penser, suivant moi, en tenant pour assuré que le travail plutonien n’est qu’à son début dans le noyau de Gallia.
– Je suis si bien de ton avis, Procope, répondit le comte Timascheff, que, loin de craindre une extinction de la chaleur centrale, je redouterais plutôt une autre éventualité, non moins terrible pour nous.
– Et laquelle ? demanda le capitaine Servadac.
– Ce serait, capitaine, que l’éruption ne se refît soudain et ne nous surprit, campés sur le chemin des laves !
– Mordioux ! s’écria le capitaine Servadac, cela pourrait bien arriver !
– Nous veillerons, répondit le lieutenant Procope, et avec tant de vigilance, que nous ne nous laisserons pas surprendre. »
Cinq jours plus tard, le 15 janvier, Gallia passait à son aphélie, à l’extrémité du grand axe de son orbite, et elle gravitait alors à deux cent vingt millions de lieues du soleil.
Chapitre XIV
Qui prouve que les humains ne sont pas faits pour graviter à deux cent vingt millions de lieues du soleil
Gallia allait donc, à partir de ce jour, remonter peu à peu sur sa courbe elliptique et avec une vitesse croissante. Tout être vivant à sa surface était désormais enfoui dans le massif volcanique, à l’exception des treize Anglais de Gibraltar.
Comment ceux-ci, volontairement demeurés sur leur îlot, avaient-ils supporté cette première moitié de l’hiver gallien ? Mieux, sans doute – c’était l’opinion générale –, que les habitants de la Terre-Chaude. En effet, ils n’avaient pas été forcés d’emprunter à un volcan la chaleur de ses laves pour l’approprier aux besoins de la vie. Leur réserve de charbons et de vivres était très abondante. Ni la nourriture ni le combustible n’avaient dû leur manquer. Le poste qu’ils occupaient, solidement casematé, avec ses épais murs de pierre, les avait évidemment protégés contre les plus forts abaissements de la température. Bien chauffés, ils n’avaient pas eu froid ; bien nourris, ils n’avaient pas eu faim, et leurs vêtements ne pouvaient qu’être devenus trop étroits. Le brigadier Murphy et le major Oliphant avaient dû se porter les coups les plus savants sur le champ clos de l’échiquier. Il n’était donc douteux pour personne que les choses ne se fussent passées à Gibraltar convenablement et confortablement. En tout cas, l’Angleterre n’aurait que des éloges pour ces deux officiers et ces onze soldats, restés fidèlement à leur poste.
Le capitaine Servadac et ses compagnons, s’ils eussent été menacés de périr par le froid, eussent pu certainement se réfugier à l’îlot de Gibraltar. La pensée de le faire leur en était venue. Ils auraient, sans aucun doute, été reçus hospitalièrement sur cet îlot, bien que le premier accueil eût laissé à désirer. Les Anglais n’étaient pas hommes à abandonner leurs semblables sans leur prêter assistance. Aussi, en cas de nécessité absolue, les colons de la Terre-Chaude n’auraient-ils pas hésité à émigrer vers Gibraltar. Mais c’eût été un long voyage sur l’immense champ de glace, sans abri, sans feu, et, de ceux qui l’auraient entrepris, tous ne seraient peut-être pas arrivés au but ! Aussi, ce projet ne pouvait-il être mis à exécution que dans un cas désespéré, et, tant que le volcan produirait une chaleur suffisante, il était bien entendu que l’on n’abandonnerait pas la Terre-Chaude.
Il a été dit plus haut que tout être vivant de la colonie gallienne avait trouvé refuge dans les excavations de la cheminée centrale. En effet, un certain nombre d’animaux avaient dû quitter les galeries de Nina-Ruche, où ils fussent morts de froid. Ce n’était pas sans peine que les deux chevaux du capitaine Servadac et de Ben-Zouf avaient été descendus à cette profondeur ; mais le capitaine et son ordonnance tenaient particulièrement à conserver Zéphir et Galette, à les ramener vivants sur terre. Ils aimaient ces deux pauvres bêtes, peu faites pour vivre dans ces nouvelles conditions climatériques. Une large anfractuosité, convertie en écurie, fut aménagée pour eux, et, très heureusement, il y avait assez de fourrage pour les nourrir.
Quant aux autres animaux domestiques, il fallut les sacrifier en partie. Les loger dans les substructions du massif, c’était une tâche impossible. Les abandonner dans les galeries supérieures, c’était les condamner à une mort cruelle. On dut les abattre. Mais comme la chair de ces animaux pouvait se conserver indéfiniment dans l’ancien magasin, qui était soumis à un froid excessif, ce fut un précieux accroissement de la réserve alimentaire.
Pour achever la nomenclature des êtres vivants qui cherchèrent refuge à l’intérieur du massif, il faut encore citer les oiseaux, dont la nourriture se composait uniquement des bribes qu’on leur abandonnait chaque jour. Le froid leur fit quitter les hauteurs de Nina-Ruche pour les sombres cavités du mont. Mais leur nombre était encore si considérable, leur présence si importune, qu’il fallut leur donner activement la chasse et les détruire en grande partie.
Tout ceci occupa la fin du mois de janvier, et l’installation ne fut complète qu’à cette époque. Mais alors une existence d’une désespérante monotonie commença pour les membres de la colonie gallienne. Pourraient-ils résister à cette espèce d’engourdissement moral, qui résulterait de leur engourdissement physique ? Leurs chefs tentèrent d’obtenir ce résultat par une plus étroite communauté de la vie quotidienne, par des conversations auxquelles tous étaient invités à prendre part, par des lectures, puisées aux livres de voyages et de sciences de la bibliothèque et faites à voix haute. Tous, assis autour de la grande table, Russes ou Espagnols, écoutaient et s’instruisaient, et, s’ils devaient revenir à la terre, ils y rentreraient moins ignorants qu’ils ne l’eussent été en demeurant dans leurs pays d’origine.
Pendant ce temps, que faisait Isac Hakhabut ? S’intéressait-il à ces conversations, à ces lectures ? En aucune manière. Quel profit en eût-il retiré ? Il passait les longues heures à faire et refaire ses calculs, à compter et recompter l’argent qui affluait entre ses mains. Ce qu’il avait gagné, joint à ce qu’il possédait déjà, s’élevait à la somme de cent cinquante mille francs au moins, dont une moitié en bon or d’Europe. Ce métal, sonnant et trébuchant, il saurait bien lui faire retrouver sa valeur sur terre, et, s’il supputait le nombre des jours écoulés, c’était au point de vue des intérêts perdus. Il n’avait pas encore trouvé l’occasion de prêter, comme il l’espérait, sur bons billets et avec bonne garantie, s’entend.
De tous les colons, ce fut encore Palmyrin Rosette qui se créa le plus vite une absorbante occupation. Avec ses chiffres, il n’était jamais seul, et ce fut au calcul qu’il demanda de lui abréger les longs jours de l’hiver.
De Gallia, il connaissait tout ce qu’on en pouvait connaître, mais il n’en était pas ainsi de Nérina, son satellite. Or, les droits de propriété qu’il réclamait sur la comète devaient bien s’étendre jusqu’à sa lune. C’était donc le moins qu’il en déterminât les nouveaux éléments, depuis qu’elle avait été arrachée à la zone des planètes télescopiques.
Il résolut d’entreprendre ce calcul. Quelques relèvements des positions de Nérina en différents points de son orbite lui étaient encore nécessaires. Cela fait, puisqu’il connaissait la masse de Gallia, obtenue par mesure directe, c’est-à-dire au moyen du peson, il serait à même de peser Nérina du fond de son réduit obscur.
Seulement, il n’avait pas ce réduit obscur, auquel il prétendait bien donner le nom de « cabinet », puisque, en bonne vérité, il ne pouvait l’appeler un observatoire. Aussi, dès les premiers jours de février, en parla-t-il au capitaine Servadac.
« Il vous faut un cabinet, cher professeur ? répondit celui-ci.
– Oui, capitaine, mais il me faut un cabinet où je puisse travailler sans craindre les importuns.
– Nous allons vous trouver cela, répondit Hector Servadac. Seulement, si ce cabinet n’est pas aussi confortable que je le voudrais, il sera certainement isolé et tranquille.
– Je n’en demande pas davantage.
– C’est entendu. »
Puis, le capitaine, voyant Palmyrin Rosette d’humeur assez passable, se hasarda à lui faire une question relative à ses calculs antérieurs, – question à laquelle il attachait justement une réelle importance.
« Cher professeur, dit-il au moment où Palmyrin Rosette se retirait, j’aurais quelque chose à vous demander.
– Demandez.
– Les calculs, desquels vous avez conclu la durée de la révolution de Gallia autour du soleil, sont évidemment exacts, reprit le capitaine Servadac. Mais enfin, si je ne me trompe, une demi-minute de retard ou d’avance, et votre comète ne rencontrerait plus la terre sur l’écliptique !…
– Eh bien ?
– Eh bien, cher professeur, ne serait-il pas à propos de vérifier l’exactitude de ces calculs…
– C’est inutile.
– Le lieutenant Procope serait tout disposé à vous aider dans cet important travail.
– Je n’ai besoin de personne, répondit Palmyrin Rosette, touché dans sa corde sensible.
– Cependant…
– Je ne me trompe jamais, capitaine Servadac, et votre insistance est déplacée.
– Mordioux ! cher professeur, riposta Hector Servadac, vous n’êtes pas aimable pour vos compagnons, et… »
Mais il garda ce qu’il avait sur le cœur, Palmyrin Rosette étant encore un homme à ménager.
« Capitaine Servadac, répondit sèchement le professeur, je ne recommencerai pas mes calculs, parce que mes calculs sont absolument justes. Mais je veux bien vous apprendre que ce que j’ai fait pour Gallia, je vais le faire pour Nérina, son satellite.
– Voilà une question tout à fait opportune, répliqua gravement le capitaine Servadac. Cependant, je croyais que, Nérina étant une planète télescopique, ses éléments étaient connus des astronomes terrestres. »
Le professeur regarda le capitaine Servadac d’un œil farouche, comme si l’utilité de son travail eût été contestée. Puis, s’animant :
« Capitaine Servadac, dit-il, si les astronomes terrestres ont observé Nérina, s’ils connaissent déjà son moyen mouvement diurne, la durée de sa révolution sidérale, sa distance moyenne au soleil, son excentricité, la longitude de son périhélie, la longitude moyenne de l’époque, la longitude du nœud ascendant, l’inclinaison de son orbite, tout cela est à recommencer, attendu que Nérina n’est plus une planète de la zone télescopique, mais un satellite de Gallia. Or, étant lune, je veux l’étudier comme lune, et je ne vois pas pourquoi les Galliens ne sauraient pas de la lune gallienne ce que les « terrestriens » savent de la lune terrestre ! »
Il fallait entendre Palmyrin Rosette prononcer ce mot « terrestriens » ! De quel ton méprisant il parlait maintenant des choses de la terre !
« Capitaine Servadac, dit-il, je finis cette conversation comme je l’ai commencée, en vous priant de me faire disposer un cabinet…
– Nous allons nous en occuper, cher professeur…
– Oh ! je ne suis pas pressé, répondit Palmyrin Rosette, et pourvu que cela soit prêt dans une heure… »
Il en fallut trois, mais enfin Palmyrin Rosette put être installé dans une sorte de trou, où sa table, son fauteuil trouvèrent à se placer. Puis, pendant les jours suivants et malgré l’extrême froid, il monta dans l’ancienne salle pour relever plusieurs positions de Nérina. Cela fait, il se confina dans son cabinet, et on ne le revit plus.
En vérité, à ces Galliens, enfouis à huit cents pieds au-dessous du sol, il fallait une grande énergie morale pour réagir contre cette situation, qui ne fut marquée par aucun incident. Bien des jours s’écoulaient sans qu’aucun d’eux remontât à la surface du sol, et, n’eût été la nécessité de se procurer de l’eau douce en rapportant des charges de glace, ils auraient fini par ne plus quitter les profondeurs du volcan.
Cependant, quelques visites furent faites jusque dans les parties basses de la cheminée centrale. Le capitaine Servadac, le comte Timascheff, Procope, Ben-Zouf voulurent sonder aussi loin que possible cet abîme creusé dans le noyau de Gallia. Cette exploration d’un massif, composé de trente centièmes d’or, les laissait indifférents, il faut en convenir. D’ailleurs, cette substance, sans valeur sur Gallia, n’en aurait même plus si elle tombait sur la terre, et ils ne faisaient pas plus de cas de ce tellurure que d’une roche de granit.
Mais ce que leur fit connaître cette exploration, c’est que le feu central conservait son activité, et ils en conclurent que si l’éruption ne se faisait plus par le volcan, c’est que d’autres bouches ignivomes s’étaient ouvertes à la surface de Gallia.
Ainsi se passèrent février, mars, avril, mai, on peut dire dans une sorte d’engourdissement moral dont ces séquestrés ne pouvaient se rendre compte. La plupart végétaient sous l’empire d’une torpeur qui devenait inquiétante. Les lectures, écoutées d’abord avec intérêt, ne réunissaient plus d’auditeurs autour de la grande table. Les conversations se limitaient à deux, à trois personnes et se faisaient à voix basse. Les Espagnols étaient surtout accablés et ne quittaient guère leur couchette. À peine se dérangeaient-ils pour prendre quelque nourriture. Les Russes résistaient mieux et accomplissaient leur tâche avec plus d’ardeur. Le défaut d’exercice était donc le grave danger de cette longue séquestration. Le capitaine Servadac, le comte Timascheff, Procope voyaient bien les progrès de cet engourdissement, mais que pouvaient-ils faire ? Les exhortations étaient insuffisantes. Eux-mêmes, ils se sentaient envahir par cet accablement particulier et n’y résistaient pas toujours. Tantôt c’était une prolongation inusitée de sommeil, tantôt une invincible répugnance pour la nourriture, quelle qu’elle fût. On eût vraiment dit que ces prisonniers, enfouis dans le sol comme les tortues pendant l’hiver, allaient dormir et jeûner comme elles jusqu’au retour de la saison chaude !
De toute la colonie gallicane, ce fut la petite Nina qui sut le mieux résister. Elle allait, venait, prodiguait ses encouragements à Pablo, que la torpeur générale gagnait aussi. Elle parlait à l’un, à l’autre, et sa voix fraîche charmait ces lugubres profondeurs comme un chant d’oiseau. Elle obligeait celui-ci à manger, celui-là à boire. Elle était l’âme de ce petit monde, elle l’animait par son va-et-vient. Elle chantait de joyeuses chansons d’Italie, lorsque, dans ce milieu lugubre, il se faisait quelque accablant silence. Elle bourdonnait comme une jolie mouche, mais plus utile, plus bienfaisante que la mouche du fabuliste. Il y avait tant de vie surabondante dans ce petit être, qu’elle se communiquait pour ainsi dire à tous. Peut-être ce phénomène de réaction s’accomplit-il presque à l’insu de ceux qui en subissaient l’influence, mais il n’en fut pas moins réel, et la présence de Nina fut incontestablement salutaire aux Galliens, demi endormis dans cette tombe.
Cependant, des mois s’écoulèrent. Comment ? le capitaine Servadac et ses compagnons n’auraient pu le dire.
Vers ce commencement de juin, la torpeur générale parut se détendre peu à peu. Était-ce l’influence de l’astre radieux, dont la comète se rapprochait ? Peut-être, mais le soleil était encore bien loin ! Le lieutenant Procope, pendant la première moitié de la révolution gallienne, avait minutieusement noté les positions et les chiffres donnés par le professeur. Il avait pu graphiquement obtenir des éphémérides, et, sur une orbite dessinée par lui, suivre avec plus ou moins de précision la marche de la comète.
Le point aphélie, une fois dépassé, il lui fut facile de marquer les positions successives du retour de Gallia. Il put donc renseigner ses compagnons sans être obligé de consulter Palmyrin Rosette.
Or, il vit que, vers le commencement de juin, Gallia, après avoir recoupé l’orbite de Jupiter, se trouvait encore à une distance énorme du soleil, soit cent quatre-vingt-dix-sept millions de lieues. Mais sa vitesse allait s’accroître progressivement, en vertu de l’une des lois de Kepler, et, quatre mois plus tard, elle rentrerait dans la zone des planètes télescopiques, à cent vingt-cinq millions de lieues seulement.
Vers cette époque – seconde quinzaine de juin –, le capitaine Servadac et ses compagnons avaient entièrement recouvré leurs facultés physiques et morales. Ben-Zouf était comme un homme qui a trop dormi, et il se détirait de la belle façon.
Les visites aux salles désertes de Nina-Ruche devinrent plus fréquentes. Le capitaine Servadac, le comte Timascheff, Procope descendirent jusque sur la grève. Il faisait encore un froid excessif, mais l’atmosphère n’avait rien perdu de sa tranquillité normale. Pas une vapeur, ni à l’horizon, ni au zénith, pas un souffle d’air. Les dernières empreintes de pas laissées sur la grève étaient là aussi nettes qu’au premier jour.
Un seul aspect du littoral s’était modifié. C’était le promontoire rocheux qui couvrait la crique. En cet endroit, le mouvement ascensionnel des couches de glace avait continué. Elles s’élevaient alors à plus de cent cinquante pieds. Là, à cette hauteur, apparaissaient la goélette et la tartane, complètement inaccessibles. Leur chute, au dégel, était certaine, leur bris inévitable. Aucun moyen n’existait de les sauver.
Fort heureusement, Isac Hakhabut, qui n’abandonnait jamais sa boutique dans les profondeurs du mont, n’accompagnait pas le capitaine Servadac pendant cette promenade à la grève.
« S’il eût été là, dit Ben-Zouf, quels cris de paon le vieux coquin eût poussés ! Or, pousser des cris de paon et ne pas en avoir la queue, c’est sans compensation ! »
Deux mois de plus, juillet et août, rapprochèrent Gallia à cent soixante-quatre millions de lieues du soleil. Pendant les courtes nuits, le froid était encore extraordinairement vif ; mais, pendant le jour, le soleil, en parcourant l’équateur de Gallia qui traversait la Terre-Chaude, émettait une chaleur assez appréciable et relevait la température d’une vingtaine de degrés. Les Galliens venaient donc quotidiennement se refaire à ces rayons vivifiants, et, en cela, ils ne faisaient qu’imiter les quelques oiseaux, qui s’ébattaient dans l’air pour ne rentrer qu’à la chute du jour.
Cette sorte de printemps, – est-il permis d’employer ce mot ? – eut une très heureuse influence sur les habitants de Gallia. L’espoir, la confiance revenaient en eux. Pendant le jour, le disque du soleil se montrait plus agrandi sur l’horizon. Pendant la nuit, la terre paraissait grossir au milieu des immuables étoiles. On voyait le but – il était loin encore –, mais on le voyait. Ce n’était pourtant qu’un point dans l’espace.
Ce qui amena un jour Ben-Zouf à faire cette réflexion devant le capitaine Servadac et le comte Timascheff :
« En vérité, on ne me fera jamais croire que la butte Montmartre puisse tenir là-dedans !
– Elle y tient, cependant, répondit le capitaine Servadac, et je compte bien que nous l’y retrouverons !
– Et moi donc, mon capitaine ! Mais, dites-moi, sans vous commander, si la comète de M. Rosette n’avait pas dû retourner à la terre, est-ce qu’il n’y aurait pas eu moyen de l’y obliger ?
– Non, mon ami, répondit le comte Timascheff. Aucune puissance humaine ne peut déranger la disposition géométrique de l’univers. Quel désordre, si chacun pouvait modifier la marche de sa planète ! Mais Dieu ne l’a pas voulu, et je crois qu’il a sagement fait. »
Chapitre XV
Où se fait le récit des premières et dernières relations qui s’établirent entre Palmyrin Rosette et Isac Hakhabut
Le mois de septembre arriva. Il était encore impossible d’abandonner les obscures mais chaudes retraites du sous-sol gallien pour réintégrer le domicile de Nina-Ruche. Les abeilles eussent été certainement gelées dans leurs anciens alvéoles.
Heureusement et malheureusement à la fois, le volcan ne menaçait pas de se remettre en activité.
Heureusement, car une éruption soudaine eût pu surprendre les Galliens dans la cheminée centrale, seul conduit réservé au passage des laves.
Malheureusement, parce que l’existence, relativement facile et confortable dans les hauteurs de Nina-Ruche, aurait été immédiatement reprise, à la satisfaction générale.
« Sept vilains mois que nous avons passés là, mon capitaine ! dit un jour Ben-Zouf. Avez-vous observé notre Nina pendant tout ce temps ?
– Oui, Ben-Zouf, répondit le capitaine Servadac. C’est un petit être tout à fait exceptionnel ! On aurait dit que toute la vie gallienne se concentrait dans son cœur !
– Bon, mon capitaine, et puis après ?…
– Après ?
– Oui, quand nous serons revenus à la terre, nous ne pouvons abandonner cette chère enfant !
– Mordioux ! Ben-Zouf, nous l’adopterons !
– Bravo, mon capitaine ! Vous serez son père, et si vous le voulez, je serai sa mère !
– Alors, nous voilà mariés, Ben-Zouf.
– Ah ! mon capitaine, répondit le brave soldat, il y a longtemps que nous le sommes ! »
Dès les premiers jours du mois d’octobre, les froids furent presque supportables, même pendant la nuit, en absence de tout trouble atmosphérique. La distance de Gallia au soleil n’était pas triple alors de la distance qui sépare la terre de son centre attractif. La température se maintenait à une moyenne de trente à trente-cinq degrés au-dessous de zéro. Des ascensions plus fréquentes furent faites à Nina-Ruche, et même au-dehors. Les colons s’aventuraient plus impunément sur la grève. Le patinage fut repris sur cette admirable surface glacée que la mer offrait aux patineurs. C’était une joie pour les prisonniers de quitter leur prison. Chaque jour aussi, le comte Timascheff, le capitaine Servadac, le lieutenant Procope venaient reconnaître l’état des choses et discuter la « grande question de l’atterrissement ». Ce n’était pas tout que d’aborder le globe terrestre, il fallait, s’il était possible, parer à toutes les éventualités du choc.
Un des plus assidus visiteurs à l’ancien domicile de Nina-Ruche, c’était Palmyrin Rosette. Il avait fait remonter sa lunette dans son observatoire, et là, aussi longtemps que le froid le permettait, il reprenait ses observations astronomiques.
Ce que fut le résultat de ces nouveaux calculs, on ne le lui demanda pas. Il n’eût certainement pas répondu. Mais, au bout de quelques jours, ses compagnons remarquèrent qu’il paraissait être peu satisfait. Il montait, descendait, remontait, redescendait sans cesse l’oblique tunnel de la cheminée centrale. Il marmottait, il maugréait. Il était plus inabordable que jamais. Une ou deux fois, Ben-Zouf – un brave, comme on sait –, enchanté au fond de ces symptômes de désappointement, accosta le terrible professeur. Comme il fut reçu, cela ne peut se dire.
« Paraît, pensa-t-il, que cela ne va pas là-haut comme il le voudrait. Mais, triple nom d’un Bédouin, pourvu qu’il ne dérange pas la mécanique céleste, et nous avec ! »
Cependant, le capitaine Servadac, le comte Timascheff, le lieutenant Procope étaient assez fondés à se demander ce qui pouvait contrarier à ce point Palmyrin Rosette. Le professeur avait-il donc revu ses calculs, et étaient-ils en désaccord avec les nouvelles observations ? En un mot, la comète n’occupait-elle pas sur son orbite la place que lui assignaient les éphémérides précédemment établies, et, conséquemment, ne devait-elle pas rencontrer la terre au point et à la seconde indiqués ?
C’était toujours leur plus grande appréhension, et, n’ayant que les affirmations de Palmyrin Rosette pour baser leurs espérances, ils avaient lieu de tout craindre, en le voyant si contrarié.
C’est qu’en effet, le professeur devenait peu à peu le plus malheureux des astronomes. Évidemment, ses calculs ne devaient pas être d’accord avec ses observations, et un homme tel que lui ne pouvait pas éprouver de plus vif désappointement. En somme, toutes les fois qu’il redescendait à son cabinet, aux trois quarts gelé par une station trop longue au bout de sa lunette, il éprouvait un véritable accès de fureur.
S’il eût été permis à l’un de ses semblables de l’approcher en ce moment, voici ce qu’il l’aurait entendu se répéter à lui-même :
« Malédiction ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Que fait-elle là ? Elle n’est pas à la place que mes calculs lui donnent ! La misérable ! Elle est en retard ! Ou Newton est un fou, ou elle est folle ! Tout cela est contraire aux lois de la gravitation universelle ! Que diable ! je n’ai pu me tromper ! Mes observations sont justes, mes calculs aussi ! Ah ! satanée coquine ! »
Et Palmyrin Rosette se prenait la tête à deux mains, et il s’arrachait les cheveux, qui ne foisonnaient cependant pas sur son occiput. Et toujours, toujours le même résultat : un désaccord constant et inexplicable entre le calcul et l’observation.
« Voyons, se disait-il, est-ce qu’il y aurait un dérangement dans la mécanique céleste ? Non, ce n’est pas possible ! C’est moi qui me trompe ! Et pourtant… pourtant… »
Vraiment, Palmyrin Rosette eût maigri à la peine, s’il lui eût été possible de maigrir.
Enfin, s’il était désappointé, on était inquiet autour de lui, mais c’était ce dont il se préoccupait le moins.
Cependant, cet état de choses devait avoir un terme.
Un jour, le 12 octobre, Ben-Zouf, qui rôdait autour de la grande salle de Nina-Ruche, dans laquelle le professeur se trouvait en ce moment, l’entendit pousser un cri retentissant.
Ben-Zouf courut à lui.
« Vous vous êtes fait mal, sans doute ? lui demanda-t-il du ton dont il aurait dit : Comment vous portez-vous ?
– Eurêka ! te dis-je, eurêka ! » répondit Palmyrin Rosette, qui trépignait comme un fou.
Il y avait dans son transport à la fois du contentement et de la rage.
« Eurêka ? redit Ben-Zouf.
– Oui, eurêka ! Sais-tu ce que cela veut dire ?
– Non.
– Eh bien, va-t’en au diable ! »
« Heureusement, pensa l’ordonnance, que lorsqu’il ne veut pas répondre, M. Rosette y met au moins des formes ! »
Et il s’en alla, non au diable, mais trouver Hector Servadac.
« Mon capitaine, dit-il, il y a du nouveau.
– Qu’est-ce donc ?
– Le savant… eh bien ! il a « eurêké… ».
– Il a trouvé !… s’écria le capitaine Servadac. Mais qu’a-t-il trouvé ?
– Cela, je ne le sais pas.
– Eh ! c’est ce qu’il faudrait précisément savoir ! »
Et le capitaine Servadac fut plus inquiet qu’il ne l’avait jamais été. Cependant, Palmyrin Rosette redescendait vers son cabinet de travail et se répétait à lui-même :
« Oui, c’est cela… ce ne peut être que cela !… Ah ! le misérable !… Si cela est, il le payera cher !… Mais voudra-t-il avouer ? Jamais !… Il lui faudrait rendre gorge !… Eh bien ! je ruserai… et nous verrons ! »
C’était à n’y rien comprendre, mais ce qui fut manifeste, c’est que, depuis ce jour, Palmyrin Rosette changea sa manière d’être vis-à-vis de maître Isac Hakhabut. Jusqu’alors, il l’avait toujours ou évité ou malmené. Il fut désormais tout autre à son égard.
Qui dut être étonné ? Ce fut certainement maître Isac, peu accoutumé à de pareilles avances. Il voyait le professeur descendre fréquemment à son obscure boutique. Palmyrin Rosette s’intéressait à lui, à sa personne, à ses affaires. Il lui demandait s’il avait bien vendu ses marchandises, quel bénéfice il en était résulté pour sa caisse, s’il avait pu profiter d’une occasion qui ne se représenterait peut-être jamais, etc., etc., et tout cela avec l’intention, qu’il dissimulait à grand-peine, de l’étrangler net.
Isac Hakhabut, défiant comme un vieux renard, ne répondait que fort évasivement. Cette modification subite des manières du professeur à son égard était bien faite pour l’étonner. Il se demandait si Palmyrin Rosette ne songeait pas à lui emprunter de l’argent.
Or, on le sait, Isac Hakhabut, en principe, ne se refusait pas à prêter, à un taux parfaitement usuraire d’ailleurs. Il comptait même sur ce genre d’opérations pour faire valoir son bien. Mais il ne voulait prêter que sur solide signature, et – il faut bien l’avouer – il ne voyait que le comte Timascheff, riche seigneur russe, avec lequel il pût se risquer. Le capitaine Servadac devait être gueux comme un Gascon ! Quant au professeur, qui aurait jamais l’idée de prêter de l’argent à un professeur ! Aussi, maître Isac se tenait-il serré.
D’autre part, le juif allait être contraint à faire de son argent un emploi aussi restreint que possible, mais sur lequel il n’avait pas compté.
En effet, à cette époque, il avait vendu aux Galliens presque tous les articles alimentaires qui composaient sa cargaison. Il n’avait pas eu la sagesse de réserver quelques produits pour sa consommation particulière. Entre autres choses, le café lui manquait. Et le café, si parcimonieusement qu’on en use, « quand il n’y en a plus, il n’y en a plus », eût dit Ben-Zouf.
Il arrivait donc que maître Isac était privé d’une boisson dont il ne pouvait se passer, et force lui fut de recourir aux réserves du magasin général.
Donc, après de longues hésitations, il se dit qu’après tout la réserve était commune aux Galliens sans distinction, qu’il y avait les mêmes droits qu’un autre, et il alla trouver Ben-Zouf.
« Monsieur Ben-Zouf, dit-il de son ton le plus aimable, j’aurais une petite demande à vous adresser.
– Parle, Gobseck, répondit Ben-Zouf.
– J’aurais besoin de prendre à la réserve une livre de café pour mon usage personnel.
– Une livre de café ! répondit Ben-Zouf. Comment ! tu demandes une livre de café ?
– Oui, monsieur Ben-Zouf.
– Oh ! oh ! voilà qui est grave !
– Est-ce qu’il n’y en a plus ?
– Si, encore une centaine de kilos.
– Eh bien ?
– Eh bien, vieux, répondit Ben-Zouf en secouant la tête d’une façon inquiétante, je ne sais pas si je peux te donner cela !
– Donnez, monsieur Ben-Zouf, dit Isac Hakhabut, donnez, et mon cœur en sera tout réjoui !
– La réjouissance de ton cœur m’est superlativement indifférente !
– Cependant, vous ne refuseriez pas, si un autre que moi…
– Ah ! voilà ! voilà ! C’est que tu n’es pas un autre, toi !
– Eh bien, monsieur Ben-Zouf ?
– Eh bien, je vais en référer à Son Excellence le gouverneur général.
– Oh ! monsieur Ben-Zouf, je ne doute pas que dans sa justice…
– Au contraire, vieux, c’est sa justice qui me fait craindre pour toi ! »
Et l’ordonnance laissa Isac Hakhabut sur cette réflexion vraiment peu consolante.
Précisément, Palmyrin Rosette, toujours aux aguets, était arrivé pendant que ces paroles s’échangeaient entre Ben-Zouf et Isac. L’occasion lui parut bonne pour tenter l’aventure, et il entra aussi en matière.
« Tiens, maître Isac, dit-il, vous avez besoin de café ?
– Oui… monsieur le professeur, répondit Isac Hakhabut.
– Vous avez donc tout vendu ?
– Hélas ! j’ai commis cette faute !
– Diable ! C’est que le café vous est nécessaire ! Oui !… oui !… Cela réchauffe le sang !
– Sans doute… et dans ce trou noir, je ne puis pas m’en passer !…
– Eh bien, maître Isac, on va vous en donner une quantité suffisante pour votre consommation.
– N’est-ce pas, monsieur le professeur… et, quoique je l’aie vendu, ce café, j’ai droit comme un autre d’en prendre pour mon usage !
– Certainement… maître Isac… certainement !… Et vous en faudra-t-il une grande quantité ?
– Une livre seulement !… Je le ménage avec tant de soin !… Cela me durera longtemps !
– Et comment pèsera-t-on ce café ? demanda Palmyrin Rosette, qui, malgré lui, accentua légèrement cette phrase.
– Avec mon peson !… » murmura le juif.
Et Palmyrin Rosette crut surprendre comme un soupir qui s’échappait de la poitrine de maître Isac.
« Oui… répliqua-t-il… avec le peson ! Il n’y a pas d’autre balance ici ?…
– Non !… répondit Isac, qui regrettait peut-être son soupir.
– Eh ! eh ! maître Isac !… Ce sera avantageux ! Pour une livre de café, on va vous en donner sept !
– Oui… sept ! c’est bien cela ! »
Le professeur regardait son homme, il le dévisageait. Il voulait lui faire une question… Il n’osait, pensant, avec raison, qu’Isac ne lui dirait pas la vérité, qu’il voulait à tout prix connaître. Cependant, ne pouvant plus contenir son impatience, il allait parler, lorsque Ben-Zouf revint.
« Eh bien ? demanda vivement Isac Hakhabut.
– Eh bien, le gouverneur ne veut pas… répondit Ben-Zouf.
– Il ne veut pas qu’on me donne du café ! s’écria Isac.
– Non, mais il veut bien qu’on t’en vende.
– M’en vendre, mein Gott !
– Oui, et cela est juste, puisque tu as ramassé tout l’argent de la colonie. Allons, voyons la couleur de tes pistoles !
– Me forcer à acheter, quand un autre…
– Je t’ai déjà dit que tu n’étais pas un autre ! Achètes-tu, oui ou non ?
– Miséricorde !
– Réponds, ou je ferme la boutique ! »
Isac savait bien qu’il ne fallait pas plaisanter avec Ben-Zouf.
« Allons… j’achèterai, dit-il.
– Bon.
– Mais à quel prix ?
– Le prix auquel tu as vendu. On ne t’écorchera pas ! Ta peau n’en vaut pas la peine ! »
Isac Hakhabut avait mis la main à la poche et y faisait remuer quelques pièces d’argent. Le professeur était de plus en plus attentif et semblait guetter les paroles à la bouche d’Isac.
« Combien, dit celui-ci, me ferez-vous payer une livre de café ?
– Dix francs, répondit Ben-Zouf. C’est le prix courant à la Terre-Chaude. Mais qu’est-ce que cela peut te faire, puisque, après notre retour à la terre, l’or n’aura plus de valeur.
– L’or ne plus avoir de valeur ! répondit Isac. Est-ce que cela peut arriver, monsieur Ben-Zouf ?
– Tu le verras.
– L’Éternel me vienne en aide ! Dix francs, une livre de café.
– Dix francs. Est-ce fini ? »
Isac Hakhabut tira alors une pièce d’or, il la regarda à la lumière de la lampe, il la baisa presque du bout des lèvres.
« Et vous allez peser avec mon peson ? demanda-t-il d’un ton si plaintif qu’il en était suspect.
– Et avec quoi veux-tu que je pèse ? » répondit Ben-Zouf.
Puis, prenant le peson, il suspendit un plateau à son crochet et versa ce qu’il fallait de café pour que l’aiguille marquât une livre, – soit sept en réalité. Isac Hakhabut suivait des yeux l’opération.
« Voilà ! dit Ben-Zouf.
– L’aiguille est-elle bien rendue au point ? demanda le négociant, en se penchant sur le cercle gradué de l’instrument.
– Oui donc, vieux Jonas !
– Poussez-la un peu du doigt, monsieur Ben-Zouf !
– Et pourquoi cela ?
– Parce que… parce que… murmura Isac Hakhabut, parce que mon peson n’est peut-être pas… tout à fait… juste !… »
Ces mots étaient à peine achevés, que Palmyrin Rosette sautait à la gorge d’Isac. Il le secouait, il l’étranglait.
« Canaille ! criait-il.
– Au secours ! à moi ! » répondait Isac Hakhabut.
La lutte continuait. Il est vrai que Ben-Zouf se gardait bien d’intervenir. Au contraire, il excitait les combattants, il éclatait de rire. Pour lui, en vérité, l’un ne valait pas mieux que l’autre.
Mais, au bruit de la bataille, le capitaine Servadac, le comte Timascheff, le lieutenant Procope vinrent voir ce qui se passait.
On sépara Isac et le professeur.
« Mais qu’y a-t-il ? demanda Hector Servadac.
– Il y a, répondit Palmyrin Rosette, il y a que ce sacripant nous a donné un peson faux, un peson qui accuse un poids plus fort que le poids réel !
– Est-ce vrai, Isac ?
– Monsieur le gouverneur… oui… non !… répondit-il… oui !…
– Il y a que ce voleur vendait à faux poids, reprit le professeur avec une fureur croissante, et que, lorsque j’ai pesé ma comète avec son instrument, j’ai obtenu un poids supérieur à celui qu’elle a réellement.
– Est-ce vrai ?
– Vraiment… je ne sais !… marmottait Isac Hakhabut.
– Il y a enfin que j’ai pris cette fausse masse pour base de mes nouveaux calculs, que ceux-ci ont été en désaccord avec mes observations, et que j’ai dû croire qu’elle n’était plus à sa place !
– Mais qui… elle ? Gallia ?
– Eh non ! Nérina, pardieu ! notre lune !
– Mais Gallia ?…
– Eh ! Gallia est toujours où elle doit être ! répondit Palmyrin Rosette. Elle va directement à la terre, et nous avec !… et aussi ce maudit Isac !… que Dieu confonde ! »
Chapitre XVI
Dans lequel le capitaine Servadac et Ben-Zouf partent et reviennent comme ils étaient partis
Cela était vrai. Depuis qu’il avait entrepris son honnête commerce de cabotage, Isac Hakhabut vendait à faux poids. L’homme étant connu, cela n’étonnera personne. Mais le jour où de vendeur il était devenu acheteur, son improbité s’était retournée contre lui. Le principal instrument de sa fortune était ce peson, faux d’un quart, comme cela fut reconnu, – ce qui permit au professeur de reprendre ses calculs, en les rétablissant sur une base juste.
Lorsque, sur la terre, ce peson marquait un poids d’un kilogramme, en réalité l’objet ne pesait que sept cent cinquante grammes. Donc, au poids qu’il avait indiqué pour Gallia, il fallait retrancher un quart. On comprend donc que les calculs du professeur, se basant sur une masse de la comète trop forte d’un quart, ne pouvaient s’accorder avec les positions vraies de Nérina, puisque c’était la masse de Gallia qui l’influençait.
Palmyrin Rosette, satisfait d’avoir consciencieusement rossé Isac Hakhabut, se remit aussitôt à la besogne pour en finir avec Nérina.
Combien, après cette scène, Isac Hakhabut fut bafoué, cela se comprend ! Ben-Zouf ne cessait de lui répéter qu’il serait poursuivi pour vente à faux poids, que son affaire s’instruisait, et qu’il serait traduit en police correctionnelle.
« Mais où et quand ? demandait-il.
– Sur la terre, à notre retour, vieux coquin ! » répondait gracieusement Ben-Zouf.
L’affreux bonhomme dut se confiner dans son trou obscur, et ne se laissa plus voir que le moins possible.
Deux mois et demi séparaient encore les Galliens du jour où ils espéraient rencontrer la terre. Depuis le 7 octobre, la comète était rentrée dans la zone des planètes télescopiques, là même où elle avait capté Nérina.
Au 1er novembre, la moitié de cette zone dans laquelle gravitent ces astéroïdes, dont l’origine est due probablement à l’éclatement de quelque planète qui gravitait entre Mars et Jupiter, avait été heureusement traversée. Pendant ce mois, Gallia allait parcourir un arc de quarante millions de lieues sur son orbite, en se rapprochant jusqu’à soixante-dix-huit millions de lieues du soleil.
La température redevenait supportable, – environ dix à douze degrés au-dessous de zéro. Cependant, aucun symptôme de dégel ne se manifestait encore. La surface de la mer restait immuablement congelée, et les deux bâtiments, juchés sur leur piédestal de glace, surplombaient l’abîme.
Ce fut alors que la question des Anglais relégués sur l’îlot de Gibraltar fut remise sur le tapis. On ne doutait pas qu’ils n’eussent impunément traversé les extrêmes froids de l’hiver gallien.
Le capitaine Servadac traita cette question à un point de vue qui faisait le plus grand honneur à sa générosité. Il dit que, malgré leur mauvais accueil lors de la visite de la Dobryna, il convenait de se remettre en communication avec eux, pour les mettre au courant de tout ce qu’ils ignoraient sans doute. Le retour à la terre, qui ne serait, après tout, que le résultat d’une nouvelle collision, offrait des dangers extrêmes. Il fallait donc en prévenir ces Anglais et les engager même à venir braver ces dangers en commun.
Le comte Timascheff et le lieutenant Procope partagèrent absolument l’avis du capitaine Servadac. Il y avait là une question d’humanité qui ne pouvait les laisser indifférents.
Mais comment arriver, à cette époque, jusqu’à l’îlot de Gibraltar ?
Par mer évidemment, c’est-à-dire en profitant de l’appui solide que sa surface glacée présentait encore.
C’était, d’ailleurs, la seule manière de voyager d’une île à l’autre, car, le dégel venu, aucun autre genre de communication ne serait possible. En effet, on ne pouvait plus compter ni sur la goélette, ni sur la tartane. Quant à la chaloupe à vapeur, l’utiliser à cet effet, c’eût été consommer quelques tonnes du charbon qui avait été précieusement mis en réserve, pour le cas où les colons devraient retourner à l’île Gourbi.
Il y avait bien le youyou, qui avait été déjà transformé en traîneau à voile. On sait dans quelles conditions de rapidité et de sécurité il avait accompli le trajet de la Terre-Chaude à Formentera.
Mais il lui fallait le vent, pour se mouvoir, et le vent ne se faisait plus sentir à la surface de Gallia. Peut-être après le dégel, avec les vapeurs que développerait la température estivale, de nouveaux troubles se produiraient-ils dans l’atmosphère gallienne ? On devait même le craindre. Mais alors le calme était absolu, et le youyou ne pouvait se rendre à l’îlot de Gibraltar.
Restait donc la possibilité de faire la route à pied ou plutôt à patins. La distance était considérable, – cent lieues environ. Pouvait-on tenter de la franchir dans ces conditions ?
Le capitaine Servadac s’offrit à cette tâche. Vingt-cinq à trente lieues par jour, soit environ deux lieues à l’heure, cela n’était pas pour embarrasser un homme rompu à l’exercice du patinage. En huit jours, il pouvait donc être revenu à la Terre-Chaude, après avoir visité Gibraltar. Une boussole pour se diriger, une certaine quantité de viande froide, un petit réchaud à esprit-de-vin pour faire du café, il n’en demandait pas davantage, et cette entreprise, un peu hasardée, allait bien à son esprit aventureux.
Le comte Timascheff, le lieutenant Procope insistèrent ou pour partir à sa place, ou pour l’accompagner. Mais le capitaine Servadac les remercia. En cas de malheur, il fallait que le comte et le lieutenant fussent à la Terre-Chaude. Sans eux, que deviendraient leurs compagnons au moment du retour ?
Le comte Timascheff dut céder. Le capitaine Servadac ne voulut accepter qu’un seul compagnon, son fidèle Ben-Zouf. Il lui demanda donc si la chose lui allait.
« Si ça me va, nom d’une butte ! s’écria Ben-Zouf. Si ça me va, mon capitaine ! Une pareille occasion de se dégourdir les jambes ! Et puis, croyez-vous que je vous aurais laissé partir seul ! »
Le départ fut décidé pour le lendemain 2 novembre. Certainement, le désir d’être utile aux Anglais, le besoin de remplir un devoir d’humanité était le premier mobile auquel obéissait le capitaine Servadac. Mais peut-être une autre pensée avait-elle germé dans son cerveau de Gascon. Il ne l’avait encore communiquée à personne, et, sans doute, il n’en voulait rien dire au comte Timascheff.
Quoi qu’il en soit, Ben-Zouf comprit qu’il y avait « quelque autre machinette », lorsque, la veille du départ, son capitaine lui dit :
« Ben-Zouf, est-ce que tu ne trouverais pas dans le magasin général de quoi faire un drapeau tricolore ?
– Oui, mon capitaine, répondit Ben-Zouf.
– Eh bien, fais ce drapeau sans qu’on te voie, mets-le dans ton sac et emporte-le. »
Ben-Zouf n’en demanda pas davantage et obéit. Maintenant, quel était le projet du capitaine Servadac, et pourquoi ne s’en ouvrait-il pas à ses compagnons ?
Avant de le dire, il convient de noter ici un certain phénomène psychologique, qui, pour ne pas appartenir à la catégorie des phénomènes célestes, n’en était pas moins très naturel, – étant donné les faiblesses de l’humanité.
Depuis que Gallia se rapprochait de la terre, peut-être le comte Timascheff et le capitaine Servadac, par un mouvement opposé, tendaient-ils à s’écarter l’un de l’autre. Il était possible que cela se fît presque à leur insu. Le souvenir de leur ancienne rivalité, si complètement oubliée pendant ces vingt-deux mois d’une existence commune, revenait peu à peu à leur esprit, et de leur esprit à leur cœur. En se retrouvant sur le globe terrestre, ces compagnons d’aventure ne redeviendraient-ils pas les rivaux d’autrefois ? Pour avoir été Gallien, on n’en est pas moins homme. Mme de L… était peut-être libre encore, – et, même, c’eût été lui faire injure que d’en douter !…
Enfin, de tout cela, volontairement ou non, il était résulté une certaine froideur entre le comte et le capitaine. On a pu remarquer, d’ailleurs, qu’il n’y avait jamais eu entre eux une réelle intimité, mais seulement cette amitié qui devait résulter des circonstances dans lesquelles ils se trouvaient.
Ceci dit, voici quel était le projet du capitaine Servadac, – projet qui eût peut-être créé entre le comte Timascheff et lui une rivalité nouvelle. C’est pourquoi il avait voulu le tenir secret.
Ce projet – il faut en convenir – était bien digne du cerveau fantaisiste dans lequel il avait pris naissance.
On sait que les Anglais, rivés à leur roc, avaient continué d’occuper l’îlot de Gibraltar pour le compte de l’Angleterre. Ils avaient eu raison, si ce poste revenait à la terre dans de bonnes conditions. Au moins, l’occupation ne saurait leur en être disputée.
Or, en face de Gibraltar se dressait l’îlot de Ceuta. Avant le choc, Ceuta appartenait aux Espagnols et commandait l’un des côtés du détroit. Mais Ceuta, abandonnée, revenait au premier occupant. Donc, se rendre au rocher de Ceuta, en prendre possession au nom de la France, y planter le pavillon français, voilà ce qui parut tout indiqué au capitaine Servadac.
« Qui sait, se disait-il, si Ceuta n’arrivera pas à bon port sur la terre et ne commandera pas quelque importante Méditerranée ? Eh bien, le pavillon français, planté sur ce roc, justifiera les prétentions de la France ! »
Et voilà pourquoi, sans en rien dire, le capitaine Servadac et son ordonnance Ben-Zouf partirent pour la conquête.
On conviendra, d’ailleurs, que Ben-Zouf était bien fait pour comprendre son capitaine. Conquérir un morceau de rocher à la France ! Faire une niche aux Anglais ! C’était son affaire !
Ce fut, après le départ, au pied de la falaise, lorsque, les adieux terminés, les deux conquérants se trouvèrent seuls, que Ben-Zouf eut connaissance des projets de son capitaine.
Et alors il sembla que les vieux refrains de régiment lui revinssent à la mémoire, car, d’une voix superbe, il se mit à chanter :
Le soleil en se levant
Nous fich’ des rayons obliques !
Vlan ! du bataillon d’Afrique,
Vlan ! les Zéphyrs en avant !
Le capitaine Servadac et Ben-Zouf, chaudement vêtus, l’ordonnance ayant le sac au dos et portant le petit matériel du voyage, tous deux les patins aux pieds, se lancèrent sur l’immense surface blanche et perdirent bientôt de vue les hauteurs de la Terre-Chaude.
Le voyage n’offrit aucun incident. Le temps du parcours fut divisé par quelques haltes, pendant lesquelles repos et nourriture étaient pris en commun. La température redevenait supportable, même pendant la nuit, et trois jours seulement après leur départ, le 5 novembre, les deux héros arrivaient à quelques kilomètres de l’îlot de Ceuta.
Ben-Zouf était bouillant. S’il eût fallu donner un assaut, le brave soldat ne demandait qu’à se former en colonne, et « même en carré » pour repousser la cavalerie ennemie.
On était au matin. La direction rectiligne avait été sévèrement relevée à la boussole et suivie exactement depuis le départ. Le rocher de Ceuta apparaissait à cinq ou six kilomètres, au milieu de l’irradiation solaire, sur l’horizon occidental.
Les deux chercheurs d’aventure avaient hâte de mettre le pied sur ce roc.
Tout à coup, à une distance de trois kilomètres environ, Ben-Zouf, qui avait une vue très perçante, s’arrêta et dit :
« Mon capitaine, voyez donc !
– Qu’y a-t-il, Ben-Zouf ?
– Quelque chose qui remue sur le rocher.
– Avançons », répondit le capitaine Servadac. Deux kilomètres furent franchis en quelques minutes. Le capitaine Servadac et Ben-Zouf, modérant leur vitesse, s’arrêtèrent de nouveau.
« Mon capitaine.
– Eh bien, Ben-Zouf ?
– Il y a positivement un monsieur quelconque sur Ceuta, et qui nous fait de grands gestes. Il a l’air de se détirer les bras comme un homme qui se réveille après avoir trop dormi.
– Mordioux ! s’écria le capitaine Servadac, est-ce que nous arriverions trop tard ? »
Tous deux avancèrent encore, et bientôt Ben-Zouf de s’écrier :
« Ah ! mon capitaine, c’est un télégraphe ! »
C’était, en effet, un télégraphe, semblable à ceux des sémaphores, qui fonctionnait sur le rocher de Ceuta.
« Mordioux ! s’écria le capitaine, mais s’il y a là un télégraphe, c’est qu’on l’y a planté !
– À moins, dit Ben-Zouf, que sur Gallia il ne pousse des télégraphes en guise d’arbres !
– Et s’il gesticule, c’est que quelqu’un le met en mouvement !
– Pardieu ! »
Hector Servadac, très désappointé, regarda dans le nord. Là, à la limite de l’horizon, s’élevait le rocher de Gibraltar, et il sembla à Ben-Zouf, comme à lui, qu’un second télégraphe, installé au sommet de l’îlot, répondait aux interpellations du premier.
« Ils ont occupé Ceuta, s’écria le capitaine Servadac, et notre arrivée est maintenant signalée à Gibraltar !
– Alors, mon capitaine ?…
– Alors, Ben-Zouf, il faut rengainer notre projet de conquête et faire contre fortune bon cœur !
– Cependant, mon capitaine, s’ils ne sont que cinq ou six Anglais à défendre Ceuta ?…
– Non, Ben-Zouf, répondit le capitaine Servadac, nous avons été prévenus, et, à moins que mes arguments ne les décident à nous céder la place, il n’y a rien à faire. »
Les déconfits Hector Servadac et Ben-Zouf étaient arrivés au pied même du rocher. En ce moment, une sentinelle en jaillit, comme si elle eût été pressée par un ressort.
« Qui vive ?
– Amis ! France !
– Angleterre ! »
Tels furent les mots échangés tout d’abord. Alors quatre hommes parurent sur la partie supérieure de l’îlot.
« Que voulez-vous ? demanda l’un de ces hommes, qui appartenaient à la garnison de Gibraltar.
– Je désire parler à votre chef, répondit le capitaine Servadac.
– Le commandant de Ceuta ?
– Le commandant de Ceuta, puisque Ceuta a déjà un commandant.
– Je vais le prévenir », répondit le soldat anglais. Quelques instants après, le commandant de Ceuta, en tenue, s’avançait jusqu’aux premières roches de son îlot.
C’était le major Oliphant en personne.
Il n’y avait plus de doute possible. Cette idée qu’avait le capitaine Servadac d’occuper Ceuta, les Anglais l’avaient eue, mais ils l’avaient exécutée avant lui. Ce rocher occupé, ils y creusèrent un poste qui fut solidement casematé. Vivres et combustible y furent transportés, dans le canot du commandant de Gibraltar, avant que la mer eût été solidifiée par le froid.
Une épaisse fumée qui sortait du roc même prouvait que l’on avait dû faire bon feu pendant l’hiver gallien et que la garnison n’avait pas souffert de ses rigueurs. Et, en effet, ces soldats anglais présentaient un embonpoint rassurant, et, quoiqu’il n’en voulût peut-être pas convenir, le major Oliphant avait légèrement engraissé.
Du reste, les Anglais de Ceuta n’étaient pas trop isolés, puisque quatre lieues au plus les séparaient de Gibraltar. Soit en traversant l’ancien détroit, soit en faisant jouer le télégraphe, ils restaient en communication constante.
Il faut même ajouter que le brigadier Murphy et le major Oliphant n’avaient point interrompu leur partie d’échecs. Leurs coups longuement préparés, ils se les transmettaient par le télégraphe.
En cela, les deux honorables officiers imitaient ces deux sociétés américaines qui, en 1846, malgré pluie et tempête, jouèrent « télégraphiquement » une célèbre partie d’échecs entre Washington et Baltimore.
Inutile d’ajouter qu’entre le brigadier Murphy et le major Oliphant, il s’agissait toujours de la même partie commencée lors de la visite du capitaine Servadac à Gibraltar.
Cependant, le major attendait froidement ce que les deux étrangers voulaient de lui.
« Le major Oliphant, je crois ? dit le capitaine Servadac en saluant.
– Le major Oliphant, gouverneur de Ceuta », répondit l’officier, qui ajouta :
« À qui ai-je l’honneur de parler ?
– Au capitaine Servadac, gouverneur général de la Terre-Chaude.
– Ah ! fort bien, répondit le major.
– Monsieur, reprit alors Hector Servadac, voulez-vous me permettre d’être légèrement surpris de vous voir installé en qualité de commandant sur ce qui reste d’une ancienne propriété de l’Espagne ?
– Je vous le permets, capitaine.
– Oserais-je vous demander de quel droit ?…
– Du droit de premier occupant.
– C’est au mieux, major Oliphant. Mais ne pensez-vous pas que les Espagnols, qui sont devenus les hôtes de la Terre-Chaude, pourraient réclamer avec quelque raison ?…
– Je ne le pense pas, capitaine Servadac.
– Et pourquoi, s’il vous plaît ?
– Parce que ce sont ces Espagnols qui ont cédé ce rocher de Ceuta en toute propriété à l’Angleterre.
– Par contrat, major Oliphant ?
– Par contrat en bonne et due forme.
– Ah ! vraiment ?
– Et ils ont même reçu en or anglais, capitaine Servadac, le prix de cette importante cession.
– Voilà donc, s’écria Ben-Zouf, pourquoi Negrete et ses compagnons avaient tant d’argent dans leur poche ! »
En effet, les choses s’étaient passées comme le disait le major Oliphant. Les deux officiers, on se le rappelle, avaient secrètement fait une visite à Ceuta, lorsque les Espagnols y étaient encore. De là cette cession, facile à obtenir, de l’îlot au profit de l’Angleterre.
Donc, l’argument sur lequel comptait un peu le capitaine Servadac tombait de lui-même. Donc, déconvenue complète du conquérant et de son chef d’état-major. Aussi se garda-t-il d’insister ni de laisser soupçonner ses projets.
« Puis-je savoir, reprit alors le major Oliphant, ce qui me vaut l’honneur de votre visite ?
– Major Oliphant, répondit le capitaine Servadac, je suis venu pour rendre service à vos compagnons et à vous.
– Ah ! fit le major du ton d’un homme qui ne croit avoir besoin des services de personne.
– Peut-être, major Oliphant, n’êtes-vous pas au courant de ce qui s’est passé, et ignorez-vous que les rochers de Ceuta et de Gibraltar courent le monde solaire à la surface d’une comète ?
– Une comète ? » répéta le major avec un sourire de parfaite incrédulité.
En quelques mots, le capitaine Servadac fit connaître les résultats de la rencontre de la terre et Gallia, – ce qui ne fit pas même sourciller l’officier anglais. Puis, il ajouta que presque toutes les chances étaient pour un retour au globe terrestre, et qu’il conviendrait peut-être que les habitants de Gallia réunissent leurs efforts pour parer aux dangers de la nouvelle collision.
« Donc, major Oliphant, si votre petite garnison et celle de Gibraltar veulent émigrer à la Terre-Chaude ?…
– Je ne saurais trop vous remercier, capitaine Servadac, répondit froidement le major Oliphant, mais nous ne pouvons pas abandonner notre poste.
– Et pourquoi ?
– Nous n’avons pas d’ordre de notre gouvernement, et le pli que nous avons destiné à l’amiral Fairfax attend toujours le passage de la malle.
– Mais je vous répète que nous ne sommes plus sur le globe terrestre, et qu’avant deux mois la comète aura de nouveau rencontré la terre !
– Cela ne m’étonne pas, capitaine Servadac, car l’Angleterre a dû tout faire pour l’attirer à elle ! »
Il était évident que le major ne croyait pas un mot de ce que lui racontait le capitaine.
« À votre aise ! reprit celui-ci. Vous voulez garder obstinément ces deux postes de Ceuta et de Gibraltar ?
– Évidemment, capitaine Servadac, puisqu’ils commandent l’entrée de la Méditerranée.
– Oh ! il n’y aura peut-être plus de Méditerranée, major Oliphant !
– Il y aura toujours une Méditerranée, si cela convient à l’Angleterre ! – Mais pardonnez-moi, capitaine Servadac. Le brigadier Murphy m’envoie par le télégraphe un coup redoutable. Vous permettez… »
Le capitaine Servadac, tordant sa moustache à l’arracher, rendit au major Oliphant le salut que celui-ci venait de lui adresser. Les soldats anglais rentrèrent dans leur casemate, et les deux conquérants se retrouvèrent seuls au pied des roches.
« Eh bien, Ben-Zouf ?
– Eh bien, mon capitaine ! Sans vous commander, une belle fichue campagne que nous avons faite là !
– Allons-nous-en, Ben-Zouf.
– Allons-nous-en, mon capitaine », répondit Ben-Zouf, qui ne songeait plus à chanter le refrain des Zéphyrs d’Afrique.
Et ils s’en retournèrent, comme ils étaient venus, sans avoir eu l’occasion de déployer leur drapeau.
Aucun incident ne signala leur retour, et, le 9 novembre, ils remettaient le pied sur le littoral de la Terre-Chaude.
Il faut ajouter qu’ils arrivèrent pour assister à une belle colère de Palmyrin Rosette ! Et, franchement, il faut avouer qu’il y avait de quoi !
On se rappelle que le professeur avait repris la série de ses observations et de ses calculs sur Nérina. Or, il venait de les terminer et tenait enfin tous les éléments de son satellite !… Mais Nérina, qui aurait dû reparaître la veille, n’était pas revenue sur l’horizon de Gallia. Captée sans doute par quelque astéroïde plus puissant, elle s’était échappée en traversant la zone des planètes télescopiques !
Chapitre XVII
Qui traite de la grande question du retour à la terre et de la proposition hardie qui fut faite par le lieutenant Procope
À son retour, Hector Servadac fit connaître au comte Timascheff le résultat de sa visite aux Anglais. Il ne lui cacha pas que Ceuta avait été vendu par les Espagnols, qui, d’ailleurs, n’avaient aucun droit de le vendre, et il ne tut que ses projets personnels.
Il fut donc convenu que, puisque les Anglais ne voulaient pas venir à la Terre-Chaude, on se passerait de leur concours. Ils étaient prévenus. À eux de s’en tirer comme ils l’entendraient.
Restait donc à traiter cette grave question de la nouvelle rencontre qui devait se produire entre la comète et le sphéroïde terrestre.
En principe, il fallait regarder comme un véritable miracle que, lors du premier choc, le capitaine Servadac, ses compagnons, les animaux, en un mot tous les êtres enlevés à la terre, eussent survécu. Cela tenait sans doute à ce que le mouvement s’était lentement modifié par suite de circonstances inconnues. Si la terre comptait quelques victimes déjà, on le saurait plus tard. En tout cas, un fait certain, c’est que nul de ceux qui avaient été emportés, aussi bien à l’île Gourbi qu’à Gibraltar, à Ceuta, à Madalena et à Formentera, n’avait personnellement souffert de la collision.
En serait-il de même au retour ? Il n’y fallait pas compter, très probablement.
Ce fut dans la journée du 10 novembre que se traita cette importante question. Le comte Timascheff, le capitaine Servadac et le lieutenant Procope se réunirent dans cette excavation qui leur servait de salle commune. Ben-Zouf fut naturellement admis à la séance. Quant à Palmyrin Rosette, régulièrement convoqué, il avait refusé de venir, cette question ne l’intéressant en aucune manière. Depuis la disparition de sa chère Nérina, il ne pouvait se consoler. Menacé de perdre sa comète, comme il avait perdu son satellite, il désirait qu’on le laissât tranquille. Ce qu’on fit.
Le capitaine Servadac et le comte Timascheff, de plus en plus froids l’un pour l’autre, ne laissèrent rien paraître de leurs secrètes pensées et discutèrent la question dans l’intérêt de tous.
Le capitaine Servadac prit d’abord la parole en ces termes :
« Messieurs, dit-il, nous voici au 10 novembre. Si les calculs de mon ex-professeur sont justes – et ils doivent l’être –, c’est donc exactement dans cinquante et un jours qu’une nouvelle rencontre s’opérera entre la comète et la terre. En prévision de cette éventualité, avons-nous quelque précaution à prendre ?
– Évidemment, capitaine, répondit le comte Timascheff ; mais est-il en notre pouvoir d’en prendre, et ne sommes-nous pas absolument à la merci de la Providence ?
– Elle ne défend pas de s’aider, monsieur le comte, reprit le capitaine Servadac. Au contraire.
– Avez-vous quelque idée de ce que l’on peut faire, capitaine Servadac ?
– Aucune, en vérité.
– Comment, messieurs, dit alors Ben-Zouf, des savants comme vous, sauf le respect que je vous dois, ne sont pas capables de diriger cette satanée comète où ils voudront et comme ils le voudront ?
– D’abord, nous ne sommes pas des savants, Ben-Zouf, répondit le capitaine Servadac, et, le fussions-nous, nous n’y pourrions rien. Vois si Palmyrin Rosette, qui, lui, est un savant…
– Mal embouché, dit Ben-Zouf.
– Soit, mais savant, peut empêcher sa Gallia de retourner à la terre !
– Mais à quoi sert la science alors ?
– À savoir, la plupart du temps, qu’on ne sait pas encore tout ! répondit le comte Timascheff.
– Messieurs, dit le lieutenant Procope, il est certain que, dans ce nouveau choc, divers dangers nous menacent. Si vous le voulez bien, je vais les énumérer, et nous verrons s’il est possible de les combattre, ou, tout au moins, d’en atténuer les effets.
– Parle, Procope », répondit le comte Timascheff. Tous causaient si tranquillement de ces choses, qu’on eût dit vraiment qu’elles ne les regardaient pas.
« Messieurs, reprit le lieutenant Procope, il faut d’abord se demander de quelle façon pourra se produire cette nouvelle rencontre entre la comète et le globe terrestre. Nous verrons ensuite ce qu’il y a à craindre ou à espérer dans chacun des cas possibles.
– Rien de plus logique, répondit le capitaine Servadac ; mais n’oublions pas que les deux astres se dirigent l’un vers l’autre, et que leur vitesse, au moment du choc, sera de quatre-vingt-dix mille lieues à l’heure !
– Deux jolis trains ! se permit d’ajouter Ben-Zouf.
– Voyons donc comment s’effectuera le choc, reprit le lieutenant Procope. Les deux astres se rencontreront ou obliquement ou normalement. Dans le premier cas, il peut arriver que Gallia ne fasse qu’effleurer la terre, comme la première fois, après en avoir arraché encore quelques morceaux, et qu’elle retourne graviter dans l’espace. Mais son orbite serait sans doute dérangée, et nous aurions peu de chances, si nous avions survécu, de jamais revoir nos semblables.
– Ce qui ferait l’affaire de M. Palmyrin Rosette, mais non la nôtre, fit observer le judicieux Ben-Zouf.
– Laissons donc de côté cette hypothèse, répondit le comte Timascheff. Nous en connaissons suffisamment les avantages et les désavantages. Arrivons au choc direct, c’est-à-dire au cas où, après avoir heurté la terre, Gallia y resterait attachée.
– Comme une verrue sur une figure, dit Ben-Zouf.
– Silence, Ben-Zouf, répondit Hector Servadac.
– Oui, mon capitaine.
– Voyons donc, reprit le lieutenant Procope, quelles sont les hypothèses que présente un choc direct. Avant tout, il faut admettre que la masse de la terre étant de beaucoup supérieure à celle de Gallia, sa vitesse ne sera pas retardée dans cette rencontre et qu’elle emportera la comète avec elle.
– Cela est admis, répondit le capitaine Servadac.
– Eh bien, messieurs, dans l’hypothèse d’un choc direct, ou Gallia accostera la terre par la partie de sa surface que nous occupons à l’équateur, ou par la partie située à nos antipodes, ou, enfin, par l’un ou l’autre de ses pôles. Or, dans ces divers cas, les chances sont pour que pas un des êtres vivants qu’elle porte n’y puisse survivre.
– Expliquez-vous, lieutenant, dit le capitaine Servadac.
– Si nous sommes, au moment de la rencontre, à la partie heurtante de l’équateur, nous serons écrasés.
– Cela va de soi, répondit Ben-Zouf.
– Si nous sommes aux antipodes de cette partie, outre la certitude d’être écrasés encore, puisque la vitesse qui nous animera sera subitement anéantie – ce qui équivaudra à un choc –, nous avons encore la certitude d’être asphyxiés. En effet, l’atmosphère gallienne ira se mêler à l’atmosphère terrestre, et il n’y aura plus d’air respirable sur le sommet de cette montagne, haute de cent lieues, que formera Gallia sur la terre.
– Et si Gallia heurte la terre par l’un ou l’autre de ses pôles ?… demanda le comte Timascheff.
– Dans ce cas, répondit le lieutenant Procope, nous serons inévitablement projetés et brisés dans une chute épouvantable.
– Très bien, dit Ben-Zouf.
– J’ajoute, au cas impossible où aucune de ces hypothèses ne se produirait, que nous serons infailliblement brûlés.
– Brûlés ? dit Hector Servadac.
– Oui, car, lorsque la vitesse de Gallia, venant à être anéantie par l’obstacle, se transformera en chaleur, la comète sera en tout ou en partie incendiée sous l’influence d’une température qui s’élèvera à quelques milliers de degrés !
Tout ce que disait le lieutenant Procope était rigoureusement exact. Ses auditeurs le regardaient et écoutaient, sans être autrement étonnés, le développement de ces différentes hypothèses.
« Mais, monsieur Procope, dit Ben-Zouf, une question. Si Gallia tombe dans la mer ?…
– Quelque profonds que soient l’Atlantique ou le Pacifique, répondit le lieutenant Procope – et leur profondeur ne dépasse pas quelques lieues –, le coussin d’eau sera toujours insuffisant pour amortir le choc. Donc, tous les effets que j’ai indiqués tout à l’heure se reproduiraient…
– Et même avec la noyade en plus !… répondit Ben-Zouf.
– Ainsi, messieurs, dit le capitaine Servadac, brisés, noyés, écrasés, asphyxiés ou rôtis, tel est le sort qui nous attend, quelle que soit la manière dont la rencontre se fera !
Oui, capitaine Servadac, répondit sans hésiter le lieutenant Procope.
– Eh bien, dit Ben-Zouf, puisqu’il en est ainsi, je ne vois absolument qu’une chose à faire !
– Laquelle ? demanda Hector Servadac.
– C’est de quitter Gallia avant le choc.
– Et le moyen ?
– Oh ! le moyen est bien simple ! répondit tranquillement Ben-Zouf. Il n’y en a pas !
– Peut-être ! » dit le lieutenant Procope.
Tous les regards se portèrent sur le lieutenant, qui, la tête dans les mains, réfléchissait à quelque projet audacieux.
« Peut-être, répéta-t-il, et, si extravagant que mon plan puisse vous paraître, je crois qu’il faudra l’exécuter.
– Parle, Procope », répondit le comte Timascheff. Le lieutenant resta, pendant quelques instants encore, plongé dans ses réflexions. Puis :
« Ben-Zouf, reprit-il, a indiqué le seul parti qu’il y eût à prendre : quitter Gallia avant le choc.
– Est-ce donc possible ? demanda le comte Timascheff.
– Oui… peut-être… oui !
– Et comment ?
– Au moyen d’un ballon !…
– Un ballon ! s’écria le capitaine Servadac. Mais c’est bien usé, votre ballon ! Même dans les romans, on n’ose plus s’en servir !
– Veuillez m’écouter, messieurs, reprit le lieutenant Procope, en fronçant légèrement le sourcil. À la condition de connaître exactement l’instant où s’effectuera le choc, nous pouvons, une heure auparavant, nous enlever dans l’atmosphère de Gallia. Cette atmosphère nous entraînera nécessairement avec sa vitesse acquise ; mais, avant la rencontre, elle pourra se confondre avec l’atmosphère terrestre, et il est possible que, par une sorte de glissement, le ballon passe de l’une à l’autre, en évitant le choc direct, et qu’il se maintienne en l’air, pendant que la collision se produira.
– Bien, Procope, répondit le comte Timascheff, nous te comprenons… et ce que tu as dit là, nous le ferons !
– Sur cent chances, reprit le lieutenant Procope, nous en avons quatre-vingt-dix-neuf contre nous !
– Quatre-vingt dix-neuf !
– Au moins, car il est certain qu’au moment où son mouvement de translation s’arrêtera, le ballon sera brûlé.
– Lui aussi ? s’écria Ben-Zouf.
– Lui aussi bien que la comète, répondit Procope… à moins que dans cette fusion entre les deux atmosphères… Je ne sais trop… il me serait difficile de dire… mais mieux vaut, ce me semble, au moment du choc, avoir quitté le sol de Gallia.
– Oui ! oui ! dit le capitaine Servadac. N’y eût-il qu’une chance bonne sur cent mille, nous la courrons !
– Mais nous n’avons pas d’hydrogène pour gonfler un ballon… dit le comte Timascheff.
– L’air chaud nous suffira, répondit Procope, car il ne sera pas nécessaire de rester plus d’une heure dans l’air.
– Bien, dit le capitaine Servadac… une montgolfière… c’est primitif et plus facile à fabriquer… Mais l’enveloppe ?…
– Nous la taillerons dans les voiles de la Dobryna, qui sont en toile légère et résistante…
– Bien parlé, Procope, répondit le comte Timascheff. Tu as vraiment réponse à tout.
– Hurrah ! bravo ! » cria Ben-Zouf, pour conclure.
C’était, en vérité, un plan hardi que venait de proposer le lieutenant Procope. Toutefois, la perte des colons étant assurée en toute autre hypothèse, il fallait tenter l’aventure et résolument. Pour cela, il importait de connaître exactement, non seulement l’heure, mais la minute, mais, s’il était possible, la seconde à laquelle la collision se produirait.
Le capitaine Servadac se chargea de le demander à Palmyrin Rosette, en prenant toutes sortes de ménagements. Donc, dès cette époque, sous la direction du lieutenant, on commença la construction de la montgolfière. Elle devait être d’assez grande dimension pour enlever tous les habitants de la Terre-Chaude, au nombre de vingt-trois, – car, après leur refus, il n’y avait plus à se préoccuper des Anglais de Gibraltar et de Ceuta.
En outre, le lieutenant Procope résolut d’accroître ses chances en se donnant la possibilité de planer plus longtemps dans l’atmosphère, après le choc, si le ballon avait résisté. Il se pouvait faire qu’il eût à chercher un endroit convenable pour atterrir, et il ne fallait pas que son véhicule lui manquât. De là, cette résolution qu’il prit d’emporter une certaine quantité de combustible, herbe ou paille sèche, pour réchauffer l’air intérieur de la montgolfière. C’est ainsi que procédaient autrefois les premiers aérostiers.
Les voiles de la Dobryna avaient été emmagasinées à Nina-Ruche. Elles étaient faites d’un tissu très serré, qu’il serait facile de rendre plus étanche encore au moyen d’un vernis. Tous ces ingrédients se trouvaient dans la cargaison de la tartane, et par conséquent à la disposition du lieutenant. Celui-ci traça avec soin le gabarit des bandes à découper. Ce travail se fit dans de bonnes conditions, et tout le monde s’employa à la couture de ces bandes, – tous, y compris la petite Nina. Les matelots russes, très exercés à ce genre d’ouvrage, montrèrent aux Espagnols comment ils devaient s’y prendre, et le nouvel atelier ne chôma pas.
On dit tous, – mais en exceptant le juif, dont personne ne regretta l’absence, et Palmyrin Rosette, qui ne voulait seulement pas savoir que l’on construisît une montgolfière !
Un mois se passa dans ces travaux. Le capitaine Servadac n’avait pas encore trouvé l’occasion de poser à son ex-professeur la question relative à la nouvelle rencontre des deux astres. Palmyrin Rosette était inabordable. Des jours se passaient sans qu’on l’aperçût. La température étant redevenue presque supportable pendant le jour, il se confinait dans son observatoire, dont il avait repris possession, et il n’y laissait pénétrer personne. À une première ouverture du capitaine Servadac, il avait fort mal répondu. Plus que jamais désespéré de revenir à la terre, il ne voulait pas se préoccuper des périls du retour, ni rien faire pour le salut commun.
Et, cependant, c’était une chose essentielle que de connaître avec une extrême exactitude cet instant où les deux astres se réuniraient l’un à l’autre avec une vitesse de vingt-sept lieues à la seconde.
Le capitaine Servadac dut donc patienter, et il patienta.
Cependant, Gallia continuait à se rapprocher progressivement du soleil. Le disque terrestre grossissait visiblement aux yeux des Galliens. La comète, pendant le mois de novembre, avait franchi cinquante-neuf millions de lieues, et, au 1er décembre, elle ne s’était plus trouvée qu’à soixante-dix-huit millions de lieues du soleil.
La température se relevait considérablement et provoqua la débâcle avec le dégel. Ce fut un magnifique spectacle que celui de cette mer qui se disloquait et se dissolvait. On entendit cette « grande voix des glaces », comme disent les baleiniers. Sur les pentes du volcan et du littoral, les premiers filets d’eau serpentèrent capricieusement. Des torrents, puis des cascades s’improvisèrent en quelques jours. Les neiges des hauteurs fondaient de toutes parts.
En même temps, les vapeurs commencèrent à s’élever sur l’horizon. Peu à peu des nuages se formèrent et se déplacèrent rapidement sous l’action des vents, qui s’étaient tus pendant le long hiver gallien. On devait compter sur de prochains troubles atmosphériques, mais, en somme, c’était la vie qui revenait avec la chaleur et la lumière à la surface de la comète.
Toutefois, deux accidents prévus se produisirent alors et amenèrent la destruction de la marine gallienne.
Au moment de la débâcle, la goélette et la tartane étaient encore élevées de cent pieds au-dessus du niveau de la mer. Leur énorme piédestal avait légèrement fléchi et s’inclinait avec le dégel. Sa base, minée par les eaux plus chaudes, ainsi que cela arrive aux icebergs de la mer Arctique, menaçait de lui manquer. Il était impossible de sauver les deux bâtiments, et c’était à la montgolfière de les remplacer.
Ce fut pendant la nuit du 12 au 13 décembre que la débâcle s’accomplit. Par suite d’une rupture d’équilibre, le massif de glace culbuta tout d’un bloc. C’en était fait de la Hansa et de la Dobryna, qui se brisèrent sur les récifs du littoral.
Ce malheur, qu’ils attendaient, qu’ils ne pouvaient empêcher, ne laissa pas d’impressionner douloureusement les colons. On eût dit que quelque chose de la terre venait de leur manquer.
Dire ce que furent les lamentations d’Isac Hakhabut devant cette destruction instantanée de sa tartane, les malédictions qu’il lança contre la mauvaise race, c’est impossible. Il accusa le capitaine Servadac et les siens. Si on ne l’avait pas obligé à conduire la Hansa à cette crique de la Terre-Chaude, si on l’eût laissée au port de l’île Gourbi, tout cela ne serait pas arrivé ! On avait agi contre sa volonté, on était responsable, et, de retour à la terre, il saurait bien actionner ceux qui lui avaient causé un tel dommage !
« Mordioux ! s’écria le capitaine Servadac, taisez-vous, maître Isac, ou je vous fais mettre aux fers ! »
Isac Hakhabut se tut et retourna dans son trou.
Le 14 décembre la montgolfière fut achevée. Soigneusement cousue et vernie, elle était d’une solidité remarquable. Le filet avait été fabriqué avec les légers cordages de la Dobryna . La nacelle, faite de claies d’osier qui formaient les compartiments de cale à bord de la Hansa, était suffisante à contenir vingt-trois personnes. Il ne s’agissait, après tout, que d’une courte ascension, – le temps de se glisser avec l’atmosphère de Gallia dans l’atmosphère terrestre. On ne devait pas regarder à ses aises.
Restait donc toujours cette question d’heure, de minute et de seconde, sur laquelle le rébarbatif, l’entêté Palmyrin Rosette ne s’était pas encore prononcé.
À cette époque, Gallia recoupa l’orbite de Mars, qui se trouvait à une distance de cinquante-six millions de lieues environ. Il n’y avait donc rien à craindre.
Cependant, ce jour-là, 15 décembre, pendant la nuit, les Galliens purent croire que leur dernière heure était arrivée. Une sorte de tremblement de « terre » se produisit. Le volcan s’agita comme s’il eût été secoué par quelque convulsion souterraine. Le capitaine Servadac et ses compagnons crurent que la comète se disloquait, et ils quittèrent en toute hâte le massif ébranlé.
En même temps, des cris se firent entendre dans l’observatoire, et l’on vit apparaître sur les roches l’infortuné professeur, un morceau de sa lunette brisée à la main.
Mais on ne s’occupa pas de le plaindre. Dans cette sombre nuit, un second satellite parut graviter autour de Gallia.
C’était un morceau même de la comète !
Sous l’action d’une expansion intérieure, elle s’était dédoublée, ainsi qu’avait fait autrefois la comète Gambart. Un énorme fragment, détaché d’elle-même, avait été lancé dans l’espace, et il emportait avec lui les Anglais de Ceuta et les Anglais de Gibraltar !
Chapitre XVIII
Dans lequel on verra que les galliens se préparent à contempler d’un peu haut l’ensemble de leur astéroïde
Quelles pouvaient être les conséquences de ce grave événement au point de vue de Gallia ? Le capitaine Servadac et ses compagnons n’osaient encore répondre à cette question.
Le soleil revint promptement sur l’horizon, et d’autant plus promptement que le dédoublement avait tout d’abord produit ce résultat : si le sens du mouvement de rotation de Gallia n’était pas modifié, si la comète se mouvait toujours sur son axe de l’orient à l’occident, la durée de cette rotation diurne avait diminué de moitié. L’intervalle entre deux levers du soleil n’était plus que de six heures au lieu de douze. Six heures après avoir paru sur l’horizon, l’astre radieux se couchait sur l’horizon opposé.
« Mordioux ! avait dit le capitaine Servadac, cela nous fait une année de deux mille huit cents jours !
– Il n’y aura jamais assez de saints pour ce calendrier là ! » avait répondu Ben-Zouf.
Et de fait, si Palmyrin Rosette voulait réapproprier son calendrier à la nouvelle durée des jours galliens, il en viendrait à parler du 238 juin ou du 325 décembre !
Quant à ce morceau de Gallia qui emportait les Anglais et Gibraltar, il fut manifestement visible qu’il ne gravitait pas autour de la comète. Il s’en éloignait, au contraire. Mais avait-il entraîné avec lui une portion quelconque de la mer et de l’atmosphère galliennes ? Se trouvait-il dans des conditions d’habitabilité suffisantes ? Et, en dernier compte, reviendrait-il jamais à la terre ?
On le saurait plus tard.
Quelles étaient les conséquences du dédoublement sur la marche de Gallia ? Voilà ce que le comte Timascheff, le capitaine Servadac et le lieutenant Procope s’étaient tout d’abord demandé. Ils avaient d’abord senti un accroissement de leurs forces musculaires et constaté une nouvelle diminution de la pesanteur. La masse de Gallia ayant diminué dans une proportion notable, sa vitesse n’en serait-elle pas modifiée, et ne pouvait-on craindre qu’un retard ou une avance dans sa révolution ne lui fissent manquer la terre ?
C’eût été là un irréparable malheur !
Mais la vitesse de Gallia avait-elle varié, si peu que ce fût ? Le lieutenant Procope ne le pensait pas. Toutefois il n’osait se prononcer, n’ayant pas des connaissances suffisantes en ces matières.
Seul, Palmyrin Rosette pouvait répondre à cette question. Il fallait donc, d’une manière ou d’une autre, par la persuasion ou par la violence, l’obliger à parler, et à dire en même temps quelle était l’heure précise à laquelle la rencontre aurait lieu.
Tout d’abord, pendant les jours suivants, on put constater que le professeur était d’une humeur massacrante. Était-ce la perte de sa fameuse lunette, ou ne pouvait-on en conclure ceci : c’est que le dédoublement n’avait point altéré la vitesse de Gallia, et que, conséquemment, elle rencontrerait la terre au moment précis. En effet, si, par suite du dédoublement, la comète eût avancé ou retardé, si le retour eût été compromis, la satisfaction de Palmyrin Rosette aurait été telle qu’il n’eût pu la contenir. Puisque sa joie ne débordait pas, c’est qu’il n’avait pas sujet d’être joyeux, – au moins de ce chef.
Le capitaine Servadac et ses compagnons tablèrent donc sur cette remarque, mais cela ne suffisait pas. Il fallait arracher son secret à ce hérisson.
Enfin, le capitaine Servadac y parvint. Voici dans quelles circonstances :
C’était le 18 décembre. Palmyrin Rosette, exaspéré, venait de soutenir une violente discussion avec Ben-Zouf. Celui-ci avait insulté le professeur en la personne de sa comète ! Un bel astre, ma foi, qui se disloquait comme un joujou d’enfant, qui crevait comme une outre, qui se fendait comme une noix sèche ! Autant vivre sur un obus, sur une bombe, dont la mèche est allumée ! etc. Enfin, on imagine aisément ce que Ben-Zouf avait pu broder sur ce thème. Les deux interlocuteurs s’étaient réciproquement jeté, l’un Gallia, l’autre Montmartre, à la tête.
Le hasard fit que le capitaine Servadac intervint au plus chaud de la discussion. Fût-ce une inspiration d’en haut ? mais il se dit que puisque la douceur ne réussissait pas avec Palmyrin Rosette, peut-être la violence agirait-elle plus efficacement, et il prit le parti de Ben-Zouf.
Colère du professeur, qui se traduisit instantanément par les paroles les plus aigres.
Colère, mais colère feinte, du capitaine Servadac, qui finit par dire :
« Monsieur le professeur, vous avez une liberté de langage qui ne me convient pas et que je suis résolu à ne plus supporter ! Vous ne vous souvenez pas assez que vous parlez au gouverneur général de Gallia !
– Et vous, riposta l’irascible astronome, vous oubliez beaucoup trop que vous répondez à son propriétaire !
– Il n’importe, monsieur ! Vos droits de propriété sont, après tout, très contestables !
– Contestables ?
– Et puisqu’il nous est impossible, maintenant, de revenir à la terre, vous vous conformerez désormais aux lois qui régissent Gallia !
– Ah ! vraiment ! répondit Palmyrin Rosette, je devrai me soumettre à l’avenir !
– Parfaitement.
– Maintenant surtout que Gallia ne doit pas revenir à la terre ?…
– Et que, par conséquent, nous sommes destinés à y vivre éternellement, répondit le capitaine Servadac.
– Et pourquoi Gallia ne doit-elle plus revenir à la terre ? demanda le professeur avec l’accent du plus profond mépris.
– Parce que depuis qu’elle s’est dédoublée, répondit le capitaine Servadac, sa masse a diminué, et que, par conséquent, un changement a dû se produire dans sa vitesse.
– Et qui a dit cela ?
– Moi, tout le monde !
– Eh bien, capitaine Servadac, tout le monde et vous, vous êtes des…
– Monsieur Rosette !
– Des ignorants, des ânes bâtés, qui ne connaissez rien à la mécanique céleste !
– Prenez garde !
– Ni à la physique la plus élémentaire…
– Monsieur !…
– Ah ! mauvais élève ! reprit le professeur, dont la colère atteignait au paroxysme. Je n’ai point oublié qu’autrefois vous déshonoriez ma classe !…
– C’en est trop !…
– Que vous étiez la honte de Charlemagne !…
– Vous vous tairez, sinon…
– Non, je ne me tairai pas, et vous m’écouterez, tout capitaine que vous êtes ! Vraiment ! Les beaux physiciens ! Parce que la masse de Gallia a diminué, ils se figurent que cela a pu modifier sa vitesse tangentielle ! Comme si cette vitesse ne dépendait pas uniquement de sa vitesse primordiale combinée avec l’attraction solaire ! Comme si les perturbations ne s’obtenaient pas sans qu’on tînt compte des masses des astres troublés ! Est-ce qu’on connaît la masse des comètes ? Non ! Est-ce qu’on calcule leurs perturbations ? Oui ! Ah ! vous me faites pitié ! »
Le professeur s’emportait. Ben-Zouf, prenant la colère du capitaine Servadac au sérieux, lui dit :
« Voulez-vous que je le casse en deux, mon capitaine, que je le dédouble comme sa fichue comète ?
– Eh bien, touchez-moi seulement ! s’écria Palmyrin Rosette en se redressant de toute sa petite taille.
– Monsieur, répliqua vivement le capitaine Servadac, je saurai vous mettre à la raison !
– Et moi, vous traduire pour menaces et voies de fait devant les tribunaux compétents !
– Les tribunaux de Gallia ?
– Non, monsieur le capitaine, mais ceux de la terre !
– Allons donc ! La terre est loin ! repartit le capitaine Servadac.
– Si loin qu’elle soit, s’écria Palmyrin Rosette, emporté au-delà de toute mesure, nous n’en couperons pas moins son orbite au nœud ascendant, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, et nous y arriverons à deux heures quarante-sept minutes trente-cinq secondes et six dixièmes du matin !…
– Mon cher professeur, répondit le capitaine Servadac avec un salut gracieux, je ne vous en demandais pas davantage ! »
Et il quitta Palmyrin Rosette, absolument interloqué, auquel Ben-Zouf crut devoir adresser un salut non moins gracieux que celui de son capitaine.
Hector Servadac et ses compagnons savaient enfin ce qu’ils avaient tant intérêt à savoir. À deux heures quarante-sept minutes trente-cinq secondes et six dixièmes du matin s’effectuerait la rencontre.
Donc, encore quinze jours terrestres, soit trente-deux jours galliens de l’ancien calendrier, soit soixante-quatre du nouveau !
Cependant, les préparatifs de départ s’accomplissaient avec une ardeur sans pareille. C’était pour tous une hâte d’avoir quitté Gallia. La montgolfière du lieutenant Procope semblait être un moyen assuré de rallier le globe terrestre. Se glisser avec l’atmosphère gallienne dans l’atmosphère terrestre, cela paraissait être la chose la plus facile du monde. On oubliait les mille dangers de cette situation sans précédent dans les voyages aérostatiques ! Rien n’était plus naturel ! Et, pourtant, le lieutenant Procope répétait avec raison que la montgolfière, brusquement arrêtée dans son mouvement de translation, serait brûlée avec tous ceux qu’elle porterait, – à moins de miracle. Le capitaine Servadac se montrait, à dessein, enthousiasmé. Quant à Ben-Zouf, il avait toujours voulu faire une promenade en ballon. Il était donc au comble de ses vœux.
Le comte Timascheff, plus froid, et le lieutenant Procope, plus réservé, envisageaient seuls tout ce que cette tentative offrait de dangers. Mais ils étaient prêts à tout.
À cette époque, la mer, délivrée de ses glaçons, était redevenue praticable. La chaloupe à vapeur fut mise en état, et, avec ce qui restait de charbon, on fit plusieurs voyages à l’île Gourbi.
Le capitaine Servadac, Procope et quelques Russes furent du premier voyage. Ils retrouvèrent l’île, le gourbi, le poste, respectés par ce long hiver. Des ruisseaux coulaient à la surface du sol. Les oiseaux, ayant quitté la Terre-Chaude à tire-d’aile, étaient revenus à ce bout de terre fertile, où ils revoyaient la verdure des prairies et des arbres. Des plantes nouvelles apparaissaient sous l’influence de cette chaleur équatoriale des jours de trois heures. Le soleil leur versait ses rayons perpendiculaires avec une extraordinaire intensité. C’était l’été brûlant, succédant presque inopinément à l’hiver.
Ce fut à l’île Gourbi que l’on fit la récolte de l’herbe et de la paille qui devaient servir au gonflement de la montgolfière. Si cet énorme appareil n’eût pas été si encombrant, peut-être l’aurait-on transporté par mer à l’île Gourbi. Mais il parut préférable de s’enlever de la Terre-Chaude et d’y apporter le combustible destiné à opérer la raréfaction de l’air.
Déjà, pour les besoins journaliers, on brûlait le bois provenant des débris des deux navires. Lorsqu’il fut question d’utiliser ainsi les bordages de la tartane, Isac Hakhabut voulut s’y opposer. Mais Ben-Zouf lui fit entendre qu’on lui ferait payer cinquante mille francs sa place dans la nacelle, s’il s’avisait seulement d’ouvrir la bouche.
Isac Hakhabut soupira et se tut.
Le 25 décembre arriva. Tous les préparatifs de départ étaient terminés. On fêta la Noël comme on l’avait fêtée un an auparavant, mais avec un plus vif sentiment religieux. Quant au prochain jour de l’an, c’était sur terre que tous ces braves gens comptaient bien le célébrer, et Ben-Zouf alla jusqu’à promettre de belles étrennes au jeune Pablo et à la petite fille.
« Voyez-vous, leur dit-il, c’est comme si vous les teniez ! »
Bien que cela soit peut-être difficile à admettre, à mesure que le moment suprême approchait, le capitaine Servadac et le comte Timascheff pensaient à toute autre chose qu’aux dangers de l’atterrissage. La froideur qu’ils se témoignaient n’était point feinte. Ces deux années qu’ils venaient de passer ensemble loin de la terre, c’était pour eux comme un rêve oublié, et ils allaient se retrouver sur le terrain de la réalité, en face l’un de l’autre. Une image charmante se plaçait entre eux et les empêchait de se voir comme autrefois.
Et c’est alors que vint au capitaine Servadac la pensée d’achever ce fameux rondeau, dont le dernier quatrain était resté inachevé. Quelques vers encore, et ce délicieux petit poème serait complet. C’était un poète que Gallia avait enlevé à la terre, ce serait un poète qu’elle lui rendrait !
Et, entre-temps, le capitaine Servadac repassait toutes ses malencontreuses rimes dans sa tête.
Quant aux autres habitants de la colonie, le comte Timascheff et le lieutenant Procope avaient hâte de revoir la terre, et les Russes n’avaient qu’une pensée : suivre leur maître partout où il lui plairait de les mener.
Les Espagnols, eux, s’étaient si bien trouvés sur Gallia, qu’ils y auraient volontiers passé le reste de leurs jours. Mais enfin Negrete et les siens ne reverraient pas les campagnes de l’Andalousie sans quelque plaisir.
Pour Pablo et Nina, ils étaient enchantés de revenir avec tous leurs amis, mais à la condition de ne plus jamais se quitter.
Restait donc un seul mécontent, le rageur Palmyrin Rosette. Il ne décolérait pas. Il jurait qu’il ne s’embarquerait pas dans la nacelle. Non ! il prétendait ne pas abandonner sa comète. Il continuait jour et nuit ses observations astronomiques. Ah ! combien sa regrettable lunette lui faisait défaut ! Voilà que Gallia allait pénétrer dans cette étroite zone des étoiles filantes ! N’y avait-il pas là des phénomènes à observer, quelque découverte à faire ?
Palmyrin Rosette, désespéré, employa alors un moyen héroïque en augmentant la pupille de ses yeux, afin de remplacer tant soit peu la puissance optique de sa lunette. Il se soumit à l’action de la belladone, ingrédient qu’il emprunta à la pharmacie de Nina-Ruche, et alors il regarda, il regarda à se rendre aveugle ! Mais, bien qu’il eût ainsi accru l’intensité de la lumière qui se peignait sur sa rétine, il ne vit rien, il ne découvrit rien !
Les derniers jours se passèrent dans une surexcitation fébrile dont personne ne fut exempt. Le lieutenant Procope surveillait les derniers détails. Les deux bas-mâts de la goélette avaient été plantés sur la grève et servaient de support à l’énorme montgolfière, non encore gonflée, mais revêtue du réseau de son filet. La nacelle était là, suffisante à contenir ses passagers. Quelques outres, attachées à ses montants, devaient lui permettre de surnager un certain temps, pour le cas où la montgolfière atterrirait en mer, près d’un littoral. Évidemment, si elle tombait en plein Océan, elle coulerait bientôt avec tous ceux qu’elle portait, à moins que quelque navire ne se trouvât à point pour les recueillir.
Les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre s’écoulèrent. Il n’y avait plus que quarante-huit heures terrestres à passer sur Gallia.
Le 31 décembre arriva. Encore vingt-quatre heures, et la montgolfière, enlevée par l’air chaud raréfié dans ses flancs, planerait dans l’atmosphère gallienne. Il est vrai que cette atmosphère était moins dense que celle de la terre ; mais il faut considérer aussi que l’attraction étant moindre, l’appareil serait moins lourd à enlever.
Gallia se trouvait alors à quarante millions de lieues du soleil, distance un peu supérieure à celle qui sépare le soleil de la terre. Elle s’avançait avec une excessive vitesse vers l’orbite terrestre qu’elle allait couper à son nœud ascendant, précisément au point de l’écliptique qu’occuperait le sphéroïde.
Quant à la distance qui séparait la comète de la terre, elle n’était plus que de deux millions de lieues. Or, les deux astres marchant l’un vers l’autre, cette distance allait être franchie à raison de quatre-vingt-sept mille lieues à l’heure. Gallia en faisant cinquante-sept mille, et la terre vingt-neuf mille environ.
Enfin, à deux heures du matin, les Galliens se préparèrent à partir. La rencontre allait s’effectuer dans quarante-sept minutes et trente-cinq secondes.
Par suite de la modification du mouvement de rotation de Gallia sur son axe, il faisait jour alors, – jour aussi sur ce côté du globe terrestre que la comète allait heurter.
Depuis une heure, le gonflement de la montgolfière était complet. Il avait parfaitement réussi. L’énorme appareil, se balançant entre les mâts, était prêt à partir. La nacelle, accrochée au filet, n’attendait que ses passagers.
Gallia n’était plus qu’à soixante-quinze mille lieues de la terre.
Isac Hakhabut, le premier, prit place dans la nacelle.
Mais, à ce moment, le capitaine Servadac remarqua qu’une ceinture, énormément gonflée, ceignait la taille du juif.
« Qu’est cela ? demanda-t-il.
– Ça, monsieur le gouverneur, répondit Isac Hakhabut, c’est ma modeste fortune que j’emporte avec moi !
– Et que pèse-t-elle, votre modeste fortune ?
– Oh ! une trentaine de kilos seulement.
– Trente kilos, et notre montgolfière n’a que la force ascensionnelle suffisante pour nous enlever ! Débarrassez-vous, maître Isac, de cet inutile fardeau.
– Mais, monsieur le gouverneur…
– Inutile, vous dis-je, puisque nous ne pouvons surcharger ainsi la nacelle !
– Dieu de l’univers ! s’écria Isac, toute ma fortune, tout mon bien, si péniblement amassé !
– Eh ! maître Isac, vous savez bien que votre or n’aura plus aucune valeur sur la terre, puisque Gallia vaut deux cent quarante-six sextillions !…
– Mais, monseigneur, par pitié !…
– Allons, Mathathias, dit alors Ben-Zouf, délivre-nous de ta présence ou de ton or, – à ton choix ! »
Et le malheureux Isac dut se délester de son énorme ceinture, au milieu de lamentations et d’objurgations dont on n’essayera même pas de donner une idée.
Quant à Palmyrin Rosette, ce fut une bien autre affaire. Le savant rageur prétendait ne pas quitter le noyau de sa comète. C’était l’arracher de son domaine ! D’ailleurs, cette montgolfière, c’était un appareil absurdement imaginé ! Le passage d’une atmosphère à l’autre ne pourrait s’opérer sans que le ballon flambât comme une simple feuille de papier ! Il y avait moins de danger à rester sur Gallia, et dans le cas où, par impossible, Gallia ne ferait qu’effleurer la terre, au moins Palmyrin Rosette continuerait à graviter avec elle ! Enfin, mille raisons accompagnées d’imprécations furibondes ou grotesques, – telles que menaces d’accabler de pensums l’élève Servadac.
Quoi qu’il en soit, le professeur fut introduit le second dans la nacelle, mais garrotté et maintenu par deux robustes matelots. Le capitaine Servadac, bien déterminé à ne point le laisser sur Gallia, l’avait embarqué de cette façon un peu vive.
Il avait fallu abandonner les deux chevaux et la chèvre de Nina ! Ce fut un crève-cœur pour le capitaine, Ben-Zouf et la petite fille, mais on ne pouvait les prendre. Seul de tous les animaux, le pigeon de Nina avait une place réservée. Qui sait, d’ailleurs, si ce pigeon ne servirait pas de messager entre les passagers de la nacelle et quelque point de la surface terrestre ?
Le comte Timascheff et le lieutenant Procope s’embarquèrent sur une invitation du capitaine.
Celui-ci foulait encore le sol gallien avec son fidèle Ben-Zouf.
« Allons, Ben-Zouf, à ton tour, dit-il.
– Après vous, mon capitaine !
– Non. Je dois rester le dernier à bord, comme un commandant qui est forcé d’abandonner son navire !
– Cependant…
– Fais, te dis-je.
– Par obéissance, alors ! » répondit Ben-Zouf.
Ben-Zouf enjamba le bord de la nacelle. Le capitaine Servadac y prit place après lui.
Les derniers liens furent alors coupés, et la montgolfière s’éleva majestueusement dans l’atmosphère.
Chapitre XIX
Dans lequel on chiffre, minute par minute, les sensations et impressions des passagers de la nacelle
La montgolfière atteignit une hauteur de deux mille cinq cents mètres. Le lieutenant Procope résolut de la maintenir dans cette zone. Un foyer en fil de fer, suspendu à l’appendice inférieur de l’appareil et chargé d’herbe sèche, pouvait être allumé facilement et conserver l’air intérieur au degré de raréfaction voulue pour que la montgolfière ne s’abaissât pas.
Les passagers de la nacelle regardèrent sous eux, autour d’eux, au-dessus d’eux.
Au-dessous s’étendait une large partie de la mer Gallienne, qui semblait former un bassin concave. Dans le nord, un point isolé, c’était l’île Gourbi.
En vain eût-on cherché, dans l’ouest, les îlots de Gibraltar et de Ceuta. Ils avaient disparu.
Au sud se dressait le volcan, dominant le littoral et le vaste territoire de la Terre-Chaude. Cette presqu’île se raccordait au continent, qui encadrait la mer Gallienne. Partout cet étrange aspect, cette contexture lamelleuse, alors irisée sous les rayons solaires. Partout cette matière minérale du tellurure d’or, qui semblait uniquement constituer la charpente de la comète, le noyau dur de Gallia.
Autour de la nacelle, au-dessus de l’horizon, qui semblait s’être relevé avec le mouvement ascensionnel de la montgolfière, le ciel se développait avec une extrême pureté. Mais vers le nord-ouest, en opposition avec le soleil, gravitait un astre nouveau, moins qu’un astre, moins qu’un astéroïde, – ce que serait une sorte de bolide. C’était le fragment qu’une force intérieure avait rejeté des flancs de Gallia. Cet énorme bloc s’éloignait suivant une nouvelle trajectoire, et sa distance se mesurait alors par plusieurs milliers de lieues. Il était peu visible, d’ailleurs ; mais, la nuit venue, il se fût montré comme un point lumineux dans l’espace.
Enfin, au-dessus de la nacelle, un peu obliquement, apparaissait le disque terrestre dans toute sa splendeur. Il semblait se précipiter sur Gallia et occultait une portion considérable du ciel.
Ce disque, splendidement éclairé, éblouissait le regard. La distance était déjà trop courte, relativement, pour qu’il fût possible d’en distinguer à la fois les deux pôles. Gallia s’en trouvait moitié plus rapprochée que n’en est la lune à sa distance moyenne, qui diminuait avec chaque minute dans une énorme proportion. Diverses taches brillaient à sa surface, les unes avec éclat, c’étaient les continents, les autres, plus sombres, par cela même qu’elles absorbaient les rayons solaires, c’étaient les océans. Au-dessus se déplaçaient lentement de grandes bandes blanches, que l’on sentait obscures sur leur face opposée : c’étaient les nuages répandus dans l’atmosphère terrestre.
Mais bientôt, avec une telle vitesse de vingt-neuf lieues à la seconde, l’aspect un peu vague du disque terrestre se dessina plus nettement. Les vastes cordons littoraux se détachèrent, les reliefs s’accentuèrent. Montagnes et plaines ne se laissèrent plus confondre. La carte plate s’accidenta, et il semblait aux observateurs de la nacelle qu’ils fussent penchés sur une carte en relief.
À deux heures vingt-sept minutes du matin, la comète n’était pas à trente mille lieues du sphéroïde terrestre. Les deux astres volaient l’un vers l’autre. À deux heures trente-sept, quinze mille lieues restaient encore à franchir.
Les grandes lignes du disque se distinguaient nettement alors, et trois cris échappèrent au lieutenant Procope, au comte Timascheff et au capitaine Servadac :
« L’Europe !
– La Russie !
– La France ! »
Et ils ne se trompaient pas. La terre tournait vers Gallia cette face où s’étalait le continent européen, en plein midi. La configuration de chaque pays était aisément reconnaissable. Les passagers de la nacelle regardaient avec une vive émotion cette terre prête à les absorber. Ils ne songeaient qu’à atterrir et non plus aux dangers de l’atterrissement. Ils allaient enfin rentrer dans cette humanité qu’ils avaient cru ne jamais revoir. Oui, c’était bien l’Europe qui s’étalait visiblement sous leurs yeux ! Ils voyaient ses divers États avec la configuration bizarre que la nature ou les conventions internationales leur ont donnée. L’Angleterre, une lady qui marche vers l’est, dans sa robe aux plis tourmentés et sa tête coiffée d’îlots et d’îles. La Suède et la Norvège, un lion magnifique, développant son échine de montagnes et se précipitant sur l’Europe du sein des contrées hyperboréennes.
La Russie, un énorme ours polaire, la tête tournée vers le continent asiatique, la patte gauche appuyée sur la Turquie, la patte droite sur le Caucase.
L’Autriche, un gros chat pelotonné sur lui-même et dormant d’un sommeil agité.
L’Espagne, déployée comme un pavillon au bout de l’Europe et dont le Portugal semble former le yacht.
La Turquie, un coq qui se rebiffe, se cramponnant d’une griffe au littoral asiatique, de l’autre étreignant la Grèce.
L’Italie, une botte élégante et fine qui semble jongler avec la Sicile, la Sardaigne et la Corse.
La Prusse, une hache formidable profondément enfoncée dans l’empire allemand et dont le tranchant effleure la France.
La France enfin, un torse vigoureux, avec Paris au cœur.
Oui, tout cela se voyait, se sentait. L’émotion était dans la poitrine de tous. Et cependant une note comique éclata au milieu de cette impression générale.
« Montmartre ! » s’écria Ben-Zouf.
Et il n’aurait pas fallu soutenir à l’ordonnance du capitaine Servadac qu’il ne pouvait apercevoir de si loin sa butte favorite !
Quant à Palmyrin Rosette, la tête penchée hors de la nacelle, il n’avait de regards que pour cette abandonnée Gallia, qui flottait à deux mille cinq cents mètres au-dessous de lui. Il ne voulait même pas voir cette terre qui le rappelait à elle, et il n’observait que sa comète, vivement éclairée dans l’irradiation générale de l’espace.
Le lieutenant Procope, son chronomètre à la main, comptait les minutes et les secondes. Le foyer, de temps en temps ravivé par son ordre, maintenait la montgolfière dans la zone convenable.
Cependant, on parlait peu dans la nacelle. Le capitaine Servadac, le comte Timascheff observaient avidement la terre. La montgolfière, par rapport à elle, se trouvait un peu sur le côté, mais en arrière de Gallia, c’est-à-dire que la comète devait précéder dans sa chute l’appareil aérostatique, – circonstance favorable, puisque celui-ci, en se glissant dans l’atmosphère terrestre, n’aurait pas à effectuer un revirement bout pour bout.
Mais où tomberait-il ? Serait-ce sur un continent ? Et, dans ce cas, ce continent offrirait-il quelques ressources ? Les communications seraient-elles faciles avec une portion habitée du globe ? Serait-ce sur un océan ? Et, dans ce cas, pouvait-on compter sur le miracle d’un navire, venant sauver les naufragés en mer ? Que de périls de toutes parts, et le comte Timascheff n’avait-il pas eu raison de dire que ses compagnons et lui étaient absolument dans la main de Dieu ?
« Deux heures quarante-deux minutes », dit le lieutenant Procope au milieu du silence général.
Cinq minutes trente-cinq secondes six dixièmes encore, et les deux astres se heurteraient !… Ils étaient à moins de huit mille lieues l’un de l’autre. Le lieutenant Procope observa alors que la comète suivait une direction un peu oblique à la terre. Les deux mobiles ne couraient pas sur la même ligne. Cependant, on devait croire qu’il y aurait arrêt subit et complet de la comète, et non pas un simple effleurement, comme cela s’était effectué deux ans auparavant. Si Gallia ne choquait pas normalement le globe terrestre, néanmoins, semblait-il, « elle s’y collerait vivement », dit Ben-Zouf.
Enfin, si aucun des passagers de la nacelle ne devait survivre à cette rencontre, si la montgolfière, prise dans les remous atmosphériques au moment où se fusionneraient les deux atmosphères, était déchirée et précipitée sur le sol, si aucun de ces Galliens ne devait revenir parmi ses semblables, tout souvenir d’eux-mêmes, de leur passage sur la comète, de leur pérégrination dans le monde solaire, allait-il donc être à jamais anéanti ?
Non ! le capitaine Servadac eut une idée. Il déchira une feuille de son carnet. Sur cette feuille, il inscrivit le nom de la comète, celui des parcelles enlevées au globe terrestre, les noms de ses compagnons, et le tout, il le signa du sien.
Puis il demanda à Nina le pigeon voyageur qu’elle tenait pressé sur sa poitrine.
Après l’avoir baisé tendrement, la petite fille donna son pigeon, sans hésiter.
Le capitaine Servadac prit l’oiseau, lui attacha au cou sa notice, et il le lança dans l’espace.
Le pigeon descendit en tournoyant dans l’atmosphère gallienne, et se tint dans une zone moins élevée que la montgolfière.
Encore deux minutes, et environ trois mille deux cents lieues ! Les deux astres allaient s’aborder avec une vitesse trois fois plus grande que celle qui anime la terre le long de l’écliptique.
Inutile d’ajouter que les passagers de la nacelle ne sentaient rien de cette effroyable vitesse, et que leur appareil semblait rester absolument immobile au milieu de l’atmosphère qui l’entraînait.
« Deux heures quarante-six minutes », dit le lieutenant Procope.
La distance était réduite à dix-sept cents lieues. La terre semblait se creuser comme un vaste entonnoir au-dessous de la comète. On eût dit qu’elle s’ouvrait pour la recevoir !
« Deux heures quarante-sept minutes », dit encore une fois le lieutenant Procope.
Plus que trente-cinq secondes six dixièmes, et une vitesse de deux cent soixante-dix lieues par seconde !
Enfin, une sorte de frémissement se fit entendre. C’était l’air gallien que soutirait la terre, et avec lui la montgolfière, allongée à faire croire qu’elle allait se rompre !
Tous s’étaient cramponnés aux rebords de la nacelle, épouvantés, effarés…
Alors les deux atmosphères se confondirent. Un énorme amas de nuages se forma. Des vapeurs s’accumulèrent. Les passagers de la nacelle ne virent plus rien ni au-dessus ni au-dessous d’eux. Il leur sembla qu’une flamme immense les enveloppait, que le point d’appui manquait sous leurs pieds, et sans savoir comment, sans pouvoir l’expliquer, ils se retrouvèrent sur le sol terrestre. C’était dans un évanouissement qu’ils avaient quitté le globe, c’était dans un évanouissement qu’ils y revenaient !
Quant au ballon, plus de vestige !
En même temps, Gallia fuyait obliquement par la tangente, et, contre toute prévision, après avoir effleuré seulement le globe terrestre, elle disparaissait dans l’est du monde.
Chapitre XX
Qui, contrairement à toutes les règles du roman, ne se termine pas par le mariage du héros
« Ah ! mon capitaine, l’Algérie !
– Et Mostaganem, Ben-Zouf ! »
Telles furent les deux exclamations qui s’échappèrent à la fois de la bouche du capitaine Servadac et de celle de son ordonnance, dès que leurs compagnons et eux eurent repris connaissance. Par un miracle, impossible à expliquer comme tous les miracles, ils étaient sains et saufs. « Mostaganem ! l’Algérie ! » avaient dit le capitaine Servadac et son ordonnance. Et ils ne pouvaient se tromper, ayant été pendant plusieurs années en garnison dans cette partie de la province. Ils revenaient donc presque à l’endroit d’où ils étaient partis, après un voyage de deux ans à travers le monde solaire ! Un hasard étonnant – est-ce bien un hasard, puisque Gallia et la terre se rencontraient à la même seconde sur le même point de l’écliptique ? – les ramenait presque à leur point de départ. Ils n’étaient pas à deux kilomètres de Mostaganem ! Une demi-heure plus tard, le capitaine Servadac et tous ses compagnons faisaient leur entrée dans la ville.
Ce qui dut leur paraître surprenant, c’est que tout paraissait être calme à la surface de la terre. La population algérienne vaquait tranquillement à ses occupations ordinaires. Les animaux, nullement troublés, paissaient l’herbe un peu humide de la rosée de janvier. Il devait être environ huit heures du matin. Le soleil se levait sur son horizon accoutumé. Non seulement il ne semblait pas que rien d’anormal se fût accompli sur le globe terrestre, mais aussi que rien d’anormal n’eût été attendu par ses habitants.
« Ah çà ! dit le capitaine Servadac, ils n’étaient donc pas prévenus de l’arrivée de la comète ?
– Faut le penser, mon capitaine, répondit Ben-Zouf. Et moi qui comptais sur une entrée triomphale ! »
Bien évidemment, le choc d’une comète n’était pas attendu. Autrement, la panique eût été extraordinaire en toutes les parties du globe, et ses habitants se seraient crus plus près de la fin du monde qu’en l’an 1000 !
À la porte de Mascara, le capitaine Servadac rencontra précisément ses deux camarades, le commandant du 2e tirailleurs et le capitaine du 8e d’artillerie. Il tomba littéralement dans leurs bras.
« Vous, Servadac ! s’écria le commandant.
– Moi-même !
– Et d’où venez-vous, mon pauvre ami, après cette inexplicable absence ?
– Je vous le dirais bien, mon commandant, mais si je vous le disais, vous ne me croiriez pas !
– Cependant…
– Bah ! mes amis ! Serrez la main à un camarade qui ne vous a point oubliés, et mettons que je n’ai fait qu’un rêve ! »
Et Hector Servadac, quoi qu’on fît, ne voulut pas en dire davantage. Toutefois, une question fut encore adressée par lui aux deux officiers :
« Et Mme de… ? »
Le commandant de tirailleurs, qui comprit, ne le laissa pas achever.
« Mariée, remariée, mon cher ! dit-il. Que voulez-vous ? Les absents ont toujours tort…
– Oui ! répondit le capitaine Servadac, tort d’aller courir pendant deux ans dans le pays des chimères ! »
Puis, se retournant vers le comte Timascheff :
« Mordioux ! monsieur le comte, dit-il, vous avez entendu ! En vérité, je suis enchanté de ne point avoir à me battre avec vous.
– Et moi, capitaine, je suis heureux de pouvoir, sans arrière-pensée, vous serrer cordialement la main !
– Ce qui me va aussi, murmura Hector Servadac, c’est de ne pas avoir à finir mon horrible rondeau ! »
Et les deux rivaux, qui n’avaient plus aucune raison d’être en rivalité, scellèrent, en se donnant la main, une amitié que rien ne devait jamais rompre.
Le comte Timascheff, d’accord avec son compagnon, fut aussi réservé que lui sur les événements extraordinaires dont ils avaient été témoins, et dont les plus inexplicables étaient leur départ et leur arrivée. Ce qui leur paraissait absolument inexplicable, c’est que tout était à sa place sur le littoral méditerranéen.
Décidément, mieux valait se taire.
Le lendemain, la petite colonie se séparait. Les Russes retournèrent en Russie avec le comte Timascheff et le lieutenant Procope, les Espagnols en Espagne, où la générosité du comte devait les mettre pour jamais à l’abri du besoin. Tous ces braves gens ne se quittèrent pas sans s’être prodigué les marques de la plus sincère amitié.
En ce qui concerne Isac Hakhabut, ruiné par la perte de la Hansa, ruiné par l’abandon qu’il avait dû faire de son or et de son argent, il disparut. La vérité oblige à avouer que personne ne le réclama.
« Le vieux coquin, dit un jour Ben-Zouf, il doit s’exhiber en Amérique comme un revenant du monde solaire ! »
Il reste à parler de Palmyrin Rosette.
Celui-là, aucune considération, on le croira sans peine, n’avait pu le faire taire ! Donc, il avait parlé !… On lui nia sa comète, qu’aucun astronome n’avait jamais aperçue sur l’horizon terrestre. Elle ne fut point inscrite au catalogue de l’Annuaire. À quel point atteignit alors la rage de l’irascible professeur, c’est à peine si l’on peut l’imaginer. Deux ans après son retour, il fit paraître un volumineux mémoire qui contenait, avec les éléments de Gallia, le récit des propres aventures de Palmyrin Rosette.
Alors, les avis se partagèrent dans l’Europe savante. Les uns, en grand nombre, furent contre. Les autres, en petit nombre, furent pour.
Une réponse à ce mémoire – et c’était probablement la meilleure que l’on pût faire – réduisit tout le travail de Palmyrin Rosette à de justes mesures, en l’intitulant :
Histoire d’une hypothèse.
Cette impertinence porta à son comble la colère du professeur, qui prétendit alors avoir revu, gravitant dans l’espace, non seulement Gallia, mais le fragment de la comète qui emportait treize Anglais dans les infinis de l’univers sidéral ! Jamais il ne devait se consoler de ne pas être leur compagnon de voyage !
Enfin, qu’ils eussent ou non réellement accompli cette exploration invraisemblable du monde solaire, Hector Servadac et Ben-Zouf restèrent plus que jamais, l’un le capitaine, l’autre l’ordonnance, que rien ne pouvait séparer.
Un jour, ils se promenaient sur la butte Montmartre, et, bien certains de ne point être entendus, ils causaient de leurs aventures.
« Ce n’est peut-être pas vrai, tout de même ! disait Ben-Zouf.
– Mordioux ! je finirai par le croire ! » répondit le capitaine Servadac.
Quant à Pablo et à Nina, adoptés, l’un par le comte Timascheff, l’autre par le capitaine Servadac, ils furent élevés et instruits sous leur direction.
Un beau jour, le colonel Servadac, dont les cheveux commençaient à grisonner, maria le jeune Espagnol, devenu un beau garçon, avec la petite Italienne, devenue une belle jeune fille. Le comte Timascheff avait voulu apporter lui-même la dot de Nina.
Et cela fait, les deux jeunes époux n’en furent pas moins heureux, pour n’avoir point été l’Adam et l’Ève d’un nouveau monde.