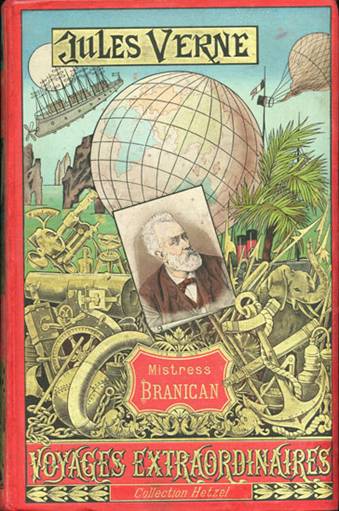Il y a deux chances de ne
jamais revoir les amis dont on se sépare pour un long voyage : ceux qui
restent peuvent ne se plus retrouver au retour ; ceux qui partent peuvent
ne plus revenir. Mais ils ne se préoccupaient guère de cette éventualité, les marins
qui faisaient leurs préparatifs d’appareillage à bord du Franklin, dans
la matinée du 15 mars 1875.
Ce jour-là, le Franklin, capitaine
John Branican, était sur le point de quitter le port de San-Diégo (Californie)
pour une navigation à travers les mers septentrionales du Pacifique.
Un joli navire, de neuf cents
tonneaux, ce Franklin, gréé en trois-mâts-goélette, largement voilé de
brigantines, focs et flèches, hunier et perroquet à son mât de misaine. Très
relevé de ses fayons d’arrière, légèrement rentré de ses œuvres vives, avec son
avant disposé pour couper l’eau sous un angle très fin, sa mâture un peu
inclinée et d’un parallélisme rigoureux, son gréement de fils galvanisés, aussi
raide que s’il eût été fait de barres métalliques, il offrait le type le plus
moderne de ces élégants clippers, dont le Nord-Amérique se sert avec tant
d’avantage pour le grand commerce, et qui luttent de vitesse avec les meilleurs
steamers de sa flotte marchande.
Le Franklin était à la
fois si parfaitement construit et si intrépidement commandé que pas un homme de
son équipage n’eût accepté d’embarquer sur un autre bâtiment – même avec
l’assurance d’obtenir une plus haute paye. Tous partaient, le cœur plein de
cette double confiance, qui s’appuie sur un bon navire et sur un bon capitaine.
Le Franklin était à la
veille d’entreprendre son premier voyage au long cours pour le compte de la
maison William H. Andrew, de San-Diégo. Il devait se rendre à Calcutta par Singapore,
avec un chargement de marchandises fabriquées en Amérique, et rapporter une
cargaison des productions de l’Inde, à destination de l’un des ports du
littoral californien.
Le capitaine John Branican
était un jeune homme de vingt-neuf ans. Doué d’une physionomie attrayante mais
résolue, les traits empreints d’une rare énergie, il possédait au plus haut
degré le courage moral, si supérieur au courage physique – ce courage « de
deux heures après minuit », disait Napoléon, c’est-à-dire celui qui fait
face à l’imprévu et se retrouve à chaque moment. Sa tête était plus
caractérisée que belle, avec ses cheveux rudes, ses yeux animés d’un regard vif
et franc, qui jaillissait comme un dard de ses pupilles noires. On eût
difficilement imaginé chez un homme de son âge une constitution plus robuste, une
membrure plus solide. Cela se sentait à la vigueur de ses poignées de main qui
indiquaient l’ardeur de son sang et la force de ses muscles. Le point sur
lequel il convient d’insister, c’est que l’âme, contenue dans ce corps de fer, était
l’âme d’un être généreux et bon, prêt à sacrifier sa vie pour son semblable.
John Branican avait le tempérament de ces sauveteurs, auxquels leur sang-froid
permet d’accomplir sans hésiter des actes d’héroïsme. Il avait fait ses preuves
de bonne heure. Un jour, au milieu des glaces rompues de la baie, un autre jour,
à bord d’une chaloupe chavirée, il avait sauvé des enfants, enfant lui-même.
Plus tard, il ne devait pas démentir les instincts de dévouement qui avaient
marqué son jeune âge.
Depuis quelques années déjà, John
Branican avait perdu son père et sa mère, lorsqu’il épousa Dolly Starter, orpheline,
appartenant à l’une des meilleures familles de San-Diégo. La dot de la jeune
fille, très modeste, était en rapport avec la situation, non moins modeste, du
jeune marin, simple lieutenant à bord d’un navire de commerce. Mais il y avait
lieu de penser que Dolly hériterait un jour d’un oncle fort riche, Edward
Starter, qui menait la vie d’un campagnard dans la partie la plus sauvage et la
moins abordable de l’État du Tennessee. En attendant, il fallait vivre à deux –
et même à trois, car le petit Walter, Wat par abréviation, vint au monde dans
la première année du mariage. Aussi, John Branican – et sa femme le comprenait
– ne pouvait-il songer à abandonner son métier de marin. Plus tard il verrait
ce qu’il aurait à faire lorsque la fortune lui serait venue par héritage, ou
s’il s’enrichissait au service de la maison Andrew. Au surplus, la carrière du
jeune homme avait été rapide. Ainsi qu’on va le voir, il avait marché vite en
même temps qu’il marchait droit. Il était capitaine au long cours à un âge où
la plupart de ses collègues ne sont encore que seconds ou lieutenants à bord
des navires de commerce. Si ses aptitudes justifiaient cette précocité, son
avancement s’expliquait aussi par certaines circonstances qui avaient à bon
droit attiré l’attention sur lui.
En effet, John Branican était
populaire à San-Diégo ainsi que dans les divers ports du littoral californien.
Ses actes de dévouement l’avaient signalé d’une façon éclatante non seulement
aux marins, mais aux négociants et armateurs de l’Union.
Quelques années auparavant, une
goélette péruvienne, la Sonora, ayant fait côte à l’entrée de Coronado-Beach,
l’équipage était perdu, si l’on ne parvenait pas à établir une communication
entre le bâtiment et la terre. Mais porter une amarre à travers les brisants, c’était
risquer cent fois sa vie. John Branican n’hésita pas. Il se jeta au milieu des
lames qui déferlaient avec une extrême violence, fut roulé sur les récifs, puis
ramené à la grève battue par un terrible ressac.
Devant les dangers qu’il
voulait affronter encore, sans se soucier de sa vie, on essaya de le retenir.
Il résista, il se précipita vers la goélette, il parvint à l’atteindre, et, grâce
à lui, les hommes de la Sonora furent sauvés.
Un an plus tard, pendant une
tempête qui se déchaîna à cinq cents milles au large dans l’ouest du Pacifique,
John Branican eut à nouveau l’occasion de montrer tout ce qu’on pouvait
attendre de lui. Il était lieutenant à bord du Washington, dont le
capitaine venait d’être emporté par un coup de mer, en même temps que la moitié
de l’équipage. Resté à bord du navire désemparé avec une demi-douzaine de matelots,
blessés pour la plupart, il prit le commandement du Washington qui ne gouvernait
plus, parvint à s’en rendre maître, à lui réinstaller des mâts de fortune, et à
le ramener au port de San-Diégo. Cette coque à peine manœuvrable, qui
renfermait une cargaison valant plus de cinq cent mille dollars, appartenait
précisément à la maison Andrew.
Quel accueil reçut le jeune
marin, lorsque le navire eut mouillé au port de San-Diégo ! Puisque les
événements de mer l’avaient fait capitaine, il n’y eut qu’une voix parmi toute
la population pour lui confirmer ce grade.
La maison Andrew lui offrit
le commandement du Franklin, qu’elle venait de faire construire. Le
lieutenant accepta, car il se sentait capable de commander, et n’eut qu’à
choisir pour recruter son équipage, tant on avait confiance en lui. Voilà dans
quelles conditions le Franklin allait faire son premier voyage sous les
ordres de John Branican.
Ce départ était un événement
pour la ville. La maison Andrew était réputée à juste titre l’une des plus
honorables de San-Diégo. Notoirement qualifiée quant à la sûreté de ses
relations et la solidité de son crédit, c’était M. William Andrew qui la
dirigeait d’une main habile. On faisait plus que l’estimer, ce digne armateur, on
l’aimait. Sa conduite envers John Branican fut applaudie unanimement.
Il n’y a donc pas lieu de
s’étonner si, pendant cette matinée du 15 mars, un nombreux concours de
spectateurs – autant dire la foule des amis connus ou inconnus du jeune
capitaine – se pressait sur les quais du Pacific-Coast-Steamship, afin de le saluer
d’un dernier hurra à son passage.
L’équipage du Franklin se
composait de douze hommes, y compris le maître, tous bons marins attachés au
port de San-Diégo, ayant fait leurs preuves, heureux de servir sous les ordres
de John Branican. Le second du navire était un excellent officier, nommé Harry
Felton. Bien qu’il fût de cinq à six ans plus âgé que son capitaine, il ne se
froissait pas d’avoir à servir sous lui, ni ne jalousait une situation qui en
faisait son supérieur. Dans sa pensée, John Branican méritait cette situation.
Tous deux avaient déjà navigué ensemble et s’appréciaient mutuellement.
D’ailleurs, ce que faisait M. William Andrew était bien fait. Harry Felton
et ses hommes lui étaient dévoués corps et âme. La plupart avaient déjà
embarqué sur quelques-uns de ses navires. C’était comme une famille d’officiers
et de matelots – famille nombreuse, affectionnée à ses chefs, qui constituait
son personnel maritime et ne cessait de s’accroître avec la prospérité de la
maison.
Dès lors c’était sans nulle
appréhension, on peut même dire avec ardeur, que l’équipage du Franklin allait
commencer cette campagne nouvelle. Pères, mères, parents étaient là pour lui
dire adieu, mais comme on le dit aux gens qu’on ne doit pas tarder à revoir :
« Bonjour et à bientôt, n’est-ce pas ? » Il s’agissait, en effet,
d’un voyage de six mois, une simple traversée, pendant la belle saison, entre
la Californie et l’Inde, un aller et retour de San-Diégo à Calcutta, et non
d’une de ces expéditions de commerce ou de découvertes, qui entraînent un
navire pour de longues années sur les mers les plus dangereuses des deux
hémisphères. Ces marins en avaient vu bien d’autres, et leurs familles avaient
assisté à de plus inquiétants départs.
Cependant les préparatifs de
l’appareillage touchaient à leur fin. Le Franklin, mouillé sur une ancre
au milieu du port, s’était déjà dégagé des autres bâtiments, dont le nombre atteste
l’importance de la navigation à San-Diégo. De la place qu’il occupait, le
trois-mâts n’aurait pas besoin de s’aider d’un « tug », d’un
remorqueur, pour sortir des passes. Dès que son ancre serait à pic, il lui
suffirait d’éventer ses voiles, et une jolie brise le pousserait rapidement
hors de la baie, sans qu’il eût à changer ses amures. Le capitaine John
Branican n’eût pu souhaiter un temps plus propice, un vent plus maniable, à la
surface de cette mer, qui étincelait au large des îles Coronado, sous les
rayons du soleil.
En ce moment – dix heures du
matin – tout l’équipage se trouvait à bord. Aucun des matelots ne devait
revenir à terre, et l’on peut dire que le voyage était commencé pour eux.
Quelques canots du port, accostés à l’échelle de tribord, attendaient les
personnes qui avaient voulu embrasser une dernière fois leurs parents et amis.
Ces embarcations les ramèneraient à quai, dès que le Franklin hisserait
ses focs. Bien que les marées soient faibles dans le bassin du Pacifique, mieux
valait partir avec le jusant, qui ne tarderait pas à s’établir.
Parmi les visiteurs, il
convient de citer plus particulièrement le chef de la maison de commerce, M. William
Andrew, et Mrs. Branican, suivie de la nourrice qui portait le petit Wat. Ils
étaient accompagnés de M. Len Burker et de sa femme, Jane Burker, cousine
germaine de Dolly. Le second, Harry Felton, n’ayant pas de famille, n’avait à
recevoir les adieux de personne. Les bons souhaits de M. William Andrew ne
lui feraient point défaut, et il n’en demandait pas davantage, si ce n’est que
la femme du capitaine John voulût bien y joindre les siens – ce dont il était
assuré d’avance.
Harry Felton se tenait alors
sur le gaillard d’avant, où une demi-douzaine d’hommes commençaient à virer
l’ancre au cabestan. On entendait les linguets qui battaient avec un bruit métallique.
Déjà le Franklin se halait peu à peu, et sa chaîne grinçait à travers
les écubiers. Le guidon, aux initiales de la maison Andrew, flottait à la pomme
du grand mât, tandis que le pavillon américain, tendu par la brise à la corne
de brigantine, développait son étamine rayée et le semis des étoiles fédérales.
Les voiles déferlées étaient prêtes à être hissées, dès que le bâtiment aurait
pris un peu d’erre sous la poussée de ses trinquettes et de ses focs.
Sur le devant du rouffle, sans
rien perdre des détails de l’appareillage, John Branican recevait les dernières
recommandations de M. William Andrew, relatives au connaissement, autrement
dit la déclaration qui contenait l’état des marchandises constituant la
cargaison du Franklin. Puis, l’armateur le remit au jeune capitaine, en
ajoutant :
« Si les circonstances
vous obligent à modifier votre itinéraire, John, agissez pour le mieux de nos intérêts,
et envoyez des nouvelles du premier point où vous atterrirez. Peut-être le Franklin
fera-t-il relâche dans l’une des Philippines, car votre intention, sans
doute, n’est point de passer par le détroit de Torrès ?
– Non, monsieur Andrew, répondit
le capitaine John, et je ne compte point aventurer le Franklin dans ces
dangereuses mers du nord de l’Australie. Mon itinéraire doit être les Hawaï, les
Mariannes, Mindanao des Philippines, les Célèbes, le détroit de Mahkassar, afin
de gagner Singapore par la mer de Java. Pour se rendre de ce point à Calcutta, la
route est tout indiquée. Je ne crois donc pas que cet itinéraire puisse être
modifié par les vents que je trouverai dans l’ouest du Pacifique. Si pourtant
vous aviez à me télégraphier quelque ordre important, veuillez l’envoyer, soit
à Mindanao, où je relâcherai peut-être, soit à Singapore, où je relâcherai
certainement.
– C’est entendu, John. De
votre côté, avisez-moi le plus tôt possible du cours des marchandises à
Calcutta. Il est possible que ces cours m’obligent à changer mes intentions
touchant le chargement du Franklin au retour.
– Je n’y manquerai pas, monsieur
Andrew », répondit John Branican.
En ce moment, Harry Felton
s’approchant dit :
« Nous sommes à pic, capitaine.
– Et le jusant ?…
– Il commence à se faire
sentir…
– Tenez bon. »
Puis, s’adressant à William
Andrew, le capitaine John, plein de reconnaissance, répéta :
« Encore une fois, monsieur
Andrew, je vous remercie de m’avoir donné le commandement du Franklin. J’espère
que je saurai justifier votre confiance…
– Je n’en doute aucunement, John,
répondit William Andrew, et je ne pouvais remettre en de meilleures mains les
affaires de ma maison ! »
L’armateur serra fortement la
main du jeune capitaine et se dirigea vers l’arrière du rouffle.
Mrs. Branican, suivie de la
nourrice et du bébé, venait de rejoindre son mari avec M. et Mrs. Burker.
L’instant de la séparation était imminent. Le capitaine John Branican n’avait
plus qu’à recevoir les adieux de sa femme et de sa famille.
On le sait, Dolly n’en était
encore qu’à la deuxième année de son mariage, et son petit enfant avait à peine
neuf mois. Bien que cette séparation lui causât un profond chagrin, elle n’en
voulait rien laisser voir, et contenait les battements de son cœur. Sa cousine
Jane, nature faible, sans énergie, ne pouvait, elle, cacher son émotion. Elle
aimait beaucoup Dolly, près de qui elle avait souvent trouvé quelque adoucissement
au chagrin que lui causait le caractère impérieux et violent de son mari. Mais,
si Dolly dissimulait ses inquiétudes, Jane n’ignorait pas qu’elle les éprouvait
dans toute leur réalité. Sans doute, le capitaine John devait être de retour à
six mois de là ; mais, enfin, c’était une séparation – la première depuis
leur mariage – et, si elle était assez forte pour retenir ses larmes, on peut dire
que Jane pleurait pour elle. Quant à Len Burker, lui, cet homme dont jamais une
émotion tendre n’avait adouci le regard, les yeux secs, les mains dans les
poches, distrait de cette scène par on ne sait quelles pensées, il allait et
venait. Évidemment, il n’était point en communauté d’idées avec les visiteurs
que des sentiments d’affection avaient amenés sur ce navire en partance.
Le capitaine John prit les
deux mains de sa femme, l’attira près de lui et d’une voix attendrie :
« Chère Dolly, dit-il, je
vais partir… Mon absence ne sera pas longue… Dans quelques mois, tu me reverras…
Je te retrouverai, ma Dolly… Sois sans crainte !… Sur mon navire, avec mon
équipage, qu’aurions-nous à redouter des dangers de la mer ?… Sois forte
comme doit l’être la femme d’un marin… Quand je reviendrai, notre petit Wat
aura quinze mois… Ce sera déjà un grand garçon… Il parlera, et le premier mot
que j’entendrai à mon retour…
– Ce sera ton nom, John !…
répondit Dolly. Ton nom sera le premier mot que je lui apprendrai !… Nous
causerons de toi tous les deux et toujours !… Mon John, écris-moi à chaque
occasion !… Avec quelle impatience j’attendrai tes lettres !…
– Et dis-moi tout ce que tu
auras fait, tout ce que tu comptes faire… Que je sente mon souvenir mêlé à
toutes tes pensées…
– Oui, chère Dolly, je
t’écrirai… Je te tiendrai au courant du voyage… Mes lettres, ce sera comme le
journal du bord avec mes tendresses en plus !
– Ah ! John, je suis
jalouse de cette mer qui t’emporte si loin !… Combien j’envie ceux qui
s’aiment et que rien ne sépare dans la vie !… Mais non… J’ai tort de
songer à cela…
– Chère femme, je t’en prie, dis-toi
que c’est pour notre enfant que je pars… pour toi aussi… pour vous assurer à
tous les deux l’aisance et le bonheur !… Si nos espérances de fortune
viennent à se réaliser un jour, nous ne nous quitterons plus ! »
En ce moment, Len Burker et
Jane s’approchèrent. Le capitaine John se retourna vers eux :
« Mon cher Len, dit-il, je
vous laisse ma femme, je vous laisse mon fils !… Je vous les confie comme
aux seuls parents qui leur restent à San-Diégo !
– Comptez sur nous, John, répondit
Len Burker, en essayant d’adoucir la rudesse de sa voix. Jane et moi, nous sommes
là… Les soins ne manqueront pas à Dolly…
– Ni les consolations, ajouta
Mrs. Burker. Tu sais combien je t’aime, ma chère Dolly !… Je te verrai
souvent… Chaque jour, je viendrai passer quelques heures près de toi… Nous
parlerons de John…
– Oui, Jane, répondit Mrs.
Branican, et je ne cesserai de penser à lui ! »
Harry Felton vint de nouveau
interrompre cette conversation :
« Capitaine, dit-il, il
serait temps…
– Bien, Harry, répondit John
Branican. Faites hisser le grand foc et la brigantine. »
Le second s’éloigna afin de
procéder à l’exécution de ces ordres, qui annonçaient un départ immédiat.
« Monsieur Andrew, dit
le jeune capitaine en s’adressant à l’armateur, le canot va vous reconduire au
quai avec ma femme et ses parents… Quand vous voudrez…
– À l’instant, John, répondit
M. William Andrew, et encore une fois, bon voyage !
– Oui !… bon voyage !…
répétèrent les autres visiteurs, qui commencèrent à descendre dans les
embarcations, accostées à tribord du Franklin.
– Adieu, Len !… Adieu, Jane ! dit John en leur
serrant la main à tous les deux.
– Adieu !… Adieu !…
répondit Mrs. Burker.
– Et toi, ma Dolly, pars !…
Il le faut !… ajouta John. Le Franklin va prendre le vent. »
Et, en effet, la brigantine
et le foc imprimaient un peu de roulis au navire, tandis que les matelots
chantaient :
En voilà une,
La jolie une !
Une s’en va, ça ira,
Deux revient, ça va bien !
En voici deux,
La jolie deux !
Deux s’en va, ça ira,
Trois revient, ça va bien…
Et ainsi de suite.
Pendant ce temps, le
capitaine John avait conduit sa femme à la coupée, et, au moment où elle allait
mettre le pied sur l’échelle, se sentant aussi incapable de lui parler qu’elle
était elle-même de lui répondre, il ne put que la presser étroitement dans ses
bras.
Et, alors, le bébé, que Dolly
venait de reprendre à sa nourrice, tendit ses bras vers son père, agita ses petites
mains en souriant, et ce mot s’échappa de ses lèvres :
« Pa… pa !… Pa… pa !…
– Mon John, s’écria Dolly, tu
auras donc entendu son premier mot avant de te séparer de lui ! »
Si énergique que fût le jeune
capitaine, il ne put retenir une larme que ses yeux laissèrent couler sur la
joue du petit Wat.
« Dolly !…
murmura-t-il, adieu !… adieu !… »
Puis :
« Dérapez ! »
cria-t-il d’une voix forte pour mettre fin à cette pénible scène.
Un instant après, le canot
débordait et se dirigeait vers le quai, où ses passagers débarquèrent aussitôt.
Le capitaine John était tout entier aux mouvements de l’appareillage. L’ancre
commençait à remonter vers l’écubier. Le Franklin, dégagé de sa dernière
entrave, recevait déjà la brise dans ses voiles dont les plis battaient violemment.
Le grand foc venait d’arriver à bloc, et la brigantine fit légèrement lofer le
navire, dès qu’elle eut été bordée sur son gui. Cette manœuvre devait permettre
au Franklin de prendre un peu de tour, afin d’éviter quelques bâtiments
mouillés à l’entrée de la baie.
À un nouveau commandement du
capitaine Branican, la grande voile et la misaine furent hissées avec un
ensemble qui faisait honneur aux bras de l’équipage. Puis, le Franklin, arrivant
d’un quart sur bâbord, prit l’allure du largue, de manière à sortir sans
changer ses armures.
De la partie du quai occupée
par de nombreux spectateurs, on pouvait admirer ces différentes manœuvres. Rien
de plus gracieux que ce bâtiment de forme si élégante, lorsque le vent
l’inclinait sous ses volées capricieuses. Pendant son évolution, il dut se
rapprocher de l’extrémité du quai, où se trouvaient M. William Andrew, Dolly,
Len et Jane Burker, à moins d’une demi-encablure.
Il en résulta donc, qu’en
laissant arriver, le jeune capitaine put encore apercevoir sa femme, ses parents,
ses amis, et leur jeter un dernier adieu.
Tous répondirent à sa voix, qui
s’entendit clairement, à sa main qui se tendait vers ses amis.
« Adieu !… Adieu !
fit-il.
– Hurra ! » cria la
foule des spectateurs, tandis que les mouchoirs s’agitaient par centaines.
C’est qu’il était aimé de
tous, le capitaine John Branican ! N’était-ce pas celui de ses enfants
dont la ville était le plus fière ? Oui ! tous seraient là, à son
retour, lorsqu’il apparaîtrait au large de la baie.
Le Franklin, qui se
trouvait déjà en face du goulet, dut lofer afin d’éviter un long courrier, qui
donnait en ce moment dans les passes. Les deux navires se saluèrent de leurs
pavillons aux couleurs des États-Unis d’Amérique.
Sur le quai, Mrs. Branican, immobile,
regardait le Franklin s’effacer peu à peu sous une fraîche brise de
nord-est. Elle voulait le suivre du regard, tant que sa mâture serait visible
au-dessus de la pointe Island.
Mais le Franklin ne
tarda pas à contourner les îles Coronado, situées en dehors de la baie. Un instant,
il montra à travers une échancrure de la falaise le guidon qui flottait en tête
du grand mât… Puis il disparut.
« Adieu, mon John… adieu !… »
murmura Dolly.
Pourquoi un inexplicable
pressentiment l’empêcha-t-il d’ajouter : « Au revoir ! »
Il convient de marquer d’un
trait plus précis Mrs. Branican, que les éventualités de cette histoire sont
appelées à mettre en pleine lumière.
À cette époque Dolly avait vingt et un ans. Elle était d’origine américaine.
Mais, sans remonter trop haut l’échelle de ses ancêtres, on eût rencontré la
génération qui la reliait à la race espagnole ou plutôt mexicaine, de laquelle
sortent les principales familles de ce pays. Sa mère, en effet, était née à
San-Diégo, et San-Diégo était déjà fondée à l’époque où la basse Californie
appartenait encore au Mexique. La vaste baie, découverte il y a environ trois
siècles et demi par le navigateur espagnol Juan Rodriguez Cabrillo, d’abord
nommée San-Miguel, prit son nouveau nom en 1602. Puis, en 1846, cette province
changea le pavillon aux trois couleurs pour les barres et les étoiles de la
Confédération, et c’est à titre définitif qu’elle compte depuis cette époque
parmi les États-Unis d’Amérique.
Une taille moyenne, une
figure animée du feu de deux grands yeux profonds et noirs, un teint chaud, une
chevelure abondante d’un brun très foncé, la main et le pied un peu plus forts
qu’on ne les observe habituellement dans le type espagnol, une démarche assurée
mais gracieuse, une physionomie qui dénotait l’énergie du caractère et aussi la
bonté de l’âme, telle était Mrs. Branican. Il est de ces femmes qu’on ne
saurait voir d’un regard indifférent, et, avant son mariage, Dolly passait, à
juste titre, pour l’une des jeunes filles de San-Diégo – où la beauté n’est
point rare – qui méritait le plus d’attirer l’attention. On la sentait sérieuse,
réfléchie, d’un grand sens, d’un esprit éclairé, qualités morales que très
certainement le mariage ne pourrait que développer en elle.
Oui ! en n’importe
quelles circonstances, si graves qu’elles pussent être, Dolly, devenue Mrs.
Branican, saurait faire son devoir. Ayant regardé franchement l’existence, et
non à travers un prisme trompeur, elle possédait une âme haute, une volonté
forte. L’amour que lui inspirait son mari la rendrait plus résolue à
l’accomplissement de sa tâche. Le cas échéant – ce n’est point une phrase
banale quand on l’applique à Mrs. Branican – elle donnerait sa vie pour John, comme
John donnerait sa vie pour elle, comme tous deux la donneraient pour cet
enfant. Ils adoraient ce bébé, qui venait de balbutier le mot de « papa »,
à l’instant où le jeune capitaine allait se séparer de sa mère et de lui. La
ressemblance du petit Wat avec son père était déjà frappante – par les traits
du moins, car il avait la chaude coloration du teint de Dolly. Vigoureusement
constitué, il n’avait rien à craindre des maladies de l’enfance. D’ailleurs, il
serait entouré de tant de soins !… Ah ! que de rêves d’avenir, l’imagination
paternelle et maternelle avait déjà conçus pour ce petit être, chez qui la vie
commençait à peine à s’ébaucher !
Certes, Mrs. Branican eût été
la plus heureuse des femmes, si la situation de John lui avait permis
d’abandonner ce métier de marin, dont le moindre des inconvénients était encore
de les tenir éloignés l’un de l’autre. Mais, au moment où le commandement du Franklin
venait de lui être attribué, comment aurait-elle eu la pensée de le retenir ?
Et puis, ne fallait-il pas songer aux nécessités du ménage, pourvoir aux besoins
d’une famille qui ne se résumerait peut-être pas tout entière dans cet unique
enfant ? C’était à peine le nécessaire que la dot de Dolly assurait à sa
maison. Évidemment John Branican devait compter sur la fortune que l’oncle
laisserait à sa nièce, et il eût fallu un concours d’invraisemblables
circonstances pour que cette fortune lui échappât, puisque M. Edward
Starter, presque sexagénaire, n’avait pas d’autre héritière que Dolly. En effet,
sa cousine Jane Burker, appartenant à la branche maternelle de la famille, n’avait
aucun degré de parenté avec l’oncle de Dolly ! Celle-ci serait donc riche…
mais dix ans, vingt ans, se passeraient peut-être avant qu’elle ne fût mise en
possession de cet héritage. De là, obligation pour John Branican de travailler
en vue du présent, s’il n’avait pas lieu de s’inquiéter de l’avenir. Aussi, était-il
bien résolu à continuer de naviguer pour le compte de la maison Andrew, d’autant
plus qu’un intérêt lui était accordé dans les opérations spéciales du Franklin.
Or, comme le marin se doublait en lui d’un négociant très entendu aux
choses du commerce, tout donnait à penser qu’il acquerrait par son travail une
certaine aisance en attendant la succession de l’oncle Starter.
Un mot seulement sur cet
Américain – d’un « américanisme » absolument original.
Il était frère du père de
Dolly et, par conséquent, l’oncle propre de la jeune fille, qui était devenue
Mrs. Branican. C’était ce frère, son aîné de cinq ou six ans, qui l’avait pour
ainsi dire élevé, car tous deux étaient orphelins. Aussi Starter jeune avait-il
toujours conservé pour lui une vive affection doublée d’une vive
reconnaissance. Les circonstances l’ayant favorisé, il avait suivi la route de
la fortune, alors que Starter aîné s’égarait sur les chemins de traverse qui mènent
rarement au but. S’il avait dû s’éloigner pour tenter d’heureuses spéculations
en achetant et défrichant de vastes terrains dans l’État de Tennessee, il n’en
avait pas moins conservé des rapports avec son frère que ses affaires
retenaient dans l’État de New York. Quand celui-ci devint veuf, il alla se
fixer à San-Diégo, la ville natale de sa femme, où il mourut, alors que le
mariage de Dolly avec John Branican était déjà décidé. Ce mariage fut célébré
après les délais de deuil, et le jeune ménage n’eut absolument pour toute
fortune que le très modeste héritage laissé par Starter aîné.
À peu de temps de là, arriva
à San-Diégo une lettre, qui était adressée à Dolly Branican par Starter jeune.
C’était la première qu’il écrivait à sa nièce ; ce devait être la dernière
aussi.
En substance, cette lettre
disait sous une forme non moins concise que pratique :
Bien que Starter jeune fût
très loin d’elle, et bien qu’il ne l’eût jamais vue, il n’oubliait pas qu’il
avait une nièce, la propre fille de son frère. S’il ne l’avait jamais vue, c’est
que Starter aîné et Starter jeune ne s’étaient point rencontrés depuis que
Starter aîné avait pris femme, et que Starter jeune résidait auprès de
Nashville, dans la partie la plus reculée du Tennessee, tandis qu’elle résidait
à San-Diégo. Or, entre le Tennessee et la Californie, il y a quelques centaines
de milles qu’il ne convenait nullement à Starter jeune de franchir. Donc, si
Starter jeune trouvait le voyage trop fatigant pour aller voir sa nièce, il
trouvait non moins fatigant que sa nièce vînt le voir, et il la priait de ne
point se déranger.
En réalité, ce personnage
était un véritable ours – non point un de ces grizzlys d’Amérique qui portent
griffes et fourrures, mais un de ces ours humains, qui tiennent à vivre en dehors
des relations sociales.
Cela ne devait pas inquiéter
Dolly, d’ailleurs. Elle était la nièce d’un ours, soit ! mais cet ours
possédait un cœur d’oncle. Il n’oubliait pas ce qu’il devait à Starter aîné, et
la fille de son frère serait l’unique héritière de sa fortune.
Starter jeune ajoutait que
cette fortune valait déjà la peine d’être recueillie. Elle se montait alors à
cinq cent mille dollars et ne pouvait que s’accroître, car les affaires de
défrichement prospéraient dans l’État de Tennessee. Comme elle consistait en
terres et en bétail, il serait facile de la réaliser ; on le ferait à un
prix très avantageux, et les acquéreurs ne manqueraient pas.
Si cela était dit de cette
façon positive et quelque peu brutale, qui appartient en propre aux Américains
de vieille race, ce qui était dit était dit. La fortune de Starter jeune irait
tout entière à Mrs. Branican ou à ses enfants, au cas où la souche des Starter
se « progénérerait » (sic) par ses soins. En cas de prédécès
de Mrs. Branican, sans descendants directs ou autres, cette fortune reviendrait
à l’État, qui serait très heureux d’accepter les biens de Starter jeune.
Deux choses encore :
1° Starter jeune était
célibataire. Il resterait célibataire. « La sottise que l’on ne fait que
trop souvent entre vingt et trente ans, ce n’est pas lui qui la ferait à
soixante » – phrase textuelle de sa lettre. Rien ne pourrait donc
détourner cette fortune du cours que sa volonté formelle entendait lui imprimer,
et elle irait se jeter dans le ménage Branican aussi sûrement que le Mississipi
se jette dans le golfe du Mexique.
2° Starter jeune ferait tous
ses efforts – des efforts surhumains – pour n’enrichir sa nièce que le plus
tard possible. Il tâcherait de mourir au moins centenaire, et il ne faudrait
pas lui savoir mauvais gré de cette obstination à prolonger son existence
jusqu’aux dernières limites du possible.
Enfin Starter jeune priait
Mrs. Branican – il lui ordonnait même – de ne point répondre. D’ailleurs, c’est
à peine si des communications existaient entre les villes et la région
forestière qu’il occupait dans le fond du Tennessee. Quant à lui, il n’écrirait
plus – si ce n’est pour annoncer sa mort, et encore cette lettre ne serait-elle
pas de sa propre main.
Telle était la singulière
missive qu’avait reçue Mrs. Branican. Qu’elle dût être l’héritière, la
légataire universelle de son oncle Starter, cela n’était point à mettre en
doute. Elle posséderait un jour cette fortune de cinq cent mille dollars, qui
serait probablement très accrue par le travail de cet habile défricheur de
forêts. Mais, comme Starter jeune manifestait très nettement son intention de
dépasser la centaine – et l’on sait si ces Américains du Nord sont tenaces –
John Branican avait sagement fait de ne point abandonner le métier de marin.
Son intelligence, son courage, sa volonté aidant, il est probable qu’il
acquerrait pour sa femme et son enfant une certaine aisance, bien avant que
l’oncle Starter eût consenti à partir pour l’autre monde.
Telle était donc la situation
du jeune ménage, au moment où le Franklin faisait voile pour les parages
occidentaux du Pacifique. Cela étant établi pour l’intelligence des faits qui
vont se dérouler dans cette histoire, il convient d’appeler maintenant
l’attention sur les seuls parents que Dolly Branican eût à San-Diégo, M. et
Mrs. Burker.
Len Burker, Américain
d’origine, âgé alors de trente et un ans, n’était venu se fixer que depuis
quelques années dans la capitale de la basse Californie. Ce Yankee de la
Nouvelle-Angleterre, froid de physionomie, dur de traits, vigoureux de corps, était
très résolu, très agissant et aussi très concentré, ne laissant rien voir de ce
qu’il pensait, ne disant rien de ce qu’il faisait. Il est de ces natures qui
ressemblent à des maisons hermétiquement fermées, et dont la porte ne s’ouvre à
personne. Cependant, à San-Diégo, aucun bruit fâcheux n’avait couru sur le
compte de cet homme si peu communicatif, que son mariage avec Jane Burker avait
fait le cousin de John Branican. Il n’y avait donc pas lieu de s’étonner que
celui-ci, n’ayant d’autre famille que les Burker, leur eût recommandé Dolly et
son enfant. Mais, en réalité, c’était plus spécialement aux soins de Jane qu’il
les remettait, sachant que les deux cousines éprouvaient une profonde affection
l’une pour l’autre.
Et il en eût été tout
autrement si le capitaine John avait su ce qu’était au juste Len Burker, s’il
avait connu la fourberie qui se dissimulait derrière le masque impénétrable de
sa physionomie, avec quel sans-gêne il traitait les convenances sociales, le respect
de soi-même et les droits d’autrui. Trompée par ses dehors assez séduisants, par
une sorte de fascination dominatrice qu’il exerçait sur elle, Jane l’avait
épousé cinq ans auparavant à Boston, où elle demeurait avec sa mère, qui mourut
peu de temps après ce mariage, dont les conséquences devaient être si
regrettables. La dot de Jane et l’héritage maternel auraient dû suffire à
l’existence des nouveaux époux, si Len Burker eut été homme à suivre les voies
usuelles et non les chemins détournés. Mais il n’en fut rien. Après avoir en
partie dévoré la fortune de sa femme, Len Burker, assez disqualifié dans son
crédit à Boston, se décida à quitter cette ville. De l’autre côté de l’Amérique,
où sa réputation douteuse ne le suivrait pas, ces pays presque neufs lui
offraient des chances qu’il ne pouvait plus trouver dans la
Nouvelle-Angleterre.
Jane, qui connaissait son
mari maintenant, s’associa sans hésiter à ce projet de départ, heureuse de
quitter Boston, où la situation de Len Burker prêtait à de désagréables
commentaires, heureuse d’aller retrouver la seule parente qui lui restât. Tous
deux vinrent s’établir à San-Diégo, où Dolly et Jane se retrouvèrent.
D’ailleurs, depuis trois ans qu’il habitait cette ville, Len Burker n’avait pas
encore donné prise aux soupçons, tant il déployait d’habileté à dissimuler le
louche de ses affaires.
Telles furent les
circonstances qui avaient amené la réunion des deux cousines, à l’époque où
Dolly n’était pas encore Mrs. Branican.
La jeune femme et la jeune
fille se lièrent étroitement. Bien qu’il semblât que Jane dût dominer Dolly, ce
fut le contraire qui eut lieu. Dolly était forte, Jane était faible, et la
jeune fille devint bientôt l’appui de la jeune femme. Lorsque l’union de John
Branican et de Dolly fut décidée, Jane se montra très heureuse de ce mariage –
un mariage qui promettait de ne jamais ressembler au sien ! Et dans
l’intimité de ce jeune ménage, que de consolations elle aurait pu trouver, si
elle se fût décidée à lui confier le secret de ses peines.
Et cependant la situation de
Len Burker devenait de plus en plus grave. Ses affaires périclitaient. Le peu
qui lui restait de la fortune de sa femme, lorsqu’il avait quitté Boston, était
presque entièrement dissipé. Cet homme, joueur ou plutôt spéculateur effréné, était
de ces gens qui veulent tout donner au hasard et ne tout attendre que de lui.
Ce tempérament, réfractaire aux conseils de la raison, ne pouvait qu’amener et
n’amenait que des résultats déplorables.
Dès son arrivée à San-Diégo, Len
Burker avait ouvert un office dans Fleet Street – un de ces bureaux qui sentent
la caverne, où n’importe quelle idée, bonne ou mauvaise, devient le point de
départ d’une affaire. Très apte à faire miroiter les aléas d’une combinaison,
sans aucun scrupule sur les moyens qu’il employait, habile à changer les
arguties en arguments, très enclin à regarder comme sien le bien des autres, il
ne tarda pas à se lancer dans vingt spéculations qui sombrèrent peu à peu, mais
ce ne fut pas sans y avoir laissé de ses propres plumes. À l’époque où débute
cette histoire, Len Burker en était réduit aux expédients, et la gêne se
glissait dans son ménage. Toutefois, comme il avait tenu ses agissements très
secrets, il jouissait encore de quelque crédit et l’employait à faire de
nouvelles dupes en faisant de nouvelles affaires.
Cette situation, cependant, ne
pouvait aboutir qu’à une catastrophe. L’heure n’était plus éloignée, où des
réclamations viendraient à se produire. Peut-être cet aventureux Yankee, transporté
dans l’Ouest-Amérique, n’aurait-il plus d’autre ressource que de quitter
San-Diégo, comme il avait quitté Boston. Et, pourtant, au milieu de cette ville
d’un sens si éclairé, d’une si puissante activité commerciale, dont les progrès
grandissent d’année en année, un homme intelligent et probe eût trouvé cent
fois l’occasion de réussir. Mais il fallait avoir ce que Len Burker n’avait pas :
la droiture des sentiments, la justesse des idées, l’honnêteté de
l’intelligence.
Il importe d’insister sur ce
point : c’est que ni John Branican ni M. William Andrew, ni personne
ne soupçonnaient rien des affaires de Len Burker. Dans le monde de l’industrie
et du commerce, on ignorait que cet aventurier – et plût au ciel qu’il n’eût
mérité que ce nom ! – courait à un désastre prochain. Et, même, quand se
produirait la catastrophe, peut-être ne verrait-on en lui qu’un homme peu
favorisé de la fortune, et non l’un de ces personnages sans moralité à qui tous
les moyens sont bons pour s’enrichir. Aussi, sans avoir ressenti pour lui une
sympathie profonde, John Branican n’avait-il à aucun moment conçu la moindre
défiance à son égard. C’était donc en pleine sécurité que, pendant son absence,
il comptait sur les bons offices des Burker envers sa femme. S’il se présentait
quelque circonstance où Dolly serait forcée de recourir à eux, elle ne le
ferait pas en vain. Leur maison lui était ouverte, et elle y trouverait
l’accueil dû, non seulement à une amie, mais à une sœur.
À ce sujet, d’ailleurs, il
n’y avait pas lieu de suspecter les sentiments de Jane Burker. L’affection
qu’elle éprouvait pour sa cousine était sans restrictions comme sans calculs.
Loin de blâmer la sincère amitié qui unissait ces deux jeunes femmes, Len
Burker l’avait encouragée, sans doute dans une vision confuse de l’avenir et
des avantages que cette liaison pourrait lui rapporter. Il savait, d’ailleurs, que
Jane ne dirait jamais rien de ce qu’elle ne devait pas dire, qu’elle garderait
une prudente réserve sur sa situation personnelle, sur ce qu’elle ne pouvait
ignorer des blâmables affaires où il s’était engagé, sur les difficultés au
milieu desquelles son ménage commençait à se débattre. Là-dessus, Jane se
tairait, et il ne lui échapperait pas même une récrimination. On le répète, entièrement
dominée par son mari, elle en subissait l’absolue influence bien qu’elle le
connût pour un homme sans conscience, ayant perdu tout reste de sens moral, capable
de s’abandonner aux actes les plus impardonnables. Et, après tant de
désillusions, comment aurait-elle pu lui conserver la moindre estime ?
Mais – on ne saurait trop revenir sur ce point essentiel – elle le redoutait, elle
était entre ses mains comme un enfant, et, rien que sur un signe de lui, elle
le suivrait encore, si sa sécurité l’obligeait à s’enfuir, en n’importe quelle
partie du monde. Enfin, ne fût-ce que par respect d’elle-même, elle n’eût rien
voulu laisser voir des misères qu’elle endurait, même à sa cousine Dolly, qui
les soupçonnait peut-être, sans en avoir jamais reçu confidence.
À présent, la situation de
John et de Dolly Branican, d’une part, celle de Len et de Jane Burker, de
l’autre, sont suffisamment établies pour l’intelligence des faits qui vont être
relatés. Dans quelle mesure ces situations allaient-elles être modifiées par
les événements inattendus qui devaient, si prochainement et si soudainement, se
produire ? Personne n’eût jamais put le prévoir.
Voilà trente ans, la basse
Californie – un tiers environ de l’État de Californie – ne comptait encore que
trente-cinq mille habitants. Actuellement, c’est par cent cinquante mille que
se chiffre sa population. À cette époque, les territoires de cette province, reculée
aux confins de l’Ouest-Amérique, étaient tout à fait incultes, et ne semblaient
propres qu’à l’élevage du bétail. Qui aurait pu deviner quel avenir était
réservé à une région si abandonnée, alors que les moyens de communication se
réduisaient, par terre, à de rares voies frayées sous la roue des chariots ;
par mer, à une seule ligne de paquebots, qui faisaient les escales de la côte.
Et cependant, depuis l’année
1769, un embryon de ville existait à quelques milles dans l’intérieur, au nord
de la baie de San-Diégo. Aussi la ville actuelle peut-elle réclamer dans
l’histoire du pays l’honneur d’avoir été le plus ancien établissement de la
contrée californienne.
Lorsque le nouveau continent,
rattaché à la vieille Europe par de simples liens coloniaux que le Royaume-Uni
s’opiniâtrait à tenir trop serrés, eut donné une violente secousse, ces liens
se rompirent. L’union des États du Nord-Amérique se fonda sous le drapeau de
l’indépendance. L’Angleterre n’en conserva plus que des lambeaux, le Dominion
et la Colombie, dont le retour est assuré à la confédération dans un temps peu
éloigné sans doute. Quant au mouvement séparatiste, il s’était propagé à travers
les populations du centre qui n’eurent plus qu’une pensée, un but : se délivrer
de leurs entraves quelles qu’elles fussent.
Ce n’était point sous le joug
anglo-saxon que pliait alors la Californie. Elle appartenait aux Mexicains, et
leur appartint jusqu’en 1846. Cette année-là, après s’être affranchie pour
entrer dans la république fédérale, la municipalité de San-Diégo, créée onze
ans auparavant, devint ce qu’elle aurait toujours dû être – américaine.
La baie de San-Diégo est
magnifique. On a pu la comparer à la baie de Naples, mais la comparaison serait
peut-être plus exacte avec celles de Vigo ou de Rio de Janeiro. Douze milles de
longueur sur deux milles de largeur lui ménagent l’espace nécessaire au
mouillage d’une flotte de commerce, aussi bien qu’aux manœuvres d’une escadre, car
elle est considérée comme port militaire. Formant une sorte d’ovale, ouverte à
l’ouest par un étroit goulet, étranglée entre la pointe Island et la pointe
Loma ou Coronado, elle est abritée de tous les côtés. Les vents du large la
respectent, la houle du Pacifique en trouble à peine la surface, les bâtiments
s’en dégagent sans peine, et peuvent s’y ranger par des fonds de vingt-trois
pieds minimum. C’est le seul port sûr et praticable, favorable aux relâches, que
le littoral de l’ouest offre dans le sud de San-Francisco et dans le nord de
San-Quentin.
Avec tant d’avantages
naturels, il était évident que l’ancienne ville se trouverait bientôt à
l’étroit dans son premier périmètre. Déjà des baraquements avaient dû être
élevés pour l’installation d’un détachement de cavalerie sur les terrains couverts
de broussailles qui l’avoisinaient. Grâce à l’initiative de M. Horton, dont
l’intervention fut d’ailleurs une excellente affaire, une annexe fut construite
à cette place. Maintenant, l’annexe est devenue la ville qui s’étage sur les
croupes situées au nord de la baie. L’agrandissement s’opéra dans ces conditions
de célérité, si familières aux Américains. Un million de dollars, semés sur le
sol, firent germer les maisons privées, les édifices publics, les offices et
les villas. En 1885, San-Diégo comptait déjà quinze mille habitants –
aujourd’hui trente-cinq mille. Son premier chemin de fer date de 1881. À
présent, l’Atlantic and Pacific road, le Southern California road, le
Southern Pacific road, la mettent en communication avec le continent, en
même temps que la Pacific Coast Steamship lui assure des rapports
fréquents avec San-Francisco.
C’est une jolie et
confortable ville, bien aérée, d’un habitat très hygiénique, sous un climat dont
l’éloge n’est plus à faire. Aux alentours, la campagne est d’une incomparable
fertilité. La vigne, l’olivier, l’oranger, le citronnier poussent côte à côte
avec les arbres, les fruits et les légumes des pays du Nord. On dirait une
Normandie fusionnée avec une Provence.
Quant à la ville de San-Diégo
elle-même, elle est bâtie avec cette aisance pittoresque, cette liberté
d’orientation, cette fantaisie privée, qui est si profitable à l’hygiène, lorsqu’on
n’est pas gêné par l’exiguïté des terrains. Il y a des places, des squares, des
rues larges, des ombrages un peu partout, c’est-à-dire de la santé en raison
directe du cube d’air, si généreusement concédé à cette heureuse population.
Et puis, si le progrès, sous
toutes ses formes, ne se trouvait pas dans une cité moderne, surtout lorsque
cette cité est américaine, où l’irait-on chercher ? Gaz, télégraphe, téléphone,
les habitants n’ont qu’un signe à faire pour être éclairés, pour échanger leurs
dépêches, pour se parler à l’oreille d’un quartier à l’autre. Il y a même des
mâts, hauts de cent cinquante pieds, qui versent la lumière électrique sur les
rues de la ville. Si on n’en est pas encore au lait distribué sous pression par
une General Milk Company, si les trottoirs mobiles, qui doivent se déplacer
avec une vitesse de quatre lieues à l’heure, ne fonctionnent pas encore à
San-Diégo, cela se fera certainement dans un délai… quelconque.
Que l’on ajoute à ces
avantages les institutions diverses où s’élabore le mouvement vital des grandes
agglomérations, une douane dans laquelle l’importance des transactions
s’accroît chaque jour, deux banques, une chambre de commerce, une société
d’émigration, de vastes offices, de nombreux comptoirs, où se traitent des
affaires énormes en bois et en farines, des églises affectées aux différents
cultes, trois marchés, un théâtre, un gymnase, trois grandes écoles, Russ
County, Court House, Maronic and old fellows, destinées aux enfants pauvres,
enfin nombre d’établissements où les études sont poussées jusqu’à l’obtention
des diplômes universitaires – et l’on pourra préjuger l’avenir d’une cité jeune
encore, opiniâtrement soigneuse de ses intérêts moraux et matériels, au sein de
laquelle s’accumulent tant d’éléments de prospérité. Les journaux lui
manquent-ils ? Non ! Elle possède trois feuilles quotidiennes, entre
autres le Hérald, et ces feuilles publient chacune une édition hebdomadaire.
Les touristes peuvent-ils craindre de ne pas trouver à se loger dans des
conditions de confort suffisant ? Mais, sans compter les hôtels d’un ordre
inférieur, n’ont-ils pas à leur disposition trois magnifiques établissements, le
Horton-House, Florence-Hôtel, Gérard-Hôtel avec ses cent chambres, et
sur le rivage opposé de la baie, dominant les grèves de la pointe Coronado, dans
un site admirable, au milieu de villas charmantes, un nouvel hôtel, qui n’a pas
coûté moins de cinq millions de dollars ?
De tous les pays du vieux
continent, comme de tous les points du nouveau, que les touristes partent pour
visiter cette jeune et vivace capitale de la Californie méridionale, ils y
seront hospitalièrement accueillis par ses généreux habitants, et ils ne
regretteront rien de leur voyage – si ce n’est qu’il leur aura probablement
paru trop court !
San-Diégo est une ville
pleine d’animation, très agissante, et aussi très réglementée dans le pêle-mêle
de ses affaires, comme la plupart des cités d’Amérique. Si la vie s’exprime par
le mouvement, on peut dire qu’on y vit dans le sens le plus intensif du mot. À
peine le temps suffit-il aux transactions commerciales. Mais, s’il en est ainsi
pour les gens que leurs instincts, leurs habitudes, lancent à travers ce
tourbillon, ce n’est plus vrai, lorsqu’il s’agit de ceux dont l’existence se
traîne dans d’interminables loisirs. Quand le mouvement s’arrête, les heures ne
s’écoulent que trop lentement !
Ce fut ce qu’éprouva Mrs.
Branican, après le départ du Franklin. Depuis son mariage, elle avait
été mêlée aux travaux de son mari. Lors même qu’il ne naviguait pas, ses
rapports avec la maison Andrew créaient au capitaine John de nombreuses occupations.
En outre des opérations de commerce auxquelles il prenait part, il avait eu à
suivre la construction du trois-mâts dont il devait prendre le commandement.
Avec quel zèle, on peut dire quel amour, il en surveillait les moindres détails !
Il y apportait les soins incessants du propriétaire, qui fait bâtir la maison
où se passera toute sa vie. Et mieux encore, car le navire n’est pas seulement
la maison, ce n’est pas seulement un instrument de la fortune, c’est
l’assemblage de bois et de fer auquel va être confiée l’existence de tant
d’hommes. N’est-ce pas, d’ailleurs, comme un fragment détaché du sol natal, qui
y revient pour le quitter encore, et dont, malheureusement, la destinée n’est
pas toujours d’achever sa carrière maritime au port où il est né !
Très souvent, Dolly
accompagnait le capitaine John au chantier. Cette membrure qui se dressait sur
la quille inclinée, ces courbes qui offraient l’aspect de l’ossature d’un
gigantesque mammifère marin, ces bordages qui venaient s’ajuster, cette coque
aux formes complexes, ce pont où se découpaient les larges panneaux destinés à
l’embarquement et au débarquement de la cargaison, ces mâts, couchés à terre en
attendant qu’ils fussent mis en place, les aménagements intérieurs, le poste de
l’équipage, la dunette et ses cabines, tout cela n’était-il pas pour
l’intéresser ? C’était la vie de John et de ses compagnons que le Franklin
aurait à défendre contre les houles de l’océan Pacifique. Aussi n’y
avait-il pas une planche à laquelle Dolly n’attachât quelque chance de salut
par sa pensée, pas un coup de marteau, au milieu des fracas du chantier, qui ne
retentît dans son cœur. John l’initiait à tout ce travail, lui disait la destination
de chaque pièce de bois ou de métal, lui expliquait la marche du plan de
construction. Elle l’aimait ce navire, dont son mari allait être l’âme, le
maître après Dieu !… Et, parfois, elle se demandait pourquoi elle ne
partait pas avec le capitaine, pourquoi il ne l’emmenait pas, pourquoi elle ne
partageait pas les périls de sa campagne, pourquoi le Franklin ne la
ramènerait pas en même temps que lui au port de San-Diégo ? Oui !
elle eût voulu ne point se séparer de son mari !… Et l’existence de ces
ménages de marins, qui naviguent ensemble pendant de longues années, n’est-elle
point depuis longtemps entrée dans les coutumes des populations du Nord, sur
l’ancien comme sur le nouveau continent ?…
Mais il y avait Wat, le bébé,
et Dolly pouvait-elle l’abandonner aux soins d’une nourrice, loin des caresses
maternelles ?… Non !… Pouvait-elle l’emmener en mer, l’exposer aux
éventualités d’un voyage si dangereux pour de petits êtres ?… Pas davantage !…
Elle serait restée près de cet enfant, afin de lui assurer la vie après la lui
avoir donnée, sans le quitter d’un instant, l’entourant d’affection et de
tendresses, afin que, dans un épanouissement de santé, il pût sourire au retour
de son père ! D’ailleurs, l’absence du capitaine John ne devait durer que
six mois. Dès qu’il aurait rechargé à Calcutta, le Franklin reviendrait
à son port d’attache. Et, d’ailleurs, ne convenait-il pas que la femme d’un
marin prît l’habitude de ces séparations indispensables, dût son cœur ne s’y
accoutumer jamais !
Il fallut donc se résigner, et
Dolly se résigna. Mais, après le départ de John, aussitôt que le mouvement, qui
faisait sa vie, eut cessé autour d’elle, combien l’existence lui eût paru vide,
monotone, désolée, si elle ne se fût absorbée dans cet enfant, si elle n’eût
concentré sur lui tout son amour.
La maison de John Branican occupait
un des derniers plans de ces hauteurs, qui encadrent le littoral au nord de la
baie. C’était une sorte de chalet, au milieu d’un petit jardin, planté
d’orangers et d’oliviers, fermé d’une simple barrière de bois. Un
rez-de-chaussée, précédé d’une galerie en retrait, sur laquelle s’ouvraient la
porte et les fenêtres du salon et de la salle à manger, un étage avec balcon
desservant la façade sur toute sa largeur, au-dessus le pignon que les arêtes
du toit ornaient de leur élégant découpage, telle était cette habitation très
simple et très attrayante. Au rez-de-chaussée, le salon et la salle à manger, meublés
modestement ; au premier, deux chambres, celle de Mrs. Branican et celle
de l’enfant ; derrière la maison, une petite annexe pour la cuisine et le
service formaient la disposition intérieure du chalet. Prospect-House jouissait
d’une situation exceptionnellement belle, grâce à son exposition au midi. La
vue s’étendait sur la ville entière et à travers la baie jusqu’aux établissements
de la pointe Loma. C’était un peu loin du quartier des affaires, sans doute ;
mais ce léger désavantage était amplement racheté par l’emplacement de ce
chalet, sa situation en bon air, que caressaient les brises du sud, chargées
des senteurs salines du Pacifique.
C’est dans cette demeure que
les longues heures de l’absence allaient s’écouler pour Dolly. La nourrice du
bébé et une domestique suffisaient au service de la maison. Les seules
personnes qui la fréquentaient étaient M. et Mrs. Burker – rarement Len, souvent
Jane. M. William Andrew, comme il l’avait promis, rendait de fréquentes
visites à la jeune femme, désireux de lui communiquer toutes les nouvelles du Franklin,
qui arriveraient par voie directe ou indirecte. Avant que des lettres aient
pu parvenir à destination, les journaux maritimes relatent les rencontres des
navires, leurs relâches dans les ports, les faits de mer quelconques, qui
intéressent les armateurs. Dolly serait donc tenue au courant. Quant aux
relations du monde, aux rapports du voisinage, habituée à l’isolement de
Prospect-House, elle ne les avait jamais recherchés. Une seule pensée
remplissait sa vie, et, lors même que les visiteurs eussent afflué au chalet, il
lui aurait paru vide, puisque John n’y était plus, et il resterait vide jusqu’à
son retour.
Les premiers jours furent
très pénibles. Dolly ne quittait pas Prospect-House, où Jane Burker venait
quotidiennement la voir. Toutes deux s’occupaient du petit Wat et parlaient du
capitaine John. Le plus ordinairement, lorsqu’elle était seule, Dolly passait
une partie de la journée sur le balcon du chalet. Son regard allait se perdre
au delà de la baie, par-dessus la pointe Island, plus loin que les îles Coronado…
Il dépassait la ligne de mer, circonscrite à l’horizon… Le Franklin en
était loin déjà… Mais elle le rejoignait par la pensée, elle s’y embarquait, elle
était près de son mari… Et, lorsqu’un bâtiment, venu du large, cherchait à
atterrir, elle se disait qu’un jour le Franklin apparaîtrait aussi, qu’il
grandirait en ralliant la terre, que John serait à bord…
Cependant la santé du petit
Wat ne se fût pas accommodée d’une réclusion absolue dans l’enclos de
Prospect-House. Avec la seconde semaine qui suivit le départ, le temps était
devenu très beau, et la brise tempérait les chaleurs naissantes. Aussi Mrs.
Branican s’imposa-t-elle de faire quelques excursions au dehors. Elle emmenait
la nourrice, qui portait le bébé. On allait à pied, lorsque la promenade se
bornait aux alentours de San-Diégo, jusqu’aux maisons d’Old-Town, la vieille
ville. Cela profitait à cet enfant, frais et rose, et lorsque sa nourrice
s’arrêtait, il battait de ses petites mains en souriant à sa mère. Une ou deux
fois, à l’occasion d’excursions plus longues, une jolie carriole, louée dans le
voisinage, les emportait tous trois, et même tous quatre, car Mrs. Burker se
mettait quelquefois de la partie. Un jour, on se rendit ainsi à la colline de
Knob-Hill, semée de villas, qui domine l’hôtel Florence, et d’où la vue s’étend
vers l’ouest jusqu’au delà des îles. Un autre jour, ce fut du côté des grèves
de Coronado-Beach, sur lesquelles de furieux coups de mer se brisent avec des
retentissements de foudre. Puis, on visita les « Lits de Mussel », où
la marée haute couvre d’embruns les roches superbes du littoral. Dolly touchait
du pied cet océan, qui lui apportait comme un écho des parages lointains, où
John naviguait alors – cet océan dont les lames assaillaient peut-être le Franklin,
emporté à des milliers de milles au large. Elle restait là, immobile, voyant
le navire du jeune capitaine dans les envolées de son imagination, murmurant le
nom de John !
Le 30 mars, vers dix heures
du matin, Mrs. Branican était sur le balcon, lorsqu’elle aperçut Mrs. Burker, qui
se dirigeait vers Prospect-House. Jane pressait le pas, en faisant un joyeux
signe de la main, preuve qu’elle n’apportait point aucune fâcheuse nouvelle.
Dolly descendit aussitôt, et se trouva à la porte du chalet, au moment où elle
allait s’ouvrir.
« Qu’y a-t-il, Jane ?…
demanda-t-elle.
– Chère Dolly, répondit Mrs.
Burker, tu vas apprendre quelque chose qui te fera plaisir ! Je viens de
la part de M. William Andrew te dire que le Boundary, qui est entré
ce matin à San-Diégo, a communiqué avec le Franklin…
– Avec le Franklin ?…
– Oui ! M. William
Andrew venait d’en être avisé, et lorsqu’il m’a rencontrée dans Fleet Street ;
il ne pouvait se rendre au chalet que dans l’après-midi, aussi me suis-je hâtée
d’accourir pour t’en instruire…
– Et on a eu des nouvelles de
John ?…
– Oui, Dolly.
– Lesquelles ?… Parle
donc !
– Il y a huit jours, le Franklin
et le Boundary se sont croisés en mer, et une correspondance a pu
être échangée entre les deux navires.
– Tout allait bien à bord ?…
– Oui, chère Dolly. Les deux
capitaines étaient assez rapprochés pour se parler, et le dernier mot qu’on a
pu entendre du Boundary, c’était ton nom !
– Mon pauvre John !
s’écria Mrs. Branican, dont les yeux laissèrent échapper une larme
d’attendrissement.
– Que je suis contente, Dolly,
reprit Mrs. Burker, d’avoir été la première à t’annoncer cette nouvelle !
– Et je te remercie bien !
répondit Mrs. Branican. Si tu savais combien cela me rend heureuse !… Ah !
si, chaque jour, j’apprenais… Mon John… mon cher John !… Le capitaine du Boundary
l’a vu… John lui a parlé… C’est comme un autre adieu qu’il lui a envoyé
pour moi !
– Oui, chère Dolly, et, je te
le répète, tout allait bien à bord du Franklin.
– Jane, dit Mrs. Branican, il faut que je voie le capitaine
du Boundary… Il me racontera tout en détail… Où la rencontre a-t-elle eu
lieu ?…
– Cela, je ne le sais pas, répondit
Jane ; mais le livre de bord nous l’apprendra, et le capitaine du Boundary
te donnera les renseignements les plus complets.
– Eh bien, Jane, le temps de
m’habiller, et nous irons ensemble… à l’instant…
– Non… pas aujourd’hui, Dolly,
répondit Mrs. Burker. Nous ne pourrions monter à bord du Boundary.
– Et pourquoi ?
– Parce qu’il n’est arrivé
que de ce matin, et qu’il est en quarantaine.
– Pour combien de temps ?
– Oh ! vingt-quatre
heures seulement… Ce n’est qu’une formalité, mais personne ne peut y être reçu.
– Et comment M. William
Andrew a-t-il eu connaissance de cette rencontre ?
– Par un mot que la douane
lui a apporté de la part du capitaine. Chère Dolly, tranquillise-toi !… Il
ne peut y avoir aucun doute sur ce que je viens de te rapporter, et tu en auras
la confirmation demain… Je ne te demande qu’un jour de patience.
– Eh bien, Jane, à demain, répondit
Mrs. Branican. Demain, je serai chez toi dans la matinée, vers neuf heures. Tu
voudras bien m’accompagner à bord du Boundary ?…
– Très volontiers, chère Dolly. Je t’attendrai demain, et,
comme la quarantaine sera levée, nous pourrons être reçues par le capitaine…
– N’est-ce pas le capitaine
Ellis, un ami de John ?… demanda Mrs. Branican.
– Lui-même, Dolly, et le Boundary
appartient à la maison Andrew.
– Bien, c’est convenu, Jane…
Je serai chez toi à l’heure dite… Mais que cette journée va me paraître longue !…
– Restes-tu à déjeuner avec
moi ?…
– Si tu le veux, ma chère
Dolly. M. Burker est absent jusqu’à ce soir, et je puis te donner mon
après-midi…
– Merci, chère Jane, et nous
parlerons de John… de lui toujours… toujours !
– Et le petit Wat ?…
Comment va-t-il, notre bébé ?… demanda Mrs. Burker
– Il va très bien !…
répondit Dolly. Il est gai comme un oiseau !… Quelle joie ce sera pour son
père de le revoir !… Jane, j’ai envie de l’emmener demain avec sa nourrice !…
Tu le sais, je n’aime pas à me séparer de mon enfant, même pour quelques heures !…
Je ne serais pas tranquille, si je le perdais de vue… si je ne l’avais pas avec
moi !
– Tu as raison, Dolly, dit
Mrs. Burker. C’est une bonne idée que tu as de faire profiter ton petit Wat de
cette promenade… Il fait beau temps… la baie est calme… Ce sera son premier
voyage en mer, à ce cher enfant !… Ainsi, c’est convenu ?…
– C’est convenu ! »
répondit Mrs. Branican.
Jane resta à Prospect-House
jusqu’à cinq heures du soir. Puis, en quittant sa cousine, elle lui répéta
qu’elle l’attendrait le lendemain chez elle vers neuf heures du matin, afin
d’aller faire visite au Boundary.
Le lendemain, on se leva de
bonne heure à Prospect-House. Il faisait un temps superbe. La brise, qui venait
de terre, chassait au large les dernières brumes de la nuit. La nourrice
habilla le petit Wat, pendant que Mrs. Branican s’occupait de sa toilette. Il
avait été convenu qu’elle déjeunerait chez Mrs. Burker. Aussi se
contenta-t-elle d’un léger repas, ce qui devait lui permettre d’attendre
jusqu’à midi, car, très probablement, la visite au capitaine Ellis prendrait
deux bonnes heures. Ce serait si intéressant tout ce que raconterait ce brave
capitaine !
Mrs. Branican et la nourrice,
qui tenait l’enfant dans ses bras, quittèrent le chalet, au moment où la demie
de huit heures sonnait aux horloges de San-Diégo. Les larges voies de la haute
ville, bordées de villas et de jardins entre leurs enclos de barrières, furent
descendues d’un bon pas, et Dolly s’engagea bientôt entre les rues plus
étroites, plus serrées de maisons, qui constituent le quartier du commerce.
C’était dans Fleet Street que
demeurait Len Burker, non loin du wharf appartenant à la compagnie du Pacific
Coast Steamship. En somme, cela faisait une bonne course, puisqu’il avait
fallu traverser toute la cité, et il était neuf heures, lorsque Jane ouvrit à
Mrs. Branican la porte de sa maison.
C’était une demeure simple, et
même d’un aspect triste, avec ses fenêtres aux persiennes fermées la plupart du
temps. Len Burker, ne recevant chez lui que quelques gens d’affaires, n’avait
aucune relation de voisinage. On le connaissait peu, même dans Fleet Street, ses
occupations l’obligeant fréquemment à s’absenter du matin au soir. Il voyageait
beaucoup, et se rendait le plus souvent à San-Francisco pour des opérations
dont il ne parlait point à sa femme. Ce matin-là, il ne se trouvait pas au
comptoir lorsque Mrs. Branican y arriva. Jane Burker excusa donc son mari de ce
qu’il ne pourrait les accompagner toutes deux dans leur visite à bord du Boundary,
en ajoutant qu’il serait certainement de retour pour le déjeuner.
« Je suis prête, ma
chère Dolly, dit-elle, après avoir embrassé l’enfant. Tu ne veux pas te reposer
un instant ?…
– Je ne suis pas fatiguée, répondit
Mrs. Branican.
– Tu n’as besoin de rien ?…
– Non, Jane !… Il me
tarde d’être en présence du capitaine Ellis !… Partons à l’instant, je
t’en prie ! »
Mrs. Burker n’avait qu’une
vieille femme pour domestique, une mulâtresse que son mari avait amenée de New
York, lorsqu’il était venu s’établir à San-Diégo. Cette mulâtresse, nommée Nô, avait
été la nourrice de Len Burker. Ayant toujours été au service de sa famille, elle
lui était entièrement dévouée et le tutoyait encore, comme elle faisait
lorsqu’il était enfant. Cette créature, rude et impérieuse, était la seule qui
eût jamais exercé quelque influence sur Len Burker, lequel lui abandonnait absolument
la conduite de sa maison. Que de fois Jane avait eu à souffrir d’une domination
qui allait jusqu’au manque d’égards. Mais elle subissait cette domination de la
mulâtresse, comme elle subissait celle de son mari. Dans sa résignation, qui
n’était que faiblesse, elle laissait aller les choses, et Nô ne la consultait
en rien pour la direction du ménage.
Au moment où Jane allait
partir, la mulâtresse lui recommanda expressément d’être rentrée avant midi, parce
que Len Burker ne tarderait pas à revenir et qu’il ne fallait pas le faire
attendre. Il avait, d’ailleurs, à entretenir Mrs. Branican d’une affaire
importante. :
« De quoi s’agit-il ?
demanda Dolly à sa cousine.
– Et comment le saurais-je ?
répondit Mrs. Burker. Viens, Dolly, viens ! »
Il n’y avait pas de temps à
perdre. Mrs. Branican et Jane Burker, accompagnées de la nourrice et de
l’enfant, se dirigèrent vers le quai, où elles arrivèrent en moins de dix
minutes.
Le Boundary, dont la
quarantaine venait d’être levée, n’avait pas encore pris son poste de déchargement
le long du wharf réservé à la maison Andrew. Il était mouillé au fond de la
baie, à une encablure en dedans de la pointe Loma. Il fallait donc traverser la
baie pour se rendre à bord du navire, qui ne devait se déhaler qu’un peu plus
tard. C’était un trajet de deux milles environ, que les steam-launches, sortes
de barques à vapeur employées à ce service, faisaient deux fois par heure.
Dolly et Jane Burker prirent
place dans la steam-launch, au
milieu d’une douzaine de passagers. La plupart étaient des amis ou des parents
de l’équipage du Boundary, qui voulaient profiter des premiers instants
où l’accès du navire était libre. L’embarcation largua son amarre, déborda le
quai et, sous l’action de son hélice, se dirigea obliquement à travers la baie,
en haletant à chaque coup de vapeur.
Par ce temps d’une limpide
clarté, la baie apparaissait dans toute son étendue, avec l’amphithéâtre des
maisons de San-Diégo, la colline dominant la vieille ville, le goulet ouvert
entre la pointe Island et la pointe Loma, l’immense hôtel de Coronado, d’une
architecture de palais, et le phare, qui projette largement ses éclats sur la
mer après le coucher du soleil.
Il y avait divers navires, mouillés
çà et là, dont la steam-launch évitait adroitement la rencontre, ainsi que les
barques, venant en sens contraire, ou les chaloupes de pêche, qui serraient le
vent pour enlever la pointe à la bordée.
Mrs. Branican était assise
près de Jane sur un des bancs de l’arrière. La nourrice, placée près d’elle, tenait
l’enfant entre ses bras. Le bébé ne dormait pas, et ses yeux s’emplissaient de
cette bonne lumière que la brise semblait aviver de son souffle. Il s’agitait, lorsqu’un
couple de mouettes passait au-dessus de l’embarcation en jetant leur cri aigu.
Il était florissant de santé avec ses joues fraîches et ses lèvres roses, encore
humides du lait qu’il avait puisé au sein de sa nourrice, avant de quitter la
maison des Burker. Sa mère le regardait attendrie, se penchant parfois pour l’embrasser ;
et il souriait en se renversant.
Mais l’attention de Dolly fut
bientôt attirée par la vue du Boundary. Dégagé maintenant des autres
navires, le trois-mâts, qui se dessinait nettement au fond de la baie, développait
ses pavillons sur le ciel ensoleillé. Il était évité de flot, l’avant tourné
vers l’ouest, à l’extrémité de sa chaîne fortement tendue, et sur lequel
venaient se briser les dernières ondulations de la houle.
Toute la vie de Dolly était
dans son regard. Elle songeait à John, emporté sur un navire qu’on eût dit le
frère de celui-ci, tant ils étaient semblables ! Et n’étaient-ils pas les
enfants de la même maison Andrew ? N’avaient-ils pas le même port
d’attache ? N’étaient-ils pas sortis du même chantier ?
Dolly, enveloppée par le charme
de l’illusion, l’imagination aiguillonnée par le souvenir, s’abandonnait à
cette pensée que John était là… à bord… qu’il l’attendait… qu’il agitait la
main en l’apercevant… qu’elle allait pouvoir se précipiter dans ses bras… Son
nom lui venait aux lèvres… Elle l’appelait… et il lui répondait en prononçant
le sien…
Puis un léger cri de son
enfant la rappelait au sentiment de la réalité. C’était le Boundary vers
lequel elle se dirigeait, ce n’était pas le Franklin, loin, bien loin
alors, et que des milliers de lieues séparaient de la côte américaine !
« Il sera là… un jour… à
cette place ! murmura-t-elle, en regardant Mrs. Burker.
– Oui, chère Dolly, répondit
Jane, et ce sera John qui nous recevra à son bord ! »
Elle comprenait qu’une vague
inquiétude serrait le cœur de la jeune femme, lorsqu’elle interrogeait
l’avenir.
Cependant la steam-launch
avait franchi en un quart d’heure les deux milles qui séparent le quai de
San-Diégo de la pointe Loma. Les passagers débarquèrent sur l’appontement de la
grève, où Mrs. Branican prit pied avec Jane, la nourrice et l’enfant. Il ne
s’agissait plus que de revenir vers le Boundary, distant au plus d’une
encablure.
Il y avait précisément, au
pied de l’appontement, sous la garde de deux matelots, une embarcation, qui
faisait le service du trois-mâts ; Mrs. Branican se nomma, et ces hommes
se mirent à sa disposition pour la mener à bord du Boundary, après
qu’elle se fut assurée que le capitaine Ellis s’y trouvait en ce moment.
Quelques coups d’aviron
suffirent, et le capitaine Ellis, ayant reconnu Mrs. Branican, vint à la coupée,
tandis qu’elle montait l’échelle, suivie de Jane, non sans avoir recommandé à
la nourrice de bien tenir l’enfant. Le capitaine les conduisit sur la dunette, pendant
que le second commençait ses préparatifs pour conduire le Boundary au
quai de San-Diégo.
« Monsieur Ellis, demanda
tout d’abord Mrs. Branican, j’ai appris que vous avez rencontré le Franklin…
– Oui, mistress, répondit le capitaine, et je puis vous
affirmer qu’il était en bonne allure, ainsi que je l’ai fait connaître à M. William
Andrew.
– Vous l’avez vu… John ?…
– Le Franklin et le Boundary
sont passés assez près à contre-bord pour que le capitaine Branican et moi,
nous ayons pu échanger quelques paroles.
– Oui !… vous l’avez vu !… »
répéta Mrs. Branican, comme si, se parlant plutôt à elle-même, elle eût cherché
dans le regard du capitaine un reflet de la vision du Franklin.
Mrs. Burker posa alors
plusieurs questions que Dolly écoutait attentivement, bien que ses yeux fussent
tournés vers l’horizon de mer, au delà du goulet.
« Ce jour-là, le temps
était très maniable, répondit le capitaine Ellis, et le Franklin courait
grand largue sous toute sa voilure. Le capitaine John était sur la dunette, sa
longue-vue à la main. Il avait lofé d’un quart pour s’approcher du Boundary,
car je n’avais pu modifier ma route, étant au plus près et serrant le vent
presque à ralinguer. »
Ces termes qu’employait le
capitaine Ellis, Mrs. Branican n’en comprenait sans doute pas la signification
précise. Mais, ce qu’elle retenait, c’est que celui qui lui parlait avait vu
John, qu’il avait pu converser un instant avec lui.
« Lorsque nous avons été
par le travers, ajouta-t-il, votre mari, mistress Branican, m’envoya un salut
de la main, criant : « Tout va bien, Ellis ! Dès votre arrivée à
San-Diégo, donnez de mes nouvelles à ma femme… à ma chère Dolly ! »
Puis, les deux bâtiments se sont séparés, et n’ont pas tardé à se perdre de
vue.
– Et quel jour avez-vous
rencontré le Franklin ? demanda Mrs. Branican.
– Le 23 mars, répondit le
capitaine Ellis, à onze heures vingt-cinq du matin ! »
Il fallut encore appuyer sur
les détails, et le capitaine dut indiquer sur la carte le point précis où
s’était fait ce croisement. C’était par 148° de longitude et 20° de latitude
que le Boundary avait rencontré le Franklin, c’est-à-dire à
dix-sept cents milles au large de San-Diégo. Si le temps continuait à être
favorable, – et il y avait des chances pour qu’il le fût avec la belle saison
qui s’affermissait – le capitaine John ferait une belle et rapide navigation à
travers les parages du Nord-Pacifique. En outre, comme il trouverait à charger
dès son arrivée à Calcutta, il ne séjournerait que fort peu de temps dans la
capitale de l’Inde, et son retour en Amérique s’effectuerait très promptement.
L’absence du Franklin serait donc limitée à quelques mois, conformément
aux prévisions de la maison Andrew.
Pendant que le capitaine
Ellis répondait tantôt aux questions de Mrs. Burker, tantôt aux questions de
Mrs. Branican, celle-ci, toujours entraînée par son imagination, se figurait
qu’elle était à bord du Franklin !… Ce n’était pas Ellis… c’était
John, qui lui disait ces choses… C’était sa voix qu’elle croyait entendre…
En ce moment, le second monta
sur la dunette et prévint le capitaine que les préparatifs allaient prendre
fin. Les matelots, placés sur le gaillard d’avant, n’attendaient plus qu’un
ordre pour déhaler le navire.
Le capitaine Ellis offrit
alors à Mrs. Branican de la faire remettre à terre, à moins qu’elle ne préférât
rester à bord ; Dans ce cas, elle pourrait traverser la baie sur le Boundary,
et débarquerait, lorsqu’il aurait accosté le wharf. Ce serait l’affaire de
deux heures au plus.
Mrs. Branican eût très
volontiers accepté l’offre du capitaine. Mais elle était attendue à déjeuner
pour midi. Elle comprit que Jane, après ce que lui avait dit la mulâtresse, serait
très inquiète de ne pas être de retour chez elle, en même temps que son mari.
Elle pria donc le capitaine Ellis de la faire reconduire à l’appontement, afin
de ne pas manquer le premier départ de la steam-launch.
Des ordres furent donnés en
conséquence. Mrs. Branican et Mrs. Burker prirent congé du capitaine, après que
celui-ci eut baisé les bonnes joues du petit Wat. Puis, toutes deux, précédant
la nourrice, s’embarquèrent dans le canot du bord, qui les ramena à
l’appontement.
En attendant l’arrivée de la
steam-launch, qui venait de quitter le quai de San-Diégo, Mrs. Branican regarda
avec un vif intérêt les manœuvres du Boundary. Au rude chant du maître
d’équipage, les matelots viraient l’ancre, le trois-mâts gagnait sur sa chaîne,
tandis que le second faisait hisser le grand foc, la trinquette et la brigantine.
Sous cette voilure, il irait aisément à son poste avec le flot portant.
Bientôt l’embarcation à
vapeur eut accosté. Puis elle envoya quelques coups de sifflet pour appeler les
passagers, et deux ou trois retardataires pressèrent le pas, en remontant la
pointe devant l’hôtel Coronado.
La steam-launch ne devait
stationner que cinq minutes. Mrs. Branican, Jane Burker, la nourrice y prirent
place et vinrent s’asseoir sur la banquette de tribord, tandis que les autres
passagers – une vingtaine environ – allaient et venaient, en se promenant de
l’avant à l’arrière du pont. Un dernier coup de sifflet fut lancé, l’hélice se
mit en mouvement, et l’embarcation s’éloigna de la côte.
Il n’était que onze heures et
demie, et Mrs. Branican serait donc rentrée à temps à la maison de Fleet Street,
puisque la traversée de la baie s’accomplissait en un quart d’heure. À mesure
que l’embarcation s’éloignait, les regards de Dolly restaient fixés sur le Boundary.
L’ancre était à pic, les voiles éventées, et le bâtiment commençait à
quitter son mouillage. Quand il serait amarré devant le wharf de San-Diégo, Dolly
pourrait rendre visite aussi souvent qu’il lui plairait au capitaine Ellis.
La steam-launch filait avec
rapidité. Les maisons de la ville grandissaient sur le pittoresque amphithéâtre
dont elles occupent les divers étages. Il n’y avait plus qu’un quart de mille
pour atteindre le débarcadère.
« Attention… » cria
en ce moment un des marins, posté à l’avant de l’embarcation.
Et il se retourna vers
l’homme de barre, qui se tenait debout sur une petite passerelle en avant de la
cheminée.
Ayant entendu ce cri, Mrs.
Branican regarda du côté du port, où se faisait alors une manœuvre, qui
attirait également l’attention des autres passagers. Aussi la plupart
s’étaient-ils portés vers l’avant.
Un grand brick-goélette, qui
venait de se dégager des navires rangés le long des quais, appareillait pour
sortir de la baie, son avant dirigé vers la pointe Island. Il était aidé par un
remorqueur qui devait le conduire en dehors du goulet, et il prenait déjà une
certaine vitesse.
Ce brick-goélette se trouvait
sur la route de l’embarcation à vapeur, et même assez près, pour qu’il fût
urgent de l’éviter en passant à son arrière. C’est ce qui avait motivé le cri
du matelot à l’homme de barre.
Un sentiment d’inquiétude
saisit les passagers – inquiétude d’autant plus justifiée que le port était
encombré de navires, mouillés çà et là sur leurs ancres. Aussi, par un
mouvement bien naturel, reculèrent-ils vers l’arrière.
La manœuvre était tout
indiquée : il fallait stopper, afin de faire place au remorqueur et au
brick, et ne se remettre en marche que lorsque le passage serait libre.
Quelques chaloupes de pêche, lancées dans le vent, rendaient encore le passage
plus difficile, tandis qu’elles croisaient devant les quais de San-Diégo.
« Attention !
répéta le matelot de l’avant.
– Oui !… oui !
répondit l’homme de barre. Il n’y a rien à craindre !… J’ai du large assez ! »
Mais, gêné par la brusque
apparition d’un grand steamer qui le suivait, le remorqueur fit un mouvement
auquel on ne pouvait s’attendre, et revint en grand sur bâbord.
Des cris se firent entendre, auxquels
se joignirent ceux de l’équipage du brick-goélette, qui cherchait à aider la
manœuvre du remorqueur en gouvernant dans la même direction.
C’est à peine si vingt pieds
séparaient alors le remorqueur de la steam-launch.
Jane, très effrayée, s’était
redressée. Mrs. Branican, par une impulsion instinctive, avait pris le petit
Wat des bras de sa nourrice et le serrait contre elle.
« Sur tribord !…
Sur tribord ! » cria vivement le capitaine du remorqueur au timonier
de l’embarcation, en lui indiquant du geste la direction à suivre.
Cet homme n’avait point perdu
son sang-froid, et il donna un violent coup de barre, afin de se rejeter hors
de la route du remorqueur, car celui-ci était dans l’impossibilité de stopper, le
brick-goélette ayant déjà pris un peu d’erre et risquant de l’aborder par son
flanc.
Sous le coup de barre qui lui
avait été vigoureusement imprimé, la steam-launch donna brusquement la bande
sur tribord, et, ce qui est presque inévitable, les passagers, perdant
l’équilibre, se jetèrent tous de ce côté.
Nouveaux cris qui, cette fois,
furent des cris d’épouvante, puisqu’on put croire que l’embarcation allait
chavirer sous cette surcharge.
À cet instant, Mrs. Branican,
qui se trouvait debout près de la lisse, ne pouvant reprendre son aplomb, fut
projetée par-dessus le bord, avec son enfant.
Le brick-goélette rasait
alors l’embarcation sans la toucher, et tout danger d’abordage était écarté
définitivement.
« Dolly !… Dolly ! »
s’écria Jane, qu’un des passagers retint au moment où elle allait tomber.
Soudain, un matelot de la
steam-launch s’élança sans hésiter par-dessus la lisse, au secours de Mrs.
Branican et du bébé.
Dolly, soutenue par ses
vêtements, flottait à la surface de l’eau ; elle tenait son enfant entre
ses bras, mais elle allait couler à fond lorsque le matelot arriva près d’elle.
L’embarcation ayant stoppé
presque aussitôt, il ne serait pas difficile à ce matelot, vigoureux et bon
nageur, de la rejoindre en ramenant Mrs. Branican. Par malheur, au moment où il
venait de la saisir par la taille, les bras de la malheureuse femme s’étaient
ouverts, tandis qu’elle se débattait à demi suffoquée, et l’enfant avait
disparu.
Lorsque Dolly eut été hissée
à bord et déposée sur le pont, elle avait entièrement perdu connaissance.
De nouveau, ce courageux
matelot – c’était un homme de trente ans, nommé Zach Fren – se jeta à la mer, plongea
à plusieurs reprises, fouilla les eaux autour de l’embarcation… Ce fut
vainement… Il ne put retrouver l’enfant, qui avait été entraîné par un courant
de dessous.
Pendant ce temps, les
passagers donnaient à Mrs. Branican tous les soins que réclamait son état. Jane,
éperdue, la nourrice, affolée, essayaient de la faire revenir à elle. La
steam-launch, immobile, attendait que Zach Fren eût renoncé à tout espoir de
sauver le petit Wat.
Enfin Dolly commença à
reprendre ses sens. Elle balbutia le nom de Wat, ses yeux s’ouvrirent, et son
premier cri fut :
« Mon enfant ! »
Elle aperçut Zach Fren qui
remontait à bord pour la dernière fois… Wat n’était pas dans ses bras.
« Mon enfant ! »
cria encore Dolly.
Puis, se redressant, elle
repoussa ceux qui l’entouraient, et courut vers l’arrière.
Et, si on ne l’eût empêchée, elle
se fût précipitée pardessus le bord…
Il fallut maintenir la
malheureuse femme, tandis que la steam-launch reprenait sa marche vers le quai
de San-Diégo.
Mrs. Branican, la figure
convulsée, les mains crispées, était retombée sur le pont, sans mouvement.
Quelques minutes après, l’embarcation
avait atteint le débarcadère, et Dolly était transportée dans la maison de
Jane. Len Burker venait de rentrer. Sur son ordre, la mulâtresse courut
chercher un médecin.
Celui-ci arriva bientôt, et
ce ne fut pas sans des soins prolongés qu’il parvint à rappeler à la vie Mrs.
Branican.
Dolly le regarda, l’œil fixe,
et dit :
« Qu’y a-t-il ?…
Que s’est-il passé ?… Ah !… je sais !… »
Puis, souriant :
« C’est mon John… Il
revient… il revient !… s’écria-t-elle. Il va retrouver sa femme et son
enfant !… John !… voilà mon John !… »
Mrs. Branican avait perdu la
raison.
Comment peindre l’effet que
produisit à San-Diégo cette double catastrophe, la mort de l’enfant… la folie
de la mère ! On sait de quelle sympathie la population entourait la
famille Branican, quel intérêt inspirait le jeune capitaine du Franklin. Il
était parti depuis quinze jours à peine et il n’était plus père… Sa malheureuse
femme était folle !… À son retour, dans sa maison vide, il ne retrouverait
plus ni les sourires de son petit Wat, ni les tendresses de Dolly, qui ne le
reconnaîtrait même pas !… Le jour où le Franklin rentrerait au port,
il ne serait pas salué par les hurras de la ville !
Mais il ne fallait pas
attendre son retour pour que John Branican fût instruit de l’horrible malheur
qui venait de le frapper. M. William Andrew ne pouvait pas laisser le
jeune capitaine dans l’ignorance de ce qui s’était passé, à la merci de quelque
circonstance fortuite qui lui apprendrait cette effroyable catastrophe. Il
fallait immédiatement expédier une dépêche à l’un des correspondants de
Singapore. De cette façon, le capitaine John connaîtrait l’affreuse vérité
avant d’arriver aux Indes.
Cependant M. William
Andrew ne voulut pas envoyer tout de suite cette dépêche. Peut-être la raison
de Dolly n’était-elle pas irrémédiablement perdue ! Savait-on si les soins
qui l’entoureraient ne lui rendraient pas la possession d’elle-même ?…
Pourquoi frapper John d’un double coup, en lui apprenant la mort de son enfant
et la folie de sa femme, si cette folie devait guérir à court terme ?
Après s’être entretenu avec
Len et Jane Burker, M. William Andrew prit le parti de surseoir jusqu’au
moment où les médecins se seraient définitivement prononcés sur l’état mental
de Dolly. Ces cas d’aliénation subite ne laissent-ils pas plus d’espoir de
guérison que ceux qui sont dus à une lente désorganisation de la vie
intellectuelle ? Oui !… et il convenait d’attendre quelques jours, ou
même quelques semaines.
Cependant la ville était
plongée dans la consternation. On ne cessait d’affluer à la maison de Fleet
Street, afin d’avoir des nouvelles de Mrs. Branican. Entre temps, des
recherches minutieuses avaient été opérées afin de retrouver le corps de
l’enfant : elles n’avaient point abouti. Vraisemblablement, ce corps avait
été entraîné par le flot, puis repris par la marée descendante. Le pauvre petit
être n’aurait pas même une tombe sur laquelle sa mère viendrait prier, si elle
recouvrait la raison !
D’abord, les médecins purent
constater que la folie de Dolly affectait la forme d’une mélancolie douce.
Nulle crise nerveuse, aucune de ces violences inconscientes, qui obligent à renfermer
les malades et à leur rendre tout mouvement impossible. Il ne parut donc pas
nécessaire de se précautionner contre ces excès auxquels se portent souvent les
aliénés, soit contre autrui, soit contre eux-mêmes. Dolly n’était plus qu’un
corps sans âme, une intelligence dans laquelle il ne restait aucun souvenir de
cet horrible malheur. Ses yeux étaient secs, son regard éteint. Elle semblait
ne plus voir, elle semblait ne plus entendre. Elle n’était plus de ce monde.
Elle ne vivait que de la vie matérielle.
Tel fut l’état de Mrs.
Branican pendant le premier mois qui suivit l’accident. On avait examiné la
question de savoir s’il conviendrait de la mettre dans une maison de santé, où
des soins spéciaux lui seraient donnés. C’était l’avis de M. William
Andrew ; et il eût été suivi sans une proposition de Len Burker qui
modifia cette détermination.
Len Burker, étant venu
trouver M. William Andrew à son bureau, lui dit :
« Nous en sommes
certains maintenant, la folie de Dolly n’a point un caractère dangereux qui
nécessite de l’enfermer, et puisqu’elle n’a pas d’autre famille que nous, nous
demandons à la garder. Dolly aimait beaucoup ma femme, et qui sait si
l’intervention de Jane ne sera pas plus efficace que celle des étrangers ?
Si des crises survenaient plus tard, il serait temps d’aviser et de prendre des
mesures en conséquence. – Qu’en pensez-vous, monsieur Andrew ? »
L’honorable armateur ne répondit
pas sans quelque hésitation, car il n’éprouvait que peu de sympathie pour Len
Burker, bien qu’il ne sût rien de sa situation si compromise alors et n’eût
point lieu de suspecter son honorabilité. Après tout, l’amitié que Dolly et
Jane éprouvaient l’une pour l’autre était profonde, et, puisque Mrs. Burker
était sa seule parente, mieux valait évidemment que Dolly fût confiée à sa
garde. L’essentiel, c’était que la malheureuse femme pût être constamment et affectueusement
entourée des soins qu’exigeait son état.
« Puisque vous voulez
assumer cette tâche, répondit M. William Andrew, je ne vois aucun inconvénient,
monsieur Burker, à ce que Dolly soit remise à sa cousine, dont le dévouement ne
peut être mis en doute…
– Dévouement qui ne lui
manquera jamais ! » ajouta Len Burker.
Mais il dit cela de ce ton
froid, positif, déplaisant, dont il ne pouvait se défaire.
« Votre démarche est
honorable, reprit alors M. William Andrew. Une simple observation, toutefois :
je me demande si, dans votre maison de Fleet Street, au milieu de ce quartier
bruyant du commerce, la pauvre Dolly sera placée dans des conditions favorables
à son rétablissement. C’est du calme qu’il lui faut, du grand air…
– Aussi, répondit Len Burker,
notre intention est-elle de la ramener à Prospect-House et d’y demeurer avec
elle. Ce chalet lui est familier, et la vue des objets auxquels elle était
habituée pourra exercer une influence salutaire sur son esprit. Là, elle sera à
l’abri des importunités… La campagne est à sa porte… Jane lui fera faire
quelques promenades dans les environs qu’elle connaît, qu’elle parcourait avec
son petit enfant… Ce que je propose, John ne l’approuverait-il pas, s’il était
là ?… Et que pensera-t-il à son retour, s’il trouve sa femme dans une
maison de santé, confiée à des mains mercenaires ?… Monsieur Andrew, il ne
faut rien négliger de ce qui serait de nature à exercer quelque influence sur
l’esprit de notre malheureuse parente. »
Cette réponse était
évidemment dictée par de bons sentiments. Mais pourquoi les paroles de cet
homme semblaient-elles toujours ne pouvoir inspirer de la confiance ? Quoi
qu’il en fût, sa proposition, dans les conditions où il la présentait, méritait
d’être acceptée, et M. William Andrew ne put que l’en remercier, en
ajoutant que le capitaine John lui en aurait une profonde reconnaissance.
Le 27 avril, Mrs. Branican
fut transportée à Prospect-House, où Jane et Len Burker vinrent, dès le soir, s’installer.
Cette détermination reçut l’approbation générale.
On devine à quel mobile
obéissait Len Burker. Le jour même de la catastrophe, il avait eu, on ne l’a
point oublié, l’intention d’entretenir Dolly d’une certaine affaire. Cette
affaire consistait précisément en une certaine somme d’argent qu’il se
proposait de lui emprunter. Mais, depuis cette époque, la situation avait
changé. Il était probable que Len Burker serait chargé des intérêts de sa
parente, peut-être en qualité de tuteur, et, dans ces fonctions, il se
procurerait des ressources, illicites sans doute, mais qui lui permettraient de
gagner du temps. C’était bien ce qu’avait pressenti Jane, et, si elle était
heureuse de pouvoir se consacrer tout entière à sa Dolly, elle tremblait en soupçonnant
les projets que son mari allait poursuivre sous le couvert d’un sentiment
d’humanité.
L’existence fut donc
organisée en ces conditions nouvelles à Prospect-House. On installa Dolly dans
cette chambre, d’où elle n’était sortie que pour courir au-devant d’un
épouvantable malheur. Ce n’était plus la mère qui y rentrait, c’était un être
privé de raison. Ce chalet si aimé, ce salon, où quelques photographies conservaient
le souvenir de l’absent, ce jardin où tous deux avaient vécu de si heureux
jours, ne lui rappelèrent rien de l’existence passée. Jane occupait la chambre
contiguë à celle de Mrs. Branican, et Len Burker avait fait la sienne de la
salle du rez-de-chaussée, qui servait de cabinet au capitaine John.
À partir de ce jour, Len
Burker reprit ses occupations habituelles. Chaque matin, il descendait à
San-Diégo, à son office de Fleet Street, où se continuait son train d’affaires.
Mais ce qu’on aurait pu observer, c’est qu’il ne manquait jamais de revenir
chaque soir à Prospect-House, et bientôt il ne fit plus que de courtes absences
en dehors de la ville.
Il va sans dire que la
mulâtresse avait suivi son maître dans sa nouvelle demeure, où elle serait ce
qu’elle avait été partout et toujours, une créature sur le dévouement de
laquelle il pouvait absolument compter. La nourrice du petit Wat avait été congédiée,
bien qu’elle eût offert de se consacrer au service de Mrs. Branican. Quant à la
servante, elle était provisoirement conservée au chalet pour les besoins auxquels
Nô seule n’aurait guère pu suffire.
D’ailleurs, personne n’aurait
valu Jane pour les soins affectueux et assidus qu’exigeait l’état de Dolly. Son
amitié s’était augmentée, s’il est possible, depuis la mort de l’enfant dont
elle s’accusait d’avoir été la cause première. Si elle n’était pas venue
trouver Dolly à Prospect-House, si elle ne lui avait pas suggéré l’idée d’aller
rendre visite au capitaine du Boundary, cet enfant serait aujourd’hui
près de sa mère, la consolant des longues heures de l’absence !… Dolly
n’aurait pas perdu la raison !
Il entrait, sans doute, dans
les intentions de Len Burker que les soins de Jane parussent suffisants à ceux
qui s’intéressaient à la situation de Mrs. Branican. M. William Andrew dut
même reconnaître que la pauvre femme ne pouvait être en de meilleures mains. Au
cours de ses visites, il observait surtout si l’état de Dolly avait quelque
tendance à s’améliorer. Il voulait encore espérer que la première dépêche, adressée
au capitaine John à Singapore ou aux Indes, ne lui annoncerait pas un double
malheur, son enfant mort… sa femme… N’était-ce pas comme si elle fût morte, elle
aussi ! Eh bien, non ! Il ne pouvait croire que Dolly, dans la force
de la jeunesse, dont l’esprit était si élevé, le caractère si énergique, eût
été irrémédiablement frappée dans son intelligence ! N’était-ce pas
seulement un feu caché sous les cendres ?… Quelque étincelle ne le
rallumerait-il pas un jour ?… Et pourtant, cinq semaines s’étaient déjà
écoulées, et aucun éclair de raison n’avait dissipé les ténèbres. Devant une
folie calme, réservée, languissante, que ne troublait aucune surexcitation
physiologique, les médecins ne semblaient point garder le plus léger espoir, et
ils ne tardèrent pas à cesser leurs visites. Bientôt même, M. William
Andrew, désespérant une guérison, ne vint que plus rarement à Prospect-House, tant
il lui était pénible de se trouver devant cette infortunée, si indifférente, et
si inconsciente à la fois.
Lorsque Len Burker était
obligé, pour un motif ou un autre, de passer une journée au dehors, la mulâtresse
avait ordre de surveiller de très près Mrs. Branican. Sans chercher à gêner en
rien les soins de Jane, elle ne la laissait presque jamais seule avec Dolly, et
rapportait fidèlement à son maître tout ce qu’elle avait remarqué dans l’état
de la malade. Elle s’ingéniait à éconduire les quelques personnes qui venaient
encore prendre des nouvelles au chalet. C’était contraire aux recommandations
des médecins, disait-elle… Il fallait un calme absolu… Ces dérangements
pouvaient provoquer des crises… Et Mrs. Burker elle-même donnait raison à Nô, quand
elle éloignait les visiteurs comme des importuns, qui n’avaient que faire à
Prospect-House. Aussi l’isolement se faisait-il autour de Mrs. Branican.
« Pauvre Dolly, pensait
Jane, si son état empirait, si sa folie devenait furieuse, si elle se portait à
des excès… on me la retirerait… on la renfermerait dans une maison de santé…
Elle serait perdue pour moi !… Non ! Dieu fasse qu’on me la laisse…
Qui la soignerait avec plus d’affection que moi ! »
Pendant la troisième semaine
de mai, Jane voulut essayer de quelques promenades aux alentours du chalet, pensant
que sa cousine en éprouverait un peu de bien. Len Burker ne s’y opposa point, mais
à la condition que Nô accompagnerait Dolly et sa femme. Ce n’était que prudent
d’ailleurs. La marche, le grand air, pouvaient déterminer un trouble chez Dolly,
peut-être faire naître dans son esprit l’idée de s’enfuir, et Jane n’aurait pas
eu la force de la retenir. On doit tout craindre d’une folle, qui peut même
être poussée à se détruire… Il ne fallait pas s’exposer à un autre malheur.
Un jour, Mrs. Branican sortit
donc appuyée au bras de Jane. Elle se laissait conduire comme un être passif, allant
où on la menait, sans prendre intérêt à rien.
Au début de ces promenades, il
ne se produisit aucun incident. Toutefois, la mulâtresse ne tarda pas à
observer que le caractère de Dolly montrait une certaine tendance à se
modifier. À son calme habituel succédait une visible exaltation, qui pouvait
avoir des conséquences fâcheuses. À plusieurs reprises, la vue des petits enfants
qu’elle rencontrait, provoqua chez elle une crise nerveuse. Était-ce au
souvenir de celui qu’elle avait perdu qu’elle se rattachait ?… Wat
revenait-il à sa pensée ?… Quoi qu’il en soit, en admettant qu’il eût
fallu voir là un symptôme favorable, il s’en suivait une agitation cérébrale, qui
était de nature à aggraver le mal.
Certain jour, Mrs. Burker et
la mulâtresse avaient amené la malade sur les hauteurs de Knob-Hill. Dolly
s’était assise, tournée vers l’horizon de la mer, mais il semblait que son
esprit fût vide de pensées, comme ses yeux étaient vides de regards.
Soudain sa figure s’anime, un
tressaillement l’agite, son œil s’empreint d’un éclat singulier, et, d’une main
tremblante, elle montre un point qui brillait au large.
« Là !… Là !… »
s’écrie-t-elle.
C’était une voile, nettement
détachée sur le ciel, et dont un rayon de soleil accusait la blancheur lumineuse.
« Là !… Là !… »
répétait Dolly.
Et sa voix profondément
altérée, ne semblait plus appartenir à une créature humaine.
Tandis que Jane la regardait
avec épouvante, la mûlatresse secouait la tête en signe de mécontentement. Elle
s’empressa de saisir le bras de Dolly, répéta ce mot :
« Venez !… Venez !… »
Dolly ne l’entendait même
pas.
« Viens, ma Dolly, viens !… »
dit Jane.
Et elle cherchait à
l’entraîner, à détourner ses regards de la voile qui se déplaçait à l’horizon.
Dolly résista.
« Non !… Non ! »
s’écria-t-elle.
Et elle repoussa la
mulâtresse avec une force dont on ne l’eût pas crue capable.
Mrs. Burker et Nô se
sentirent très inquiètes. Elles pouvaient craindre que Dolly leur échappât, qu’irrésistiblement
attirée par cette troublante vision, où dominait le souvenir de John, elle
voulût descendre les pentes de Knob-Hill et se précipiter vers la mer.
Mais, subitement, cette
surexcitation tomba. Le soleil venait de disparaître derrière un nuage, et la
voile n’apparaissait plus à la surface de l’Océan.
Dolly redevenue inerte, le
bras retombé, le regard éteint, n’avait plus conscience de la situation. Les
sanglots qui soulevaient convulsivement sa poitrine avaient cessé, comme si la
vie se fût retirée d’elle. Alors Jane lui prit la main ; elle se laissa
emmener sans résistance et rentra tranquillement à Prospect-House.
À partir de ce jour, Len
Burker décida que Dolly ne se promènerait plus que dans l’enclos du chalet, et
Jane dut se conformer à cette injonction.
Ce fut à cette époque que M. William
Andrew se décida à instruire le capitaine John de tout ce qui s’était passé, l’aliénation
de Mrs. Branican ne laissant plus l’espoir d’une amélioration. Ce ne fut pas à
Singapore, d’où le Franklin devait être déjà reparti, après avoir achevé
sa relâche, ce fut à Calcutta qu’il adressa une longue dépêche, que John
trouverait à son arrivée aux Indes.
Et cependant, bien que M. William
Andrew ne conservât plus alors aucune espérance au sujet de Dolly, d’après les
médecins, une modification dans son état mental était encore possible, si elle
éprouvait une secousse violente, par exemple le jour où son mari reparaîtrait
devant elle. Cette chance, il est vrai, c’était la seule qui restât, et, si faible
qu’elle fût, M. William Andrew ne voulut pas la négliger dans sa dépêche à
John Branican. Aussi, après l’avoir supplié de ne point s’abandonner au désespoir,
il l’engageait à remettre au second, Harry Felton, le commandement du Franklin,
et à revenir à San-Diégo par les voies les plus rapides. Cet excellent
homme eût sacrifié ses intérêts les plus chers pour tenter cette dernière
épreuve sur Dolly et il demandait au jeune capitaine de lui répondre
télégraphiquement ce qu’il croirait devoir faire.
Lorsque Len Burker eut pris
connaissance de cette dépêche que M. William Andrew jugea convenable de
lui communiquer, il l’approuva, tout en exprimant sa crainte que le retour de
John fût impuissant à produire un ébranlement moral dont on pût espérer quelque
salutaire effet. Mais Jane se rattacha à cet espoir, que la vue de John
pourrait rendre la raison à Dolly, et Len Burker promit de lui écrire dans ce
sens, afin qu’il ne retardât pas son départ pour San-Diégo – promesse qu’il ne
tint pas, d’ailleurs.
Pendant les semaines qui
suivirent, aucun changement ne se produisit dans l’état de Mrs. Branican. Si la
vie physique n’était nullement troublée en elle, et bien que la santé ne
laissât rien à désirer, l’altération de sa physionomie n’était que trop
visible. Ce n’était plus cette femme qui n’avait pas encore atteint sa vingt et
unième année, avec ses traits plus accusés, son teint dont la coloration si
chaude avait pâli, comme si le feu de l’âme se fût éteint en elle. D’ailleurs
il était rare qu’on pût l’apercevoir, à moins que ce fût dans le jardin du
chalet, assise sur quelque banc, ou se promenant auprès de Jane, qui la
soignait avec un dévouement infatigable.
Au commencement du mois de
juin, il y avait deux mois et demi que le Franklin avait quitté le port
de San-Diégo. Depuis sa rencontre avec le Boundary, on n’en avait plus eu
de nouvelles. À cette date, après avoir relâché à Singapore, sauf le cas
d’accidents improbables, il devait être sur le point d’arriver à Calcutta.
Aucun mauvais temps exceptionnel n’avait été signalé dans le Nord-Pacifique ni
dans l’océan Indien, qui aurait pu occasionner des retards à un voilier de
grande marche.
Cependant M. William
Andrew ne laissait pas d’être surpris de ce défaut d’informations nouvelles. Il
ne s’expliquait pas que son correspondant ne lui eût pas signalé le passage du Franklin
à Singapore. Comment admettre que le Franklin n’y eût pas relâché, puisque
le capitaine John avait des ordres formels à cet égard. Enfin, on le saurait
dans quelques jours, dès que le Franklin serait arrivé à Calcutta.
Une semaine s’écoula. Au 15
juin, pas de nouvelles encore. Une dépêche fut alors expédiée au correspondant
de la maison Andrew demandant une réponse immédiate à propos de John Branican
et du Franklin.
Cette réponse arriva deux
jours après.
On ne savait rien du Franklin
à Calcutta. Le trois-mâts américain n’avait pas même été rencontré, à cette
date, dans les parages du golfe du Bengale.
La surprise de M. William
Andrew se changea en inquiétude, et, comme le secret d’un télégramme est
impossible à garder, le bruit se répandit à San-Diégo que le Franklin n’était
arrivé ni à Calcutta ni à Singapore.
La famille Branican
allait-elle donc être frappée d’un autre malheur – malheur qui atteindrait
aussi les familles de San-Diégo, auxquelles appartenait l’équipage du Franklin ?
Len Burker ne laissa pas
d’être très impressionné, lorsqu’il apprit ces alarmantes nouvelles. Cependant
son affection pour le capitaine John n’avait jamais été démonstrative, et il
n’était pas homme à s’affliger du malheur des autres, même quand il s’agissait
de sa propre famille. Quoi qu’il en soit, depuis le jour où l’on put être très
sérieusement inquiet sur le sort du Franklin, il parut plus sombre, plus
soucieux, plus fermé à toutes relations – même pour ses affaires. On ne le vit
que rarement dans les rues de San-Diégo, à son office de Fleet Street, et il
eut l’air de vouloir se confiner dans l’enclos de Prospect-House.
Quant à Jane, sa figure pâle,
ses yeux rougis par les larmes, sa physionomie profondément abattue, disaient
qu’elle devait passer de nouveau par de terribles épreuves.
Ce fut vers cette époque
qu’un changement se produisit dans le personnel du chalet. Sans motif apparent,
Len Burker renvoya la servante, qui avait été gardée jusqu’alors, et dont le
service cependant ne donnait lieu à aucune plainte.
La mulâtresse resta
uniquement chargée des soins du ménage. À l’exception de Jane et d’elle, personne
n’eut plus accès près de Mrs. Branican. M. William Andrew, dont la santé
était très éprouvée par ces coups de la mauvaise fortune, avait dû cesser ses
visites à Prospect-House. Au surplus, devant la perte presque probable du Franklin,
qu’aurait-il pu dire, qu’aurait-il pu faire ? D’ailleurs, depuis
l’interruption de ses promenades, il savait que Dolly avait recouvré tout son
calme et que les troubles nerveux avaient disparu. Elle vivait, maintenant, elle
végétait plutôt dans un état d’inconscience, qui était le caractère propre de
sa folie, et sa santé n’exigeait plus aucun soin spécial.
À la fin de juin, M. William
Andrew reçut une nouvelle dépêche de Calcutta. Les correspondances maritimes ne
signalaient le Franklin sur aucun des points de la route qu’il avait dû
suivre à travers les parages des Philippines, des Célèbes, de la mer de Java et
de l’océan Indien. Or, comme ce bâtiment avait quitté depuis trois mois le port
de San-Diégo, il était à supposer qu’il s’était perdu corps et biens, soit par
collision, soit par naufrage, avant même d’être arrivé à Singapore.
Cette suite de catastrophes, dont
la famille Branican venait d’être victime, faisait à Len Burker une situation
sur laquelle il est nécessaire d’appeler l’attention.
On ne l’a point oublié, si la
position pécuniaire de Mrs. Branican était fort modeste, celle-ci devait être
l’unique héritière de son oncle, le riche Edward Starter. Toujours retiré dans
son vaste domaine forestier, relégué pour ainsi dire dans la partie la plus
inabordable de l’État de Tennessee, cet original s’était interdit de jamais
donner de ses nouvelles. Comme il n’avait guère que cinquante-neuf ans, sa
fortune pouvait se faire longtemps attendre.
Peut-être même eût-il modifié
ses dispositions, s’il avait appris que Mrs. Branican, la seule parente directe
qui lui restât de toute sa famille, avait été frappée d’aliénation mentale
depuis la mort de son enfant. Mais il l’ignorait, ce double malheur ; il
n’aurait d’ailleurs pu l’apprendre, s’étant constamment refusé à recevoir des
lettres comme à en écrire. Len Burker aurait pu, il est vrai, enfreindre cette
défense, à raison des changements survenus dans l’existence de Dolly, et Jane
lui avait laissé entendre que son devoir exigeait qu’il avisât Edward Starter ;
mais il lui avait imposé silence, et s’était bien gardé de suivre ce conseil.
C’est que son intérêt lui
commandait de s’abstenir, et, entre son intérêt et son devoir, il n’était pas
homme à hésiter, fût-ce un instant. Ses affaires prenaient chaque jour une
tournure trop inquiétante pour qu’il voulût sacrifier cette dernière chance de fortune.
En effet, la situation était
très simple : si Mrs. Branican mourait sans enfants, sa cousine Jane, unique
parente qui eût qualité pour hériter d’elle, bénéficierait de son héritage. Or,
depuis la mort du petit Wat, Len Burker avait certainement vu s’accroître les
droits de sa femme à l’héritage d’Edward Starter, c’est-à-dire les siens.
Et, en réalité, les
événements ne s’accordaient-ils pas pour lui procurer cette énorme fortune ?
Non seulement l’enfant était mort, non seulement Dolly était folle, mais, d’après
l’avis des médecins, il n’y avait que le retour du capitaine John qui pût
modifier son état mental.
Et précisément, le sort du Franklin
donnait les plus vives inquiétudes. Si les nouvelles continuaient à faire
défaut pendant quelques semaines encore, si John Branican n’était pas rencontré
en mer, si la maison Andrew n’apprenait pas que son bâtiment eût relâché dans
un port quelconque, c’est que ni le Franklin ni l’équipage ne
reviendraient jamais à San-Diégo. Alors, il n’y aurait plus que Dolly, privée
de raison, entre la fortune qui devait lui revenir et Len Burker. Et, aux
prises avec une situation désespérée, que ne tenterait-il pas, cet homme sans
conscience, lorsque la mort d’Edward Starter aurait mis Dolly en possession de
son riche héritage ?
Mais, pour que Mrs. Branican
héritât, il fallait qu’elle survécût à son oncle. Len Burker avait donc intérêt
à ce que la vie de cette malheureuse femme se prolongeât jusqu’au jour où
l’héritage d’Edward Starter aurait passé sur sa tête. Il n’avait plus à présent
que deux chances contre lui : ou la mort de Dolly, survenant trop tôt, ou
le retour du capitaine John, dans le cas où, après avoir fait naufrage sur
quelque île inconnue, il parviendrait à se rapatrier. Mais cette dernière
éventualité était à tout le moins très aléatoire, et la perte totale du Franklin
devait être déjà considérée comme certaine.
Tel était le cas de Len
Burker, tel était l’avenir qu’il entrevoyait, et cela au moment où il se
sentait réduit aux suprêmes expédients. En effet, si la justice intervenait
dans ses affaires, il aurait à répondre d’abus de confiance caractérisés. Une
partie des fonds qui lui avaient été confiés par des imprudents, ou qu’il avait
attirés en usant de manœuvres indélicates, n’était plus dans sa caisse. Les
réclamations finiraient par se produire, bien qu’il employât l’argent des uns à
désintéresser les autres. Il y avait là un état de choses qui ne pouvait durer.
La ruine approchait, plus que la ruine, le déshonneur, et ce qui touchait bien
autrement un tel homme, son arrestation sous les inculpations les plus graves.
Mrs. Burker soupçonnait sans
doute que la situation de son mari était extrêmement menacée, mais n’en était
pas à croire qu’elle pût se dénouer par l’intervention de la justice. Au surplus,
la gêne n’était pas encore très sensible dans le chalet de Prospect-House.
Voici pour quelle raison.
Depuis que Dolly avait été
frappée d’aliénation mentale, en l’absence de son mari, il y avait eu lieu de
lui nommer un tuteur. Len Burker s’était trouvé tout désigné pour cette fonction
en raison de sa parenté avec Mrs. Branican, et il avait par le fait
l’administration de sa fortune. L’argent que le capitaine John avait laissé en
partant pour subvenir aux besoins du ménage étant à sa disposition, il en avait
usé pour ses nécessités personnelles.
C’était peu de choses, en
somme, car l’absence du Franklin ne devait durer que cinq à six mois, mais
il y avait le patrimoine que Dolly avait apporté en mariage, et bien qu’il ne
comprît que quelques milliers de dollars, Len Burker, en l’employant à faire
face aux réclamations trop pressantes, serait à même de gagner du temps – ce
qui était l’essentiel.
Aussi ce malhonnête homme
n’hésita-t-il pas à abuser de son mandat de tuteur. Il détourna les titres qui
composaient l’avoir de Mrs. Branican, à la fois sa pupille et sa parente. Grâce
à ces ressources illicites, il put obtenir un peu de répit et se lancer dans de
nouvelles affaires non moins équivoques. Engagé sur la route qui conduit au
crime, Len Burker, s’il le fallait, la suivrait jusqu’au bout.
D’ailleurs, le retour du
capitaine John était de moins en moins à redouter. Les semaines s’écoulaient, et
la maison Andrew ne recevait aucune nouvelle du Franklin, dont la
présence n’avait été signalée nulle part depuis six mois. Août et septembre se
passèrent. Ni à Calcutta, ni à Singapore, les correspondances n’avaient relevé
le plus léger indice qui permît de savoir ce qu’était devenu le trois-mâts
américain. Maintenant, on le considérait, non sans raison, comme perdu
totalement, et c’était un deuil public pour San-Diégo. Comment avait-il péri ?
Là-dessus, les opinions ne pouvaient guère varier, bien que l’on fût réduit à
des conjectures. En effet, depuis le départ du Franklin, plusieurs
bâtiments de commerce, de même destination, avaient nécessairement pris la même
direction. Or, comme ils n’en avaient retrouvé aucune trace, il y avait lieu de
s’arrêter à une hypothèse très vraisemblable : c’est que le Franklin, engagé
dans un de ces formidables ouragans, une de ces irrésistibles tornades, qui battent
les parages de la mer des Célèbes ou de la mer de Java, avait péri corps et
biens ; c’est que pas un seul homme n’avait survécu à ce désastre. Au 15
octobre 1875, il y avait sept mois que le Franklin avait quitté San-Diégo,
et tout portait à croire qu’il n’y reviendrait jamais.
C’était même, à cette époque,
une telle conviction dans la ville, que des souscriptions venaient d’être
ouvertes en faveur des familles si malheureusement frappées par cette
catastrophe. L’équipage du Franklin, officiers et matelots, appartenait
au port de San-Diégo, et il y avait là des femmes, des enfants, des parents, menacés
de misère, et qu’il fallait secourir.
L’initiative de ces
souscriptions fut prise par la maison Andrew, qui s’inscrivit pour une somme importante.
Par intérêt autant que par prudence, Len Burker voulut contribuer lui aussi à
cette œuvre charitable. Les autres maisons de commerce de la ville, les
propriétaires, les détaillants, suivirent cet exemple. Il en résulta que les familles
de l’équipage disparu purent être assistées dans une large mesure, ce qui allégea
quelque peu les conséquences de ce sinistre maritime.
On le pense, M. William
Andrew considérait comme un devoir d’assurer à Mrs. Branican, privée de la vie
intellectuelle, au moins la vie matérielle. Il savait qu’avant son départ, le
capitaine John avait laissé au ménage ce qui était nécessaire pour ses besoins,
calculés sur une absence de six à sept mois. Mais, pensant que ces ressources
devaient toucher à leur fin, et ne voulant pas que Dolly fût à la charge de ses
parents, il résolut de s’entretenir à ce sujet avec Len Burker.
Le 17 octobre, dans
l’après-midi, bien que sa santé ne fût pas encore complètement rétablie, l’armateur
prit le chemin de Prospect-House, et, après avoir remonté le haut quartier de
la ville, il arriva devant le chalet.
À l’extérieur, rien de changé,
si ce n’est que les persiennes des fenêtres du rez-de-chaussée et du premier
étage étaient fermées hermétiquement. On eût dit une maison inhabitée, silencieuse,
enveloppée de mystère.
M. William Andrew sonna
à la porte qui était ménagée entre les barrières de l’enclos. Personne ne se
montra. Il ne semblait même pas que le visiteur eût été vu ni entendu.
Est-ce donc qu’il n’y avait
personne en ce moment à Prospect-House ?
Second coup de sonnette, suivi,
cette fois, du bruit d’une porte latérale qui s’ouvrait.
La mulâtresse parut, et, dès
qu’elle eut reconnu M. William Andrew, elle ne put retenir un geste de
dépit, dont celui-ci ne s’aperçut pas, d’ailleurs.
Cependant la mulâtresse
s’était approchée, et sans attendre que la porte eût été ouverte, M. William
Andrew, lui parlant par-dessus la clôture :
« Est-ce que mistress
Branican n’est pas chez elle ? demanda-t-il.
– Elle est sortie… monsieur Andrew…
répondit Nô, avec une hésitation singulière, très visiblement mêlée de crainte.
– Où donc est-elle ?…
dit M. William Andrew, qui insista pour entrer.
– Elle est en promenade avec
mistress Burker.
– Je croyais qu’on avait
renoncé à ces promenades, qui la surexcitaient et provoquaient des crises ?…
– Oui, sans doute… répondit
Nô. Mais, depuis quelques jours… nous avons repris ces sorties… Cela semble
maintenant faire quelque bien à mistress Branican…
– Je regrette qu’on ne m’ait
pas prévenu, répondit M. William Andrew. – M. Burker est-il au chalet ?
– Je ne sais…
– Assurez-vous-en, et, s’il y
est, prévenez-le que je désire lui parler. »
Avant que la mulâtresse eût
répondu – et peut-être eût-elle été très embarrassée pour répondre ! – la
porte du rez-de-chaussée s’ouvrit. Len Burker parut alors sur le perron, traversa
le jardin, et s’avança, disant :
« Veuillez vous donner
la peine d’entrer, monsieur Andrew. En l’absence de Jane qui est sortie avec
Dolly, vous me permettrez de vous recevoir. »
Et cela ne fut pas dit de ce
ton froid, qui était si habituel à Len Burker, mais d’une voix légèrement
troublée.
En somme, puisque c’était
précisément pour voir Len Burker que M. William Andrew était venu à
Prospect-House, il franchit la porte de l’enclos. Puis, sans accepter l’offre
qui lui fut faite de passer dans le salon du rez-de-chaussée, il vint s’asseoir
sur un des bancs du jardin.
Len Burker, prenant alors la
parole, confirma ce que la mulâtresse avait dit : depuis quelques jours, Mrs.
Branican avait recommencé ses promenades aux environs de Prospect-House, ce qui
était très profitable à sa santé.
« Dolly ne
reviendra-t-elle pas bientôt ? demanda M. William Andrew.
– Je ne crois pas que Jane
doive la ramener avant le dîner », répondit Len Burker.
M. William Andrew parut fort
contrarié, car il fallait absolument qu’il fût de retour à sa maison de
commerce pour l’heure du courrier. D’ailleurs, Len Burker ne lui offrit même
pas d’attendre au chalet Mrs. Branican.
« Et vous n’avez
constaté aucune amélioration dans l’état de Dolly ? reprit-il.
– Non, malheureusement, monsieur
Andrew, et il est à craindre qu’il ne s’agisse là d’une folie, dont ni les
soins ni le temps ne pourront avoir raison.
– Qui sait, monsieur Burker ?
Ce qui ne semble plus possible aux hommes est toujours possible à Dieu ! »
Len Burker secoua la tête en
homme qui n’admet guère l’intervention divine dans les choses de ce monde.
« Ce qui est surtout
regrettable, reprit M. William Andrew, c’est que nous ne devons plus
compter sur le retour du capitaine John. Il faut donc renoncer aux modifications
heureuses, que ce retour aurait peut-être amenées dans l’état mental de la
pauvre Dolly. Vous n’ignorez pas, monsieur Burker, que nous avons renoncé à
tout espoir de revoir le Franklin ?…
– Je ne l’ignore point, monsieur Andrew, et c’est un nouveau
et plus grand malheur ajouté à tant d’autres. Et cependant – sans même que la
Providence s’en mêlât, ajouta-t-il d’un ton ironique assez déplacé en ce moment
– le retour du capitaine John, à mon sens, ne serait nullement extraordinaire.
– Après que sept mois se sont
écoulés sans aucune nouvelle du Franklin, fit observer M. William
Andrew, et lorsque les informations que j’ai fait prendre n’ont donné aucun
résultat ?…
– Mais rien ne prouve que le Franklin
ait sombré en pleine mer, reprit Len Burker. N’a-t-il pu faire naufrage sur
un des nombreux écueils de ces parages qu’il a dû traverser ?… Qui sait si
John et ses matelots ne se sont pas réfugiés dans une île déserte ?… Or, si
cela est, ces hommes, résolus et énergiques, sauront bien travailler à leur
rapatriement… Ne peuvent-ils construire une barque avec les débris de leur
navire ?… Leurs signaux ne peuvent-ils pas être aperçus, si un bâtiment
passe en vue de l’île ?… Évidemment, un certain temps est nécessaire pour
que ces éventualités se produisent… Non !… je ne désespère pas du retour
de John… dans quelques mois, sinon dans quelques semaines… Il y a nombre
d’exemples de naufragés que l’on croyait définitivement perdus… et qui sont
revenus au port ! »
Len Burker avait parlé, cette
fois, avec une volubilité qui ne lui était pas ordinaire. Sa physionomie, si
impassible, s’était animée. On eût dit qu’en s’exprimant de la sorte, en
faisant valoir des raisons plus ou moins bonnes au sujet des naufragés, ce
n’était pas à M. William Andrew qu’il répondait, mais à lui-même, à ses
propres anxiétés, à la crainte qu’il éprouvait toujours de voir, sinon le Franklin
signalé au large de San-Diégo, du moins un autre navire ramenant le
capitaine John et son équipage. C’eût été le renversement du système sur lequel
il avait échafaudé son avenir.
« Oui… répondit alors M. William
Andrew, je le sais… Il y a eu de ces sauvetages quasi miraculeux… Tout ce que
vous m’avez dit là, monsieur Burker, je me le suis dit… Mais il m’est
impossible de conserver le moindre espoir ! Quoi qu’il en soit – et c’est
ce dont je suis venu vous parler aujourd’hui – je désire que Dolly ne reste
point à votre charge…
– Oh ! monsieur Andrew…
– Non, monsieur Burker, et
vous permettrez que les appointements du capitaine John restent à la
disposition de sa femme, tant qu’elle vivra…
– Je vous remercie pour elle,
répondit Len Burker. Cette générosité…
– Je ne crois faire que mon
devoir, reprit M. William Andrew. Et, pensant que l’argent laissé par John
avant son départ doit être en grande partie dépensé…
– En effet, monsieur Andrew, répondit
Len Burker ; mais Dolly n’est pas sans famille, c’est aussi notre devoir
de lui venir en aide… tout autant que par affection…
– Oui… je sais que nous
pouvons compter sur le dévouement de Mrs. Burker. Néanmoins, laissez-moi
intervenir dans une certaine mesure pour assurer à la femme du capitaine John, à
sa veuve, hélas !… l’aisance et les soins qui, j’en suis certain, ne lui
auraient jamais fait défaut de votre part.
– Ce sera comme vous le
voudrez, monsieur Andrew.
– Je vous ai apporté, monsieur
Burker, ce que je regarde comme étant légitimement dû au capitaine Branican depuis
le départ du Franklin, et, en votre qualité de tuteur, vous pourrez
chaque mois faire toucher ses émoluments à ma caisse.
– Puisque vous le désirez…
répondit Len Burker.
– Si même vous voulez bien me
donner un reçu de la somme que je vous apporte…
– Très volontiers, monsieur
Andrew. »
Et Len Burker alla dans son
cabinet pour libeller le reçu en question. Lorsqu’il fut revenu dans le jardin,
M. William Andrew, très au regret de n’avoir pas rencontré Dolly et de ne
pouvoir attendre son retour, le remercia du dévouement que sa femme et lui
montraient envers la pauvre folle. Il était bien entendu qu’au moindre changement
qui se produirait dans son état, Len Burker en donnerait avis à M. William
Andrew. Celui-ci prit alors congé, fut reconduit jusqu’à la porte de l’enclos, s’arrêta
un instant pour voir s’il n’apercevrait pas Dolly revenant à Prospect-House en
compagnie de Jane, puis, il redescendit vers San-Diégo. Dès qu’il fut hors de
vue, Len Burker appela vivement la mulâtresse et lui dit :
« Jane sait-elle que
monsieur Andrew vient de se présenter au chalet ?
– Très probablement, Len.
Elle l’a vu arriver comme elle l’a vu s’en aller.
– S’il se représentait ici –
et ce n’est pas à supposer, du moins de quelque temps – il ne faut pas qu’il
voie Jane, ni Dolly surtout !… Tu entends, Nô ?
– J’y veillerai, Len.
– Et si Jane insistait…
– Oh ! quand tu as dit :
je ne veux pas ! répliqua Nô, ce n’est pas Jane qui essayera de lutter
contre ta volonté.
– Soit, mais il faut se
garder des surprises !… Le hasard pourrait amener une rencontre… et… dans
ce moment… ce serait risquer de tout perdre…
– Je suis là, répondit la
mulâtresse, et tu n’as rien à craindre, Len !… Personne n’entrera à Prospect-House
tant que… tant que cela ne nous conviendra pas ! »
Et, de fait, pendant les deux
mois qui suivirent, la maison resta plus fermée que jamais. Jane et Dolly ne se
montraient plus, même dans le petit jardin. On ne les apercevait ni sous la
véranda, ni aux fenêtres du premier étage qui étaient invariablement closes.
Quant à la mulâtresse, elle ne sortait que pour les besoins du ménage, le moins
longtemps possible, et encore ne le faisait-elle point en l’absence de Len Burker,
de sorte que Dolly ne fut jamais seule avec Jane au chalet. On aurait pu observer
aussi que, pendant les derniers mois de l’année, Len Burker ne vint que très
rarement à son office de Fleet Street. Il y eut même des semaines qui se
passèrent sans qu’il y parût, comme si, prenant à tâche de diminuer ses affaires,
il se préparait un nouvel avenir.
Et ce fut dans ces conditions
que s’acheva cette année 1875, qui avait été si funeste à la famille Branican, John
perdu en mer, Dolly privée de raison, leur enfant noyé dans les profondeurs de
la baie de San-Diégo !
Aucune nouvelle du Franklin,
pendant les premiers mois de l’année 1876. Nul indice de son passage, dans
les mers des Philippines, des Célèbes ou de Java. Il en fut de même pour les
parages de l’Australie septentrionale. D’ailleurs, comment admettre que le
capitaine John se fût aventuré à travers le détroit de Torrès ? Une fois
seulement, au nord des îles de la Sonde, à trente milles de Batavia, un morceau
d’étrave fut repêché par une goélette fédérale et rapporté à San-Diégo, pour
voir s’il n’appartenait pas au Franklin. Mais, après un examen plus approfondi,
il fut démontré que cette épave devait être d’un bois plus vieux que les
matériaux employés par les constructeurs du navire disparu.
Au surplus, ce fragment ne se
serait détaché que si le navire s’était fracassé sur quelque écueil ou s’il
avait été abordé en mer. Or, dans ce dernier cas, le secret de la collision
n’aurait pu être si bien gardé qu’il n’en eût transpiré quelque chose – à moins
que les deux bâtiments n’eussent coulé après l’abordage. Mais, puisqu’on ne
signalait point la disparition d’un autre navire, qui eût remonté à une dizaine
de mois, l’idée d’une collision était à écarter, comme aussi la supposition
d’un naufrage sur côte, pour en revenir à l’explication la plus simple :
c’est que le Franklin devait avoir sombré sous le coup d’une de ces
tornades qui visitent fréquemment les parages de la Malaisie, et auxquelles nul
bâtiment ne saurait résister.
Un an s’étant écoulé depuis
le départ du Franklin, il fut définitivement classé dans la catégorie
des navires perdus ou supposés perdus, qui figurent en si grand nombre dans les
annales des sinistres maritimes.
Cet hiver – 1875-1876 – avait
été très rigoureux, même dans cette heureuse région de la basse Californie, où
le climat est généralement modéré. Par les froids excessifs qui persistèrent
jusqu’à la fin de février, personne ne pouvait s’étonner que Mrs. Branican
n’eût jamais quitté Prospect-House, pas même pour prendre l’air dans le petit
enclos.
À se prolonger, cependant, cette
réclusion eût sans doute fini par devenir suspecte aux gens qui demeuraient
dans le voisinage du chalet. Mais on se serait demandé si la maladie de Mrs.
Branican ne s’était pas aggravée, plutôt que de supposer que Len Burker pût
avoir un intérêt quelconque à cacher la malade. Aussi le mot de séquestration
ne fut-il jamais prononcé. Quant à M. William Andrew, il avait été retenu
à la chambre durant une grande partie de l’hiver, impatient de voir par
lui-même dans quel état se trouvait Dolly, il se promettait d’aller à
Prospect-House, dès qu’il serait en état de sortir.
Or, dans la première semaine
de mars, voilà que Mrs. Branican reprit ses promenades aux environs de
Prospect-House, en compagnie de Jane et de la mulâtresse. Peu de temps après, dans
une visite qu’il fit au chalet, M. William Andrew constata que la santé de
la jeune femme ne donnait aucune inquiétude. Physiquement, son état était aussi
satisfaisant que possible. Moralement, il est vrai, aucune amélioration ne
s’était produite : inconscience, défaut de mémoire, manque d’intelligence,
c’était toujours là les caractères de cette dégénérescence mentale. Même au
cours de ses promenades, qui auraient pu lui rappeler quelques souvenirs, en
présence des enfants qu’elle rencontrait sur sa route, devant cette mer animée
de voiles lointaines où se perdait son regard, Mrs. Branican n’éprouvait plus
cette émotion qui l’avait si profondément troublée autrefois. Elle ne cherchait
pas à s’enfuir, et, maintenant, on pouvait la laisser seule à la garde de Jane.
Toute idée de résistance, toute velléité de réaction étant éteintes, c’était la
plus absolue résignation, doublée de la plus complète indifférence. Et, lorsque
M. William Andrew eut revu Dolly, il dut se répéter que sa folie était
incurable.
À cette époque, la situation
de Len Burker était de plus en plus compromise. Le patrimoine de Mrs. Branican
dont il avait violé le dépôt, n’avait pas suffi à combler l’abîme creusé sous
ses pieds. Cette lutte à laquelle il s’opiniâtrait allait prendre fin avec ses
dernières ressources. Quelques mois encore, quelques semaines peut-être, il
serait menacé de poursuites judiciaires, dont il ne parviendrait à éviter les
conséquences qu’en abandonnant San-Diégo.
Une seule circonstance aurait
pu le sauver ; mais il ne semblait pas qu’elle dût se produire – du moins
en temps utile. En effet, si Mrs. Branican était vivante, son oncle Edward
Starter continuait à vivre et à bien vivre. Non sans d’infinies précautions, afin
qu’il n’en fût point informé, Len Burker avait pu se procurer des nouvelles de
ce Yankee, confiné au fond de ses terres du Tennessee.
Robuste et vigoureux, dans la
plénitude de ses facultés morales et physiques, ayant à peine soixante ans, Edward
Starter passait son existence au grand air, au milieu des prairies et des
forêts de cet immense territoire, dépensant son activité en parties de chasse à
travers cette giboyeuse contrée, ou en parties de pêche sur les nombreux cours
d’eau qui l’arrosent, se démenant sans cesse à pied ou à cheval, administrant
par lui et rien que par lui ses vastes domaines. Décidément, c’était un de ces
rudes fermiers du Nord-Amérique, qui meurent centenaires, et encore ne s’explique-t-on
pas pourquoi ils veulent bien se décider à mourir.
Il n’y avait donc pas à
compter dans un délai prochain sur cet héritage, et toute vraisemblance était
même pour que l’oncle survécût à sa nièce. Les espérances que Len Burker avait
pu concevoir de ce chef s’écroulaient manifestement, et devant lui se dressait
l’inévitable catastrophe.
Deux mois s’écoulèrent, deux
mois pendant lesquels sa situation devint pire encore. Des bruits inquiétants
coururent sur son compte à San-Diégo comme au dehors. Maintes menaces lui
furent adressées par des gens qui ne pouvaient plus rien obtenir de lui. Pour
la première fois, M. William Andrew eut connaissance de ce qui était, et, très
alarmé au sujet des intérêts de Mrs. Branican, il prit la résolution d’obliger
son tuteur à lui rendre des comptes. S’il le fallait, la tutelle de Dolly
serait remise à quelque mandataire plus digne de confiance, bien qu’il n’y eût
rien à reprocher à Jane Burker, profondément dévouée à sa cousine.
Or, à cette époque déjà, les
deux tiers du patrimoine de Mrs. Branican étaient dévorés, et, de cette fortune,
il ne restait à Len Burker qu’un millier et demi de dollars.
Au milieu des réclamations
qui le pressaient de toutes parts, un millier et demi de dollars, c’était une
goutte d’eau dans la baie de San-Diégo ! Mais, ce qui était insuffisant
pour faire face à ses obligations devait lui suffire encore, s’il voulait fuir
pour se mettre à l’abri des poursuites. Et il n’était que temps.
En effet, des plaintes ne
tardèrent pas à être déposées contre Len Burker – plaintes en escroqueries et
abus de confiance. Bientôt il fut sous le coup d’un mandat d’arrestation. Mais,
lorsque les agents se présentèrent à son office de Fleet Street, il n’y avait
pas paru depuis la veille.
Les agents se transportèrent
aussitôt à Prospect-House… Len Burker avait quitté le chalet au milieu de la
nuit. Qu’elle l’eût voulu ou non, sa femme avait été contrainte de le suivre.
Seule la mulâtresse Nô était restée près de Mrs. Branican.
Des recherches furent alors
ordonnées à San-Diégo, puis à San-Francisco, et sur divers points de l’État de
Californie, afin de retrouver les traces de Len Burker : elles ne
produisirent aucun résultat.
Dès que le bruit de cette
disparition se fut répandu dans la ville, un tollé s’éleva contre l’indigne
agent d’affaires, dont le déficit – on l’apprit rapidement – se chiffrait par
une somme considérable.
Ce jour-là – 17 mai – à la
première heure, M. William Andrew, s’étant rendu à Prospect-House, avait
constaté qu’il ne restait plus rien des valeurs appartenant à Mrs. Branican.
Dolly était absolument sans ressources. Son infidèle tuteur n’avait même pas
laissé de quoi subvenir à ses premiers besoins.
M. William Andrew
s’arrêta aussitôt au seul parti qu’il y eût à prendre : c’était de faire
entrer Mrs. Branican dans une maison de santé, où sa situation serait assurée, et
de congédier cette Nô, qui ne lui inspirait aucune confiance.
Donc, si Len Burker avait
espéré que la mulâtresse resterait près de Dolly, et qu’elle le tiendrait au
courant des modifications que son état de santé ou de fortune subirait dans
l’avenir, il fut déçu de ce chef.
Nô, mise en demeure de
quitter Prospect-House, partit le jour même. Dans la pensée qu’elle chercherait
sans doute à rejoindre les époux Burker, la police la fit observer pendant quelque
temps. Mais cette femme, très défiante et très rusée, parvint à dépister les
agents, et disparut à son tour, sans que l’on sût ce qu’elle était devenue.
Maintenant, il était abandonné,
ce chalet de Prospect-House, où John et Dolly avaient vécu si heureux, où ils
avaient fait tant de rêves pour le bonheur de leur enfant !
Ce fut dans la maison de
santé du docteur Brumley, qui l’avait déjà soignée, que Mrs. Branican fut
conduite par M. William Andrew. Son état mental se ressentirait-il du changement
récemment produit dans son existence ? On l’espéra vainement. Elle resta
aussi indifférente qu’elle l’avait été à Prospect-House. La seule particularité
digne d’être relevée, c’est qu’une sorte d’instinct naturel semblait surnager
au milieu du naufrage de sa raison. Quelquefois, il lui arrivait de murmurer
une chanson de bébé, comme si elle eût voulu endormir un enfant entre ses bras.
Mais le nom du petit Wat ne s’échappait jamais de ses lèvres.
Au cours de l’année 1876, aucune
nouvelle de John Branican. Les rares personnes qui auraient pu croire encore
que, si le Franklin ne revenait pas, son capitaine et son équipage
seraient, malgré cela, rapatriés, furent contraintes de renoncer à cette
conjecture. L’espérance ne peut indéfiniment résister à l’action destructive du
temps. Aussi cette chance de retrouver les naufragés, qui s’affaiblissait de
jour en jour, fut elle réduite à néant, lorsque l’année 1877, prenant fin, eut
porté à plus de dix-huit mois le délai durant lequel on n’avait rien appris
relativement au navire disparu.
Il en fut de même pour ce qui
concernait les époux Burker. Les recherches étant demeurées infructueuses, on
ne savait en quel pays ils étaient allés se réfugier, on ignorait le lieu où
tous deux se cachaient sous un faux nom.
Et, à la vérité, il aurait eu
raison de se plaindre de sa malchance, ce Len Burker, de n’avoir pu maintenir
sa situation à l’office de Fleet Street. En effet, deux ans après sa
disparition, l’aléa sur lequel il avait échafaudé ses plans venait de se
réaliser, et il est permis de dire qu’il avait sombré au port !
Vers le milieu du mois de
juin 1878, M. William Andrew reçut une lettre à l’adresse de Dolly Branican.
Cette lettre l’informait de la mort inopinée d’Edward Starter. Le Yankee avait
péri dans un accident. Une balle, tirée par un de ses compagnons de chasse, l’avait
par ricochet frappé en plein cœur et tué sur le coup.
À l’ouverture de son
testament, il fut reconnu qu’il laissait toute sa fortune à sa nièce, Dolly
Starter, femme du capitaine Branican. L’état dans lequel se trouvait actuellement
son héritière n’avait rien pu changer à ses dispositions, puisqu’il ignorait
qu’elle eût été atteinte de folie, comme il ignorait aussi la disparition du
capitaine John.
Aucune de ces nouvelles
n’était jamais parvenue au fond de cet État du Tennessee, dans cet inaccessible
et sauvage domaine, où, conformément à la volonté d’Edward Starter, ne pénétraient
ni lettres ni journaux.
En fermes, en forêts, en
troupeaux, en valeurs industrielles de diverses sortes, la fortune du testateur
pouvait être évaluée à deux millions de dollars.
Tel était l’héritage que la
mort accidentelle d’Edward Starter venait de faire passer sur la tête de sa
nièce. Avec quelle joie San-Diégo eût applaudi à cet enrichissement de la
famille Branican, si Dolly eût encore été épouse et mère, en pleine possession
de son intelligence, si John avait été là pour partager cette richesse avec
elle ! Quel usage la charitable femme en aurait fait : Que de
malheureux elle aurait secourus ! Mais non ! Les revenus de cette
fortune mis en réserve, s’accumuleraient sans profit pour personne. Dans la
retraite inconnue où il s’était réfugié, Len Burker eut-il connaissance de la
mort d’Edward Starter et des biens considérables qu’il laissait, il est
impossible de le dire.
M. William Andrew, administrateur
des biens de Dolly, prit le parti d’aliéner les terres du Tennessee, fermes, forêts
et prairies, qu’il eût été difficile de gérer à de telles distances. Nombre
d’acquéreurs se présentèrent, et les ventes furent faites dans d’excellentes
conditions. Les sommes qui en provinrent, converties en valeurs de premier
choix, jointes à celles qui formaient une part importante de l’héritage
d’Edward Starter, furent déposées dans les caisses de la Consolidated
National Bank de San-Diégo. L’entretien de Mrs. Branican dans la maison du
docteur Brumley ne devait absorber qu’une très faible part des revenus dont
elle allait être créditée annuellement, et leur accumulation finirait par lui
constituer l’une des plus grosses fortunes de la basse Californie.
D’ailleurs, malgré ce
changement de situation, il ne fut point question de retirer Mrs. Branican de
la maison du docteur Brumley. M. William Andrew ne le jugea pas
nécessaire. Cette maison lui offrait tout le confort et aussi tous les soins
que ses amis pouvaient désirer. Elle y resta donc, et là, sans doute, s’achèverait
cette misérable, cette vaine existence, à laquelle il semblait que l’avenir
réservait toutes les chances de bonheur !
Mais si le temps marchait, le
souvenir des épreuves qui avaient accablé la famille Branican était toujours
aussi vivace à San-Diégo, et la sympathie que Dolly inspirait aussi sincère, aussi
profonde qu’au premier jour.
L’année 1879 commença, et
tous ceux qui croyaient qu’elle s’écoulerait comme les autres, sans amener
aucun changement dans cette situation, se trompaient absolument.
En effet, pendant les
premiers mois de l’année nouvelle, le docteur Brumley et les médecins attachés
à sa maison furent vivement frappés des modifications que présentait l’état
moral de Mrs. Branican. Ce calme désespérant, cette indifférence apathique
qu’elle montrait pour tous les détails de la vie matérielle, faisaient graduellement
place à une agitation caractéristique. Ce n’étaient point des crises, suivies
d’une réaction, où l’intelligence s’annihilait plus absolument encore. Non !
On eût pu croire que Dolly éprouvait le besoin de se reprendre à la vie
intellectuelle, que son âme cherchait à rompre les liens qui l’empêchaient de
s’épandre à l’extérieur. Des enfants, qui lui furent présentés, obtinrent
d’elle un regard, presque un sourire. On ne l’a pas oublié, à Prospect-House, durant
la première période de sa folie, elle avait eu de ces échappées d’instinct, qui
s’évanouissaient avec la crise. Maintenant, au contraire, ces impressions
tendaient à persister. Il semblait que Dolly fût dans le cas d’une personne qui
s’interroge, qui cherche à retrouver au fond de sa mémoire des souvenirs
lointains.
Mrs. Branican allait-elle
donc recouvrer la raison ? Était-ce un travail de régénération qui
s’opérait en elle ? La plénitude de sa vie morale lui serait-elle rendue ?…
Hélas ! à présent qu’elle n’avait plus ni enfant ni mari, était-il à
souhaiter que cette guérison, on peut dire ce miracle, se manifestât, puisqu’elle
n’en serait que plus malheureuse !
Que cela fût désirable ou non,
les médecins entrevirent la possibilité d’obtenir ce résultat. Tout fut mis en œuvre
pour produire sur l’esprit, sur le cœur de Mrs. Branican des secousses durables
et salutaires. On jugea même à propos de lui faire quitter la maison du docteur
Brumley, de la ramener à Prospect-House, de la réinstaller dans sa chambre du
chalet. Et lorsque cela fut fait, elle eut certainement conscience de cette
modification apportée à son existence, elle parut prendre intérêt à se trouver
dans ces conditions nouvelles.
Avec les premières journées
du printemps – on était alors en avril – les promenades recommencèrent aux
environs. Mrs. Branican fut plusieurs fois conduite sur les grèves de la pointe
Island. Les quelques navires qui passaient au large, elle les suivait du regard,
et sa main se tendait vers l’horizon. Mais elle ne cherchait plus à s’échapper
comme autrefois, à fuir le docteur Brumley qui l’accompagnait. Elle n’était
point affolée par le bruit des lames tumultueuses, couvrant le rivage de leurs
embruns. Y avait-il lieu de penser que son imagination l’entraînait alors sur
cette route suivie par le Franklin en quittant le port de San-Diégo, au
moment où ses hautes voiles disparaissaient derrière les hauteurs de la falaise ?…
Oui… peut-être ! Et ses lèvres, un jour, murmurèrent distinctement le nom
de John !…
Il était manifeste que la
maladie de Mrs. Branican venait d’entrer dans une période dont il y avait lieu
d’étudier soigneusement les diverses phases. Peu à peu, en s’habituant à vivre
au chalet, elle reconnaissait çà et là les objets qui lui étaient chers. Sa
mémoire se reconstituait dans ce milieu, qui avait été si longtemps le sien. Un
portrait du capitaine John, au mur de sa chambre, commençait à fixer son
attention. Chaque jour, elle le regardait avec plus d’insistance et une larme, inconsciente
encore, s’échappait parfois de ses yeux.
Oui ! s’il n’y avait pas
eu certitude sur la perte du Franklin, si John eût été sur le point de
revenir, s’il eût apparu soudain, peut-être Dolly eût-elle recouvré la raison !…
Mais il ne fallait plus compter sur le retour de John !
C’est pourquoi le docteur
Brumley résolut de provoquer chez la pauvre femme une secousse qui n’était pas
sans danger. Il voulait agir avant que l’amélioration observée fût venue à
s’amoindrir, avant que la malade fût retombée dans cette indifférence qui avait
été la caractéristique de sa folie depuis quatre ans. Puisqu’il semblait que
son âme vibrait encore au souffle des souvenirs, il fallait lui imprimer une vibration
suprême, dût-elle en être brisée ! Oui ! tout plutôt que de laisser
Dolly rentrer dans ce néant, comparable à la mort !
Ce fut aussi l’avis de M. William
Andrew, et il encouragea le docteur Brumley à tenter l’épreuve.
Un jour, le 27 mai, tous deux
vinrent chercher Mrs. Branican, à Prospect-House. Une voiture, qui les
attendait à la porte, les conduisit à travers les rues de San-Diégo jusqu’aux
quais du port, et s’arrêta à l’embarcadère, où la steam-launch prenait les
passagers qui voulaient se rendre à la pointe Loma.
L’intention du docteur
Brumley, c’était, non de reconstituer la scène de la catastrophe, mais de replacer
Mrs. Branican dans la situation où elle se trouvait, lorsqu’elle avait été si
brusquement frappée dans sa raison.
En ce moment, le regard de
Dolly brillait d’un extraordinaire éclat. Elle était en proie à une singulière
animation. Il se faisait comme un remuement dans tout son être…
Le docteur Brumley et M. William
Andrew la conduisirent vers la steam-launch, et, à peine eut-elle mis le pied
sur le pont, que l’on fut encore plus vivement surpris de son attitude.
D’instinct, elle était allée reprendre la place qu’elle occupait au coin de la
banquette de tribord, alors qu’elle tenait son enfant entre ses bras. Puis elle
regardait le fond de la baie, du côté de la pointe Loma, comme si elle eut
cherché le Boundary à son mouillage.
Les passagers de
l’embarcation avaient reconnu Mrs. Branican, et, M. William Andrew les
ayant prévenus de ce qui allait être tenté, tous étaient sous le coup d’une
émotion profonde. Devaient-ils être les témoins d’une scène de résurrection…
non la résurrection d’un corps, mais celle d’une âme ?…
Il va sans dire que toutes
les précautions avaient été prises pour que, dans une crise d’affolement, Dolly
ne pût se jeter par-dessus le bord de l’embarcation.
Déjà on avait franchi un
demi-mille, et les yeux de Dolly ne s’étaient pas encore abaissés vers la surface
de la baie. Ils étaient toujours dirigés vers la pointe Loma, et, lorsqu’ils
s’en détournèrent, ce fut pour observer les manœuvres d’un navire de commerce, qui,
toutes voiles dessus, apparaissait à l’entrée du goulet, se rendant à son poste
de quarantaine.
La figure de Dolly fut comme
transformée… Elle se redressa, en regardant ce navire…
Ce n’était pas le Franklin,
et elle ne s’y trompa point. Mais secouant la tête, elle dit :
« John !… Mon John !…
Toi aussi, tu reviendras bientôt… et je serai là pour te recevoir ! »
Soudain ses regards
semblèrent fouiller les eaux de cette baie qu’elle venait de reconnaître. Elle
poussa un cri déchirant, et se retournant vers M. William Andrew :
« Monsieur Andrew… vous…
dit-elle. Et lui… mon petit Wat… mon enfant… mon pauvre enfant !… Là… là…
je me souviens !… Je me souviens !… »
Et elle tomba agenouillée sur
le pont de l’embarcation, les yeux noyés de larmes.
Mrs. Branican revenue à la
raison, c’était comme une morte qui serait revenue à la vie. Puisqu’elle avait
résisté à ce souvenir, à l’évocation de cette scène, puisque cet éclair de sa
mémoire ne l’avait pas foudroyée, pouvait-on, devait-on espérer que cette
reprise d’elle-même serait définitive ? Son intelligence ne
succomberait-elle pas une seconde fois, lorsqu’elle apprendrait que, depuis
quatre ans, les nouvelles du Franklin faisaient défaut, qu’il fallait le
considérer comme perdu, corps et biens, qu’elle ne reverrait jamais le
capitaine John ?…
Dolly, brisée par cette
violente émotion, avait été immédiatement ramenée à Prospect-House. Ni M. William
Andrew, ni le docteur Brumley n’avaient voulu la quitter, et grâce aux femmes
attachées à son service, elle reçut tous les soins que réclamait son état.
Mais la secousse avait été si
rude qu’une fièvre intense s’en suivit. Il y eut même quelques jours de délire,
dont les médecins se montrèrent très inquiets, bien que Dolly fût rentrée dans
la plénitude de ses facultés intellectuelles. À la vérité, lorsque le moment
serait venu de lui faire connaître toute l’étendue de son malheur, que de
précautions il y aurait à prendre !
Et d’abord, la première fois
que Dolly demanda depuis combien de temps elle était privée de raison :
« Depuis deux mois, répondit
le docteur Brumley, qui était préparé à cette question.
– Deux mois… seulement ! »
murmura-t-elle.
Et il lui semblait qu’un
siècle avait passé sur sa tête !
« Deux mois !
ajouta-t-elle. John ne peut encore être de retour, puisqu’il n’y a que trois
mois qu’il est parti !… Et sait-il que notre pauvre petit enfant ?…
– Monsieur Andrew a écrit…
répliqua sans hésiter le docteur Brumley.
– Et a-t-on reçu des
nouvelles du Franklin ?… »
Réponse fut faite à Mrs.
Branican que le capitaine John avait dû écrire de Singapore, mais que ses
lettres n’avaient pu encore parvenir. Toutefois, d’après les correspondances
maritimes, il y avait lieu de croire que le Franklin ne tarderait pas à
arriver aux Indes. Des dépêches étaient attendues sous peu de temps. Puis Dolly
ayant demandé pourquoi Jane Burker n’était pas près d’elle, le docteur lui répondit
que M. et Mrs. Burker étaient en voyage, et que l’on n’était pas fixé sur
l’époque de leur retour. C’était à M. William Andrew qu’incombait la tâche
d’apprendre à Mrs. Branican la catastrophe du Franklin. Mais il fut
convenu qu’il ne parlerait que lorsque sa raison serait assez raffermie pour supporter
ce nouveau coup. Il aurait même soin de ne lui révéler que peu à peu les faits permettant
de conclure qu’il ne restait aucun survivant du naufrage.
La question de l’héritage, acquis
par la mort de M. Edward Starter, fut également réservée. Mrs. Branican
saurait toujours assez tôt qu’elle possédait cette fortune, puisque son mari ne
pourrait plus la partager avec elle !
Pendant les quinze jours qui
suivirent, Mrs. Branican n’eut aucune communication avec le dehors. M. William
Andrew et le docteur Brumley eurent seuls accès près d’elle. Sa fièvre, très
intense au début, commençait à diminuer, et ne tarderait probablement pas à
disparaître. Autant au point de vue de sa santé que pour n’avoir point à
répondre à des questions trop précises, trop embarrassantes, le docteur avait
prescrit à la malade un silence absolu. Et, surtout, on évitait devant elle
toute allusion au passé, tout ce qui aurait pu lui permettre de comprendre que
quatre ans s’étaient écoulés depuis la mort de son enfant, depuis le départ du
capitaine John. Pendant quelque temps encore, il importait que l’année 1879 ne
fût pour elle que l’année 1875.
D’ailleurs, Dolly n’éprouvait
qu’un désir ou plutôt une impatience bien naturelle : c’était de recevoir
une première lettre de John. Elle calculait que le Franklin étant sur le
point d’arriver à Calcutta, s’il n’y était déjà, la maison Andrew ne tarderait
pas à en être avisée par télégramme… Le courrier transocéanique ne se ferait
pas attendre… Puis, elle-même, dès qu’elle en aurait la force, écrirait à John…
Hélas ! que dirait cette lettre – la première qu’elle lui aurait adressée
depuis leur mariage, puisqu’ils n’avaient jamais été séparés avant le départ du
Franklin ?… Oui ! que de tristes choses renfermerait cette
première lettre !
Et alors se reportant vers le
passé, Dolly s’accusait d’avoir causé la mort de son enfant !… Cette néfaste
journée du 31 mars revenait à son souvenir !… Si elle eût laissé le petit
Wat à Prospect-House, il vivrait encore !… Pourquoi l’avait-elle emmené
lors de cette visite au Boundary ?… Pourquoi avait-elle refusé
l’offre du capitaine Ellis, qui lui proposait de rester à bord jusqu’à
l’arrivée du navire au quai de San-Diégo ?… L’effroyable malheur ne fût
pas arrivé !… Et aussi pourquoi, dans un mouvement irréfléchi, avait-elle
arraché l’enfant des bras de sa nourrice, au moment où l’embarcation évoluait
brusquement pour éviter un abordage !… Elle était tombée, et le petit Wat
lui avait échappé… à elle, sa mère… et elle n’avait pas eu l’instinct de le
serrer dans une étreinte convulsive… Et, lorsque le matelot l’avait ramenée à
bord, le petit Wat n’était plus dans ses bras !… Pauvre enfant, qui
n’avait pas même une tombe sur laquelle sa mère pût aller pleurer !
Ces images, trop vivement
évoquées dans son esprit, faisaient perdre à Dolly le calme qui lui était si
nécessaire. À plusieurs reprises, un violent délire, dû au redoublement de la
fièvre, rendit le docteur Brumley extrêmement inquiet. Par bonheur, ces crises
se calmèrent, s’éloignèrent, disparurent. enfin. Il n’y eut plus à craindre
pour l’état mental de Mrs. Branican. Le moment approchait où M. William
Andrew pourrait tout lui dire.
Dès que Dolly fut franchement
entrée dans la période de convalescence, elle obtint la permission de quitter
son lit. On l’installa sur une chaise longue, devant les fenêtres de sa chambre,
d’où son regard embrassait la baie de San-Diégo, et pouvait se porter plus loin
que la pointe Loma, jusqu’à l’horizon de mer. Là, elle restait immobile pendant
de longues heures.
Puis Dolly voulut écrire à
John ; elle avait besoin de lui parler de leur enfant qu’il ne verrait
plus, et elle laissa déborder toute sa douleur dans une lettre que John ne
devait jamais recevoir.
M. William Andrew prit
cette lettre, en promettant de la joindre à son courrier pour les Indes, et, cela
fait, Mrs. Branican redevint assez calme, ne vivant plus que dans l’espérance
d’obtenir par voie directe ou indirecte des nouvelles du Franklin.
Cependant cet état de choses
ne devait pas durer. Évidemment, Dolly apprendrait, tôt ou tard, ce qu’on lui
cachait – par excès de prudence peut-être. Plus elle se concentrait dans cette
pensée qu’elle ne tarderait pas à recevoir une lettre de John, que chaque jour
écoulé la rapprochait de son retour, plus le coup serait terrible !
Et cela ne parut que trop
certain à la suite d’un entretien que Mrs. Branican et M. William Andrew
eurent le 19 juin.
Pour la première fois, Dolly
était descendue dans le petit jardin de Prospect-House, où M. William
Andrew l’aperçut assise sur un banc, devant le perron du chalet. Il alla
s’asseoir près d’elle, et lui prenant les mains, les serra affectueusement.
Dans cette dernière période
de convalescence, Mrs. Branican se sentait déjà forte. Son visage avait repris
sa chaude coloration d’autrefois, bien que ses yeux fussent toujours humides de
larmes.
« Je vois que votre
guérison fait de rapides progrès, chère Dolly, dit M. William Andrew. Oui,
vous allez mieux !
– En effet, monsieur Andrew, répondit
Dolly, mais il me semble que j’ai bien vieilli pendant ces deux mois !…
– Combien mon pauvre John me
trouvera changée à son retour !… Et puis, je suis seule à l’attendre !…
Il n’y a plus que moi…
– Du courage, ma chère Dolly,
du courage !… Je vous défends de vous laisser abattre… Je suis maintenant
votre père… oui, votre père !… et je veux que vous m’obéissiez !
– Cher monsieur Andrew !
– À la bonne heure !
– La lettre que j’ai écrite à
John est partie, n’est-ce pas ?… demanda Dolly.
– Assurément… et il faut
attendre sa réponse avec patience !… Il y a quelquefois de longs retards
pour ces courriers de l’Inde !… Voilà que vous pleurez encore !… Je
vous en prie, ne pleurez plus !…
– Le puis-je, monsieur Andrew,
lorsque je songe… Et ne suis-je pas la cause… moi…
– Non, pauvre mère, non !
Dieu vous a frappée cruellement… mais il veut que toute douleur ait une fin !
– Dieu !… murmura Mrs.
Branican, Dieu qui me ramènera mon John !
– Ma chère Dolly, avez-vous
eu aujourd’hui la visite du docteur ? demanda M. William Andrew.
– Oui, et ma santé lui a paru
meilleure !… Les forces me reviennent, et bientôt je pourrai sortir…
– Pas avant qu’il vous le
permette, Dolly !
– Non, monsieur Andrew, je
vous promets de ne pas faire d’imprudences.
– Et je compte sur votre
promesse.
– Vous n’avez encore rien
reçu de relatif au Franklin, monsieur Andrew ?
– Non, et je ne saurais m’en
étonner !… Les navires mettent quelquefois bien du temps à se rendre aux
Indes…
– John aurait pu écrire de
Singapore ?… Est-ce qu’il n’y a pas fait relâche ?
– Cela doit être, Dolly !…
Mais, s’il a manqué le courrier de quelques heures, il n’en faut pas plus pour
que ses lettres éprouvent un retard de quinze jours.
– Ainsi… vous n’êtes point
surpris que John n’ait pas pu jusqu’ici vous faire parvenir une lettre ?…
– Aucunement… répondit M. William
Andrew, qui sentait combien la conversation devenait embarrassante.
– Et les journaux maritimes
n’ont point mentionné son passage ?… demanda Dolly.
– Non… depuis qu’il a été
rencontré par le Boundary… il y a environ…
– Oui… environ deux mois… Et
pourquoi faut-il que cette rencontre ait eu lieu !… Je ne serais point
allée à bord du Boundary… et mon enfant… »
Le visage de Mrs. Branican
s’était altéré, et des larmes coulaient de ses yeux.
« Dolly… ma chère Dolly,
répondit M. William Andrew, ne pleurez pas, je vous en prie, ne pleurez
pas !
– Ah ! monsieur Andrew…
je ne sais… Un pressentiment me saisit parfois… C’est inexplicable… Il me
semble qu’un nouveau malheur… Je suis inquiète de John !
– Il ne faut pas l’être, Dolly !…
Il n’y a aucune raison d’avoir de l’inquiétude…
– Monsieur Andrew, demanda
Mrs. Branican, ne pourriez-vous m’envoyer quelques-uns des journaux où se
trouvent les correspondances maritimes ? Je voudrais les lire…
– Certainement, ma chère
Dolly, je le ferai… D’ailleurs, si l’on savait quelque chose qui concernât le Franklin…
soit qu’il eût été rencontré en mer, soit que sa prochaine arrivée aux Indes
fût signalée, j’en serais le premier informé, et aussitôt… »
Mais il convenait de donner
un autre tour à l’entretien, Mrs. Branican aurait fini par remarquer
l’hésitation avec laquelle lui répondait M. William Andrew, dont le regard
se baissait devant le sien, lorsqu’elle l’interrogeait plus directement. Aussi
le digne armateur allait-il parler pour la première fois de la mort d’Edward
Starter, et de la fortune considérable qui était échue en héritage à sa nièce, lorsque
Dolly fit cette question :
« Jane Burker et son
mari sont en voyage, m’a-t-on dit ?… Y a-t-il longtemps qu’ils ont quitté
San-Diégo ?…
– Non… Deux ou trois semaines…
– Et ne sont-ils pas bientôt
près de revenir ?…
– Je ne sais… répondit M. William
Andrew. Nous n’avons reçu aucune nouvelle…
– On ignore donc où ils sont
allés ?…
– On l’ignore, ma chère
Dolly. Len Burker était engagé dans des affaires très aventureuses. Il a pu
être appelé loin… très loin…
– Et Jane ?…
– Mistress Burker a dû
accompagner son mari… et je ne saurais vous dire ce qui s’est passé…
– Pauvre Jane ! dit Mrs.
Branican. J’ai pour elle une vive affection, et je serai heureuse de la revoir…
N’est-ce pas la seule parente qui me reste ! »
Elle ne songeait même pas à
Edward Starter, ni au lien de famille qui les unissait.
« Comment se fait-il que
Jane ne m’ait pas écrit une seule fois ? demanda-t-elle.
– Ma chère Dolly… vous étiez
déjà bien malade, lorsque M. Burker et sa femme sont partis de San-Diégo…
– En effet, monsieur Andrew, et
pourquoi écrire à qui ne sait plus comprendre !… Chère Jane, elle est à
plaindre !… La vie aura été dure pour elle !… J’ai toujours craint
que Len Burker se lançât dans quelque spéculation qui tournerait mal !…
Peut-être John le craignait-il aussi !
– Et cependant, répondit M. William
Andrew, personne ne s’attendait à un si fâcheux dénouement…
– Est-ce donc à la suite de
mauvaises affaires que Len Burker a quitté San-Diégo ?… » demanda vivement
Dolly.
Et elle regardait M. William
Andrew, dont l’embarras n’était que trop visible.
« Monsieur Andrew, reprit-elle,
parlez !… Ne me laissez rien ignorer !… Je désire tout savoir !…
– Eh bien, Dolly, je ne veux
point vous cacher un malheur que vous ne tarderiez pas à connaître !… Oui !
dans ces derniers temps, la situation de Len Burker s’est aggravée… Il n’a pu
faire face à ses engagements… Des réclamations se sont élevées… Menacé d’être
mis en état d’arrestation, il a dû prendre la fuite…
– Et Jane l’a suivi ?…
– Il a certainement dû l’y
contraindre, et, vous le savez, elle était sans volonté devant lui…
– Pauvre Jane !… Pauvre
Jane ! murmura Mrs. Branican. Que je la plains, et si j’avais été à même
de lui venir en aide…
– Vous l’auriez pu ! dit
M. William Andrew. Oui… vous auriez pu sauver Len Burker, sinon pour lui, qui
ne mérite aucune sympathie, du moins pour sa femme…
– Et John eût approuvé, j’en
suis sûre, l’emploi que j’aurais fait de notre modeste fortune ! »
M. William Andrew se garda
bien de répondre que le patrimoine de Mrs. Branican avait été dévoré par Len
Burker. C’eût été avouer qu’il avait été son tuteur, et elle se serait
peut-être demandé comment en un temps si court – deux mois à peine – tant
d’événements avaient pu s’accomplir.
Aussi M. William Andrew
se borna-t-il à répondre :
« Ne parlez plus de
votre modeste position, ma chère Dolly… Elle est bien changée maintenant !
– Que voulez-vous dire, monsieur
Andrew ? demanda Mrs. Branican.
– Je veux dire que vous êtes
riche… extrêmement riche !
– Moi ?…
– Votre oncle Edward Starter
est mort…
– Mort ?… Il est mort !…
Et depuis quand ?…
– Depuis… »
M. William Andrew fut sur le
point de se trahir, en donnant la date exacte du décès d’Edward Starter, vieille
de deux ans déjà, ce qui eût fait connaître l’entière vérité.
Mais Dolly était toute à
cette pensée que la mort de son oncle, la disparition de sa cousine, la laissaient
sans famille. Et, quand elle apprit que, du fait de ce parent qu’elle avait à
peine connu, dont John et elle n’entrevoyaient l’héritage que dans un avenir
assez éloigné, sa fortune se montait à deux millions de dollars, elle ne vit là
que l’occasion du bien qu’elle aurait pu accomplir.
« Oui, monsieur Andrew, dit-elle,
je serais venue au secours de la pauvre Jane !… Je l’aurai sauvée de la
ruine et de la honte !… Où est-elle ?… Où peut-elle être ?… Que va-t-elle
devenir ?… »
M. William Andrew dut
répéter que les recherches faites pour retrouver Len Burker n’avaient donné
aucun résultat. Len Burker s’était-il réfugié sur quelque lointain territoire des
États-Unis, ou n’avait-il pas plutôt quitté l’Amérique ? Il avait été impossible
de le savoir.
« Cependant, s’il n’y a
que quelques semaines que Jane et lui ont disparu de San-Diégo, fit observer
Mrs. Branican, peut-être apprendra-t-on…
– Oui… quelques semaines ! »
se hâta de répondre M. William Andrew.
Mais, en ce moment, Mrs.
Branican ne songeait qu’à ceci : c’est que, grâce à l’héritage d’Edward
Starter, John n’aurait plus besoin de naviguer… C’est qu’il ne la quitterait
plus. C’est que ce voyage à bord du Franklin, pour le compte de la
maison Andrew, serait le dernier qu’il aurait fait…
Et n’était-ce pas le dernier,
puisque le capitaine John n’en devait jamais revenir !
« Cher monsieur Andrew, s’écria
Dolly, une fois de retour, John ne reprendra plus la mer !… Ses goûts de
marin, il me les sacrifiera !… Nous vivrons ensemble… toujours ensemble !…
Rien ne nous séparera plus ! »
À l’idée que ce bonheur
serait brisé d’un mot – un mot qu’il faudrait bientôt prononcer – M. William
Andrew ne se sentait plus maître de lui. Il se hâta de mettre fin à cet
entretien ; mais, avant de s’éloigner, il obtint de Mrs. Branican la
promesse qu’elle ne commettrait aucune imprudence, qu’elle ne se hasarderait
pas à sortir, qu’elle ne reviendrait pas à sa vie d’autrefois, tant que le
docteur ne l’aurait pas permis. De son côté, il dut répéter que s’il recevait
directement ou indirectement quelques informations sur le Franklin, il
s’empresserait de les communiquer à Prospect-House.
Lorsque M. William
Andrew eut rapporté cette conversation au docteur Brumley, celui-ci ne cacha
point sa crainte qu’une indiscrétion ne fît connaître la vérité à Mrs.
Branican. Que sa folie avait duré quatre ans, que, depuis quatre ans, on ne
savait ce qu’était devenu le Franklin, qu’elle ne reverrait jamais John.
Oui ! mieux valait que ce fût par M. William Andrew ou par lui-même, et
en prenant tous les ménagements possibles, que Dolly fût informée de la
situation.
Il fut donc décidé que dans
une huitaine de jours, lorsqu’il n’y aurait plus un motif plausible pour interdire
à Mrs. Branican de quitter le chalet, elle serait instruite de tout.
« Et que Dieu lui donne
la force de résister à cette épreuve ! » dit M. William Andrew.
Pendant la dernière semaine
de juin, l’existence de Mrs. Branican continua d’être à Prospect-House ce
qu’elle avait toujours été. Grâce aux soins dont on l’entourait, elle
recouvrait la force physique en même temps que l’énergie morale. Aussi M. William
Andrew se sentait-il de plus en plus embarrassé, lorsque Dolly le pressait de
questions auxquelles il lui était interdit de répondre.
Dans l’après-midi du 23, il
vint la voir, afin de mettre à sa disposition une importante somme d’argent et
de lui rendre compte de sa fortune, qui était déposée en valeurs mobilières à
la Consolidated National Bank de San-Diégo.
Ce jour-là, Mrs. Branican se
montra très indifférente au sujet de ce que lui disait M. William Andrew.
Elle l’écoutait à peine. Elle ne parlait que de John, elle ne pensait qu’à lui.
Quoi ! pas encore de lettre !… Cela l’inquiétait au dernier point !…
Comment se faisait-il que la maison Andrew n’eût pas reçu même de dépêche mentionnant
l’arrivée du Franklin aux Indes ?
L’armateur essaya de calmer
Dolly en lui disant qu’il venait d’envoyer des télégrammes à Calcutta, que, d’un
jour à l’autre, il aurait une réponse. Bref, s’il réussit à détourner ses idées,
elle le troubla singulièrement, lorsqu’elle lui demanda :
« Monsieur Andrew, il y
a un homme dont je ne vous ai point parlé jusqu’ici… C’est celui qui m’a sauvée
et qui n’a pu sauver mon pauvre enfant… C’est ce marin…
– Ce marin ?… répondit M. William
Andrew non sans une visible hésitation.
– Oui… cet homme courageux… à
qui je dois la vie… A-t-il été récompensé ?…
– Il l’a été, Dolly. »
Et, en réalité, c’est ce qui
avait été fait.
« Se trouve-t-il à
San-Diégo, monsieur Andrew ?…
– Non… ma chère Dolly… Non !…
J’ai entendu dire qu’il avait repris la mer… »
Ce qui était vrai.
Après avoir quitté le service
de la baie, ce marin avait fait plusieurs campagnes au commerce et il se
trouvait actuellement en cours de navigation.
« Mais, au moins, pouvez-vous
me dire comment il se nomme ?… demanda Mrs. Branican.
– Il se nomme Zach Fren.
– Zach Fren ?… Bien !…
Je vous remercie, monsieur Andrew ! » répondit Dolly.
Et elle n’insista pas
davantage sur ce qui concernait le marin dont elle venait d’apprendre le nom.
Mais, depuis ce jour, Zach
Fren ne cessa plus d’occuper la pensée de Dolly. Il était désormais indissolublement
lié dans son esprit au souvenir de la catastrophe qui avait eu pour théâtre la
baie de San-Diégo. Ce Zach Fren, elle le retrouverait à la fin de sa campagne…
Il n’était parti que depuis quelques semaines… Elle saurait à bord de quel
navire il avait embarqué… Un navire du port de San-Diégo probablement… ce
navire reviendrait dans six mois… dans un an… et alors… Certainement, le Franklin
serait de retour avant lui… John et elle seraient d’accord pour récompenser
Zach Fren… pour lui payer leur dette de reconnaissance… Oui ! John ne
pouvait tarder à ramener le Franklin, dont il résignerait le commandement…
Ils ne se sépareraient plus l’un de l’autre !
« Et, ce jour-là, pensait-elle,
pourquoi faudra-t-il que nos baisers soient mêlés de larmes ! »
Cependant M. William
Andrew désirait et craignait cet entretien dans lequel Mrs. Branican apprendrait
la disparition définitive du Franklin, la perte de son équipage et de
son capitaine – perte qui ne faisait plus doute à San-Diégo. Sa raison, ébranlée
une première fois, résisterait-elle à ce dernier coup ? Bien que quatre
ans se fussent écoulés depuis le départ de John, ce serait comme si sa mort
n’eût daté que de la veille ! Le temps, qui avait passé sur tant d’autres
douleurs humaines, n’avait point marché pour elle !
Tant que Mrs. Branican
resterait à Prospect-House, on pouvait espérer qu’aucune indiscrétion ne serait
prématurément commise. M. William Andrew et le docteur Brumley avaient
pris leurs précautions à cet égard, en empêchant journaux ou lettres d’arriver
au chalet. Mais Dolly se sentait assez forte pour sortir, et, bien que le
docteur ne l’eût pas encore autorisée à le faire, ne pouvait-elle quitter
Prospect-House sans en rien dire ?… Aussi ne fallait-il plus hésiter, et, comme
cela avait été convenu, Dolly apprendrait bientôt qu’il n’y avait plus à
compter sur le retour du Franklin.
Or, après la conversation
qu’elle avait eue avec M. William Andrew, Mrs. Branican avait pris la résolution
de sortir, sans prévenir ses femmes, qui auraient tout fait pour l’en
dissuader. Si cette sortie ne représentait aucun danger dans l’état actuel de
sa santé, elle pouvait amener de déplorables résultats, dans le cas où un
hasard quelconque lui ferait connaître la vérité, sans de préalables
ménagements.
En quittant Prospect-House, Mrs.
Branican se proposait de faire une démarche au sujet de Zach Fren.
Depuis qu’elle connaissait le
nom de ce marin, une pensée n’avait cessé de l’obséder.
« On s’est occupé de lui,
se répétait-elle. Oui !… Un peu d’argent lui aura été donné, et je n’ai pu
intervenir moi-même… Puis Zach Fren est parti, il y a cinq ou six semaines…
Mais peut-être a-t-il une famille, une femme, des enfants… de pauvres gens à
coup sûr !… C’est mon devoir d’aller les visiter, de subvenir à leurs
besoins, de leur assurer l’aisance !… Je les verrai, et je ferai pour eux
ce que je dois faire ! »
Et, si Mrs. Branican eut
consulté M. William Andrew à ce propos, comment aurait-il pu la détourner
d’accomplir cet acte de reconnaissance et de charité ?
Le 21 juin, Dolly sortit de
chez elle vers neuf heures du matin ; personne ne l’avait aperçue. Elle
était vêtue de deuil – le deuil de son enfant, dont la mort, dans sa pensée, remontait
à deux mois à peine. Ce ne fut pas sans une profonde émotion qu’elle franchit
la porte du petit jardin – seule, ce qui ne lui était pas encore arrivé.
Le temps était beau, et la
chaleur déjà forte avec ces premières semaines de l’été californien, bien
qu’elle fût atténuée par la brise de mer.
Mrs. Branican s’engagea entre
les clôtures de la haute ville. Absorbée par l’idée de ce qu’elle allait faire,
le regard distrait, elle n’observa pas certains changements survenus dans ce
quartier, quelques constructions récentes qui auraient dû attirer son
attention. Du moins n’en eut-elle qu’une perception très vague. D’ailleurs, ces
modifications n’étaient pas assez importantes pour qu’elle fût embarrassée de retrouver
son chemin, en traversant les rues qui descendent vers la baie. Elle ne
remarqua pas non plus que deux ou trois personnes, qui la reconnaissaient, la
regardaient avec un certain étonnement.
En passant devant une
chapelle catholique, voisine de Prospect-House, et dont elle avait été l’une
des plus assidues paroissiennes, Dolly éprouva un irrésistible désir d’y
entrer. Le desservant de cette chapelle commençait à dire la messe, au moment
où elle vint s’agenouiller sur une chaise basse dans un angle assez obscur. Là,
son âme s’épancha en prières pour son enfant, pour son mari, pour tous ceux
qu’elle aimait. Les quelques fidèles qui assistaient à cette messe ne l’avaient
point entrevue, et, lorsqu’elle se retira, ils avaient déjà quitté la chapelle.
C’est alors que son esprit
fut frappé d’un détail d’aménagement qui ne laissa pas que de la surprendre. Il
lui sembla que l’autel n’était plus celui devant lequel elle avait l’habitude
de prier. Cet autel plus riche, d’un style nouveau, était placé en avant d’un
chevet, qui paraissait être de construction récente. Est-ce que la chapelle
avait été récemment agrandie ?…
Ce ne fut encore là qu’une
fugitive impression, qui se dissipa dès que Mrs. Branican eut commencé à
descendre les rues de ce quartier du commerce, où l’animation était grande
alors. Mais, à chaque pas, la vérité pouvait éclater à ses yeux… une affiche
avec une date… un horaire de railroads… un avis de départ des lignes du Pacifique…
l’annonce d’une fête ou d’un spectacle portant le millésime de 1879… Et alors
Dolly apprendrait brusquement que M. William Andrew et le docteur Brumley
l’avaient trompée, que sa folie avait duré quatre ans et non quelques semaines…
Et, de là, cette conséquence, c’est que ce n’était pas depuis deux mois, mais
depuis quatre années que le Franklin avait quitté San-Diégo… Et, si on
le lui avait caché, c’est que John n’était pas revenu… c’est qu’il ne devait
jamais revenir !…
Mrs. Branican se dirigeait
rapidement vers les quais du port, lorsque l’idée lui vint de passer devant la
maison de Len Burker. Cela ne lui occasionnait qu’un léger détour.
« Pauvre Jane ! »
murmurait-elle.
Arrivée en face de l’office
de Fleet Street, elle eut quelque peine à le reconnaître – ce qui lui causa
plus qu’un mouvement de surprise, une vague et troublante inquiétude…
En effet, au lieu de la
maison étroite et sombre qu’elle connaissait, il y avait là une bâtisse importante,
d’architecture anglo-saxonne, comprenant plusieurs étages, avec de hautes
fenêtres, grillées au rez-de-chaussée. Au-dessus du toit, s’élevait un
lanterneau, sur lequel se déployait un pavillon dont l’étamine portait les
initiales H. W. Près de la porte s’étalait un cadre, où l’on pouvait lire ces
mots en lettres dorées :
HARRIS WADANTON AND CO.
Dolly crut d’abord
s’être trompée. Elle regarda à droite, à
gauche. Non ! c’était bien ici, à l’angle de Fleet Street, la maison où
elle venait voir Jane Burker…
Dolly mit la main sur ses
yeux… Un inexplicable pressentiment lui serrait le cœur… Elle ne pouvait se
rendre compte de ce qu’elle éprouvait…
La maison de commerce de M. William
Andrew n’était pas éloignée. Dolly, ayant pressé le pas, l’aperçut au détour de
la rue. Elle eut d’abord la pensée de s’y rendre. Non… elle s’y arrêterait en
revenant… lorsqu’elle aurait vu la famille de Zach Fren… Elle comptait demander
l’adresse du marin au bureau des steam-launches, près de l’embarcadère.
L’esprit égaré, l’œil indécis,
le cœur palpitant, Dolly continua sa route. Ses regards s’attachaient
maintenant sur les personnes qu’elle rencontrait… Elle éprouvait comme un
irrésistible besoin d’aller à ces personnes, afin de les interroger, de leur
demander… quoi ?… On l’aurait prise pour une folle… Mais était-elle sûre
que sa raison ne l’abandonnait pas encore une fois ?… Est-ce qu’il y avait
des lacunes dans sa mémoire ?…
Mrs. Branican arriva sur le
quai. Au delà, la baie se montrait dans toute son étendue. Quelques navires
roulaient sous la houle à leur poste de mouillage. D’autres faisaient leurs
préparatifs pour appareiller. Quels souvenirs rappelait à Dolly ce mouvement du
port !… Il y avait trois mois à peine, elle s’était placée à l’extrémité
de ce wharf… C’est de cet endroit qu’elle avait vu le Franklin évoluer
une dernière fois pour se diriger sur le goulet… C’est là qu’elle avait reçu le
dernier adieu de John !… Puis, le navire avait doublé la pointe Island ;
les hautes voiles s’étaient un instant découpées au-dessus du littoral, et le Franklin
avait disparu dans les lointains de la haute mer…
Quelques pas encore, et Dolly
se trouva devant le bureau des steam-launches, près de l’appontement qui
servait aux passagers. Une des embarcations s’en détachait en ce moment, poussant
vers la pointe Loma.
Dolly la suivit du regard, écoutant
le bruit de la vapeur qui haletait à l’extrémité du tuyau noir.
À quel triste souvenir son
esprit se laissa entraîner alors – le souvenir de son enfant, dont ces eaux
n’avaient pas même rendu le petit corps, et qui l’attiraient… la fascinaient…
Elle se sentait défaillir, comme si le sol lui eût manqué… La tête lui tournait…
Elle fut sur le point de tomber…
Un instant après, Mrs.
Branican entrait dans le bureau des steam-launches.
En voyant cette femme, les
traits contractés, la figure blême, l’employé, qui était assis devant une table,
se leva, approcha une chaise, et dit :
« Vous êtes souffrante, mistress ?
– Ce n’est rien, monsieur, répondit
Dolly. Un moment de faiblesse… Je me sens mieux…
– Veuillez vous asseoir en
attendant le prochain départ. Dans dix minutes au plus…
– Je vous remercie, monsieur,
répondit Mrs. Branican. Je ne suis venue que pour demander un renseignement…
Peut-être pouvez-vous me le donner ?…
– À quel propos, mistress ? »
Dolly s’était assise, et, après
avoir porté la main à son front, pour rassembler ses idées :
« Monsieur, dit-elle, vous
avez eu à votre service un matelot nommé Zach Fren ?…
– Oui, mistress, répondit
l’employé. Ce matelot n’est pas resté longtemps avec nous, mais je l’ai parfaitement
connu.
– C’est bien lui, n’est-ce
pas, qui a risqué sa vie pour sauver une femme… une malheureuse mère…
– En effet, je me rappelle…
mistress Branican… Oui !… c’est bien lui.
– Et maintenant, il est en
mer ?…
– En mer.
– Sur quel navire est-il
embarqué ?…
– Sur le trois-mâts Californian.
– De San-Diégo ?…
– Non, mistress, de San-Francisco.
– À quelle destination ?…
– À destination des mers
d’Europe. »
Mrs. Branican, plus fatiguée
qu’elle n’aurait cru l’être, se tut pendant quelques instants, et l’employé
attendit qu’elle lui adressât de nouvelles questions. Lorsqu’elle fut un peu remise :
« Zach Fren est-il de
San-Diégo ?… demanda-t-elle.
– Oui, mistress.
– Pouvez-vous m’apprendre où
demeure sa famille ?…
– J’ai toujours entendu dire
à Zach Fren qu’il était seul au monde. Je ne crois pas qu’il lui reste aucun
parent, ni à San-Diégo ni ailleurs.
– Il n’est pas marié ?…
– Non, mistress. »
Il n’y avait pas lieu de
mettre en doute la réponse de cet employé, à qui Zach Fren était particulièrement
connu.
Donc, en ce moment, rien à
faire, puisque ce marin n’avait pas de famille, et il faudrait que Mrs.
Branican attendît le retour du Californian en Amérique.
« Sait-on combien doit
durer le voyage de Zach Fren ? demanda-t-elle.
– Je ne saurais vous le dire,
mistress, car le Californian est parti pour une très longue campagne.
– Je vous remercie, monsieur,
dit Mrs. Branican. J’aurais eu grande satisfaction à rencontrer Zach Fren, mais
bien du temps se passera, sans doute…
– Oui, mistress !
– Toutefois, il est possible
qu’on ait des nouvelles du Californian dans quelques mois… dans quelques
semaines ?…
– Des nouvelles ?…
répondit l’employé. Mais la maison de San-Francisco à laquelle ce navire appartient
a déjà dû en recevoir plusieurs fois…
– Déjà ?…
– Oui… mistress !
– Et plusieurs fois ?… »
En répétant ces mots, Mrs.
Branican, qui s’était levée, regardait l’employé, comme si elle n’eût rien
compris à ses paroles.
« Tenez, mistress, reprit
celui-ci, en tendant un journal. Voici la Shipping-Gazette… Elle annonce
que le Californian a quitté Liverpool il y a huit jours…
– Il y a huit jours ! »
murmura Mrs. Branican, qui avait pris le journal en tremblant. Puis, d’une voix
si profondément altérée que l’employé put à peine l’entendre :
« Depuis combien de
temps Zach Fren est-il donc parti ?… demanda-t-elle.
– Depuis près de dix-huit
mois…
– Dix-huit mois ! »
Dolly dut s’appuyer à l’angle
du bureau… Son cœur avait cessé de battre pendant quelques instants. Soudain
ses regards s’arrêtèrent sur une affiche appendue au mur, et qui indiquait les
heures du service des steam-launches pour la saison d’été. En tête de l’affiche,
il y avait ce mot et ces chiffres :
MARS 1879
Mars 1879 !… On l’avait
trompée !… Il y avait quatre ans que son enfant était mort… quatre ans que
John avait quitté San-Diégo !… Elle avait donc été folle pendant ces
quatre années !… Oui !… Et si M. William Andrew, si le docteur
Brumley lui avaient laissé croire que sa folie n’avait duré que deux mois, c’est
qu’ils avaient voulu lui cacher la vérité sur le Franklin… C’est que, depuis
quatre ans, on était sans nouvelles de John et de son navire !
Au grand effroi de l’employé,
Mrs. Branican fut saisie d’un spasme violent. Mais un suprême effort lui permit
de se dominer, et s’élançant hors du bureau, elle marcha rapidement à travers
les rues de la basse ville.
Ceux qui virent passer cette
femme, la figure pâle, les yeux hagards, durent penser que c’était une folle.
Et si elle ne l’était pas, la
malheureuse Dolly, n’allait-elle pas le redevenir ?…
Où se dirigeait-elle ?
Ce fut vers la maison de M. William Andrew, où elle arriva presque inconsciemment
en quelques minutes. Elle franchit les bureaux, elle passa au milieu des commis,
qui n’eurent pas le temps de l’arrêter, elle poussa la porte du cabinet où se
trouvait l’armateur.
Tout d’abord, M. William
Andrew fut stupéfait de voir entrer Mrs. Branican, puis épouvanté en observant
ses traits décomposés, son effroyable pâleur.
Et, avant qu’il eût pu lui
adresser la parole :
« Je sais… je sais !…
s’écria-t-elle. Vous m’avez trompée !… Pendant quatre ans, j’ai été folle !…
– Ma chère Dolly… calmez-vous !
– Répondez !… Le Franklin ?…
Voilà quatre ans qu’il est parti, n’est-ce pas ?… »
M. William Andrew baissa
la tête.
« Vous n’en avez plus de
nouvelles… depuis quatre ans… depuis quatre ans ?… »
M. William Andrew se taisait
toujours.
« On considère le Franklin
comme perdu !… Il ne reviendra plus personne de son équipage… et je ne
reverrai jamais John ! »
Des larmes furent la seule
réponse que put faire M. William Andrew.
Mrs. Branican tomba
brusquement sur un fauteuil… Elle avait perdu connaissance.
M. William Andrew appela
une des femmes de la maison qui s’empressa de porter secours à Dolly. L’un des
commis fut aussitôt expédié chez le docteur Brumley, qui demeurait dans le
quartier, et qui se hâta de venir.
M. William Andrew le mit
au courant. Par une indiscrétion ou par un hasard, il ne savait, Mrs. Branican
venait de tout apprendre. Était-ce à Prospect-House ou bien dans les rues de
San-Diégo, peu importait ! Elle savait, à présent ! Elle savait que
quatre ans s’étaient écoulés depuis la mort de son enfant, que pendant quatre
ans elle avait été privée de raison, que quatre ans s’étaient passés sans qu’on
eût reçu aucune nouvelle du Franklin…
Ce ne fut pas sans peine que
le docteur Brumley parvint à ranimer la malheureuse Dolly, se demandant si son
intelligence aurait résisté à ce dernier coup, le plus terrible de ceux qui
l’eussent frappée.
Lorsque Mrs. Branican eut
repris peu à peu ses sens, elle avait conscience de ce qui venait de lui être
révélé !… Elle était revenue à la vie avec toute sa raison !… Et, à
travers ses larmes, son regard interrogeait M. William Andrew, qui lui
tenait les mains, agenouillé près d’elle.
« Parlez… parlez…
monsieur Andrew ! »
Et ce furent les seuls mots
qui purent s’échapper de ses lèvres. Alors, d’une voix entrecoupée de sanglots,
M. William Andrew lui apprit quelles inquiétudes avait d’abord causées le
défaut de nouvelles relatives au Franklin… Lettres et dépêches avaient
été envoyées à Singapore et aux Indes, où le bâtiment n’était jamais arrivé…
une enquête avait été faite sur le parcours du navire de John !… Et aucun
indice n’avait pu mettre sur la trace du naufrage ! Immobile, Mrs.
Branican écoutait, la bouche muette, le regard fixe. Et lorsque M. William
Andrew eut achevé son récit :
« Mon enfant mort… mon
mari mort… murmura-t-elle. Ah ! pourquoi Zach Fren ne m’a-t-il pas laissée
mourir ! »
Mais sa figure se ranima
soudain, et son énergie naturelle se manifesta avec tant de puissance, que le
docteur Brumley en fut effrayé.
« Depuis les dernières
recherches, dit-elle d’une voix résolue, on n’a rien su du Franklin ?…
– Rien, répondit M. William Andrew.
– Et vous le considérez comme
perdu ?…
– Oui… perdu !
– Et de John, de son équipage,
on n’a obtenu aucune nouvelle ?…
– Aucune, ma pauvre Dolly, et
maintenant, nous n’avons plus d’espoir…
– Plus d’espoir ! »
répondit Mrs. Branican d’un ton presque ironique.
Elle s’était relevée, elle
tendait la main vers une des fenêtres par laquelle on apercevait l’horizon de
mer.
M. William Andrew et le
docteur Brumley la regardaient avec épouvante, craignant pour son état mental.
Mais Dolly se possédait tout entière, et, le regard illuminé du feu de son âme :
« Plus d’espoir !…
répéta-t-elle. Vous dites plus d’espoir !… Monsieur Andrew, si John est
perdu pour vous, il ne l’est pas pour moi !… Cette fortune qui
m’appartient, je n’en veux pas sans lui !… Je la consacrerai à rechercher
John et ses compagnons du Franklin !… Et, Dieu aidant, je les
retrouverai !… Oui !… je les retrouverai ! »
Une vie nouvelle allait
commencer pour Mrs. Branican. S’il y avait eu certitude absolue de la mort de
son enfant, il n’en était pas de même en ce qui concernait son mari. John et
ses compagnons ne pouvaient-ils avoir survécu au naufrage de leur navire et
s’être réfugiés sur l’une des nombreuses îles de ces mers des Philippines, des
Célèbes ou de Java ? Était-il donc impossible qu’ils fussent retenus chez
quelque peuplade indigène, et sans nul moyen de s’enfuir ? C’est à cette
espérance que devait désormais se rattacher Mrs. Branican, et avec une ténacité
si extraordinaire qu’elle ne tarda pas à provoquer un revirement dans l’opinion
de San-Diégo au sujet du Franklin. Non ! elle ne croyait pas, elle
ne pouvait pas croire que John et son équipage eussent péri, et, peut-être, fut-ce
la persistance de cette idée qui lui permit de garder sa raison intacte. À
moins, comme quelques-uns inclinèrent à le penser, que ce fût là une espèce de
monomanie, une sorte de folie qu’on aurait pu appeler la « folie de
l’espoir à outrance ». Mais il n’en était rien : on le verra par la
suite. Mrs. Branican était rentrée en possession complète de son intelligence ;
elle avait recouvré cette sûreté de jugement qui l’avait toujours caractérisée.
Un seul but : retrouver John, se dressait devant sa vie, et elle y
marcherait avec une énergie que les circonstances ne manqueraient pas
d’accroître.
Puisque Dieu avait permis que
Zach Fren l’eût sauvée d’une première catastrophe, et que la raison lui fût
rendue, puisqu’il avait mis à sa disposition tous les moyens d’action que donne
la fortune, c’est que John était vivant, c’est qu’il serait sauvé par elle.
Cette fortune, elle l’emploierait à d’incessantes recherches, elle la prodiguerait
en récompenses, elle la dépenserait en armements. Il n’y aurait pas une île, pas
un îlot des parages traversés par le jeune capitaine, qui ne serait reconnu, visité,
fouillé. Ce que lady Franklin avait fait pour John Franklin, Mrs. Branican le
ferait pour John Branican, et elle réussirait là où avait échoué la veuve de
l’illustre amiral.
Depuis ce jour, ce que
comprirent les amis de Dolly, c’était qu’il fallait l’aider dans cette nouvelle
période de son existence, l’encourager à ses investigations, joindre leurs
efforts aux siens. Et c’est ce que fit M. William Andrew, bien qu’il
n’espérât guère un heureux résultat de tentatives qui auraient pour but de retrouver
les survivants du naufrage. Aussi devint-il le conseiller le plus ardent de
Mrs. Branican, appuyé en cela par le commandant du Boundary, dont le
navire était alors à San-Diégo en état de désarmement. Le capitaine Ellis, homme
résolu, sur lequel on pouvait compter, ami dévoué de John, reçut l’invitation
de venir conférer avec Mrs. Branican et M. William Andrew.
Il y eut de fréquents entretiens
à Prospect-House. Si riche qu’elle fût maintenant, Mrs. Branican n’avait pas
voulu quitter ce modeste chalet. C’était là que John l’avait laissée en partant,
c’est là qu’il la retrouverait à son retour. Rien ne devait être changé à sa
manière de vivre, tant que son mari ne serait pas revenu à San-Diégo. Elle y
mènerait la même existence avec la même simplicité, ne dépensant au delà de ses
habitudes que pour subvenir aux frais de ses recherches et au budget de ses
charités.
On le sut bientôt dans la
ville. De là un redoublement de sympathie envers cette vaillante femme, qui ne
voulait pas être veuve de John Branican. Sans qu’elle s’en doutât, on se passionnait
à son égard, on l’admirait, on la vénérait même, car ses malheurs justifiaient
qu’on allât pour elle jusqu’à la vénération. Non seulement nombre de gens
faisaient des vœux pour la réussite de la campagne qu’elle se préparait à
entreprendre, mais ils voulaient croire à son succès. Lorsque Dolly descendant
des hauts quartiers se rendait soit à la maison Andrew, soit chez le capitaine
Ellis, lorsqu’on l’apercevait, grave et sombre, serrée dans ses vêtements de
deuil, vieillie de dix ans – et elle en avait à peine vingt-cinq – on se
découvrait avec respect, on s’inclinait sur son passage. Mais elle ne voyait
rien de ces déférences qui s’adressaient à sa personne.
Pendant les entretiens de
Mrs. Branican, de M. William Andrew et du capitaine Ellis, le premier travail
porta sur l’itinéraire que le Franklin avait dû suivre. C’était ce qu’il
importait d’établir avec une rigoureuse exactitude.
La maison Andrew avait
expédié son navire, aux Indes après relâche à Singapore, et c’était dans ce
port qu’il avait à livrer une partie de sa cargaison avant de se rendre aux
Indes. Or, en gagnant le large dans l’ouest de la côte américaine, les probabilités
étaient pour que le capitaine John fût allé prendre connaissance de l’archipel
des Hawaï ou Sandwich. En quittant les zones de la Micronésie, le Franklin avait
dû rallier les Mariannes, les Philippines ; puis, à travers la mer des
Célèbes et le détroit de Mahkassar, gagner la mer de Java, limitée au sud par
les îles de la Sonde, afin d’atteindre Singapore. À l’extrémité ouest du
détroit de Malacca, formé par la presqu’île de ce nom et l’île de Java, se
développe le golfe du Bengale, dans lequel, en dehors des îles Nicobar et des
îles Andaman, des naufragés n’auraient pu trouver refuge. D’ailleurs, il était
hors de doute que John Branican n’avait pas paru dans le golfe du Bengale. Or, du
moment qu’il n’avait pas fait relâche à Singapore – ce qui n’était que trop
certain – c’est qu’il n’avait pu dépasser la limite de la mer de Java et des
îles de la Sonde.
Quant à supposer que le Franklin,
au lieu de prendre les routes de la Malaisie, eût cherché à se rendre à
Calcutta en suivant les difficiles passes du détroit de Torrès, le long de la
côte septentrionale du continent australien, aucun marin ne l’eût admis. Le
capitaine Ellis affirmait que jamais John Branican n’avait pu commettre cette
inutile imprudence de se hasarder au milieu des dangers de ce détroit. Cette
hypothèse fut absolument écartée : c’était uniquement sur les parages
malaisiens que devaient se poursuivre les recherches.
En effet, dans les mers des
Carolines, des Célèbes et de Java, les îles et les îlots se comptent par milliers,
et c’était là seulement, s’il avait survécu à un accident de mer, que
l’équipage du Franklin pouvait être abandonné ou retenu par quelque tribu,
sans aucun moyen de se rapatrier.
Ces divers points établis, il
fut décidé qu’une expédition serait envoyée dans les mers de la Malaisie. Mrs.
Branican fit une proposition à laquelle elle attachait une grande importance.
Elle demanda au capitaine Ellis s’il lui conviendrait de prendre le
commandement de cette expédition.
Le capitaine Ellis était
libre alors, puisque le Boundary avait été désarmé par la maison Andrew.
Aussi, bien que surpris par l’inattendu de la proposition, il n’hésita pas à se
mettre à la disposition de Mrs. Branican, avec l’acquiescement de M. William
Andrew, qui l’en remercia vivement.
« Je ne fais que mon
devoir, répondit-il, et, tout ce qui dépendra de moi pour retrouver les survivants
du Franklin, je le ferai !… Si le capitaine est vivant…
– John est vivant ! »
dit Mrs. Branican d’un ton si affirmatif que les plus incrédules n’auraient pas
osé la contredire.
Le capitaine Ellis mit alors
en discussion divers points qu’il était nécessaire de résoudre. Recruter un
équipage digne de seconder ses efforts, cela se ferait sans difficultés. Mais restait
la question du navire. Évidemment, il n’y avait pas à songer à utiliser le Boundary
pour une expédition de ce genre. Ce n’était pas un bâtiment à voiles qui
pouvait entreprendre une telle campagne, il fallait un navire à vapeur.
Il se trouvait alors dans le
port de San-Diégo un certain nombre de steamers très convenables à cette
navigation. Mrs. Branican chargea donc le capitaine Ellis d’acquérir le plus rapide
de ces steamers, et mit à sa disposition les fonds nécessaires à cet achat.
Quelques jours après, l’affaire avait été conduite à bonne fin, et Mrs. Branican
était propriétaire du Davitt, dont le nom fut changé en celui de Dolly-Hope,
de favorable augure.
C’était un steamer à hélice
de neuf cents tonneaux, aménagé de manière à embarquer une grande quantité de
charbon dans ses soutes, ce qui lui permettait de fournir un long parcours, sans
avoir à se réapprovisionner. Gréé en trois-mâts-goélette, pourvu d’une voilure
assez considérable, sa machine, d’une force effective de douze cents chevaux, fournissait
une moyenne de quinze nœuds à l’heure. Dans ces conditions de vitesse et de
tonnage, le Dolly-Hope, très maniable, très marin, devait répondre à
toutes les exigences d’une traversée au milieu de mers resserrées, semées
d’îles, d’îlots et d’écueils. Il eût été difficile de faire un choix mieux
approprié à cette expédition.
Il ne fallut pas plus de
trois semaines pour remettre le Dolly-Hope en état, visiter ses
chaudières, vérifier sa machine, réparer son gréement et sa voilure, régler ses
compas, embarquer son charbon, assurer les vivres d’un voyage qui durerait
peut-être plus d’un an. Le capitaine Ellis était résolu à n’abandonner les
parages où le Franklin avait pu se perdre qu’après qu’il en aurait
exploré tous les refuges. Il y avait engagé sa parole de marin, et c’était un
homme qui tenait ses engagements.
Joindre bon navire à bon
équipage, c’est accroître les chances de réussite, et, à cet égard, le capitaine
Ellis n’eut qu’à se féliciter du concours que lui prêta la population maritime
de San-Diégo. Les meilleurs marins s’offrirent à servir sous ses ordres. On se
disputait pour aller à la recherche des victimes, qui appartenaient toutes aux
familles du port.
L’équipage du Dolly-Hope fut
composé d’un second, d’un lieutenant, d’un maître, d’un quartier-maître et de
vingt-cinq hommes, en comprenant les mécaniciens et les chauffeurs. Le
capitaine Ellis était certain d’obtenir tout ce qu’il voudrait de ces matelots
dévoués et courageux, si longue ou si dure que dût être cette campagne à
travers les mers de la Malaisie.
Il va sans dire que, pendant
que se faisaient ces préparatifs, Mrs. Branican n’était pas restée inactive.
Elle secondait le capitaine Ellis par son intervention incessante, résolvant
toutes difficultés à prix d’argent, ne voulant rien négliger de ce qui pourrait
garantir le succès de l’expédition.
Entre temps, cette charitable
femme n’avait point oublié les familles que la disparition du navire avait
laissées dans la gêne ou la misère. En cela, elle avait seulement complété les
mesures déjà prises par la maison Andrew et appuyées par les souscriptions
publiques. Désormais, l’existence de ces familles était suffisamment assurée, en
attendant que la tentative de Mrs. Branican leur eût rendu les naufragés du Franklin.
Ce que Dolly avait fait pour
les familles si cruellement éprouvées par ce sinistre, que ne pouvait-elle le
faire aussi pour Jane Burker ? Elle savait à présent combien cette pauvre
femme s’était montrée bonne envers elle pendant sa maladie. Elle savait que
Jane ne l’avait pas quittée d’un instant. Et, en ce moment, Jane serait encore
à Prospect-House, partageant son espoir, si les déplorables affaires de son
mari ne l’eussent obligée à quitter San-Diégo, et même les États-Unis, sans
doute. Quelques reproches que méritât Len Burker, il est certain que la
conduite de Jane avait été celle d’une parente dont l’affection allait jusqu’à
l’absolu dévouement. Dolly lui avait donc conservé une profonde amitié, et, en
songeant à sa malheureuse situation, son plus vif regret était de ne pouvoir
lui témoigner sa reconnaissance en lui venant en aide. Mais, malgré toute la
diligence de M. William Andrew, il avait été impossible de savoir ce
qu’étaient devenus les époux Burker. Il est vrai, si le lieu de leur retraite
eût été connu, Mrs. Branican n’aurait pu les rappeler à San-Diégo, puisque Len
Burker était sous le coup des plus accablantes accusations de détournements ;
mais elle se serait empressée de faire parvenir à Jane des secours dont cette
infortunée devait avoir grand besoin.
Le 27 juillet, le Dolly-Hope
était prêt à partir. Mrs. Branican vint à bord dans la matinée, afin de recommander
une dernière fois au capitaine Ellis de ne rien ménager pour découvrir les
traces du Franklin. Elle ne doutait pas, d’ailleurs, qu’il y réussirait.
On rapatrierait John, on rapatrierait son équipage !… Elle répéta ces
paroles avec une telle conviction, que les matelots battirent des mains. Tous
partageaient sa foi, aussi bien que leurs amis, leurs parents, qui étaient
venus assister au départ du Dolly-Hope.
Le capitaine Ellis
s’adressant alors à Mrs. Branican, en même temps qu’à M. William Andrew, qui
l’avait accompagnée à bord :
« Devant vous, mistress,
dit-il, devant M. William Andrew, au nom de mes officiers et de mon équipage,
je jure, oui ! je jure de ne me laisser décourager par aucun danger ni par
aucune fatigue pour retrouver le capitaine John et les hommes du Franklin. Ce
navire que vous avez armé s’appelle maintenant le Dolly-Hope, et il
saura justifier ce nom…
– Avec l’aide de Dieu et le
dévouement de ceux qui mettent leur confiance en lui ! répondit Mrs.
Branican.
– Hurrah !… Hurrah pour
John et Dolly Branican ! »
Ces cris furent répétés par
la foule entière, qui se pressait sur les quais du port.
Ses amarres larguées, le Dolly-Hope,
obéissant aux premiers tours d’hélice, évolua pour sortir de la baie. Puis,
dès qu’il eut franchi le goulet, il mit le cap au sud-ouest, et, sous l’action
de sa puissante machine, il eut bientôt perdu de vue la terre américaine.
Après un parcours de deux
mille deux cents milles, le Dolly-Hope eut connaissance de la montagne
de Mouna Kea, qui domine de quinze mille pieds l’île Hawaï, la plus méridionale
du groupe des Sandwich.
Indépendamment de cinq
grandes îles et de trois petites, ce groupe compte encore un certain nombre
d’îlots, sur lesquels il n’y avait pas lieu de rechercher les traces du Franklin.
Il était évident que ce naufrage eût été depuis longtemps connu, s’il se
fût produit sur les nombreux écueils de cet archipel, même ceux de Medo-Manou, bien
qu’ils ne soient fréquentés que par d’innombrables oiseaux de mer. En effet, les
Sandwich possèdent une population assez dense – cent mille habitants, rien que
pour l’île Hawaï – et, grâce aux missionnaires français, anglais et américains
qui séjournent dans ces îles, la nouvelle du désastre fût promptement arrivée
aux ports de la Californie.
D’ailleurs, quatre ans
auparavant, lorsque le capitaine Ellis avait fait la rencontre du Franklin, les
deux navires se trouvaient déjà au delà du groupe des Sandwich. Le Dolly-Hope
continua donc sa route vers le sud-ouest, à travers cette mer admirable du
Pacifique, qui mérite volontiers son nom pendant les quelques mois de la saison
chaude.
Six jours plus tard, le
rapide steamer avait franchi la ligne conventionnelle que les géographes ont
tracée du sud au nord entre la Polynésie et la Micronésie. Dans cette partie
occidentale des mers polynésiennes, le capitaine Ellis n’avait aucune investigation
à faire. Mais, au delà, les mers micronésiennes fourmillent d’îles, d’îlots et
de récifs, où le Dolly-Hope aurait la tâche périlleuse de relever les
indices d’un naufrage.
Le 22 août, on relâcha à Otia,
l’île la plus importante du groupe des Marshall, visité par Kotzebue et les
Russes en 1817. Ce groupe, réparti sur trente milles de l’est à l’ouest, et
treize milles du nord au sud, ne renferme pas moins de soixante-cinq îlots ou
attolons.
Le Dolly-Hope, qui
aurait eu la facilité de refaire sa provision d’eau en quelques heures à
l’aiguade de l’île, prolongea cependant sa relâche durant cinq jours. Embarqué
sur la chaloupe à vapeur, le capitaine Ellis put se convaincre qu’aucun navire
ne s’était perdu sur ces écueils les quatre dernières années. On rencontra bien
quelques débris le long des îlots Mulgrave ; mais ce n’étaient que des
troncs de sapins, de palmiers, de bambous, apportés par les courants du nord ou
du sud, et dont les habitants se servent pour construire leurs pirogues. Le
capitaine Ellis apprit du chef de l’île Otia que, depuis 1872, on n’avait mentionné
qu’un seul bâtiment qui se fût brisé sur les attolons de l’est, et c’était un
brick anglais, dont l’équipage dut être rapatrié ultérieurement.
Une fois hors de l’archipel
des Marshall, le Dolly-Hope fit route vers les Carolines. En passant, il
détacha sa chaloupe sur l’île Oualam, dont l’exploration ne donna aucun
résultat. Le 3 septembre, il s’engagea à travers le vaste archipel, qui s’étend
entre le douzième degré de latitude nord et le troisième degré de latitude sud,
d’une part, et de l’autre, entre le cent vingt-neuvième degré de longitude est
et le cent soixante-dixième degré de longitude ouest, soit deux cent vingt-cinq
lieues du nord au midi des deux côtés de l’équateur, et mille lieues environ de
l’ouest à l’est.
Le Dolly-Hope demeura
trois mois dans ces mers des Carolines, suffisamment connues maintenant que les
travaux de Lütke, l’audacieux navigateur russe, se sont ajoutés à ceux des
Français Duperrey et Dumont d’Urville. Il ne fallut pas moins que ce temps pour
visiter successivement les principaux groupes, qui forment cet archipel, groupe
des Péliou, des Dangereuses-Matelotes, des Martyrs, de Saavedra, de Sonsorol, les
îles Mariera, Anna, Lord-North, etc.
Le capitaine Ellis avait pris
pour centre de ses opérations Yap ou Gouap, qui appartient au groupe des
Carolines propres, lequel comprend près de cinq cents îles. C’est de là que le
steamer dirigea ses investigations vers les points les plus éloignés. De
combien de naufrages cet archipel avait été le théâtre, entre autres celui de
l’Antilope en 1793, du capitaine américain Barnard sur les îles Mortz et
Lord-North, en 1832 !
Durant cette période, le
dévouement des hommes du Dolly-Hope fut au-dessus de tout éloge. Aucun
d’eux ne regarda ni aux périls ni aux fatigues, occasionnés par cette
navigation au milieu de récifs sans nombre, à travers ces étroites passes dont
les fonds sont hérissés d’excroissances coralligènes. En outre, la mauvaise
saison commençait à troubler ces parages, où les vents se déchaînent avec une
effroyable impétuosité, et dans lesquels les sinistres sont si nombreux encore.
Chaque jour, les embarcations
du bord fouillaient les criques, au fond desquelles les courants auraient pu
jeter quelques débris. Lorsque les marins débarquaient, ils étaient bien armés,
car il ne s’agissait pas ici de recherches pareilles à celles qui furent faites
pour l’amiral Franklin, c’est-à-dire sur les terres désertes des contrées
arctiques, les îles étaient habitées pour la plupart, et la tâche du capitaine
Ellis consistait surtout à manœuvrer comme fit d’Entrecasteaux, lorsqu’il
fouilla les attolons où l’on pensait qu’avait dû se perdre Lapérouse. Ce qui
importait, c’était de se mettre en rapport avec les indigènes. L’équipage du Dolly-Hope
fut souvent accueilli par des démonstrations hostiles chez certaines de ces
peuplades, qui ne sont rien moins qu’hospitalières aux étrangers. Des
agressions se produisirent, et il fallut les repousser par la force. Deux ou
trois matelots reçurent même des blessures, lesquelles, heureusement, n’eurent
pas de suites fâcheuses.
Ce fut de cet archipel des
Carolines que les premières lettres du capitaine Ellis purent être adressées à
Mrs. Branican par des navires qui faisaient route vers le littoral américain.
Mais elles ne contenaient rien de relatif aux traces du Franklin ou des
naufragés. Les tentatives, n’ayant pas abouti dans les Carolines, allaient être
reprises à l’ouest, en englobant le vaste système de la Malaisie. Là, en
réalité, il y avait des chances plus sérieuses de retrouver les survivants de
la catastrophe, peut-être sur l’un de ces nombreux îlots dont les travaux
hydrographiques révèlent encore l’existence, même après les trois reconnaissances
qui ont été faites dans cette partie de l’océan Pacifique.
Sept cents milles plus à
l’ouest des Carolines, à la date du 2 décembre, le Dolly-Hope atteignit
l’une des grandes îles des Philippines, le plus important des archipels malais,
le plus considérable aussi de ceux dont les géographes ont relevé la position
dans l’hydrographie malaisienne et même sur toute la surface de l’Océanie. Ce
groupe, découvert par Magellan en 1521, s’étend du cinquième degré au vingt et
unième degré de latitude septentrionale, et du cent quatorzième degré au cent
vingt-troisième degré de longitude orientale.
Le Dolly-Hope ne vint
point relâcher à la grande île de Luçon, aussi nommée Manille. Comment admettre
que le Franklin se fût élevé si haut dans les mers de Chine, puisqu’il
faisait route vers Singapore. C’est pour cette raison que le capitaine Ellis préféra
établir son centre d’investigations à l’île Mindanao, au sud dudit archipel, c’est-à-dire
sur l’itinéraire même qu’avait certainement suivi John Branican pour atteindre
la mer de Java.
À cette date, le Dolly-Hope
était mouillé sur la côte sud-ouest, dans le port de Zamboanga, résidence
du gouverneur duquel dépendent les trois alcadies de l’île.
Mindanao comprend deux
parties, l’une espagnole, l’autre indépendante sous la domination d’un soulthan,
qui a fait de Sélangan sa capitale.
Il était indiqué que le
capitaine Ellis prît ses premières informations près du gouverneur et des alcades
à propos d’un naufrage dont le littoral de Mindanao aurait pu être le théâtre.
Les autorités se mirent très obligeamment à sa disposition. Mais, dans la
région espagnole de Mindanao, tout au moins, aucun sinistre maritime n’avait
été signalé depuis cinq ans.
Il est vrai, sur les côtes de
la partie indépendante de l’île, où habitent les Mindanais, les Caragos, les
Loutas, les Soubanis, et aussi diverses peuplades sauvages très justement
suspectées de cannibalisme, que de désastres peuvent se produire, sans qu’on en
ait jamais connaissance, ces populations ayant intérêt à ne point les ébruiter !
Il se rencontre même nombre de ces Malais, qui font couramment le métier de
corsaires. Avec leurs légers navires, armés de fauconneaux, ils donnent la
chasse aux bâtiments de commerce que les vents d’ouest poussent sur leur
littoral, et, lorsqu’ils s’en emparent, c’est pour les détruire. Que pareil
sort eût été réservé au Franklin, certainement le gouverneur n’en aurait
pas été informé. Les seuls renseignements qu’il put donner relativement à la
portion de l’île soumise à son autorité furent donc jugés insuffisants.
Aussi le Dolly-Hope dut-il
braver ces mers si dures pendant la saison d’hiver. Maintes fois, on opéra des
débarquements sur plusieurs points de la côte, et les matelots s’aventurèrent
sous ces admirables forêts de tamarins, de bambous, de palétuviers, d’ébéniers
noirs, d’acajous sauvages, de bois de fer, de mangliers qui sont une des richesses
des Philippines. Au milieu des fertiles campagnes où s’entremêlent les produits
des zones tempérées et des zones tropicales, le capitaine Ellis et ses hommes
visitèrent certains villages dans l’espoir d’y recueillir quelques indices, débris
de naufrage, prisonniers retenus par les tribus malaisiennes ; mais leurs
opérations furent infructueuses, et le steamer fut contraint de revenir à Zamboanga,
très fatigué par le mauvais temps, et n’ayant échappé que par miracle aux
récifs sous-marins de ces parages.
L’exploration de l’archipel
des Philippines ne dura pas moins de deux mois et demi ; il avait fallu
s’attarder à plus de cent îles, dont les principales, après Luçon et Mindanao, sont
Mindoro, Leyte, Samar, Panay, Négros, Zebou, Masbate, Palawan, Catandouanès, etc.
Le capitaine Ellis fouilla le
groupe de Bassilan au sud de Zamboanga, puis se dirigea vers l’archipel de Rolo
où il arriva le 25 février 1880.
C’était là un véritable nid à
pirates, dans lequel les indigènes fourmillent au milieu de ces nombreuses îles
couvertes d’un fouillis de jungles, qui sont semées entre la pointe sud de Mindanao
et la pointe nord de Bornéo. Un seul port est parfois fréquenté par les navires
qui traversent la mer de Chine et les bassins de la Malaisie, le port de Bévouan,
situé sur l’île principale qui a donné son nom au groupe.
C’est à Bévouan que vint
relâcher le Dolly-Hope. Là, quelques relations purent être établies avec
le soulthan et les datous, qui gouvernent une population de six ou sept mille
habitants. Il est vrai que le capitaine Ellis n’épargna les présents ni en argent
ni en nature. Les indigènes le mirent alors sur la piste de différents
naufrages, dont ces îles, défendues par leur ceinture de coraux et de
madrépores, avaient été le théâtre.
Mais, parmi les débris qui
furent recueillis, on n’en reconnut aucun qui eût pu appartenir au Franklin.
D’ailleurs, les naufragés avaient péri ou avaient été rapatriés.
Le Dolly-Hope, qui
avait refait son charbon pendant sa relâche à Mindanao, était déjà très allégé
à la fin de cette navigation à travers les méandres du groupe du Holo. Il lui
restait néanmoins assez de combustible pour franchir la mer des Célèbes, en se
dirigeant sur les îles Maratoubas, et atteindre le port de Bandger-Massing, situé
au sud de Bornéo.
Le capitaine Ellis se lança
au milieu de ce bassin fermé comme un lac, ici par les grandes îles malaises, là
par une ceinture d’îlots. La mer des Célèbes est mal défendue, d’ailleurs, malgré
ces obstacles naturels, contre la furie des tempêtes, et, s’il est permis de
vanter les splendeurs de ses eaux qui fourmillent de zoophytes aux couleurs
éclatantes et de mollusques de mille espèces, si l’imagination des navigateurs
est allée jusqu’à la comparer à un parterre de fleurs liquides, les typhons qui
la désolent font ombre à ce merveilleux tableau.
Le Dolly-Hope l’éprouva
rudement dans la nuit du 28 au 29 février. Pendant la journée, le vent avait
fraîchi peu à peu, et, bien qu’il se fût sensiblement apaisé vers le soir, d’énormes
nuages de teinte livide, entassés à l’horizon, laissaient présager une nuit
très troublée.
En effet, l’ouragan se
déclara avec une extrême violence vers onze heures, et la mer se montra en
quelques instants d’une impétuosité vraiment extraordinaire.
Le capitaine Ellis, justement
alarmé pour la machine du Dolly-Hope, voulut prévenir tout accident qui
aurait pu compromettre sa campagne ; dans ce but il se mit en cape, de manière
à ne demander à l’hélice que la vitesse nécessaire pour que son navire restât
sensible à l’action de la barre.
Malgré ces précautions, la
tornade se déroula avec une telle intensité, les lames déferlaient avec tant de
furie que le Dolly-Hope ne put éviter de formidables coups de mer. En
plusieurs embardées, une centaine de tonnes d’eau furent précipitées sur le
pont, défoncèrent les capots, s’accumulèrent dans la cale. Mais les cloisons
étanches résistèrent, et, faisant obstacle à l’eau, l’empêchèrent de se
répandre jusque dans les compartiments de la chaufferie et de la machine. Cela
fut très heureux, car, ses feux éteints, le Dolly-Hope aurait été livré
sans défense à la lutte des éléments, et, ne gouvernant plus, roulé dans le
creux des lames, assailli par le travers, il se serait trouvé en perdition.
L’équipage témoigna d’autant
de sang-froid que de courage en ces circonstances critiques. Il seconda
vaillamment son commandant et ses officiers. Il fut digne du capitaine qui
l’avait choisi parmi l’élite des marins de San-Diégo. Le navire fut sauvé par
l’habileté et la précision de ses manœuvres.
Après quinze terribles heures
de tourmente, la mer s’apaisa ; on peut même dire qu’elle tomba presque
subitement aux approches de la grande île de Bornéo, et, dans la matinée du 2
mars, le Dolly-Hope eut connaissance des îles Maratoubas.
Ces îles, qui, géographiquement,
dépendent de Bornéo, devinrent l’objet des plus minutieuses explorations
pendant la première quinzaine de mars. Grâce aux présents qui ne furent point
ménagés, les chefs de peuplades se prêtèrent à toutes les exigences de
l’enquête. Pourtant, il fut impossible de se procurer le moindre renseignement
relatif à la disparition du Franklin. Comme ces parages de la Malaisie
sont trop souvent écumés par les pirates, on pouvait craindre que John Branican
et son équipage eussent été massacrés jusqu’au dernier homme.
Et un jour, le capitaine
Ellis, causant de ces éventualités avec son second, lui dit :
« Il est fort possible
que la perte du Franklin soit due à une attaque de ce genre. Cela
expliquerait pourquoi nous n’avons jusqu’ici découvert aucun indice de naufrage.
Ces pirates ne se vantent pas de leurs exploits. Quand un navire disparaît, on
met la catastrophe sur le compte d’un typhon, et tout est dit !
– Vous n’avez que trop raison,
capitaine, fit observer le second du Dolly-Hope. Ce ne sont pas les pirates
qui manquent dans ces mers et nous aurons même à redoubler de vigilance en
descendant le détroit de Mahkassar.
– Sans doute, reprit le
capitaine Ellis, mais nous sommes dans des conditions meilleures que celles où
se trouvait John Branican pour échapper à ces coquins. Avec des vents irréguliers
et changeants, un navire à voiles ne manœuvre pas à volonté. Pour nous, tant
que notre machine fonctionnera, ce ne sont pas les embarcations malaises qui
pourront nous atteindre. Néanmoins, je recommande la plus complète vigilance. »
Le Dolly-Hope embouqua
le détroit de Mahkassar, qui sépare le littoral de Bornéo du littoral si capricieusement
découpé de l’île Célèbes. Pendant deux mois, du 15 mars au 15 mai, après avoir
renouvelé son charbon au port de Damaring, le capitaine Ellis fouilla toutes
les criques de l’est.
Cette île Célèbes, qui fut
reconnue par Magellan, ne mesure pas moins de cent quatre-vingt-douze lieues de
longueur sur une largeur de vingt-cinq. Elle est dessinée de telle sorte que
certains géographes ont pu la comparer à une tarentule, dont les énormes pattes
seraient figurées par des presqu’îles. La beauté de ses paysages, la richesse
de ses produits, l’heureuse disposition de ses montagnes, en font l’égale de la
superbe Bornéo. Mais les découpures multiples de sa côte offrent tant de
refuges à la piraterie, que la navigation du détroit est réellement des plus
dangereuses.
Malgré cela, le capitaine
Ellis mit toute la précision désirable dans l’accomplissement de son œuvre.
Ayant toujours ses chaudières en pression, il visitait les anses avec les
embarcations du bord, prêt à les rallier à la moindre apparence de danger.
En se rapprochant de
l’extrémité méridionale du détroit, le Dolly-Hope put naviguer dans des
conditions moins alarmantes. En effet, cette partie de l’île Célèbes est sous
la domination hollandaise. La capitale de ces possessions est Mahkassar, autrefois
Wlaardingen, défendue par le fort Rotterdam. C’est là que le capitaine Ellis
vint en relâche, le 17 mai, afin de donner un peu de repos à l’équipage et de
refaire le combustible. S’il n’avait rien découvert qui pût le mettre sur la
trace de John Branican, il apprit dans ce port une nouvelle très importante au
sujet de l’itinéraire qu’avait dû suivre le Franklin : à la date du
3 mai 1875, ce bâtiment avait été signalé à dix milles au large de Mahkassar, se
dirigeant vers la mer de Java. La certitude existait dès lors qu’il n’avait
point péri dans ces redoutables mers de la Malaisie. C’était au delà de Célèbes
et de Bornéo, c’est-à-dire dans la mer de Java, qu’il fallait aller rechercher
ses vestiges, en poussant jusqu’à Singapore.
Dans une lettre qu’il adressa
à Mrs. Branican de ce point extrême de l’île Célèbes, le capitaine Ellis
l’informa de cette circonstance, en renouvelant sa promesse de la tenir au
courant des investigations qui seraient maintenant localisées entre la mer de
Java et les îles de la Sonde.
En effet, il convenait que le
Dolly-Hope ne dépassât pas le méridien de Singapore, qui serait le terminus
de sa campagne vers l’ouest. Il la compléterait au retour en scrutant les
rivages méridionaux de la mer de Java, et en visitant ce chapelet d’îles qui en
forme la limite ; puis, se dirigeant parmi ce groupe des Moluques, il
regagnerait l’océan Pacifique pour revenir à la terre américaine.
Le Dolly-Hope quitta
Mahkassar le 23, longea la partie inférieure du détroit qui sépare l’île
Célèbes de l’île Bornéo, et vint en relâche à Bandger-Massing. C’est là que
réside le gouverneur de l’île de Bornéo, ou plutôt Kalématan, pour lui
restituer son véritable nom géographique. Les registres de la marine y furent
compulsés minutieusement ; mais on n’y put relever la mention que le Franklin
eût été aperçu dans ces parages. Après tout, cela s’expliquait, s’il avait
gardé le large à travers la mer de Java.
Dix jours après, le capitaine
Ellis, ayant porté vers le sud-ouest, vint jeter l’ancre dans le port de Batavia,
à l’extrémité de cette grande île de Java, d’origine essentiellement volcanique,
et presque toujours empanachée de la flamme de ses cratères.
Quelques jours suffirent à
l’équipage pour refaire ses approvisionnements dans cette grande cité, qui est
la capitale des possessions hollandaises de l’Océanie. Le gouverneur général, que
les correspondances maritimes avaient tenu au courant des efforts de Mrs.
Branican pour retrouver les naufragés, reçut avec empressement le capitaine
Ellis. Malheureusement, il ne put fournir aucun renseignement sur le sort du Franklin.
À cette époque, l’opinion des marins de Batavia était que le trois-mâts
américain, désemparé dans quelque tornade, avait dû sombrer sous voiles et être
englouti corps et biens. Pendant les premiers six mois de 1875, on citait un
certain nombre de navires dont on n’avait pas eu de nouvelles, et qui avaient
disparu ainsi, sans que les courants en eussent jamais jeté la moindre épave à
la côte.
En quittant Batavia, le Dolly-Hope
laissa sur bâbord le détroit de la Sonde, qui met en communication la mer
de Java et la mer de Timor, puis il prit connaissance des îles de Billitow et
de Bangha. Autrefois, les approches de ces îles étaient infestées par les
pirates, et les bâtiments qui s’y rendaient pour embarquer des chargements de
minerais de fer et d’étain, n’évitaient pas sans peine leurs attaques. Mais la
police maritime a fini par les détruire, et il n’y avait pas lieu de penser que
le Franklin et son équipage eussent été victimes de leurs agressions.
Continuant à remonter vers le
nord-ouest, en visitant les îles du littoral de Sumatra, le Dolly-Hope, ayant
relevé la pointe de la presqu’île de Malacca, relâcha à l’île de Singapore dans
la matinée du 20 juin, après une traversée qui avait été retardée par les vents
contraires.
Des réparations à sa machine
obligèrent le capitaine Ellis à rester quinze jours dans le port, qui est situé
au sud de l’île. Peu étendue – deux cent soixante-dix milles carrés sans plus –
cette possession, si importante par le mouvement de son commerce avec l’Europe
et l’Amérique, est devenue l’une des plus riches de l’extrême Orient, depuis le
jour où les Anglais y fondèrent leur premier comptoir en 1818.
C’était à Singapore, on le
sait, que le Franklin devait livrer une partie de sa cargaison pour le
compte de la maison Andrew, avant de se rendre à Calcutta. On sait aussi que le
trois-mâts américain n’y avait jamais paru. Toutefois, le capitaine Ellis
voulut mettre son séjour à profit afin d’obtenir des informations relatives aux
sinistres survenus dans la mer de Java durant les dernières années.
Effectivement, puisque, d’une
part, le Franklin avait été signalé au large de Mahkassar, et que, d’autre
part, il n’était point arrivé à Singapore, il fallait de toute nécessité admettre
qu’il avait fait naufrage entre ces deux points. À moins que le capitaine John
Branican n’eût quitté la mer de Java et franchi l’un de ces détroits qui
séparent les îles de la Sonde pour descendre vers la mer de Timor… Mais
pourquoi s’y serait-il résolu, puisqu’il était à destination de Singapore ?
C’eût été inexplicable, c’était inadmissible.
L’enquête n’ayant donné que
des résultats négatifs, le capitaine Ellis n’eut plus qu’à prendre congé du
gouverneur de Singapore pour ramener son navire en Amérique.
Le 25 août, l’appareillage se
fit par un temps très orageux. La chaleur était excessive, comme elle l’est
d’ordinaire au mois d’août en cette partie de la zone torride, située à
quelques degrés au-dessous de l’équateur. Le Dolly-Hope fut très éprouvé
par les mauvais temps qui marquèrent les dernières semaines de ce mois.
Cependant, en longeant les semis des îles de la Sonde, il n’en laissa pas un
point inexploré. Successivement, l’île de Madura, une des vingt régences de
Java, Bâli, l’une des plus commerçantes de ces possessions, reçurent sa visite,
et aussi Lombok et Sumbava, dont le volcan de Tombovo menaçait alors cette
région d’une éruption aussi désastreuse que celle de 1815.
Entre ces diverses îles
s’ouvrent autant de détroits, qui donnent accès sur la mer de Timor. Le Dolly-Hope
eut à manœuvrer prudemment afin d’éviter des courants d’une telle impétuosité
qu’ils entraînent les bâtiments même contre la mousson de l’ouest. On comprend
dès lors combien la navigation offre de périls dans cette mer, surtout aux
voiliers, qui n’ont pas en eux leur puissance de locomotion. De là, ces
catastrophes maritimes si fréquentes à l’intérieur de la zone malaisienne.
À partir de l’île de Flores, le
capitaine Ellis suivit la chaîne des autres îles, qui ferme au sud la mer des
Moluques, mais inutilement. À la suite de si nombreuses déceptions, on ne
s’étonnera pas que son équipage fût découragé par l’insuccès de cette campagne.
Il ne fallait pas, malgré cela, renoncer à toute espérance de retrouver le Franklin,
tant que l’exploration ne serait pas achevée. Il était possible que le capitaine
John, au lieu de descendre le détroit de Mahkassar en quittant Mindanao des
Philippines, eût traversé l’archipel et la mer des Moluques pour atteindre la
mer de Java, et se montrer au large de l’île Célèbes.
Cependant le temps s’écoulait,
et le livre de bord continuait à être muet sur le sort du Franklin. Ni à
Timor, ni dans les trois groupes qui constituent l’archipel des Moluques, le
groupe d’Amboine, résidence du gouverneur général, qui comprend Céram et Bourou,
le groupe de Banda, celui de Gilolo, il ne fut possible de recueillir des
renseignements sur un navire qui se serait perdu entre ces îles au printemps de
1875. Du 23 septembre, date de l’arrivée du Dolly-Hope à Timor, au 27
décembre, date de son arrivée à Gilolo, trois mois avaient été employés en
investigations, auxquelles les Hollandais se prêtaient de bonne grâce, et rien
n’était venu jeter un peu de lumière sur ce sinistre.
Le Dolly-Hope avait
terminé son expédition. À cette île de Gilolo, qui est la plus importante des Moluques,
se fermait le cercle que le capitaine Ellis s’était engagé à suivre autour des
contrées malaisiennes. L’équipage prit alors quelques jours de repos, auxquels
il avait bien droit. Et, pourtant, si un nouvel indice eût été relevé, que
n’eussent pas encore tenté ces braves gens, même au prix de dangers plus grands
encore !
Ternate, la capitale de l’île
Gilolo, qui commande la mer des Moluques, et où demeure un résident hollandais,
fournit au Dolly-Hope tout ce qui lui était nécessaire en vivres et en
charbon pour le voyage de retour. Là s’acheva cette année 1881 – la sixième qui
se fut écoulée depuis la disparition du Franklin.
Le capitaine Ellis appareilla
dans la matinée du 9 janvier et prit direction vers le nord-est.
On était alors dans la
mauvaise saison. La traversée fut pénible, et les vents défavorables occasionnèrent
d’assez longs retards. C’est seulement à la date du 23 janvier, que le Dolly-Hope
fut signalé par les sémaphores de San-Diégo.
Cette campagne de la Malaisie
avait duré dix-neuf mois. Malgré les efforts du capitaine Ellis, malgré le
dévouement de son équipage, le secret du Franklin restait enseveli dans
le mystérieux dédale des mers.
Les lettres que Mrs. Branican
avait reçues au cours de l’expédition ne lui permettaient guère d’espérer que
cette tentative serait couronnée de succès. Aussi, après l’arrivée de la dernière,
ne conservait-elle que peu d’espoir au sujet des recherches que le capitaine
Ellis opérait dans les parages des Moluques.
Dès qu’elle apprit que le Dolly-Hope
était au large de San-Diégo, Mrs. Branican, accompagnée de M. William
Andrew, se rendit sur le port. À peine eut-il pris son poste de mouillage, que
tous deux se firent conduire à bord.
L’attitude du capitaine Ellis
et de son équipage disait assez que la seconde période de la campagne n’avait
pas eu meilleure chance que la première.
Mrs. Branican, ayant tendu la
main au capitaine, s’avança vers ces hommes, si durement éprouvés par les
fatigues d’un pareil voyage, et, d’une voix ferme :
« Je vous remercie, capitaine
Ellis, dit-elle, je vous remercie, mes amis !… Vous avez fait tout ce que
je devais attendre de votre dévouement ! Vous n’avez pas réussi, et
peut-être désespérez-vous de jamais réussir ?… Je ne désespère pas, moi !…
Non ! je ne désespère pas de revoir John et ses compagnons du Franklin !…
Mon espoir est en Dieu… Dieu le réalisera ! »
Ces paroles, empreintes d’une
extraordinaire assurance, affirmaient une si rare énergie, disaient si
fermement la résolution où était Mrs. Branican de ne jamais s’abandonner, que
sa conviction aurait dû se communiquer à tous les cœurs. Mais, si on l’écouta
avec le respect que commandait son attitude, il n’était personne qui mit en
doute la perte définitive du Franklin et de son équipage.
Et pourtant, peut-être eût-il
mieux valu s’en rapporter à cette pénétration spéciale dont une femme est
souvent douée par sa nature ? Tandis que l’homme ne s’attache qu’à
l’observation directe des faits et aux conséquences qui en découlent, il est
certain que la femme a parfois une plus juste prévision de l’avenir, grâce à
ses qualités intuitives. C’est une sorte d’instinct génial qui la guide, et lui
donne une certaine prescience des choses… Qui sait si Mrs. Branican n’aurait
pas un jour raison contre l’opinion générale ?
M. William Andrew et
elle se rendirent alors dans le carré du Dolly-Hope, où le capitaine
Ellis leur fit le récit détaillé de son expédition. Les cartes de la Polynésie
et de la Malaisie, déployées sur la table, permettaient de suivre la route du
steamer, ses relâches sur les nombreux points explorés, les renseignements
recueillis dans les principaux ports et les villages indigènes, les recherches
exécutées au milieu des îlots et des îles avec une minutieuse patience et un
zèle infatigable.
Puis, en terminant :
« Permettez-moi, mistress
Branican, dit le capitaine Ellis, d’appeler plus particulièrement votre attention
sur ceci : le Franklin a été aperçu pour la dernière fois à la
pointe sud de Célèbes, le 3 mai 1875, environ sept semaines après son départ de
San-Diégo, et, depuis ce jour, il n’a été rencontré nulle part. Donc, puisqu’il
n’est pas arrivé à Singapore, il est hors de doute que la catastrophe s’est
produite dans la mer de Java. Comment ? Il n’y a que deux suppositions. La
première, c’est que le Franklin a sombré sous voiles ou qu’il a péri
dans une collision, sans qu’il en soit resté aucune trace. La seconde, c’est
qu’il s’est brisé sur des écueils ou qu’il a été détruit par les pirates malais,
et, dans ces deux cas, il eût été possible d’en retrouver quelques débris. Or, malgré
nos recherches, nous n’avons pu relever la preuve matérielle de la destruction
du Franklin. »
La conclusion qui ressortait
de cette argumentation, c’est qu’il était plus logique de se ranger à l’un des
cas de la première hypothèse – celui qui attribuait la perte du Franklin au
déchaînement de ces tornades si fréquentes dans les parages malaisiens. En
effet, pour le second cas, celui d’une collision, comme il est assez rare que
l’un des deux navires abordés ne continue pas à tenir la mer, le secret de
cette rencontre aurait été connu tôt ou tard. Il n’y avait donc plus aucun
espoir à garder.
C’est là ce qu’avait compris M. William
Andrew, et il baissait tristement la tête devant le regard de Mrs. Branican, qui
ne cessait de l’interroger.
« Eh bien, non !
dit-elle, non !… Le Franklin n’a pas sombré !… Non !…
John et son équipage n’ont point péri !… »
Et, l’entretien continuant
sur l’instance de Dolly, il fallut que le capitaine Ellis lui rapportât les
détails les plus circonstanciés. Elle y revenait sans cesse, questionnant, discutant,
ne cédant rien.
Cette conversation se
prolongea pendant trois heures, et lorsque Mrs. Branican se disposa à prendre
congé du capitaine Ellis, celui-ci lui demanda s’il entrait dans ses intentions
que le Dolly-Hope fût désarmé.
« Nullement, capitaine, répondit-elle,
et je verrais avec regret que votre équipage et vous eussiez l’intention de
débarquer. Peut-on affirmer que de nouveaux indices ne nous amèneront pas à
entreprendre une nouvelle campagne ? Si donc vous consentiez à garder le
commandement du Dolly-Hope…
– Ce serait très volontiers, répondit le capitaine Ellis,
mais j’appartiens à la maison Andrew, mistress Branican, et elle peut avoir
besoin de mes services…
– Que cette considération ne
vous arrête pas, mon cher Ellis, répondit M. William Andrew. Je serai
heureux que vous restiez à la disposition de Dolly, puisqu’elle le désire.
– Je suis à ses ordres, monsieur
Andrew. Mon équipage et moi nous ne quitterons pas le Dolly-Hope…
– Et je vous prie, capitaine, répondit Mrs. Branican, de
veiller à ce qu’il soit toujours en état de reprendre la mer ! »
En donnant son consentement, l’armateur
n’avait eu d’autre pensée que de déférer aux désirs de Dolly. Mais le capitaine
Ellis et lui ne doutaient pas qu’elle renoncerait à une seconde campagne, après
les inutiles résultats de la première. Si le temps ne devait jamais affaiblir
en elle le souvenir de la catastrophe, il finirait du moins par y détruire tout
reste d’espoir.
Ainsi, conformément à la
volonté de Mrs. Branican, le Dolly-Hope ne fut pas désarmé. Le capitaine
Ellis et ses hommes continuèrent à figurer sur les rôles d’équipage, à toucher
leurs gages, comme s’ils eussent été en cours de navigation. Il y avait
d’ailleurs d’importantes réparations à faire, après dix-neuf mois dans ces mers
si dures de la Malaisie, la coque à passer au bassin de carénage, le gréement à
renouveler en partie, les chaudières à remplacer, quelques pièces de la machine
à changer. Puis, lorsque ces travaux eurent pris fin, le Dolly-Hope embarqua
ses vivres, fit son plein de charbon, et il fut en mesure de mettre en mer au
premier ordre.
Mrs. Branican avait repris sa
vie habituelle à Prospect-House, où, sauf M. William Andrew et le capitaine
Ellis, personne n’était admis dans son intimité. Elle vivait entièrement
absorbée par ses souvenirs et ses espérances, ayant toujours présent le double
malheur qui l’avait atteinte. Le petit Wat aurait eu sept ans à cette époque –
l’âge où les premières lueurs de la raison éclairent ces jeunes cerveaux si impressionnables,
et le petit Wat n’était plus ! Puis, la pensée de Dolly se reportait sur
celui qui s’était dévoué pour elle, ce Zach Fren, qu’elle aurait voulu
connaître et qui n’était pas encore de retour à San-Francisco. Mais cela ne
pouvait tarder. Plusieurs fois, les annales maritimes avaient donné des
nouvelles du Californian, et sans doute, l’année 1881 ne finirait pas
avant qu’il ne fût rentré à son port d’attache. Dès qu’il y serait arrivé, Mrs.
Branican appellerait Zach Fren près d’elle, et lui paierait sa dette de reconnaissance
en assurant son avenir.
D’ici là, Mrs. Branican ne
cessait de venir en aide aux familles éprouvées par la perte du Franklin. C’était
uniquement pour visiter leurs modestes demeures, les aider de ses soins, faire œuvre
de charité envers elles qu’elle quittait Prospect-House et descendait aux bas
quartiers de la ville. Sa générosité se manifestait sous toutes les formes, s’inquiétant
des besoins moraux comme des besoins matériels de ses protégés. Ce fut aussi
dans les premiers mois de cette année qu’elle consulta M. William Andrew
sur un projet qu’elle avait hâte de mettre à exécution.
Il s’agissait de la fondation
d’un hospice, destiné à recueillir les enfants abandonnés, les petits orphelins
de père et de mère, et dont elle voulait doter San-Diégo.
« Monsieur Andrew, dit-elle
à l’armateur, c’est en souvenir de notre enfant, que je veux me dévouer à cette
institution et lui garantir les ressources nécessaires à son entretien. John, je
n’en doute pas, m’approuvera à son retour. Et quel meilleur emploi pourrions-nous
faire de notre fortune ? »
M. William Andrew, n’ayant
aucune objection à exprimer, se mit à la disposition de Mrs. Branican à propos
des démarches que nécessitait la création d’un établissement de ce genre. Cent
cinquante mille dollars devaient y être consacrés, d’abord pour l’acquisition
d’un immeuble convenable, ensuite pour en rétribuer annuellement les divers
services.
Cette affaire fut très
rapidement conduite, grâce au concours que la municipalité prêta à Mrs. Branican.
Du reste, il n’y eut pas lieu de bâtir. On fit l’acquisition d’un vaste édifice,
situé en bon air, sur les pentes de San-Diégo, du côté de Old-Town. Un habile
architecte appropria cet édifice à sa nouvelle destination, et sut l’aménager
de manière à pouvoir loger une cinquantaine d’enfants avec un personnel suffisant
pour les élever, soigner et instruire. Entouré d’un vaste jardin, couvert de
beaux ombrages, arrosé d’eaux courantes, il offrait, en ce qui se rapporte aux
questions d’hygiène, les systèmes réclamés par l’expérience.
Le 19 mai, cet hospice – qui
reçut le nom de Wat-House – fut inauguré aux applaudissements de la ville
entière, qui voulut, à cette occasion, prodiguer à Mrs. Branican les plus éclatants
témoignages de sympathie. La charitable femme ne parut point à la cérémonie
cependant, elle n’avait pas voulu quitter son chalet. Mais, dès qu’un certain
nombre d’enfants eurent été recueillis à Wat-House, elle vint, chaque jour, les
visiter comme si elle eût été leur mère. Ces enfants pouvaient rester jusqu’à
douze ans dans l’hospice. Dès que leur âge le permettait, on leur enseignait à
lire, à écrire, on s’occupait de leur donner une éducation morale et religieuse,
en même temps que de leur apprendre un métier suivant leurs aptitudes.
Quelques-uns, appartenant à des familles de marins, qui montraient du goût pour
la mer, étaient destinés à s’embarquer comme mousses ou novices. Et, en vérité,
il semblait que Dolly ressentît pour ceux-là une affection plus particulière –
sans doute en souvenir du capitaine John.
À la fin de 1881, aucune
nouvelle relative au Franklin n’était parvenue à San-Diégo ni ailleurs.
Bien que des primes considérables eussent été offertes à quiconque en eût
retrouvé le plus léger indice, il n’avait pas été possible de lancer le Dolly-Hope
dans une seconde campagne. Et pourtant, Mrs. Branican ne désespérait pas.
Ce que 1881 ne lui avait pas donné, peut-être 1882 le lui donnerait-il ?…
Pour ce qui concerne M. et
Mrs. Burker, qu’étaient-ils devenus ? En quel endroit s’était réfugié Len
Burker afin d’échapper aux poursuites ordonnées contre lui ? La police fédérale
ayant fini par abandonner toute enquête à ce sujet, Mrs. Branican avait dû
renoncer à savoir ce que Jane était devenue.
Et, cependant, c’était là une
cause de sincère affliction pour elle, si vivement préoccupée de la situation
de son infortunée parente. Elle s’étonnait de n’avoir jamais reçu aucune lettre
de Jane – lettre que celle-ci aurait pu lui écrire, sans compromettre la
sécurité de son mari. Ignoraient-ils donc tous les deux que Dolly, rendue à la
raison, avait envoyé un navire à la recherche du Franklin, et que cette
expédition n’avait donné aucun résultat ? C’était inadmissible. Est-ce que
les journaux des deux mondes n’avaient-ils pas suivi les diverses phases de
cette entreprise, et pouvait-on imaginer que Len et Jane Burker n’en eussent
pas eu connaissance ? Ils devaient même avoir appris que Mrs. Branican
avait été enrichie par la mort de son oncle Edward Starter, et qu’elle était en
situation de leur venir en aide ! Et pourtant, ni l’un ni l’autre
n’avaient essayé d’entrer en correspondance avec elle, bien que leur position
fût probablement très précaire.
Janvier, février, mars, étaient
déjà passés, et l’on pouvait croire que l’année 1882 n’apporterait aucune
modification à cet état de choses, lorsqu’un fait se produisit, qui parut de
nature à jeter quelque lumière sur la catastrophe du Franklin.
Le 27 mars, le steamer Californian,
sur lequel était embarqué le matelot Zach Fren, vint mouiller dans la baie
de San-Francisco, après une campagne de plusieurs années à travers les diverses
mers d’Europe.
Aussitôt que Mrs. Branican
eut appris le retour de ce navire, elle écrivit à Zach Fren, qui était alors
maître d’équipage à bord du Californian, en l’invitant à partir
immédiatement pour se rendre auprès d’elle à San-Diégo.
Comme Zach Fren avait
précisément l’intention de revenir dans sa ville natale afin d’y prendre
quelques mois de repos, il répondit que, dès qu’il pourrait débarquer, il se
rendrait à San-Diégo, où sa première visite serait pour Prospect-House. C’était
l’affaire de quelques jours.
Mais, en même temps, se
répandit une nouvelle, dont le retentissement serait immense dans les États de
la Confédération, si elle se confirmait.
On disait que le Californian
avait recueilli une épave, qui, vraisemblablement, provenait du Franklin…
Un journal de San-Francisco ajoutait que le Californian avait
rencontré cette épave au nord de l’Australie, dans les parages compris entre la
mer de Timor et la mer d’Arafoura, au large de l’île Melville, à l’ouest du
détroit de Torrès.
Dès que cette nouvelle fut
arrivée à San-Diégo, M. William Andrew et le capitaine Ellis, qui en
avaient été informés par dépêche, accoururent à Prospect-House.
Au premier mot qui lui fut
dit à ce sujet, Mrs. Branican devint très pâle. Mais, de ce ton qui dénotait
chez elle une conviction absolue :
« Après l’épave, on
retrouvera le Franklin, dit-elle, et après le Franklin, on retrouvera
John et ses compagnons ? »
En réalité, la rencontre de
cette épave était un fait qui avait son importance.
C’était la première fois, en
somme, qu’un débris du navire perdu venait d’être recueilli. Pour aller
chercher le théâtre de la catastrophe, Mrs. Branican possédait maintenant un
anneau de cette chaîne qui reliait le présent au passé.
Immédiatement, elle fit
apporter une carte de l’Océanie. Puis, M. William Andrew et le capitaine Ellis
durent étudier la question d’une nouvelle campagne à entreprendre, car elle voulait
que cette résolution fût prise séance tenante.
« Ainsi le Franklin n’aurait
pas fait route sur Singapore en traversant les Philippines et la Malaisie, fit
tout d’abord observer M. William Andrew.
– Mais cela est improbable…
cela est impossible ! répondit le capitaine Ellis.
– Cependant, reprit
l’armateur, s’il avait suivi cet itinéraire, comment cette épave aurait-elle pu
être retrouvée dans la mer d’Arafoura, au nord de l’île Melville ?
– Je ne puis l’expliquer, je
ne puis le comprendre. monsieur Andrew, répondit le capitaine Ellis. Tout ce
que je sais, c’est que le Franklin a été vu à son passage au sud-ouest
de l’île Célèbes, après être sorti du détroit de Mahkassar. Or, s’il a pris ce
détroit, c’est évidemment parce qu’il est venu par le nord et non par l’est. Il
n’a donc pu s’engager à travers le détroit de Torrès ! »
Cette question fut discutée
longuement, et il fallut se ranger à l’opinion du capitaine Ellis.
Mrs. Branican écoutait les
objections et les réponses sans faire aucune observation. Mais un pli vertical
de son front indiquait avec quelle ténacité, avec quel entêtement, elle se
refusait à admettre la perte de John et de ses compagnons. Non ! elle n’y
croirait pas, tant que la preuve de leur mort ne lui serait pas matériellement
fournie !
« Soit ! dit M. William
Andrew. Je pense comme vous, mon cher Ellis, que le Franklin a dû
traverser la mer de Java, en faisant route sur Singapore…
– En partie du moins, monsieur
Andrew, puisque c’est entre Singapore et l’île Célèbes que le naufrage a pu se
produire.
– Soit, vous dis-je. Mais
comment l’épave a-t-elle dérivé jusqu’aux parages de l’Australie, si le Franklin
s’est brisé sur quelque écueil de la mer de Java ?
– Cela ne peut se comprendre
que d’une façon, répondit le capitaine Ellis, en admettant que cette épave a
été entraînée à travers le détroit de la Sonde ou l’un des autres détroits qui
séparent ces îles des mers de Timor et d’Arafoura.
– Les courants portent-ils de
ce côté ?…
– Oui, monsieur Andrew, j’ajouterai
même que si le Franklin était désemparé à la suite de quelque tempête, il
a pu être drossé dans l’un de ces détroits, pour aller finalement se perdre sur
les récifs au nord du littoral australien.
– En effet, mon cher Ellis, répondit
M. William Andrew, c’est la seule hypothèse plausible, et, dans ce cas, si
une épave a été rencontrée au large de l’île Melville, six ans après le naufrage,
c’est qu’elle s’est récemment détachée des écueils sur lesquels s’est fracassé
le Franklin ! »
Cette explication, très
sérieuse, pas un marin n’aurait accepté de la combattre.
Mrs. Branican, dont les regards
ne s’étaient point distraits de la carte déployée devant elle, dit alors :
« Puisque le Franklin
a été vraisemblablement jeté sur la côte de l’Australie, et puisque les
survivants du naufrage n’ont pas reparu, c’est qu’ils sont prisonniers d’une peuplade
indigène…
– Cela, Dolly, cela n’est pas
impossible… et pourtant… » répondit M. William Andrew.
Mrs. Branican allait
protester avec énergie contre le doute que laissait pressentir la réponse de M. William
Andrew, lorsque le capitaine Ellis crut devoir dire :
« Il reste à savoir si
l’épave repêchée par le Californian appartient réellement au Franklin.
– En doutez-vous ? demanda Dolly.
– Nous serons bientôt fixés à
cet égard, répondit l’armateur, car j’ai donné ordre que cette épave nous fût
expédiée…
– Et moi, ajouta Mrs.
Branican, je donne ordre que le Dolly-Hope se tienne prêt à reprendre la
mer. »
Trois jours après cet
entretien, le maître d’équipage Zach Fren, qui venait d’arriver à San-Diégo, se
présentait au chalet de Prospect-House.
Âgé de trente-sept ans à
cette époque, vigoureux et d’allure résolue, avec sa face rougie par le hâle de
la mer, sa physionomie franche et avenante, il était de ces matelots qui
inspirent la confiance en eux-mêmes, et qui vont toujours droit où on leur dit
d’aller.
L’accueil qu’il reçut de Mrs.
Branican fut empreint d’un tel sentiment de reconnaissance, que le brave marin
ne savait trop comment répondre.
« Mon ami, lui dit-elle,
après avoir donné cours aux premiers épanchements de son cœur, c’est vous… vous
qui m’avez sauvé la vie, vous qui avez tout fait pour sauver mon pauvre enfant…
Que puis-je pour vous ? »
Le maître se défendit d’avoir
fait plus que son devoir !… Un matelot qui n’agirait pas comme il avait
agi, ce ne serait pas un matelot… ce ne serait qu’un mercenaire !… Son
seul regret, c’était de n’avoir pu rendre à sa mère son petit bébé !… Mais
enfin il ne méritait rien pour cela… Il remerciait Mrs. Branican de ses bonnes
intentions à son égard… Si elle le permettait, il retournerait la voir, tant
qu’il serait à terre…
« Depuis bien des années,
Zach Fren, j’attends votre arrivée, répondit Mrs. Branican, et j’espère que
vous serez près de moi, le jour où le capitaine John reparaîtra…
– Le jour où le capitaine
John reparaîtra !…
– Zach Fren, pouvez-vous
penser…
– Que le capitaine John a
péri ?… Ah ! cela, non, par exemple ! répliqua le maître.
– Oui !… vous avez
l’espoir…
– Plus que l’espoir, mistress
Branican… une belle et bonne certitude !… Est-ce qu’un capitaine tel que
le capitaine John, cela se perd à la façon d’un béret dans un coup de vent !…
Allons donc !… Voilà ce qui ne s’est jamais vu !… »
Ce que disait Zach Fren, et
dans ces termes qui témoignent d’une foi absolue, fit palpiter le cœur de Mrs.
Branican. Elle ne serait plus seule à croire que John serait retrouvé… Un autre
partageait sa conviction… et cet autre, c’était celui à qui elle-même devait la
vie… Elle voulait voir là comme une indication de la Providence.
« Merci, Zach Fren, dit-elle,
merci !… Vous ne savez pas le bien que vous me faites !… Répétez-moi…
répétez-moi que le capitaine John a survécu à ce naufrage…
– Mais oui !… mais oui !
mistress Branican. Et la preuve qu’il a survécu, c’est qu’on le retrouvera un
jour ou l’autre !… Et si ce n’est pas là une preuve… »
Puis, Zach Fren dut donner
nombre de détails sur les circonstances dans lesquelles l’épave avait été
repêchée par le Californian. Enfin Mrs. Branican lui dit :
« Zach Fren, je suis
décidée à entreprendre immédiatement de nouvelles recherches.
– Bien… et elles réussiront
cette fois… et j’en serai, si vous le permettez, mistress !
– Vous accepteriez de vous
joindre au capitaine Ellis ?…
– De grand cœur !
– Merci, Zach Fren !… Je
me figure que, vous à bord du Dolly-Hope, ce serait une chance de plus…
– Je le crois, mistress
Branican ! répondit le maître, en clignant de l’œil… Oui !… je le
crois… et suis prêt à partir… »
Dolly avait pris la main de
Zach Fren, elle la pressait comme celle d’un ami. Son imagination l’entraînait,
l’égarait peut-être. Mais elle voulait croire que le maître devait réussir là
où d’autres avaient échoué.
Cependant, ainsi que l’avait
fait observer le capitaine Ellis – et bien que la conviction de Mrs. Branican
fût à ce sujet – il fallait obtenir cette certitude que l’épave rapportée par
le Calijornian avait appartenu au Franklin.
Expédiée, ainsi qu’il a été
dit, sur la demande de M. William Andrew, cette épave arriva à San-Diégo
par chemin de fer, et fut aussitôt transportée aux chantiers de la marine. Là
on la soumit à l’examen de l’ingénieur et des contremaîtres qui avaient dirigé
la construction du Franklin.
Le débris, rencontré par
l’équipage du Californian au large de l’île Melville, à une dizaine de
milles de la côte, était un morceau d’étrave, ou plutôt de cette guibre
sculptée qui figure ordinairement à la proue des navires à voiles. Ce fragment
de bois avait été très détérioré, non par un long séjour dans l’eau, mais parce
qu’il avait été exposé aux intempéries de l’air. De là cette conclusion qu’il
avait dû demeurer longtemps sur les récifs contre lesquels s’était brisé le
navire, puis qu’il s’en était détaché pour une cause quelconque – probablement
sous l’action d’un courant – et qu’il allait en dérive depuis plusieurs mois ou
plusieurs semaines, lorsqu’il avait été aperçu par les matelots du Californian.
Quant à ce navire, était-ce celui du capitaine John ?… Oui, car les
débris de sculpture, reconnus sur ce fragment, ressemblaient à ceux qui
ornaient le guibre du Franklin.
C’est, en effet, ce qui fut
établi à San-Diégo. À cet égard, il n’y eut aucun doute de la part des constructeurs.
Le bois de teck, employé pour cette guibre, provenait bien des réserves du
chantier. On releva même la trace d’une armature en fer, qui reliait la guibre
à l’extrémité de l’étrave, et les restes d’une couche de peinture rouge, à
filet d’or, sur le rinceau dessiné à l’avant.
Ainsi, l’épave rapportée par
le Californian appartenait sans conteste au navire de la maison Andrew, vainement
recherché dans le bassin de la Malaisie.
Ce point acquis, il y avait
lieu d’admettre l’explication donnée par le capitaine Ellis : puisque le Franklin
avait été signalé dans la mer de Java, au sud-ouest de l’île Célèbes, il
fallait nécessairement que, quelques jours plus tard, il eût été entraîné à
travers le détroit de la Sonde ou autres passes ouvertes sur la mer de Timor ou
la mer d’Arafoura, pour aller se perdre contre les accores de la côte
australienne.
L’envoi d’un bâtiment, qui
aurait pour mission d’explorer le bassin compris entre les îles de la Sonde et
le littoral nord de l’Australie, était par là entièrement justifié. Cette
campagne réussirait-elle mieux que celle des Philippines, des Célèbes et des
Moluques ? Il y avait lieu de l’espérer.
Cette fois, Mrs. Branican eut
la pensée d’y prendre part personnellement, en s’embarquant sur le Dolly-Hope.
Mais M. William Andrew et le capitaine Ellis, auxquels se joignit Zach
Fren, parvinrent à l’en dissuader, non sans peine. Une navigation de ce genre, qui
serait forcément très longue, aurait pu être compromise par la présence d’une
femme à bord.
Il va de soi que Zach Fren
fut embarqué comme maître d’équipage du Dolly-Hope, et le capitaine Ellis
prit ses dernières dispositions pour mettre en mer dans le plus court délai.
Le Dolly-Hope quitta
le port de San-Diégo à dix heures du matin, le 3 avril 1882. Au large de la
terre d’Amérique, le capitaine Ellis suivit vers le sud-ouest une direction un
peu inférieure à celle de sa première campagne. En effet, il voulait atteindre
par le plus court la mer d’Arafoura, en franchissant le détroit de Torrès, au-delà
duquel avait été rencontré le fragment de guibre du Franklin.
Le 26 avril, on eut
connaissance des îles Gilbert, éparses au milieu de ces parages, où les calmes
du Pacifique, à cette époque de l’année, rendent la navigation si lente, si
pénible pour les navires à voiles. Après avoir laissé dans le nord les deux
groupes de Scarborough et de Kingsmill, qui composent cet archipel, situé à
huit cents milles du littoral californien, au sud-est des Carolines, le
capitaine Ellis s’engagea à travers le groupe de Vanikoro, signalé depuis une
quinzaine de lieues par le mont Kapogo, qui pointait à l’horizon.
Ces îles verdoyantes et
fertiles, couvertes d’impénétrables forêts sur toute leur étendue, appartiennent
à l’archipel Viti. Elles sont cernées de récifs madréporiques, qui en rendent
les approches extrêmement dangereuses. C’est là, on le sait, que Dumont
d’Urville et Dillon retrouvèrent les débris des bâtiments de Lapérouse, la Recherche
et l’Espérance, partis de Brest en 1791, et qui, poussés sur les
récifs de Vanikoro, ne devaient jamais revenir.
En vue de cette île si
tristement célèbre, il s’opérait un rapprochement bien naturel dans l’esprit
des hommes du Dolly-Hope. Le Franklin avait-il subi le sort des
navires de Lapérouse ? Ainsi que cela était arrivé pour Dumont d’Urville
et Dillon, le capitaine Ellis ne retrouverait-il que les débris du navire perdu ?
Et, s’il ne découvrait pas le lieu de la catastrophe, le destin de John
Branican et de ses compagnons demeurerait-il à l’état de mystère ?
À deux cents milles au delà, le
Dolly-Hope traversa obliquement l’archipel des Salomon, dénommé
autrefois Nouvelle-Géorgie ou Terres Arsacides.
Cet archipel renferme une
dizaine de grandes îles, dispersées sur une aire de deux cents lieues en
longueur et quarante en largeur. Parmi elles se trouvent les îles Carteret, autrement
dites les îles du Massacre, et dont le nom indique de quelles scènes sanglantes
elles furent le théâtre.
Le capitaine Ellis n’avait
aucun renseignement à demander aux indigènes de ce groupe, aucune investigation
à faire dans ces parages. Il n’y relâcha pas et hâta sa marche vers le détroit
de Torrès, non moins impatient que Zach Fren de rallier la partie de cette mer
d’Arafoura où l’épave avait été découverte. Ce serait là que l’enquête serait
conduite avec un soin minutieux, une infatigable persévérance, qui en
assurerait peut-être le succès.
Les terres de la Papouasie, appelées
aussi Nouvelle-Guinée, n’étaient pas très éloignées. Quelques jours après avoir
franchi l’archipel des Salomon, le Dolly-Hope eut connaissance de
l’archipel des Louisiades. Il passa au large des îles Rossel, d’Entrecasteaux, Trobriand,
et d’un grand nombre d’îlots, enfouis sous le magnifique dôme de leurs
cocotiers.
Enfin, au bout d’une
traversée de trois semaines, les vigies reconnurent à l’horizon les hautes
terres de la Nouvelle-Guinée, puis les pointes du cap York, projetées par le
littoral australien, qui limitent au nord et au sud le détroit de Torrès.
C’est un passage extrêmement
dangereux, ce détroit. À moins d’y être contraints, les capitaines au long
cours se gardent bien de s’y hasarder. C’est à ce point, paraît-il, que les
compagnies d’assurances maritimes refusent de garantir les risques de mer que
l’on y rencontre.
Il y a lieu de se défier de
ces courants, qui vont incessamment de l’est à l’ouest, entraînant les eaux du
Pacifique vers la mer des Indes. Les hauts-fonds y rendent la navigation extrêmement
périlleuse. On ne peut s’y aventurer que pendant quelques heures de jour, lorsque
la position du soleil permet d’apercevoir les brisants sous les traînées de la
houle.
Ce fut en vue du détroit de
Torrès que le capitaine Ellis, dans une conversation qu’il eut avec son second
officier et Zach Fren, demanda au maître :
« C’est bien à la
hauteur de l’île Melville que le Californian a repêché l’épave du Franklin ?
– Précisément, répondit Zach Fren.
– Il faudrait donc compter à
peu près cinq cents milles à travers la mer d’Arafoura depuis le détroit ?…
– En effet, capitaine, et je
comprends ce qui vous embarrasse. Étant donnés les courants réguliers, qui
portent de l’est à l’ouest, il semble que, puisque ce morceau de guibre a été recueilli
au large de l’île Melville, c’est que le Franklin a dû se perdre à
l’entrée du détroit de Torrès…
– Sans doute, Zach Fren, et
il faudrait en conclure que John Branican serait allé choisir ce dangereux
passage pour se rendre à Singapore ? Or, cela, je ne l’admettrai jamais. À
moins de circonstances qui m’échappent, je persiste à croire qu’il a dû
traverser les parages de la Malaisie, comme nous l’avons fait lors de notre
première campagne, puisqu’il a été aperçu pour la dernière fois dans le sud de
l’île Célèbes.
– Et comme ce fait ne peut
être discutable, fit observer le second, il en résulte que si le capitaine
Branican a pénétré dans la mer de Timor, il n’a pu y arriver que par l’un des
détroits qui séparent les îles de la Sonde.
– C’est incontestable, répondit
le capitaine Ellis, et je ne comprends plus comment le Franklin a pu
être ramené vers l’est. De deux choses l’une, ou il était désemparé, ou il ne
l’était pas. S’il était désemparé, c’est à des centaines de milles dans l’ouest
du détroit de Torrès que les courants ont dû l’entraîner. S’il ne l’était pas, pourquoi
serait-il revenu vers ce détroit, puisque Singapore est dans une direction
opposée.
– Je ne sais que penser, répliqua
le second. Si l’épave avait été trouvée dans la mer des Indes, cela pourrait
s’expliquer par un naufrage qui aurait eu lieu soit sur les îles de la Sonde, soit
sur le littoral ouest de l’Australie…
– Tandis qu’elle a été
repêchée à la hauteur de l’île Melville, répondit le capitaine Ellis, ce qui
indiquerait que le Franklin s’est perdu dans la partie de la mer
d’Arafoura voisine du détroit de Torrès, ou même dans ce détroit.
– Peut-être, fit observer
Zach Fren, existe-t-il des contrecourants le long de la côte australienne, qui
ont repoussé l’épave vers le détroit. Dans ce cas, le naufrage pourrait s’être
produit dans l’ouest de la mer d’Arafoura.
– Nous le verrons, dit le
capitaine Ellis. Mais, en attendant, manœuvrons comme si le Franklin s’était
brisé sur les écueils du détroit de Torrès…
– Et si nous manœuvrons bien,
répéta Zach Fren, nous retrouverons le capitaine John ! »
C’était, en somme, ce qu’il y
avait de mieux à faire, et c’est ce qui fut fait.
La largeur du détroit de
Torrès est estimée à une trentaine de milles. On se figurerait difficilement le
fourmillement de ses îlots et de ses récifs, dont la position est à peine
établie par les meilleurs hydrographes. On en compte au moins neuf cents, à
fleur d’eau pour la plupart, et dont les plus considérables ne mesurent que
trois à quatre milles de circonférence. Ils sont habités par des tribus
d’Andamènes, très redoutables aux équipages qui tombent entre leurs mains, ainsi
que le prouve le massacre des matelots du Chesterfield et du Hormuzier.
En se transportant de l’un à
l’autre dans leurs légères pirogues, leurs praos-volants, de construction
malaise, ces naturels peuvent aller sans peine de la Nouvelle-Guinée à
l’Australie ou de l’Australie à la Nouvelle-Guinée. Donc, si le capitaine John
et ses compagnons s’étaient réfugiés sur l’un de ces îlots, il leur eût été
assez facile de rallier la côte australienne, puis de gagner quelque bourgade
du golfe de Carpentarie ou de la péninsule du cap York, et leur rapatriement
n’aurait pas offert de grandes difficultés. Or, comme aucun d’eux n’avait
reparu, la seule hypothèse admissible, c’est qu’ils étaient tombés au pouvoir
des indigènes du détroit, et ce n’est point de ces sauvages qu’il faut attendre
le respect des prisonniers : ils les tuent sans pitié, ils les dévorent, et
où alors rechercher les traces de ces sanglantes catastrophes ?
Voilà ce que pensait le
capitaine Ellis, ce que disaient les hommes du Dolly-Hope. Tel avait dû
être le sort des survivants du Franklin, s’il s’était perdu dans le
détroit de Torrès… Restait, il est vrai, le cas où il ne se serait pas engagé à
travers ce détroit ; mais alors, de quelle façon expliquer que ce fragment
de sa guibre eût été rencontré au large de l’île Melville ?
Le capitaine Ellis se lança
intrépidement à travers ces redoutables passes, prenant en même temps toutes
les mesures que commandait la prudence. Ayant un bon steamer, des officiers
vigilants, un équipage courageux et de sang-froid, il comptait bien se
débrouiller au milieu de ce labyrinthe d’écueils et aussi tenir en respect les
indigènes qui tenteraient de l’attaquer.
Lorsque – pour une raison ou
pour une autre – les bâtiments embouquent le détroit de Torrès, dont
l’ouverture est sillonnée de bancs de coraux du côté de l’océan Pacifique, ils
longent de préférence la côte australienne. Mais, dans le sud de la Papouasie, il
existe une assez grande île, l’île Murray, qu’il importait de visiter avec
soin.
Pour cela, le Dolly-Hope s’avança
entre les deux dangereux récifs désignés par les noms Eastern-Fields et
Boot-Reef. Et même, ce dernier, par la disposition de ses roches, présentant de
loin l’apparence d’un navire naufragé, on put croire que c’étaient les restes
du Franklin. De là une émotion de courte durée, car la chaloupe à vapeur
eut bientôt permis de constater qu’il n’y avait là qu’un bizarre amoncellement
de masses coralligènes.
Plusieurs canots, simples
troncs d’arbres creusés au feu ou à la hache, munis de balanciers qui assurent
leur stabilité en mer, manœuvrés à la pagaie par cinq ou six naturels, furent
aperçus aux approches de l’île Murray. Ces naturels s’en tinrent à des cris, ou
plutôt à de véritables hurlements de fauves. Sous petite vapeur, le Dolly-Hope
put faire le tour de l’île, sans avoir à repousser leur agression. Nulle
part, on n’aperçut les débris d’un naufrage. Sur ces îles et îlots, rien que de
noirs indigènes aux formes athlétiques, à la chevelure laineuse, teinte en
rouge, à la peau luisante, au nez gros, non épaté. En vue de manifester des
intentions hostiles, ils agitaient leurs lances, leurs arcs, leurs flèches, après
s’être rassemblés sous l’abri de cocotiers, qui se comptent par milliers dans ces
régions du détroit.
Pendant un mois, jusqu’au 10
juin, après avoir renouvelé sa provision de combustible à Somerset, un des
ports de l’Australie septentrionale, le capitaine Ellis visita minutieusement
l’espace compris entre le golfe de Carpentarie et la Nouvelle-Guinée. Il
relâcha aux îles Mulgrave, Banks, Horn, Albany, à l’île Booby, creusée de
cavernes obscures, dans l’une desquelles est établie la boîte aux lettres du
détroit de Torrès. Mais les navigateurs ne se contentent pas de déposer leurs
lettres dans cette boîte, dont la levée n’est pas régulière, on le pense bien. Une
sorte de convention internationale oblige les marines des divers États à faire
des dépôts de charbon et de vivres sur cette île Booby, et il n’est pas à
craindre qu’ils soient pillés par les naturels, car la violence des courants ne
permet pas à leurs fragiles embarcations d’y accoster.
À plusieurs reprises, en les
amadouant par des présents d’infime valeur, on réussit à communiquer avec
quelques mados ou chefs de ces îles. Ils offraient en revanche du « kaiso »
ou écailles de tortue, et des « incras », coquilles enfilées qui leur
servent de monnaie. Faute de pouvoir se faire comprendre ou de comprendre leur
langage, il fut impossible de savoir si ces Andamènes avaient connaissance d’un
naufrage, qui aurait coïncidé par sa date avec la disparition du Franklin. En
tout cas, il ne semblait pas qu’ils eussent en leur possession des objets de
fabrication américaine, armes ou ustensiles. On ne trouva ni ferrures, ni
pièces de charpente, ni débris de mâture ou d’espars, qui auraient pu provenir
de la démolition d’un navire. Aussi, lorsque le capitaine Ellis quitta
définitivement les insulaires du détroit de Torrès, s’il n’était pas à même
d’affirmer que le Franklin n’était pas venu se fracasser sur ces récifs,
du moins n’avait-il recueilli aucun indice à ce sujet.
Il s’agissait maintenant
d’explorer la mer d’Arafoura, à laquelle fait suite la mer de Timor, entre le
chapelet des petites îles de la Sonde au nord, et le littoral australien au
sud. Quant au golfe de Carpentarie lui-même, le capitaine Ellis ne jugea point
à propos de le visiter, vu qu’un naufrage qui se fût produit sur ses côtes
n’aurait pu rester inconnu des colons du voisinage. C’était, au contraire, sur
le littoral de la Terre d’Arnheim qu’il songeait à porter d’abord ses
investigations. Puis, au retour, il explorerait la partie septentrionale de la
mer de Timor, et les nombreuses passes qui y donnent accès entre les îles.
Cette navigation sur les
accores de la Terre d’Arnheim, semés d’îlots et de récifs, ne demanda pas moins
d’un mois. Elle fut faite avec un zèle et aussi une audace que rien ne pouvait
décourager. Mais partout, depuis la pointe occidentale du golfe de Carpentarie
jusqu’au golfe de Van Diémen, les renseignements firent défaut. Nulle part, l’équipage.
du Dolly-Hope ne parvint à retrouver les restes d’un bâtiment naufragé.
Ni les indigènes australiens, ni les Chinois, qui font le commerce du tripang
dans ces mers, ne fournirent un éclaircissement quelconque. En outre, si les
survivants du Franklin avaient été faits prisonniers par les tribus
australiennes de cette contrée, tribus adonnées au cannibalisme, pas un d’eux
n’aurait été épargné, ou c’eût été miracle.
Le 11 juillet, arrivé sur le
cent trentième degré de longitude, le capitaine Ellis commença à opérer la
reconnaissance de l’île Melville et de l’île Bathurst, qui ne sont séparées
l’une de l’autre que par une passe assez étroite. C’était à dix milles dans le
nord de ce groupe que l’épave du Franklin avait été recueillie. Pour
qu’elle n’eût pas été entraînée plus loin vers l’ouest, il fallait que les
courants ne l’eussent détachée des récifs que peu de temps avant l’arrivée du Californian.
Il était donc possible que le théâtre de la catastrophe ne fût pas très
éloigné.
Cette exploration dura près
de quatre mois, car elle engloba non seulement le périple des deux îles, mais
aussi les lignes côtières de la Terre d’Arnheim jusqu’au canal de la Reine et
même jusqu’à l’embouchure de la Victoria River.
Il était très difficile de
pousser les investigations vers l’intérieur. C’eût été se risquer sans aucune
chance d’obtenir des renseignements. Elles sont extrêmement redoutables, ces
tribus qui fréquentent les territoires au nord du continent australien.
Récemment – et le capitaine Ellis venait de l’apprendre pendant une des
relâches de sa campagne – de nouveaux faits de cannibalisme s’étaient accomplis
dans ces parages. L’équipage d’un navire hollandais, le Groningue, attiré
par de fausses démonstrations des indigènes de l’île Bathurst, avait été
massacré et dévoré par ces bêtes fauves – n’est-ce pas le seul nom qui leur
convienne ? Quiconque devient leur prisonnier peut être considéré comme
destiné à la plus épouvantable des morts !
Cependant, si le capitaine
Ellis devait renoncer à savoir où et quand l’équipage du Franklin était
tombé entre les mains de ces naturels, peut-être parviendrait-on à retrouver
quelque indice du naufrage. Et il y avait d’autant plus lieu de l’espérer que
huit mois ne s’étaient pas écoulés depuis que le Californian avait
ramassé ce fragment de guibre au nord de l’île Melville.
Le capitaine Ellis et son
équipage s’appliquèrent dès lors à fouiller les anses, les criques, les récifs
de la côte, sans souci ni des fatigues ni des dangers auxquels ils
s’exposaient. C’est ce qui explique la durée de cette exploration. Elle fut
très longue parce qu’il importait qu’elle fût très minutieuse.
Plusieurs fois, le Dolly-Hope
faillit s’anéantir sur les brisants encore mal reconnus de ces mers. Plusieurs
fois aussi, il fut sur le point d’être envahi par les indigènes, dont on eut à
repousser les praos, à coups de fusil lorsqu’ils étaient à distance, à coups de
hache lorsqu’ils tentaient l’abordage.
Mais, ni sur les îles
Melville et Bathurst, pas plus sur la Terre d’Arnheim jusqu’à l’embouchure de
la Victoria, que dans le détroit de Torrès, les recherches ne donnèrent
satisfaction. On ne découvrit nulle part les restes d’un naufrage, et aucune
épave ne fut rencontrée.
Voilà où en était
l’expédition à la date du 3 novembre. Quel parti allait prendre le capitaine
Ellis ? Considérait-il sa mission comme terminée – du moins en ce qui
concernait le littoral australien, les îles et îlots qui en dépendent ?
Devait-il songer au retour, après avoir exploré les petites îles de la Sonde, dans
la partie septentrionale de la mer de Timor ? En un mot, avait-il
conscience d’avoir fait tout ce qu’il était humainement possible de faire ?
Ce brave marin hésitait, on
le comprend, à se tenir quitte de sa tâche même en l’ayant poursuivie jusqu’aux
rivages de l’Australie.
Un incident vint mettre un
terme à ses hésitations.
Dans la matinée du 4 novembre,
il se promenait avec Zach Fren à l’arrière du steamer, lorsque le maître lui
montra quelques objets qui flottaient à un demi-mille du Dolly-Hope. Ce
n’étaient point des morceaux de bois, des fragments de bordages ou des troncs
d’arbres, mais d’énormes paquets d’herbes, sortes de sargasses jaunâtres
arrachées des profondeurs sous-marines, et qui suivaient les contours de la
haute terre.
« Voilà qui est
singulier, fit observer Zach Fren. Que je perde mon nom, si ces herbes ne
remontent pas de l’ouest et même du sud-ouest ! Il y a certainement un
courant qui les porte du côté du détroit ?
– Oui, répondit le capitaine
Ellis, et ce doit être un courant local, qui se dirige à l’est, à moins qu’il
n’y ait là qu’un déplacement de marée.
– Je ne crois pas, capitaine,
répondit Zach Fren, car, au petit jour – cela me revient en ce moment – j’ai
déjà vu quantité de ces sargasses dérivant vers l’amont.
– Maître, vous êtes certain
du fait ?…
– Comme je suis certain que
nous finirons par retrouver le capitaine John !
– Eh bien, si ce courant
existe, reprit le capitaine Ellis, il pourrait se faire que l’épave du Franklin
fût venue de l’ouest, en longeant la côte australienne.
– C’est absolument ma manière
de voir, répondit Zach Fren.
– Alors nous n’avons pas à
hésiter, maître. Il faut prolonger la reconnaissance de ces côtes à travers la
mer de Timor jusqu’à l’extrémité de l’Australie occidentale ?
– Jamais je n’en ai été plus
convaincu, capitaine Ellis, puisqu’il est hors de doute qu’il y ait un courant
de côte, dont la direction, très sensible, va toucher l’île Melville. À
supposer que le capitaine Branican se soit perdu dans les parages de l’ouest, cela
expliquerait qu’un débris de son navire ait pu être ramené dans les parages où
nous l’avons repêché à bord du Californian. »
Le capitaine Ellis fit venir
son second, et le consulta sur la convenance qu’il y aurait de continuer la
navigation plus avant dans l’ouest.
Le second fut d’avis que
l’existence de ce courant local exigeait qu’elle fût au moins poussée jusqu’à
l’endroit où il prenait naissance.
« Poursuivons notre
route à l’ouest, répondit le capitaine Ellis. Ce ne sont pas des doutes, c’est
une certitude que nous devons rapporter à San-Diégo. La certitude qu’il ne
reste plus rien du Franklin, s’il a péri sur la côte australienne ! »
En conséquence de cette
détermination, très justifiée d’ailleurs, le Dolly-Hope remonta jusqu’à
l’île Timor, afin de renouveler son approvisionnement de combustible.
Après une relâche de
quarante-huit heures, il redescendit vers ce promontoire de Londonderry, qui se
projette à l’angle de l’Australie occidentale.
En quittant Queen’s Channel, le
capitaine Ellis s’appliqua à suivre d’aussi près que possible les contours du
continent à partir de Turtle-Point. En cet endroit, le courant manifestait très
nettement sa direction de l’ouest à l’est.
Ce n’était pas un de ces
effets de marée, qui changent avec le flux et le reflux, mais un transport
permanent des eaux d’aval en amont dans cette partie méridionale de la mer de
Timor. Il y avait donc lieu de le remonter, en fouillant les criques et les récifs,
tant que le Dolly-Hope ne se trouverait pas en face de la haute mer, sur
la limite de l’océan Indien.
Arrivé à l’entrée du golfe de
Cambridge, qui baigne la base du mont Cockburn, le capitaine Ellis jugea qu’il
serait imprudent d’aventurer son navire au sein de ce long entonnoir, hérissé
d’écueils, et dont les rives sont fréquentées par de redoutables tribus. Aussi
la chaloupe à vapeur, montée par une demi-douzaine d’hommes bien armés, fut-elle
mise sous les ordres de Zach Fren, afin de visiter l’intérieur de ce golfe.
« Évidemment, lui fit
observer le capitaine Ellis, si John Branican est tombé au pouvoir des indigènes
de cette partie du continent, il n’est pas supposable que son équipage et lui
aient survécu. Mais, ce qui nous importe, c’est de savoir s’il existe encore
quelques débris du Franklin, au cas où les Australiens l’auraient fait
échouer dans le golfe de Cambridge…
– Ce qui ne m’étonnerait pas
de la part de ces coquins ! » répondit Zach Fren.
La tâche du maître étant bien
justifiée, il la remplit consciencieusement, en se tenant toujours sur le qui-vive.
Il conduisit sa chaloupe jusqu’à l’île Adolphus, presque au fond du golfe ;
il en fit le tour, et ne découvrit rien qui l’engageât à porter plus loin ses
investigations.
Le Dolly-Hope reprit
alors sa route au delà du golfe de Cambridge, contourna le cap Dusséjour, et
remonta vers le nord-ouest, en longeant la côte qui appartient à l’une de ces
grandes divisions de l’Australie, connue sous le nom d’Australie Occidentale.
Les îlots y sont nombreux, les anses s’y découpent très capricieusement. Mais, ni
au cap Rhuliers, ni au promontoire de Londonderry, un résultat quelconque ne
vint payer l’équipage de tant de fatigues, si courageusement acceptées.
Les fatigues et les dangers
de cette navigation furent bien autrement graves, lorsque le Dolly-Hope eut
doublé le promontoire de Londonderry. Sur cette côte, directement assaillie par
les grandes houles de l’océan Indien, il existe peu de refuges praticables, dans
lesquels un bâtiment désemparé puisse se mettre à l’abri. Or un steamer est
toujours à la merci de sa machine, qui peut lui manquer, lorsque les secousses
du tangage et du roulis sont dues à de violents coups de mer. À partir de ce
promontoire jusqu’à la baie Collier, dans le York-Sund et dans la baie
Brunswick, on ne voit qu’un entremêlement d’îlots, un labyrinthe de bas-fonds
et de récifs, comparables à ceux qui fourmillent dans le détroit de Torrès. Aux
caps Talbot et Bougainville, la côte se défend par un si monstrueux ressac que
ses abords ne sont possibles qu’aux embarcations des indigènes, rendues presque
inchavirables par le contrepoids de leurs balanciers. La baie Admiralty, ouverte
entre le cap Bougainville et le cap Voltaire, est tellement enchevêtrée de roches, que la chaloupe
à vapeur risqua plus d’une fois de se perdre. Mais rien n’arrêta l’ardeur de
l’équipage, et, parmi ces hardis marins, c’était à qui se disputerait la
redoutable tâche de coopérer à une si périlleuse opération.
Au delà de la baie Collier, le
capitaine Ellis se lança à travers l’archipel Buccaneer. Son intention n’était
pas, d’ailleurs, de dépasser le cap Lévêque, dont la pointe termine le
King-Sund au nord-ouest.
Ce n’est pas qu’il y eût lieu
de se préoccuper de l’état atmosphérique, lequel tendait à s’améliorer chaque
jour. Pour cette partie de l’océan Indien, située dans l’hémisphère austral, les
mois d’octobre et de novembre correspondent aux mois d’avril et de mai de
l’hémisphère boréal. La belle saison commençait ainsi à s’établir graduellement,
et la campagne aurait pu se poursuivre dans des conditions assez favorables.
Mais il n’y avait pas à la prolonger indéfiniment ; son point extrême serait
atteint dès que ce courant littoral, qui remontait vers l’est en charriant des
épaves jusqu’à l’île Melville, aurait cessé de se faire sentir.
C’est ce qui fut enfin reconnu
vers la fin du mois de janvier 1883, lorsque le Dolly-Hope eut achevé –
infructueusement du reste – la reconnaissance du large estuaire du King-Sund, au
fond duquel vient se jeter la rivière de Fitz-Roy. La chaloupe à vapeur avait
même eu à subir à l’embouchure de cet important cours d’eau une furieuse
attaque des naturels. Deux hommes furent blessés dans cette rencontre, peu
grièvement, il est vrai. Ce fut grâce au sang-froid du capitaine Ellis que
cette dernière tentative ne dégénéra pas en désastre.
Dès que le Dolly-Hope fut
sorti du King-Sund, il vint stopper à la hauteur du cap Lévêque. Le capitaine
Ellis tint alors conseil avec son second et le maître d’équipage. Les cartes
ayant été soigneusement examinées, il fut décidé que l’expédition prendrait fin
ici même, sur la limite du dix-huitième parallèle de l’hémisphère austral. Au
delà du King-Sund, la côte est franche, on n’y compte que de rares îlots, et
cette portion de la Terre de Tasman, qu’elle limite sur la mer des Indes, figure
encore en blanc dans les atlas de publication récente. Il n’y avait aucun
intérêt à se porter plus loin vers le sud-ouest, ni à visiter les abords de
l’archipel de Dampier.
En outre, il ne restait plus
au Dolly-Hope qu’une faible quantité de charbon, et le mieux était de
prendre route directement sur Batavia, où il pourrait refaire son plein de
combustible. Puis il regagnerait le Pacifique en traversant la mer de Timor le
long des îles de la Sonde. Le cap fut donc mis au nord, et bientôt le Dolly-Hope
eut perdu de vue la côte australienne.
L’espace compris entre la
côte nord-ouest de l’Australie et la partie occidentale de la mer de Timor ne
contient pas d’îles importantes. À peine les géographes y relèvent-ils quelques
îlots. Ce qu’on y rencontre, ce sont principalement de ces hauts-fonds bizarres,
de ces formations coralligènes, désignés par les qualifications de « banks »,
de « rocks », de « rifts » ou de « shoals » –
tels Lynher-Riff, Scotts-Riff, Seringapatam-Riff, Korallen-Riff, Courtier-Shoal,
Rowley-Shoal, Hibernia-Shoal, Sahul-Bank, Echo-Rock, etc. La position de ces
écueils est déterminée, exactement pour la plupart, approximativement pour
quelques-uns. Il est même possible qu’il reste à découvrir un certain nombre de
ces inquiétants récifs parmi ceux qui se trouvent à fleur d’eau. Aussi la
navigation est-elle difficile et exige-t-elle une surveillance constante au
milieu de ces parages où se hasardent quelquefois les bâtiments en venant de la
mer des Indes.
Le temps était beau, la mer
assez calme en dehors des brisants. L’excellente machine du Dolly-Hope n’avait
point souffert depuis le départ de San-Diégo ; ses chaudières fonctionnaient
généreusement. Toutes les circonstances de temps et de mer promettaient une
traversée favorable entre le cap Lévêque et l’île de Java. Mais, en réalité, c’était
la route du retour. Le capitaine Ellis ne prévoyait d’autres retards que ceux
des relâches dont il voulait profiter encore en explorant les petites îles de
la Sonde.
Pendant les premiers jours
qui suivirent le départ effectué à la hauteur du cap Lévêque, il ne se
produisit aucun incident de mer. La plus sévère vigilance était imposée aux
hommes de garde. Placés dans la mâture, ils devaient signaler d’aussi loin que
possible ces shoals, ces riffs, dont quelques-uns émergeaient à peine de la
surface des eaux.
Le 7 février, vers neuf
heures du matin, l’un des matelots juchés sur les barres de misaine cria :
« Récif par bâbord
devant ! »
Comme ce récif n’était pas
visible pour les hommes du pont, Zach Fren s’élança dans les haubans, afin de
reconnaître par lui-même la position indiquée.
Lorsqu’il se fut achevalé sur
les barres, le maître aperçut assez distinctement un plateau rocheux à six
milles au large par la hanche de bâbord.
En réalité, ce n’était ni un
rock ni un shoal, mais bien un îlot disposé en dos d’âne, qui se dessinait vers
le nord-ouest. Étant donnée la distance, il était même admissible que cet îlot
fût une île d’une certaine étendue, si elle se présentait alors dans le sens de
sa largeur.
Quelques minutes après, Zach
Fren redescendit et fit son rapport au capitaine Ellis. Celui-ci donna l’ordre
de lofer d’un quart, afin de se rapprocher du dit îlot.
À l’observation de midi, lorsqu’il
eut pris hauteur et fait son point, le capitaine nota sur le livre de bord que
le Dolly-Hope se trouvait par 14°07’ de latitude sud et 133°13’ de
longitude est. Ce point, ayant été rapporté sur la carte, coïncidait avec le
gisement d’une certaine île, désignée sous le nom d’île Browse par les
géographes modernes, et située à deux cent cinquante milles environ du
York-Sund de la côte australienne.
Puisque cette île était à peu
près sur sa route, le capitaine Ellis résolut d’en suivre les contours, bien
qu’il n’eût pas l’intention de s’y arrêter.
Une heure plus tard, l’île
Browse n’était plus qu’à un mille par le travers du Dolly-Hope. La mer, un
peu houleuse, brisait avec fracas et couvrait d’une poussière d’embruns un cap
allongé vers le nord-est. On ne pouvait guère juger de l’étendue de l’île, parce
que le regard la prenait obliquement. En tout cas, elle se présentait sous
l’apparence d’un plateau ondulé, dont aucune tumescence ne dominait la surface.
Cependant, comme il n’avait
pas de temps à perdre, le capitaine Ellis, ayant un peu ralenti sa marche, allait
donner au mécanicien l’ordre de se remettre en route, lorsque Zach Fren attira
son attention, en disant :
« Capitaine, voyez donc…
là-bas… Est-ce que ce n’est pas un mât qui se dresse sur ce cap ? »
Et le maître tendait la main
dans la direction du cap projeté au nord-est, et que terminait brusquement une
haute arête rocheuse taillée à pic.
« Un mât ?… Non !…
Il me semble que ce n’est qu’un tronc d’arbre », répondit le capitaine
Ellis.
Puis, prenant sa lunette, il
regarda avec plus d’attention l’objet signalé par Zach Fren.
« C’est vrai, dit-il, vous
ne vous trompez pas, maître !… C’est un mât, et je crois apercevoir un morceau
de pavillon déloqueté par le vent… Oui !… oui !… Ce doit être un
signal !…
– Alors nous ferions
peut-être bien de laisser arriver… dit le maître d’équipage.
– C’est mon avis », répondit
le capitaine Ellis. Et il donna ordre de porter sur l’île Browse à petite
vapeur. Cet ordre fut immédiatement exécuté. Le Dolly-Hope commença à se
rapprocher des récifs, qui faisaient ceinture à l’île sur environ trois cents
pieds au large. La mer les battait violemment, non pas que le vent fût fort, mais
parce que les courants poussaient la houle dans cette direction. Bientôt les
détails de la côte apparurent nettement à l’œil nu. Ce littoral se présentait
sous un aspect sauvage, aride, désolé, sans une échappée de verdure, et montrait
des trous béants de caverne, où le ressac se propageait avec des bruits de
tonnerre. Par intervalles, un morceau de grève jaunâtre coupait la ligne des
roches, au-dessus desquelles voltigeaient des bandes d’oiseaux de mer. De ce
côté, toutefois, on ne voyait rien des épaves d’un naufrage, ni débris de
mâture, ni restes de coque. Le mât planté à la pointe extrême du promontoire
devait être formé d’un bout-dehors de beaupré ; mais, quant à cette
étamine, dont la brise agitait les lambeaux, il était impossible d’en discerner
la couleur.
« Il y a là des
naufragés… s’écria Zach Fren.
– Ou il y en a eu !
répondit le second.
– Il n’est pas douteux, dit
le capitaine Ellis, qu’un bâtiment s’est mis au plein sur cette île.
– Ce qui est non moins
certain, ajouta le second, c’est que des naufragés y ont trouvé refuge, puisqu’ils
ont dressé ce mât de signal, et peut-être ne l’ont-ils pas quittée, car il est
rare que les navires à destination de l’Australie ou des Indes passent en vue
de l’île Browse.
– Je pense que votre
intention, capitaine, est de la visiter ? demanda Zach Fren.
– Oui, maître, mais, jusqu’à
présent, je n’ai aperçu aucun endroit où on pût l’accoster. Commençons donc par
la contourner, avant de prendre une décision. Si elle est encore habitée par de
malheureux naufragés, il est impossible qu’ils ne nous aperçoivent pas et ne fassent
pas des signaux…
– Et si nous ne voyons
personne, quelles sont vos intentions ?… demanda Zach Fren.
– Nous essaierons de
débarquer, dès que la chose sera praticable, répondit le capitaine Ellis. Si
elle n’est pas habitée, cette île peut avoir conservé les indices d’un naufrage,
et cela est d’un grand intérêt pour notre campagne.
– Et qui sait ?… murmura
Zach Fren.
– Qui sait ?…
Voulez-vous dire, maître, que le Franklin a pu se jeter sur cette île
Browse, située en dehors de la route à suivre ?…
– Pourquoi non, capitaine ?…
– Bien que ce soit absolument
invraisemblable, répondit le capitaine Ellis, nous ne devons pas nous arrêter
devant une invraisemblance, et nous tenterons un débarquement ! »
Ce projet, qui consistait à
contourner l’île Browse, fut aussitôt mis à exécution. En se tenant par
prudence à une encablure des récifs, le Dolly-Hope ne tarda pas à
doubler les diverses pointes que l’île projetait vers le nord. L’aspect du
littoral ne variait pas – roches rangées comme si elles eussent cristallisé
sous une forme presque identique, accores rudement battus de la houle, écueils
couverts d’embruns, et qui rendaient l’atterrissage impraticable. En
arrière-plan, quelques bouquets de cocotiers rabougris dominant un plateau
rocailleux, où n’apparaissait aucune trace de culture. D’habitants, personne.
D’habitations, néant. Pas une chaloupe, pas un canot de pêche. Mer déserte, île
aussi. De nombreuses bandes de mouettes, s’enfuyant d’une pointe à l’autre, animaient
seules cette morne solitude.
Si ce n’était pas là l’île
souhaitée des naufragés, où les besoins de l’existence sont assurés, du moins
avait-elle pu offrir refuge aux survivants d’un naufrage.
L’île Browse mesure environ
six à sept milles de circonférence : c’est ce qui fut constaté, lorsque le
Dolly-Hope eut relevé ses contours du sud. En vain l’équipage
cherchait-il à distinguer l’entrée d’un port, ou, à défaut de port, une crique
ménagée au milieu des roches, entre lesquelles le steamer eût pu se mettre à
l’abri au moins pendant quelques heures. Il fut bientôt démontré qu’un
débarquement ne pourrait s’effectuer qu’en employant les embarcations du bord, et
encore fallait-il trouver une passe qui leur permît d’atterrir.
Il était une heure après midi,
lorsque le Dolly-Hope se trouva sous le vent de l’île. Comme la brise
soufflait alors du nord-ouest, la houle battait moins violemment le pied des roches.
En cet endroit, la côte, décrivant une large concavité, formait une sorte de
vaste rade foraine, où un bâtiment pourrait mouiller sans imprudence, tant que
l’aire du vent ne serait pas modifiée. Il fut aussitôt décidé que le Dolly-Hope
se tiendrait là, sinon à l’ancre, du moins sous petite vitesse, tandis que
sa chaloupe à vapeur irait à terre. Restait à reconnaître l’endroit où les hommes
seraient à même de prendre pied entre ces récifs, que blanchissait la longue
écume du ressac.
En fouillant la grève du bout
de sa lunette, le capitaine Ellis finit par découvrir une dépression du plateau,
une sorte de coupure, évidée dans le massif de l’île, et par laquelle un
ruisseau se déversait dans la mer.
Lorsqu’il eut regardé à son
tour, Zach Fren affirma qu’un débarquement pourrait s’effectuer au pied de
cette coupure. La côte semblait y être moins accore, et son profil se rompait
par un angle assez aigu. On voyait aussi une étroite passe, ménagée à travers
le récif, et sur laquelle la mer ne brisait pas.
Le capitaine Ellis commanda
d’armer la chaloupe à vapeur qu’une demi-heure suffisait à mettre en état de
marcher. Il s’y embarqua avec Zach Fren, un homme de barre, un homme de gaffe, le
chauffeur et le mécanicien. Par prudence, deux fusils, deux haches et quelques
revolvers furent mis à bord. Pendant l’absence du capitaine, le second devait
évoluer avec le Dolly-Hope dans cette rade foraine, et donner attention
à tous les signaux qui pourraient être faits.
À une heure et demie, l’embarcation
déborda, se dirigea vers le rivage distant d’un bon mille, et s’engagea à
travers la passe, tandis que des milliers de mouettes assourdissaient l’espace
de leurs cris stridents. Quelques minutes plus tard, elle vint s’échouer
doucement sur une grève sablonneuse, percée çà et là d’arêtes vives. Le
capitaine Ellis, Zach Fren et les deux matelots débarquèrent aussitôt, laissant
le mécanicien et le chauffeur de garde à la chaloupe, qui devait être maintenue
en pression. Remontant alors la coupure par laquelle le ruisseau s’écoulait à
la mer, tous quatre atteignirent la crête du plateau.
À quelque cents mètres de
distance se dressait une sorte de morne rocheux, de forme bizarre, dont le
sommet dominait la grève d’une trentaine de yards.
Le capitaine Ellis et ses
compagnons se dirigèrent immédiatement vers ce morne, ils le gravirent non sans
difficulté, et, observée de cette hauteur, l’île apparut dans toute son
étendue.
Ce n’était, en réalité, qu’un
massif ovale, ressemblant à une carapace de tortue, dont le promontoire aurait
figuré la queue. Un peu de terre végétale recouvrait par endroits ce massif, qui
n’était pas de formation madréporique, tels que les attolons de la Malaisie ou
les groupes coralligènes du détroit de Torrès. Çà et là, des morceaux de
verdure apparaissaient entre le granit ; mais il y avait plus de mousses
que d’herbes, plus de pierres que de racines, plus de broussailles que
d’arbrisseaux. D’où sortait ce creek, dont le lit, visible sur une partie de
son cours, sinuait à travers les pentes du plateau ? S’alimentait-il à
quelque source intérieure ? C’est ce qu’il eût été malaisé de reconnaître,
bien que la vue s’étendît jusqu’au mât de signal.
De la crête du morne, le
capitaine Ellis et ses hommes regardèrent en toutes directions. Aucune fumée ne
se déroulait dans l’air, aucun être humain ne se montrait. Il s’ensuivait dès
lors que, si l’île Browse avait été habitée – et nul doute à cela – il était
peu probable qu’elle le fût actuellement.
« Triste abri pour des
naufragés ! dit alors le capitaine Ellis. Si leur séjour s’y est prolongé
longtemps, je me demande comment ils ont pu y vivre !
– Oui… répondit Zach Fren, ce
n’est qu’un plateau presque nu. Çà et là, un maigre bouquet d’arbres… C’est à
peine si la roche y est recouverte de terre végétale… Mais enfin, il ne faut
pas être difficile quand on a fait naufrage !… Un morceau de roche sous le
pied, ça vaut toujours mieux qu’un trou avec de l’eau par-dessus la tête !
– Au premier moment, oui !
dit le capitaine Ellis, mais après !…
– D’ailleurs, fit observer
Zach Fren, il est possible que les naufragés qui s’étaient réfugiés sur cette
île aient été promptement recueillis par quelque bâtiment…
– Comme il est également
possible, maître, qu’ils aient succombé aux privations…
– Et qui vous le fait penser,
capitaine ?
– C’est que, s’ils avaient pu
quitter l’île d’une façon ou d’une autre, ils auraient pris la précaution
d’abattre ce mât de signal. Il est à craindre que le dernier de ces malheureux
ne soit mort avant d’avoir pu être secouru. Au surplus, dirigeons-nous vers ce
mât. Peut-être trouverons-nous là quelque indice sur la nationalité du navire
qui s’est perdu dans ces parages. »
Le capitaine Ellis, Zach Fren
et les deux matelots redescendirent les talus du morne, et marchèrent vers le
promontoire qui se projetait dans la direction du nord. Mais, à peine
avaient-ils avancé que l’un des hommes s’arrêtait, pour ramasser un objet que
son pied venait de heurter.
« Tiens, qu’est-ce que
cela ?… dit-il.
– Donne ! »
répondit Zach Fren.
C’était une lame de coutelas,
du genre de ceux que les marins portent à leur ceinture, engainé dans un
fourreau de cuir. Brisée au ras du manche, tout ébréchée, cette lame avait été
jetée sans doute comme étant hors d’usage.
« Eh bien, maître ?…
demanda le capitaine Ellis.
– Je cherche quelque marque
qui indique la provenance de cette lame », répondit Zach Fren.
Il était à croire, en effet, qu’elle
portait une marque de fabrication. Mais elle était tellement oxydée qu’il
fallut d’abord en gratter l’épaisse rouille.
C’est ce que fit Zach Fren, et
il put alors, non sans un peu de difficulté, déchiffrer ces mots gravés sur
l’acier : Sheffield England.
Ainsi ce coutelas était
d’origine anglaise. Mais, affirmer de là que les naufragés de l’île Browse étaient
anglais, c’eût été se montrer trop affirmatif. Pourquoi cet ustensile n’aurait
il pas appartenu à un matelot d’une nationalité différente, puisque les
produits de la manufacture de Sheffield sont répandus dans le monde entier ?
Si l’on trouvait d’autres objets, cette hypothèse pourrait se changer en
certitude.
Le capitaine Ellis et ses
compagnons continuèrent à se diriger vers le promontoire. Sur ce sol, que ne
sillonnait aucun sentier, la marche fut assez pénible. En admettant qu’il eût
été foulé par le pied des hommes, cela remontait à une époque difficile à
déterminer, puisque toute empreinte avait disparu sous l’herbe et les mousses.
Après un parcours de deux
milles environ, le capitaine Ellis s’arrêta près d’un bouquet de cocotiers, de
pauvre venue, et dont les noix, tombées il y avait longtemps, n’étaient plus
que poussière et pourriture.
Jusqu’alors, aucun autre
objet n’avait été recueilli ; mais, à quelques pas du bouquet d’arbres, sur
la pente d’un léger vallonnement, il fut facile de reconnaître quelques traces
de culture au milieu du fouillis clairsemé de broussailles. Ce qui en restait, c’étaient
des ignames et des patates paraissant revenues à l’état sauvage. Une pioche
gisait sous d’épaisses ronces, où l’un des matelots la découvrit par hasard. Il
semblait bien qu’elle dût avoir été fabriquée en Amérique, d’après
l’emmanchement de son fer, qui était profondément rongé par la rouille.
« Qu’en pensez-vous, capitaine
Ellis ? demanda le maître d’équipage.
– Je pense qu’il n’y a pas
lieu, pour l’instant, de nous prononcer à ce sujet, répondit le capitaine
Ellis.
– Alors poussons plus avant »,
répliqua Zach Fren, en faisant signe aux hommes de le suivre.
Ayant descendu les pentes du
plateau, ils arrivèrent sur la bordure à laquelle se rattachait le promontoire
du nord. En cet endroit, se creusait une étroite sinuosité, entaillant la crête,
qui permettait de descendre sans trop de peine au niveau d’une petite grève
sablonneuse. Cette grève, mesurant un acre environ, était encadrée de roches
d’un beau ton roux que les coups du ressac balayaient sans relâche.
Sur ce sable étaient épars de
nombreux objets, indiquant que des êtres humains avaient fait un séjour
prolongé en ce point de l’île – morceaux de verre ou de faïence, débris de grès,
chevilles de fer, boîtes de conserves dont la provenance américaine n’était pas
douteuse cette fois ; puis, d’autres ustensiles à l’usage de la marine, quelques
fragments de chaînes, des anneaux rompus, des bouts de gréement en fer
galvanisé, une patte de grappin, plusieurs réas de poulie, un organeau faussé, une
bringuebale de pompe, des débris d’espars et de dromes, des plaques de tôle arrachées
d’une pièce à eau, sur l’origine desquels des marins de la Californie ne pouvaient
guère se tromper.
« Ce n’est point un
navire anglais qui s’est mis au plein sur cette île, dit le capitaine Ellis, c’est
un navire des États-Unis…
– Et l’on pourrait même
affirmer qu’il a été construit dans un de nos ports du Pacifique ! »
répondit Zach Fren, dont l’opinion fut partagée par les deux matelots.
Toutefois, rien jusqu’ici ne
permettait de croire que ce navire eût été le Franklin.
En tout cas, une question se
posait : ce bâtiment, quel qu’il fût, avait-il donc sombré en mer, puisqu’on
ne retrouvait ni les couples ni les bordages de sa coque ? Était-ce à bord
de ses embarcations que l’équipage avait pu se réfugier sur l’île Browse ?
Non ! et le capitaine
Ellis acquit bientôt la preuve matérielle que le naufrage avait eu lieu sur ces
récifs.
À une encablure environ de la
grève, au milieu d’un amoncellement de roches aiguës et d’écueils à fleur d’eau,
apparut ce lamentable enchevêtrement d’un bâtiment qui s’est jeté à la côte, alors
que la mer est démontée, que les lames se précipitent avec la violence d’un
mascaret, et qu’en un instant, bois ou fer, tout est démembré, démoli, dispersé,
fracassé, emporté par le ressac jusque par-dessus les écueils.
Le capitaine Ellis, Zach Fren,
les deux matelots regardaient, non sans une émotion profonde, ce que les roches
gardaient encore d’un tel désastre. De la coque de ce navire, il ne restait que
des courbes déformées, des bordages déchiquetés et hérissés de chevilles
rompues, des barreaux faussés, un morceau de safre du gouvernail, plusieurs
virures du pont, mais rien de l’acastillage extérieur, rien de la mâture, soit
qu’elle eût été coupée en mer, soit que, depuis l’échouage du bâtiment, on
l’eût employée aux besoins de l’installation sur l’île. Il n’y avait pas une
pièce de la membrure qui fût intacte, pas une pièce de la quille qui fût entière.
Au milieu de ces rochers aux arêtes coupantes, disposés comme des chevaux de
frise, on s’expliquait que ce navire eût été broyé à ce point que ses débris
n’eussent pu être utilisés.
« Cherchons, dit le
capitaine Ellis, et peut-être trouverons-nous un nom, une lettre, une marque, qui
permette de reconnaître la nationalité de ce bâtiment…
– Oui ! et fasse Dieu
que ce ne soit point le Franklin qui ait été réduit à un pareil état ! »
répondit Zach Fren.
Mais existait-il cet indice
que réclamait le capitaine ? En admettant même que le ressac eût respecté
un morceau du tableau d’arrière ou des pavois de l’avant, sur lequel s’inscrit
ordinairement le nom des navires, est-ce que les intempéries du ciel, les
embruns de la mer, ne devaient pas l’avoir effacé ?
D’ailleurs, rien ne se
rencontra ni des pavois ni du tableau. Les recherches demeurèrent infructueuses,
et, si quelques-uns des objets ramassés sur la grève étaient de fabrication
américaine, on ne pouvait affirmer qu’ils eussent appartenu au Franklin.
Mais, en admettant que des
naufragés eussent trouvé refuge sur l’île Browse – et le mât de signal, dressé
à l’extrémité du promontoire, le prouvait péremptoirement – et que, pendant un
temps dont on ne pouvait évaluer la durée, ils eussent vécu sur cette île, ils
avaient certainement dû chercher abri au fond d’une grotte, probablement dans
le voisinage de la grève, afin de pouvoir utiliser les débris accumulés entre
les roches.
L’un des matelots ne tarda
pas à découvrir la grotte, qui avait été occupée par les survivants du
naufrage. Elle était creusée dans une énorme masse granitique, à l’angle formé
par le plateau et la grève.
Le capitaine Ellis et Zach
Fren se hâtèrent de rejoindre le matelot qui les appelait. Peut-être cette
grotte renfermait-elle le secret du sinistre ?… Peut-être révélerait-elle
le nom du bâtiment ?…
On ne pouvait y pénétrer que
par une étroite ouverture très surbaissée, près de laquelle se voyaient les
cendres d’un foyer extérieur, dont la fumée avait noirci la paroi rocheuse.
À l’intérieur, haute
d’environ dix pieds sur vingt de profondeur et quinze de large, cette grotte
était suffisante pour servir de logement à une douzaine de personnes. Pour tout
mobilier, une litière d’herbes sèches, recouverte d’une voile en lambeaux, un banc
fabriqué avec des morceaux de bordage, deux escabeaux de même nature, une table
boiteuse qui provenait du navire – probablement la table du carré. En fait
d’ustensiles, quelques assiettes et quelques plats en fer battu, trois fourchettes,
deux cuillers, un couteau, trois gobelets de métal, le tout mangé de rouille.
Dans un coin, un baril, placé sur champ, qui devait servir à la provision d’eau
fournie par le creek. Sur la table, une lampe de bord, bossuée et oxydée, qui
était hors d’usage. Çà et là, divers objets de cuisine, plusieurs vêtements en
loques, jetés sur la litière d’herbes.
« Les malheureux !
s’écria Zach Fren, à quel dénuement ils ont été réduits pendant leur séjour sur
cette île !
– Ils n’avaient à peu près
rien sauvé du matériel de leur bâtiment, répondit le capitaine Ellis, et cela
démontre avec quelle violence il s’est mis à la côte ! Tout ayant été
brisé, tout ! comment ces pauvres gens ont-ils pourvu à leur nourriture ?…
Sans doute un peu de graines qu’ils auront semées, de la viande salée, des
conserves dont ils auront vidé jusqu’à la dernière boîte !… Mais quelle
existence, et ce qu’ils ont dû souffrir ! »
Oui ! et, en y ajoutant
les ressources que leur procurait la pêche, c’est bien ainsi que ces naufragés
avaient dû subvenir à leurs besoins. Quant à dire s’ils étaient encore sur
l’île, il semblait que cette question était résolue négativement. Du reste, s’ils
avaient succombé, il était probable que l’on trouverait les restes de celui qui
était mort le dernier… Cependant, de minutieuses recherches, faites à
l’intérieur et en dehors de la grotte, ne donnèrent aucun résultat.
« Cela me porterait à
croire, fit observer Zach Fren, que ces naufragés ont pu être rapatriés ?…
– Et comment ? répondit
le capitaine Ellis. Est-ce qu’ils auraient été en état de construire, avec les
débris de leur bâtiment, une embarcation assez grande pour tenir la mer ?…
– Non, capitaine, et ils
n’avaient pas même de quoi construire un canot. Je croirais plus volontiers que
leurs signaux auront été aperçus de quelque navire…
– Et moi, je ne puis accepter
ce fait, maître.
– Et pourquoi, capitaine ?
– Parce que, si un navire les
eût recueillis, cette nouvelle se fût répandue dans le monde entier, à moins
que ce navire n’eût ultérieurement péri corps et biens – ce qui n’est guère
croyable. J’écarte donc l’hypothèse que les naufragés de l’île Browse aient été
sauvés dans ces conditions.
– Soit ! dit Zach Fren, qui
ne se rendait pas aisément. Mais, s’il leur était impossible de construire une
chaloupe, rien ne prouve que toutes les embarcations du bord eussent péri dans
le naufrage, et en ce cas…
– Eh bien, même en ce cas, répondit
le capitaine Ellis, puisqu’on n’a point entendu dire qu’un équipage disparu ait
été recueilli, depuis quelques années, dans les parages de l’Australie
occidentale, je penserais que l’embarcation a dû sombrer pendant cette
traversée de plusieurs centaines de milles entre l’île Browse et la côte australienne ! »
Il eût été difficile de
répondre à ce raisonnement. Zach Fren le comprit bien ; mais, ne voulant
pas renoncer à savoir ce qu’étaient devenus les naufragés :
« Maintenant, capitaine,
demanda-t-il, je pense que votre intention est de visiter les autres parties de
l’île ?
– Oui… par acquit de
conscience, répondit le capitaine Ellis. Et d’abord, allons abattre ce mât de signal,
afin que des navires ne se dérangent pas de leur route, puisqu’il n’y a plus un
homme à sauver ici ! »
Le capitaine, Zach Fren et
les deux matelots, après être sortis de la grotte, explorèrent une dernière fois
la grève. Puis, ayant remonté par la coupure sur le plateau, ils se dirigèrent
vers l’extrémité du promontoire.
Ils eurent à contourner une
profonde excavation, sorte d’étang pierreux dans lequel s’amassaient les eaux
pluviales, et reprirent ensuite leur première direction.
Soudain le capitaine Ellis
s’arrêta.
En cet endroit, le sol
présentait quatre renflements, parallèles les uns aux autres. Probablement, cette
disposition n’aurait pas attiré l’attention, si de petites croix de bois, à
demi pourries, n’eussent signalé ces renflements. C’étaient des tombes. Là
était le cimetière des naufragés.
« Enfin, s’écria le
capitaine Ellis, peut-être allons-nous pouvoir apprendre ?… »
Ce n’était point manquer de
ce respect dû aux morts que de fouiller ces tombes, d’en exhumer les corps
qu’elles renfermaient, de reconnaître l’état dans lequel ils étaient réduits, de
chercher là un indice réel de leur nationalité.
Les deux matelots se mirent à
l’œuvre, et, creusant la terre avec leurs couteaux, ils la rejetèrent de chaque
côté. Mais nombre d’années déjà s’étaient écoulées depuis que ces cadavres
avaient été ensevelis à cette place, car le sol ne renfermait que des
ossements. Le capitaine Ellis les fit alors recouvrir, et les croix furent
replacées sur les tombes.
Il s’en fallait beaucoup que
les questions relatives à ce naufrage fussent résolues. Si quatre créatures
humaines avaient été ensevelies en cet endroit, qu’était devenu celui qui leur
avait rendu les derniers devoirs ? Et lui-même, lorsque la mort l’avait
frappé à son tour, où était-il tombé, et ne retrouverait-on pas son squelette
abandonné sur un autre point de l’île ?
Le capitaine Ellis ne
l’espérait pas.
« Ne parviendrons-nous
pas, s’écria-t-il, à connaître le nom du navire qui s’est perdu sur l’île
Browse !… Rentrerons-nous à San-Diégo, sans avoir découvert les débris du Franklin,
sans savoir ce que sont devenus John Branican et son équipage ?…
– Pourquoi ce navire ne
serait-il pas le Franklin ? dit un des matelots.
– Et pourquoi serait-ce lui ? »
répondit Zach Fren.
Rien, en effet, ne permettait
d’affirmer que c’était le Franklin dont les débris couvraient les récifs
de l’île Browse, et il semblait que cette seconde expédition du Dolly-Hope ne
devait pas réussir mieux que la première. Le capitaine Ellis était resté
silencieux, les regards baissés vers ce sol, où de pauvres naufragés n’avaient
trouvé qu’avec la fin de leur vie la fin de leurs misères ! Étaient-ce des
compatriotes, des Américains comme lui ?… Étaient-ce ceux que le Dolly-Hope
était venu chercher ?…
« Au mât de signal ! »
dit-il.
Zach Fren et ses hommes
l’accompagnèrent, pendant qu’il suivait la longue pente rocailleuse, par
laquelle le promontoire se raccordait au massif de l’île.
Le demi-mille qui les
séparait du mât, vingt minutes furent employées à le franchir, car le sol était
encombré de ronces et de pierres.
Lorsque le capitaine Ellis et
ses compagnons eurent fait halte près du mât, ils virent qu’il était profondément
engagé par le pied dans une excavation rocheuse – ce qui expliquait qu’il eût
pu résister à de longues et rudes tourmentes. Ainsi que cela avait été déjà
reconnu à l’aide de la lunette, ce mât – un bout-dehors de beaupré – provenait
des débris du navire.
Quant au chiffon, cloué à sa
pointe, ce n’était qu’un morceau de toile à voile, effiloché par les brises, sans
aucun indice de nationalité.
Sur l’ordre du capitaine
Ellis, les deux matelots se préparaient à abattre le mât, lorsque Zach Fren
s’écria :
« Capitaine… là… voyez !…
– Cette cloche ! »
Sur un bâti assez solide
encore, il y avait une cloche, dont la poignée de métal était rongée de
rouille. Ainsi les naufragés ne s’étaient pas contentés de dresser ce mât de
signal et d’y attacher ce pavillon. Ils avaient transporté en cet endroit la
cloche du bord, espérant qu’elle pourrait être entendue d’un bâtiment qui
passerait en vue de l’île… Mais cette cloche ne portait-elle pas le nom du
navire auquel elle appartenait, suivant l’usage à peu près commun à toutes les
marines ? Le capitaine Ellis se dirigeait vers le bâti, lorsqu’il
s’arrêta. Au pied de ce bâti gisaient les restes d’un squelette, ou, pour mieux
dire, un amas d’ossements tombés sur le sol, auxquels n’adhéraient plus que
quelques haillons. Ils étaient donc au nombre de cinq les survivants qui avaient
trouvé refuge sur l’île Browse. Quatre étaient morts, et le cinquième était
resté seul… Puis, un jour, il avait quitté la grotte, il s’était traîné jusqu’à
l’extrémité du promontoire, il avait sonné cette cloche, pour se faire entendre
d’un navire au large… et il était tombé à cette place pour ne plus se relever…
Après avoir donné ordre aux deux matelots de creuser une tombe pour y enfermer
ces ossements, le capitaine Ellis fit signe à Zach Fren de le suivre pour
examiner la cloche…
Sur le bronze, il y avait ce
nom et ce chiffre, gravés en creux, très lisibles encore :
FRANKLIN 1875
Tandis que le Dolly-Hope poursuivait
sa seconde campagne à travers la mer de Timor et l’achevait dans les conditions
que l’on sait, Mrs. Branican, ses amis, les familles de l’équipage disparu, avaient
passé par toutes les angoisses de l’attente. Que d’espérances s’étaient
rattachées à ce morceau de bois recueilli par le Californian et qui
appartenait sans conteste au Franklin ! Le capitaine Ellis
parviendrait-il à découvrir les débris du navire sur une des îles de cette mer
ou sur quelque point du littoral australien ? Retrouverait-il John
Branican, Harry Felton, les douze matelots embarqués sous leurs ordres ?
Ramènerait-il enfin à San-Diégo un ou plusieurs des survivants de cette catastrophe ?
Deux lettres du capitaine
Ellis étaient arrivées depuis le départ du Dolly-Hope. La première
faisait connaître l’inutile résultat de l’exploration parmi les passes du
détroit de Torrès et jusqu’à l’extrémité de la mer d’Arafoura. La seconde
apprenait que les îles Melville et Bathurst avaient été visitées, sans qu’on
eût trouvé trace du Franklin. Ainsi Mrs. Branican était avisée que les
recherches allaient être portées, en suivant la mer de Timor, jusqu’à la partie
occidentale de l’Australie, au milieu des divers archipels qui confinent à la
Terre de Tasman. Le Dolly-Hope reviendrait alors, après avoir fouillé
les petites îles de la Sonde, et lorsqu’il aurait perdu tout espoir de
recueillir un dernier indice.
À la suite de cette dernière
lettre, les correspondances avaient été interrompues. Plusieurs mois
s’écoulèrent, et maintenant on attendait d’un jour à l’autre que le Dolly-Hope
fût signalé par les sémaphores de San-Diégo.
Cependant l’année 1882 avait
pris fin, et, bien que Mrs. Branican n’eût plus reçu de nouvelles du capitaine
Ellis, il n’y avait pas lieu d’en être surpris ; les communications
postales sont lentes et irrégulières à travers l’océan Pacifique. En fait, on
n’avait aucune raison d’être inquiet sur le compte du Dolly-Hope, tout
en étant impatient de le revoir.
Fin février, pourtant, M. William
Andrew commençait à trouver que l’expédition du Dolly-Hope se
prolongeait outre mesure. Chaque jour, un certain nombre de personnes se rendaient
à la pointe Island, dans l’espoir que le navire serait aperçu au large. D’aussi
loin qu’il se montrerait, et sans qu’il eût besoin d’envoyer son numéro, les
marins de San-Diégo sauraient le reconnaître rien qu’à son allure – comme on
reconnaît un Français d’un Allemand, et même un Anglais d’un Américain.
Le Dolly-Hope apparut
enfin dans la matinée du 27 mars, à neuf milles au large, marchant à toute
vapeur, sous une fraîche brise de nord-ouest. Avant une heure, il aurait
franchi le goulet et pris son poste de mouillage à l’intérieur de la baie de
San-Diégo.
Ce bruit s’étant répandu à
travers la ville, la population se massa partie sur les quais, partie à la
pointe Island et à la pointe Loma.
Mrs. Branican, M. William
Andrew, joints à quelques amis, ayant hâte d’entrer en communication avec le Dolly
Hope, s’embarquèrent sur un remorqueur pour se porter au-devant de lui. La
foule était dominée par on ne sait quelle inquiétude, et, lorsque le remorqueur
rangea le dernier wharf pour sortir du port, il n’y eut pas un cri. Il semblait
que si le capitaine Ellis eût réussi dans cette seconde campagne, la nouvelle
en aurait déjà dû courir le monde entier.
Vingt minutes plus tard, Mrs.
Branican, M. William Andrew et leurs compagnons accostaient le Dolly-Hope.
Encore quelques instants, et
chacun connaissait le résultat de l’expédition. C’était à la limite ouest de la
mer de Timor, sur l’île Browse, que s’était perdu le Franklin… C’était
là qu’avaient trouvé refuge les survivants du naufrage… C’est là qu’ils étaient
morts !
« Tous ?… dit Mrs.
Branican.
– Tous ! » répondit
le capitaine Ellis.
La consternation était
générale, lorsque le Dolly-Hope vint mouiller au milieu de la baie, son
pavillon en berne, signe de deuil – le deuil des naufragés du Franklin. Le
Dolly-Hope, parti de San-Diégo le 3 avril 1882, y revenait le 27 mars
1883. Sa campagne avait duré près de douze mois – campagne au cours de laquelle
les dévouements ne fléchirent jamais. Mais elle n’avait eu d’autre résultat que
de détruire jusqu’aux dernières espérances. Pendant les quelques instants que
Mrs. Branican et M. William Andrew étaient restés à bord, le capitaine
Ellis avait pu sommairement leur faire connaître les faits relatifs au naufrage
du Franklin sur les récifs de l’île Browse. Bien qu’elle eût appris
qu’il n’existait aucun doute à l’égard du capitaine John et de ses compagnons, Mrs.
Branican n’avait rien perdu de son attitude habituelle. Pas une larme ne
s’était échappée de ses yeux. Elle n’avait articulé aucune question. Puisque
les débris du Franklin avaient été retrouvés sur cette île, puisqu’il ne
restait plus un seul des naufragés qui s’y étaient réfugiés, qu’aurait-elle eu
à demander de plus en ce moment ? Le récit de l’expédition, on le lui
communiquerait plus tard. Aussi, après avoir tendu la main au capitaine Ellis
et à Zach Fren, elle était allée s’asseoir à l’arrière du Dolly-Hope, concentrée
en elle-même et, malgré tant de preuves irréfragables, ne se résignant pas à
désespérer encore, « ne se sentant pas veuve de John Branican » !
Aussitôt que le Dolly-Hope
eut jeté l’ancre dans la baie, Dolly revenant sur l’avant de la dunette, pria
M. William Andrew, le capitaine Ellis et Zach Fren, de vouloir bien se
rendre le jour même à Prospect-House. Elle les attendrait dans l’après-midi, afin
d’apprendre par le détail tout ce qui avait été tenté pendant cette exploration
à travers le détroit de Torrès, la mer d’Arafoura et la mer de Timor.
Une embarcation mit à terre
Mrs. Branican. La foule s’écarta respectueusement, tandis qu’elle traversait le
quai, et elle se dirigea vers le haut quartier de San-Diégo.
Un peu avant trois heures, le
même jour, M. William Andrew, le capitaine Ellis et le maître se présentèrent
au chalet, où ils furent immédiatement reçus, puis introduits dans le salon du
rez-de-chaussée, où se trouvait Mrs. Branican.
Lorsqu’ils eurent pris place
autour d’une table, sur laquelle était déployée une carte des mers de
l’Australie septentrionale :
« Capitaine Ellis, dit
Dolly, voulez-vous me faire le récit de votre campagne ? »
Et alors, le capitaine Ellis
parla comme s’il avait eu sous les yeux son livre de bord, n’omettant aucune
particularité, n’oubliant aucun incident, s’adressant quelquefois à Zach Fren
pour confirmer son dire. Il raconta même par le menu les explorations opérées
dans le détroit de Torrès, dans la mer d’Arafoura, aux îles Melville et
Bathurst, entre les archipels de la Terre de Tasman, bien que ce fût au moins
inutile. Mais Mrs. Branican y prenait intérêt, écoutant en silence, et fixant
sur le capitaine un regard que ses paupières ne voilèrent pas un seul instant.
Lorsque le récit fut arrivé
aux épisodes de l’île Browse, il dut relater heure par heure, minute par minute,
tout ce qui s’était passé depuis que le Dolly-Hope avait aperçu le mât
de signal dressé sur le promontoire. Mrs. Branican, toujours immobile, avec un
léger tremblement des mains, revoyait en son imagination ces divers incidents
comme s’ils eussent été reproduits devant ses yeux : le débarquement du
capitaine Ellis et de ses hommes à l’embouchure du creek, l’ascension du morne,
la lame de coutelas ramassée sur le sol, les traces de culture, la pioche
abandonnée, la grève où s’étaient accumulés les débris du naufrage, les restes
informes du Franklin parmi cet amoncellement de roches, où il n’avait pu
être jeté que par la plus violente des tempêtes, la grotte que les survivants
avaient habitée, la découverte des quatre tombes, le squelette du dernier de
ces malheureux, au pied du mât de signal, près de la cloche d’alarme… À ce
moment, Dolly se releva, comme si elle eût entendu les sons de cette cloche au
milieu des solitudes de Prospect-House…
Le capitaine Ellis, tirant de
sa poche un médaillon, terni par l’humidité, le lui présenta.
C’était le portrait de Dolly
– un médaillon photographique à demi effacé qu’elle avait remis à John au
départ du Franklin, et que des recherches subséquentes avaient fait
retrouver dans un coin obscur de la grotte.
Et, si ce médaillon
témoignait que le capitaine John était au nombre des cinq naufragés ayant
trouvé refuge sur l’île, n’en fallait-il pas conclure qu’il était de ceux qui
avaient succombé aux longues misères du dénuement et de l’abandon ?…
La carte des mers
australiennes était déployée sur la table – cette carte devant laquelle, pendant
sept ans, Dolly avait tant de fois évoqué le souvenir de John. Elle demanda au
capitaine de lui montrer l’île Browse, ce point à peine perceptible, perdu dans
les parages que battent les typhons de l’océan Indien.
« Et, en y arrivant
quelques années plus tôt, ajouta le capitaine Ellis, peut-être eût-on trouvé
encore vivants… John… ses compagnons…
– Oui, peut-être, murmura M. William
Andrew, et c’était là qu’il eût fallu conduire le Dolly-Hope à sa
première campagne !… Mais qui aurait jamais pensé que le Franklin fût
allé se perdre sur une île de l’océan Indien ?…
– On ne le pouvait pas, répondit
le capitaine Ellis, d’après la route qu’il devait suivre, et qu’il a effectivement
suivie, puisque le Franklin a été vu au sud de l’île Célèbes !… Le
capitaine John, n’étant plus maître de son bâtiment, aura été entraîné à
travers les détroits de la Sonde dans la mer de Timor et poussé jusqu’à l’île
Browse ?
– Oui, et il n’est pas
douteux que les choses se soient passées ainsi ! répondit Zach Fren.
– Capitaine Ellis, dit alors
Mrs. Branican, en cherchant le Franklin dans les mers de la Malaisie, vous
avez agi comme vous deviez agir… Mais c’est à l’île Browse qu’il aurait fallu
aller d’abord !… Oui !… c’était là ! »
Puis, prenant part à la
conversation, et voulant en quelque sorte appuyer sur des chiffres certains sa
ténacité à conserver une dernière lueur d’espoir :
« À bord du Franklin,
dit-elle, il y avait le capitaine John, le second, Harry Felton, et douze
matelots. Vous avez retrouvé sur l’île les restes des quatre hommes, qui
avaient été enterrés, et le dernier mort au pied du mât de signal. Que
pensez-vous que soient devenus les neuf autres ?
– Nous l’ignorons, répondit
le capitaine Ellis.
– Je le sais, reprit Mrs.
Branican, en insistant, mais je vous demande : Que pensez-vous qu’ils aient
pu devenir ?
– Peut-être ont-ils péri
pendant que le Franklin se fracassait sur les récifs de l’île.
– Vous admettez donc qu’ils
n’ont été que cinq à survivre au naufrage ?…
– C’est malheureusement
l’explication la plus plausible ! ajouta M. William Andrew.
– Ce n’est pas mon avis, répondit
Mrs. Branican. Pourquoi John, Felton et les douze hommes de l’équipage
n’auraient-ils pas atteint l’île Browse sains et saufs ?… Pourquoi neuf
d’entre eux ne seraient-ils pas parvenus à la quitter ?…
– Et comment, mistress
Branican ? répondit vivement le capitaine Ellis.
– Mais en s’embarquant sur
une chaloupe construite avec les débris de leur navire…
– Mistress Branican, reprit
le capitaine Ellis, Zach Fren vous l’affirmera aussi bien que moi, dans l’état
où étaient ces débris, il nous a paru que c’était impossible !
– Mais… un de leurs canots…
– Les canots du Franklin, en
admettant qu’ils n’eussent pas été brisés, n’auraient pu s’aventurer dans une
traversée jusqu’à la côte australienne ou aux îles de la Sonde.
– Et, d’ailleurs, fit
observer M. William Andrew, si neuf des naufragés ont pu quitter l’île, pourquoi
les cinq autres y seraient-ils restés ?
– J’ajoute, reprit le
capitaine Ellis, que, s’ils ont eu une embarcation quelconque à leur
disposition, ceux qui sont partis ont péri en mer, ou ils ont été victimes des
indigènes australiens, puisqu’ils n’ont jamais reparu ! »
Alors Mrs. Branican, sans
laisser voir aucun signe de faiblesse, s’adressant au maître :
« Zach Fren, dit-elle, vous
pensez de tout cela ce qu’en pense le capitaine Ellis ?
– Je pense… répondit Zach
Fren en secouant la tête, je pense que, si les choses ont pu être ainsi… il est
très possible qu’elles aient pu être autrement !
– Aussi, répondit Mrs.
Branican, mon avis est-il que nous n’avons pas de certitude absolue sur ce que
sont devenus les neuf hommes dont on n’a pas retrouvé les restes sur l’île.
Quant à vous et à votre équipage, capitaine Ellis, vous avez fait tout ce qu’on
pouvait demander au plus intrépide dévouement.
– J’aurais voulu mieux
réussir, mistress Branican !
– Nous allons nous retirer, ma
chère Dolly, dit M. William Andrew, estimant que cet entretien avait assez
duré.
– Oui, mon ami, répondit Mrs.
Branican. J’ai besoin d’être seule… Mais, toutes les fois que le capitaine
Ellis voudra venir à Prospect-House, je serai heureuse de reparler avec lui de
John, de ses compagnons…
– Je serai toujours à votre
disposition, mistress Branican, répondit le capitaine.
– Et vous aussi, Zach Fren, ajouta
Mrs. Branican, n’oubliez pas que ma maison est la vôtre.
– La mienne ?… répondit
le maître. Mais que deviendra le Dolly-Hope ?…
– Le Dolly-Hope ? dit Mrs. Branican, comme
si cette demande lui eut paru inutile.
– Votre avis n’est-il pas, ma
chère Dolly, fit observer M. William Andrew, que, s’il se présente une
occasion de le vendre…
– Le vendre, répondit
vivement Mrs. Branican, le vendre ?… Non, monsieur Andrew, jamais ! »
Mrs. Branican et Zach Fren
avaient échangé un regard ; tous deux s’étaient compris.
À partir de ce jour, Dolly
vécut très retirée à Prospect-House, où elle avait ordonné de transporter les
quelques objets recueillis sur l’île Browse, les ustensiles dont s’étaient
servis les naufragés, la lampe de bord, le morceau de toile cloué en tête du
mât de signal, la cloche du Franklin, etc.
Quant au Dolly-Hope, après
avoir été reconduit au fond du port et désarmé, il fut confié à la garde de
Zach Fren. Les hommes de l’équipage, généreusement récompensés, avaient désormais
leur existence à l’abri du besoin. Mais, si jamais le Dolly-Hope devait
reprendre la mer pour une nouvelle expédition, on pouvait compter sur eux.
Toutefois Zach Fren ne
laissait pas de venir fréquemment à Prospect-House. Mrs. Branican se plaisait à
le voir, à causer avec lui, à reprendre par le détail les divers incidents de
sa dernière campagne. D’ailleurs, une même manière d’envisager les choses les
rapprochait chaque jour davantage l’un de l’autre. Ils ne croyaient pas que le
dernier mot eût été dit sur la catastrophe du Franklin, et Dolly
répétait au maître :
« Zach Fren, ni John ni
ses huit compagnons ne sont morts !
– Les huit ?… je ne sais
pas, répondait invariablement le maître. Mais, pour sûr, le capitaine John est
vivant !
– Oui !… vivant !…
Et où l’aller chercher, Zach Fren ?… Où est-il, mon pauvre John ?
– Il est où il est, et bien
certainement quelque part, mistress Branican !… Et si nous n’y allons pas,
nous recevrons de ses nouvelles !… Je ne dis pas que ce sera par la poste
avec lettre affranchie… mais nous en recevrons !…
– John est vivant, Zach Fren !
– Sans cela, mistress
Branican, est-ce que j’aurais jamais pu vous sauver ?… Est-ce que Dieu
l’aurait permis ?… Non… Cela aurait été trop mal de sa part ! »
Et Zach Fren, avec sa façon
de dire les choses, Mrs. Branican, avec l’obstination qu’elle y apportait, s’entendaient
pour garder un espoir que ni M. William Andrew, ni le capitaine Ellis, ni
personne de leurs amis, ne pouvaient plus conserver.
Durant l’année 1883, il ne
survint aucun incident de nature à ramener l’attention publique sur l’affaire
du Franklin. Le capitaine Ellis, pourvu d’un commandement pour le compte
de la maison Andrew, avait repris la mer. M. William Andrew et Zach Fren
étaient les seuls visiteurs qui fussent reçus au chalet. Quant à Mrs. Branican,
elle se donnait tout entière à l’œuvre de Wat-House pour les enfants
abandonnés.
Maintenant, une cinquantaine
de pauvres êtres, les uns tout petits, les autres déjà grandelets, étaient
élevés dans cet hospice, où Mrs. Branican les visitait chaque jour, s’occupant
de leur santé, de leur instruction et aussi de leur avenir. La somme
considérable affectée à l’entretien de Wat-House permettait de les rendre
heureux autant que peuvent l’être des enfants sans père ni mère. Lorsqu’ils
étaient arrivés à l’âge où l’on entre en apprentissage, Dolly les plaçait dans
les ateliers, les maisons de commerce et les chantiers de San-Diégo, où elle
continuait de veiller sur eux. Cette année-là, trois ou quatre fils de marins purent
même s’embarquer sous le commandement d’honnêtes capitaines dont on était sûr.
Partis mousses, ils passeraient novices entre treize et dix-huit ans, puis
matelots, puis maîtres, assurés ainsi d’un bon métier pour leur âge mûr et
d’une retraite pour leurs vieux jours. Et cela fut constaté par la suite, l’hospice
de Wat-House était destiné à constituer la pépinière de ces marins qui font
honneur à la population de San-Diégo et autres ports de la Californie.
En outre de ces occupations, Mrs.
Branican ne cessait d’être la bienfaitrice des pauvres gens. Pas un ne frappait
en vain à la porte de Prospect-House. Avec les revenus considérables de sa
fortune, administrée par les soins de M. William Andrew, elle concourait à
toutes ces bonnes œuvres, dont les familles des matelots du Franklin avaient
la plus importante part. Et, de ces absents, n’espérait-elle pas que
quelques-uns reviendraient un jour ?
C’était l’unique sujet de ses
entretiens avec Zach Fren. Quel avait été le sort des naufragés dont on n’avait
point retrouvé trace sur l’île Browse ?… Pourquoi ne l’auraient-ils pas
quittée sur une embarcation construite par eux, quoi qu’en eût dit le capitaine
Ellis ?… Il est vrai, tant d’années s’étaient écoulées déjà, que c’était
folie d’espérer encore !
La nuit surtout, au sein d’un
sommeil agité par d’étranges rêves, Dolly voyait et revoyait John lui
apparaître… Il avait été sauvé du naufrage et recueilli dans ces mers
lointaines… Le navire qui le rapatriait était au large… John était de retour à
San-Diégo… Et, ce qu’il y avait de plus extraordinaire, c’est que ces illusions,
après le réveil, persistaient avec une intensité telle que Dolly s’y attachait
comme à des réalités.
Et c’est bien à cela aussi
que s’obstinait Zach Fren. À l’en croire, ces idées-là étaient forcées à coups
de maillet dans son cerveau comme des gournables dans la membrure d’un navire !
Lui aussi se répétait qu’on n’avait retrouvé que cinq naufragés sur quatorze, que
ceux-ci avaient pu quitter l’île Browse, qu’on errait en affirmant qu’il eût
été impossible de construire une embarcation avec les débris du Franklin. Il
est vrai, on ignorait ce qu’ils étaient devenus depuis si longtemps ? Mais
Zach Fren n’y voulait pas songer, et ce n’était pas sans effroi que M. William
Andrew le voyait entretenir Dolly dans ces illusions. N’y avait-il pas lieu de
craindre que cette surexcitation devînt dangereuse pour un cerveau que la folie
avait déjà frappé ?… Mais, lorsque M. William Andrew voulait
entreprendre le maître à ce sujet, celui-ci s’entêtait dans ses idées et
répondait :
« Je n’en démordrai pas
plus qu’une maîtresse ancre, quand ses pattes sont solides et que la tenue est
bonne ! »
Plusieurs années
s’écoulèrent. En 1890, il y avait quatorze ans que le capitaine John Branican
et les hommes du Franklin avaient quitté le port de San-Diégo. Mrs.
Branican était alors âgée de trente-sept ans. Si ses cheveux commençaient à blanchir,
si la chaude coloration de son teint se faisait plus mate, ses yeux étaient
toujours animés du même feu qu’autrefois. Il ne semblait pas qu’elle eût rien
perdu de ses forces physiques et morales, rien perdu de cette énergie qui la
caractérisait, et dont elle n’attendait qu’une occasion pour donner de
nouvelles preuves.
Que ne pouvait-elle, à
l’exemple de lady Franklin, organiser expéditions sur expéditions, dépenser sa
fortune entière pour retrouver les traces de John et de ses compagnons ?
Mais où les aller chercher ?… L’opinion générale n’était-elle pas que ce
drame maritime avait eut le même dénouement que l’expédition de l’illustre
amiral anglais ?… Les marins du Franklin n’avaient-ils pas succombé dans
les parages de l’île Browse, comme les marins de l’Erebus et du Terror
avaient péri au milieu des glaces des mers arctiques ?…
Pendant ces longues années, qui
n’avaient apporté aucun éclaircissement à cette mystérieuse catastrophe, Mrs.
Branican n’avait pas cessé de s’enquérir de ce qui concernait Len et Jane
Burker. De ce côté, aussi, défaut absolu de renseignements. Aucune lettre
n’était parvenue à San-Diégo. Tout portait à croire que Len Burker avait quitté
l’Amérique, et était allé s’établir sous un nom d’emprunt en quelque pays
éloigné. C’était pour Mrs. Branican un très vif chagrin ajouté à tant d’autres.
Cette malheureuse femme qu’elle affectionnait, quel bonheur elle aurait éprouvé
à l’avoir près d’elle !… Jane eût été une compagne dévouée… Mais elle
était loin, et non moins perdue pour Dolly que l’était le capitaine John !
Les six premiers mois de
l’année 1890 avaient pris fin, lorsqu’un journal de San-Diégo reproduisit, dans
son numéro du 26 juillet, une nouvelle dont l’effet devait être et fut immense,
on peut dire, dans les deux continents.
Cette nouvelle était donnée
d’après le récit d’un journal australien, le Morning-Herald de Sydney, et
voici en quels termes :
« On se souvient que les
dernières recherches faites, il y a sept ans, par le Dolly-Hope, dans le
but de retrouver les survivants du Franklin, n’ont pas abouti. On devait
croire que les naufragés avaient tous succombé, soit avant d’avoir atteint
l’île Browse, soit après l’avoir quittée.
« Or, la question est loin
d’être résolue.
« En effet, l’un des
officiers du Franklin vient d’arriver à Sydney. C’est Harry Felton, le
second du capitaine John Branican. Rencontré sur les bords du Parru, un des
affluents du Darling, presque sur la limite de la Nouvelle-Galles du Sud et du
Queensland, il a été ramené à Sydney. Mais son état de faiblesse est tel qu’on
n’a pu tirer aucun renseignement de lui, et il est à craindre que la mort
l’emporte d’un jour à l’autre.
« Avis de cette
communication est donné aux intéressés dans la catastrophe du Franklin. »
Le 27 juillet, dès que M. William
Andrew eut connaissance de cette note, qui arriva par le télégraphe à San-Diégo,
il se rendit à Prospect-House, où Zach Fren se trouvait en ce moment.
Mrs. Branican fut aussitôt
mise au courant, et sa seule réponse fut celle-ci :
« Je pars pour Sydney.
– Pour Sydney ?… dit M. William
Andrew.
– Oui… » répondit Dolly.
Et se retournant vers le maître :
« M’accompagnerez-vous, Zach
Fren ?
– Partout où vous irez, mistress
Branican.
– Le Dolly-Hope est-il
en état de prendre la mer ?
– Non, répondit M. William
Andrew, et il faudrait trois semaines pour l’armer…
– Avant trois semaines, il
faut que je sois à Sydney ! dit Mrs. Branican. Y a-t-il un paquebot en partance
pour l’Australie ?…
– L’Orégon quittera
San-Francisco cette nuit même.
– Zach Fren et moi, nous
serons ce soir à San Francisco.
– Ma chère Dolly, dit M. William
Andrew, que Dieu vous réunisse à votre John !…
– Il nous réunira ! »
répondit Mrs. Branican.
Ce soir-là, vers onze heures,
un train spécial, qui avait été organisé sur sa demande, déposait Mrs. Branican
et Zach Fren dans la capitale de la Californie.
À une heure du matin, l’Orégon
quittait San-Francisco à destination de Sydney.
Le steamer Orégon avait
marché à une vitesse moyenne de dix-sept nœuds pendant cette navigation, qui
fut favorisée par un temps superbe – temps normal d’ailleurs dans cette partie
du Pacifique et à cette époque de l’année. Ce brave navire partageait
l’impatience de Mrs. Branican, à ce que répétait volontiers Zach Fren. Il va
sans dire que les officiers, les passagers, l’équipage, témoignaient à cette
vaillante femme la respectueuse sympathie, dont ses malheurs et l’énergie avec
laquelle elle les supportait, la rendaient si digne.
Lorsque l’Orégon se
trouva par 33°51’ de latitude sud et 148°40’ de longitude est, les vigies
signalèrent la terre. Le 15 août, après une traversée de sept mille milles, accomplie
en dix-neuf jours, le steamer pénétrait dans la baie de Port-Jackson, entre ces
hautes falaises schisteuses qui forment comme une porte grandiose, ouverte sur
le Pacifique.
Laissant à droite et à gauche
ces petits golfes, semés de villas et de cottages, portant les noms de Watson, Vaucluse,
Rose, Double, Elisabeth, l’Orégon passa devant Earme-Love, Sydney-Love, et
vint dans Darling-Harbour, qui est le port même de Sydney, s’amarrer au quai de
débarquement.
À la première personne qui se
présenta à bord – c’était un des agents de la douane – Mrs. Branican demanda :
« Harry Felton ?…
– Il est vivant », lui
répondit cet agent, qui avait reconnu Mrs. Branican.
Tout Sydney ne savait-il pas
qu’elle s’était embarquée sur l’Orégon, et n’était-elle pas attendue
avec la plus vive impatience ?
« Où est Harry Felton ?
ajouta-t-elle.
– À l’hôpital de la Marine. »
Mrs. Branican, suivie de Zach
Fren, débarqua aussitôt. La foule l’accueillit avec cette déférence qui
l’accueillait à San-Diégo, et qu’elle eût trouvée partout. Une voiture les
conduisit à l’hôpital de la Marine, où ils furent reçus par le médecin de service.
« Harry Felton a-t-il pu
parler ?… A-t-il sa connaissance ?… demanda Mrs. Branican.
– Non, mistress, répondit le
médecin. Cet infortuné n’est pas revenu à lui… Il semble qu’il ne puisse parler…
La mort peut l’emporter d’une heure à l’autre !
– Il ne faut pas que Harry
Felton meure ! dit Mrs. Branican. Lui seul sait si le capitaine John, si
quelques-uns de ses compagnons, vivent encore !… Lui seul peut dire où ils
sont !… Je suis venue pour voir Harry Felton… pour l’entendre…
– Mistress, je vous conduis
sur-le-champ près de lui », répondit le médecin. Quelques instants après, Mrs.
Branican et Zach Fren étaient introduits dans la chambre occupée par Harry Felton.
Six semaines auparavant, des voyageurs traversaient la province d’Ulakarara, dans
la Nouvelle-Galles du Sud, à la limite inférieure du Queensland. Arrivés sur la
rive gauche du Parm, ils aperçurent un homme qui gisait au pied d’un arbre.
Couvert de vêtements en lambeaux, épuisé par les privations, brisé par la fatigue,
cet homme ne put reprendre connaissance, et, si son engagement d’officier de la
marine marchande n’eût été trouvé dans l’une de ses poches, on n’aurait jamais
su qui il était.
C’était Harry Felton, le
second du Franklin.
D’où arrivait-il ? De
quelle partie lointaine et inconnue du continent australien était-il parti ?
Depuis combien de temps errait-il à travers ces redoutables solitudes des
déserts du centre ? Avait-il été prisonnier des indigènes, et était-il parvenu
à leur échapper ? Ses compagnons, s’il lui en restait, où les avait-il
laissés ? À moins, cependant, qu’il ne fût le seul survivant de ce
désastre, vieux de quatorze ans déjà ?… Toutes ces questions étaient
demeurées sans réponse jusqu’alors.
Il y avait pourtant un
intérêt considérable à savoir d’où venait Harry Felton, à connaître son existence
depuis le naufrage du Franklin sur les récifs de l’île Browse, à savoir
enfin le dernier mot de cette catastrophe.
Harry Felton fut conduit à la
station la plus proche, la station d’Oxley, d’où le railway le transporta à
Sydney. Le Morning-Herald, informé, avant tout autre journal, de son
arrivée dans la capitale de l’Australie, en fit l’objet de l’article que l’on
connaît, en ajoutant que le lieutenant du Franklin n’avait encore pu
répondre à aucune des questions qui lui avaient été adressées.
Et maintenant, Mrs. Branican
était devant Harry Felton, qu’elle n’aurait pu reconnaître. Il n’était âgé que
de quarante-six ans alors, et on lui en eût donné soixante. Et c’était le seul
homme – presque un cadavre – qui fût à même de dire ce qu’il en était du
capitaine John et de son équipage !
Jusqu’à ce jour, les soins
les plus assidus n’avaient en rien amélioré l’état d’Harry Felton – état évidemment
dû aux épouvantables fatigues subies pendant les semaines, qui sait même ?
les mois qu’avait duré son voyage à travers l’Australie centrale. Ce souffle de
vie qui lui restait, une syncope pouvait l’éteindre d’un instant à l’autre.
Depuis qu’il était dans cet hospice, c’est à peine s’il avait ouvert les yeux, sans
qu’on eût pu savoir s’il se rendait compte de ce qui se passait autour de lui.
On le soutenait d’un peu de nourriture, et il ne semblait même pas s’en
apercevoir. Il était à craindre que des souffrances excessives n’eussent
annihilé ses facultés intellectuelles, détruit en lui le fonctionnement de sa
mémoire, auquel se rattachait peut-être le salut des naufragés.
Mrs. Branican avait pris
place au chevet d’Harry Felton, guettant son regard, lorsque ses paupières
s’agitaient, les murmures de sa voix, le moindre indice qu’il serait possible
de saisir, un mot échappé à ses lèvres. Zach Fren, debout près d’elle, cherchait
à surprendre quelque lueur d’intelligence, comme un marin cherche un feu à
travers les brumes de l’horizon.
Mais la lueur ne brilla ni ce
jour-là ni les jours suivants. Les paupières d’Harry Felton demeuraient
obstinément closes, et, lorsque Dolly les soulevait, elle n’y trouvait qu’un
regard inconscient.
Elle ne désespérait pas, cependant,
Zach Fren non plus, et il lui répondait :
« Si Harry Felton
reconnaît la femme de son capitaine, il saura bien se faire comprendre, et cela
sans parler ! »
Oui ! il était important
qu’il reconnût Mrs. Branican, et possible qu’il en éprouvât une impression salutaire ?
On agirait alors avec une extrême prudence, tandis qu’il s’accoutumerait à la
présence de Dolly. Peu à peu, les souvenirs du Franklin se rétabliraient
dans sa mémoire… Il saurait exprimer par signe ce qu’il ne pourrait dire…
Bien qu’on eût conseillé à
Mrs. Branican de ne pas rester enfermée dans la chambre d’Harry Felton, elle
refusa de prendre même une heure de repos pour aller respirer l’air du dehors.
Elle ne voulut pas abandonner le chevet de ce lit.
« Harry Felton peut
mourir, et, si le seul mot que j’attends de lui s’échappe avec son dernier
souffle, il faut que je sois là pour l’entendre… Je ne le quitterai pas ! »
Vers le soir, une légère
amélioration sembla se manifester dans l’état d’Harry Felton. Ses yeux
s’ouvrirent plusieurs fois ; mais leur regard ne s’adressait pas à Mrs.
Branican. Et pourtant, penchée sur lui, elle l’appelait par son nom, elle
répétait le nom de John… le capitaine du Franklin… de San-Diégo !…
Comment ces noms ne lui rappelaient-ils pas le souvenir de ses compagnons ?…
Un mot… on ne lui demandait qu’un mot : « Vivants ?… Étaient-ils
vivants ? »
Et, tout ce qu’Harry Felton
avait eu à souffrir pour en arriver là, Dolly se disait que John devait l’avoir
souffert aussi… Puis la pensée lui venait que John était tombé sur la route…
Mais non… John n’avait pu suivre Harry Felton… Il était resté là-bas… avec les
autres… Où ?… Était-ce chez une tribu du littoral australien ?…
Quelle était cette tribu ?… Harry Felton pouvait seul le dire, et il
semblait que son intelligence était anéantie, que ses lèvres avaient désappris
de parler !
La nuit, la faiblesse d’Harry
Felton augmenta. Ses yeux ne se rouvraient plus, sa main se refroidissait, comme
si le peu de vie qui lui restait se fût retiré vers le cœur. Allait-il donc
mourir sans avoir prononcé une parole ?… Et il passait par l’esprit de
Dolly qu’elle aussi avait perdu le souvenir et la raison pendant bien des
années !… De même qu’on ne pouvait rien obtenir d’elle alors, elle ne
pouvait rien obtenir de ce malheureux… rien de ce qu’il était seul à savoir !
Le jour venu, le médecin, très
inquiet de l’état de prostration de Harry Felton, essaya des plus énergiques
médications, qui ne produisirent aucun effet. Il ne tarderait pas à expirer…
Ainsi, Mrs. Branican allait
voir rentrer dans le néant les espérances que le retour de Harry Felton avait
permis de concevoir !… À la lumière qu’il aurait pu apporter succéderait
une obscurité profonde, qu’on ne parviendrait plus à dissiper !… Et alors,
tout serait fini, bien fini !…
Sur la demande de Dolly, les
principaux médecins de la ville s’étaient réunis en consultation. Mais, après
avoir examiné le malade, ils se déclarèrent impuissants.
« Vous ne pouvez quoi
que ce soit pour ce malheureux ? leur demanda Mrs. Branican.
– Non, madame, répondit l’un
des médecins.
– Pas même lui redonner une
minute d’intelligence… une minute de souvenir ?… »
Et, cette minute, Mrs.
Branican l’eût payée de sa fortune tout entière ! Mais ce qui n’est plus
au pouvoir des hommes est toujours au pouvoir de Dieu. C’est à lui que l’homme
doit s’adresser, lorsque les ressources humaines font défaut.
Dès que les médecins se
furent retirés, Dolly s’agenouilla, et, quand Zach Fren vint la rejoindre, il
la trouva en prière près du mourant.
Soudain, Zach Fren, qui
s’était rapproché pour s’assurer si un souffle s’échappait encore des lèvres de
Harry Felton, s’écria :
« Mistress !…
mistress ! »
Dolly, croyant que le maître
n’avait plus trouvé qu’un cadavre dans ce lit, se releva…
« Mort ?…
murmura-t-elle.
– Non… mistress… non !…
Voyez… Ses yeux sont ouverts… Il regarde… »
En effet, sous ses paupières
soulevées, les yeux d’Harry Felton brillaient d’un éclat extraordinaire. Sa
figure s’était colorée légèrement, et ses mains s’agitèrent à plusieurs
reprises. Il parut sortir de cette torpeur dans laquelle il était depuis si longtemps
plongé. Puis, son regard s’étant porté vers Mrs. Branican, une sorte de sourire
anima ses lèvres.
« Il m’a reconnue !
s’écria Dolly.
– Oui !… répondit Zach
Fren… C’est la femme de son capitaine qui est près de lui, il le sait… il va
parler !…
– Et, s’il ne le peut, que
Dieu permette qu’il se fasse du moins comprendre ! »
Alors, prenant la main de
Harry Felton qui pressa faiblement la sienne, Dolly s’approcha près de lui.
« John ?… John ?
… » dit-elle.
Un mouvement des yeux indiqua
que Harry Felton l’avait entendue et comprise.
« Vivant ?…
demanda-t-elle.
– Oui ! »
Et ce oui ! si
faiblement qu’il eût été prononcé, Dolly avait bien su l’entendre !
Mrs. Branican fit aussitôt
appeler le médecin. Celui-ci, malgré le changement qui s’était produit dans
l’état intellectuel de Harry Felton, comprit qu’il n’y avait là qu’une dernière
manifestation de la vie, que la mort allait anéantir.
Le mourant, d’ailleurs, ne
semblait voir que Mrs. Branican. Ni Zach Fren ni le médecin n’attiraient son
attention. Ce qui lui restait de force intellectuelle se concentrait en entier
sur la femme de son capitaine, de John Branican.
« Harry Felton, demanda
Mrs. Branican, si John est vivant, où l’avez-vous laissé ?… Où est-il ? »
Harry Felton ne répondit pas.
« Il ne peut parler, dit
le médecin, mais peut-être aurons-nous de lui une réponse par signes ?…
– Et rien qu’à son regard, je
saurai interpréter ! répondit Mrs. Branican.
– Attendez, dit Zach Fren. Il
importe que les questions lui soient posées d’une certaine manière, et, comme
nous nous entendons entre marins, laissez-moi faire. Que mistress Branican
tienne la main de Felton, que ses yeux ne quittent pas les siens. Je vais
l’interroger… Il dira oui ou non du regard, et cela suffira ! »
Mrs. Branican, penchée sur
Harry Felton, lui prit la main.
Si Zach Fren eut, pour
commencer, demandé où se trouvait le capitaine John, il aurait été impossible
d’obtenir une indication satisfaisante, puisque c’eût été obliger Harry Felton
à prononcer le nom d’une contrée, d’une province, ou d’une bourgade – ce dont
sans nul doute il était incapable. Mieux valait y arriver graduellement en
reprenant l’histoire du Franklin à partir du dernier jour où il avait
été aperçu jusqu’à celui où Harry Felton s’était séparé de John Branican.
« Felton, dit Zach Fren
d’une voix claire, vous avez près de vous mistress Branican, la femme de John
Branican, le commandant du Franklin. Vous l’avez reconnue ?… »
Les lèvres de Harry Felton ne
remuèrent pas ; mais un mouvement de ses paupières, une faible pression de
sa main, répondirent affirmativement.
« Le Franklin, reprit
Zach Fren, n’a plus été signalé nulle part après qu’on l’eut vu dans le sud de
l’île Célèbes… Vous m’entendez… vous m’entendez, n’est-ce pas, Felton ? »
Nouvelle affirmation du
regard.
« Eh bien, reprit Zach
Fren, écoutez-moi, et, selon que vous ouvrirez ou fermerez les yeux, je saurai
si ce que j’exprime est exact ou ne l’est pas. »
Il n’était pas douteux que
Harry Felton eût compris ce que venait de dire Zach Fren.
« En quittant la mer de
Java, reprit celui-ci, le capitaine John a donc passé dans la mer de Timor ?
– Oui.
– Par le détroit de la Sonde ?…
– Oui.
– Volontairement ?… »
Cette question fut suivie
d’un signe négatif, auquel il n’y avait pas à se tromper.
« Non ! » dit
Zach Fren.
Et c’est bien ce que le
capitaine Ellis et lui avaient toujours pensé. Pour que le Franklin eût
passé de la mer de Java dans la mer de Timor, il fallait qu’il y eût été
contraint.
« C’était pendant une
tempête ?… demanda Zach Fren.
– Oui.
– Une violente tornade, qui
vous a surpris dans la mer de Java, probablement ?…
– Oui.
– Et qui vous a rejetés à
travers le détroit de la Sonde ?…
– Oui.
– Peut-être le Franklin était-il
désemparé, sa mâture en bas, son gouvernail démonté ?…
– Oui. »
Mrs. Branican, les yeux fixés
sur Harry Felton, le regardait sans prononcer une parole. Zach Fren, voulant
reconstituer les diverses phases de la catastrophe, continua en ces termes :
« Le capitaine John, n’ayant
pu faire son point depuis quelques jours, ignorait sa position ?…
– Oui.
– Et, après avoir été
entraîné pendant un certain temps jusque dans l’ouest de la mer de Timor, il
est venu se perdre sur les récifs de l’île Browse ?… »
Un léger mouvement marqua la
surprise de Harry Felton, qui ignorait évidemment le nom de l’île sur laquelle
le Franklin était allé se briser, et dont aucune observation n’avait
permis de déterminer la position dans la mer de Timor.
Zach Fren reprit :
« Quand vous avez pris
la mer à San-Diégo, il y avait à bord le capitaine John, vous, Harry Felton, douze
hommes d’équipage, en tout quatorze… Étiez-vous quatorze, après le naufrage du Franklin ?…
– Non.
– Quelques-uns des hommes
avaient donc péri au moment où le navire se jetait sur les roches ?…
– Oui.
– Un ?… Deux ?… »
Un signe affirmatif approuva
ce dernier chiffre.
Ainsi deux matelots
manquaient lorsque les naufragés avaient pris pied sur l’île Browse. En ce moment,
à la recommandation du médecin, il convint de donner un peu de repos à Harry
Felton, que cet interrogatoire fatiguait visiblement. Puis, les questions ayant
été reprises quelques minutes après, Zach Fren obtint divers renseignements sur
la manière dont le capitaine John, Harry Felton et leurs dix compagnons avaient
pourvu aux besoins de leur existence. Sans une partie de la cargaison, consistant
en conserves et farines, qui avait été recueillie à la côte, sans la pêche qui
devint une de leurs principales ressources, les naufragés seraient morts de
faim. Ils n’avaient vu que très rarement des navires passer au large de l’île.
Leur pavillon, hissé au mât de signal, ne fût jamais aperçu. Et, cependant, ils
n’avaient pas d’autre chance de salut que d’être rapatriés par un bâtiment.
Lorsque Zach Fren demanda :
« Combien de temps
avez-vous habité l’île Browse ?… Un an… deux ans… trois ans… six ans ?… »
Ce fut sur ce dernier chiffre
que Harry Felton répondit « oui » du regard.
Ainsi, de 1875 à 1881, le
capitaine John et ses compagnons avaient vécu sur cette île !
Mais comment étaient-ils
parvenus à la quitter ? C’était là un des points les plus intéressants que
Zach Fren aborda par cette question :
« Est-ce que vous avez
pu construire une embarcation avec les débris du navire ?…
– Non. »
C’est bien ce qu’avaient
admis le capitaine Ellis et le maître, alors qu’ils exploraient le lieu du naufrage :
il n’eût pas été possible de tirer seulement un canot avec ces débris. Arrivé à
ce point de l’interrogatoire, Zach Fren fut assez embarrassé pour les questions
relatives à la manière dont les naufragés avaient réussi à abandonner l’île
Browse.
« Vous dites, demanda-t-il,
qu’aucun bâtiment n’a aperçu vos signaux…
– Non.
– Est-ce donc un prao des
îles malaisiennes, une embarcation des indigènes de l’Australie, qui est venu
aborder ?…
– Non.
– Alors ce serait donc une
chaloupe – la chaloupe d’un navire – qui a été entraînée sur l’île ?…
– Oui.
– Une chaloupe en dérive ?…
– Oui. »
Ce point étant enfin éclairci,
il fut facile à Zach Fren d’en déduire les conséquences naturelles.
« Cette chaloupe, vous
avez pu la mettre en état de prendre la mer ? demanda-t-il.
– Oui.
– Et le capitaine John s’en
est servi pour gagner la côte la plus proche sous le vent ?…
– Oui. »
Mais pourquoi le capitaine
John et ses compagnons ne s’étaient-ils pas tous embarqués dans cette chaloupe ?
C’est ce qu’il importait de savoir.
« Sans doute, cette
chaloupe était trop petite pour prendre douze passagers ?… demanda Zach
Fren.
– Oui.
– Et vous êtes partis à sept,
le capitaine John, vous et cinq hommes ?…
– Oui. »
Et alors on put lire
clairement dans le regard du mourant qu’il y avait peut-être encore à sauver
ceux qui étaient restés dans l’île Browse. Mais, sur un signe de Dolly, Zach
Fren s’abstint de dire que les cinq matelots avaient succombé depuis le départ
du capitaine. Quelques minutes de repos furent données à Harry Felton, dont les
yeux s’étaient fermés, pendant que sa main continuait à presser la main de Mrs.
Branican.
Maintenant, transportée par
la pensée sur l’île Browse, Dolly assistait à toutes ces scènes… Elle voyait
John tenter même l’impossible pour le salut de ses compagnons… Elle l’entendait,
elle lui parlait, elle l’encourageait, elle prenait passage avec lui… Où
avait-elle abordé, cette chaloupe ?…
Les yeux de Harry Felton se
rouvrirent, et Zach Fren recommença à l’interroger.
« C’est bien ainsi que
le capitaine John, vous et cinq hommes, avez quitté l’île Browse ?…
– Oui.
– Et la chaloupe a mis le cap
à l’est, afin de gagner la terre la plus rapprochée de l’île ?…
– Oui.
– C’était la terre
australienne ?…
– Oui.
– A-t-elle donc été jetée à
la côte par quelque tempête au terme de sa traversée ?…
– Non.
– Vous avez pu aborder dans
une des criques du littoral australien ?…
– Oui.
– Sans doute, aux environs du
cap Lévêque ?…
– Oui.
– Peut-être à York-Sund ?…
– Oui.
– En débarquant, êtes-vous
donc tombés aux mains des indigènes ?…
– Oui.
– Et ils vous ont entraînés ?…
– Oui.
– Tous ?…
– Non.
– Quelques-uns de vous
avaient-ils donc péri au moment où ils débarquaient à York-Sund ?…
– Oui.
– Massacrés par les indigènes ?…
– Oui.
– Un… deux… trois… quatre ?…
– Oui.
– Vous n’étiez plus que trois,
lorsque les Australiens vous ont emmenés à l’intérieur du continent ?…
– Oui.
– Le capitaine John, vous et
un des matelots ?…
– Oui.
– Et ce matelot… est-il
encore avec le capitaine John ?…
– Non.
– Il était mort avant votre
départ ?…
– Oui.
– Il y a longtemps ?…
– Oui. »
Ainsi, le capitaine John et
le second Harry Felton étaient actuellement les seuls survivants du Franklin,
et encore l’un d’eux n’avait-il plus que quelques heures à vivre !
Il ne fut pas aisé d’obtenir
de Harry Felton les éclaircissements qui concernaient le capitaine John –
éclaircissements qu’il convenait d’avoir avec une extrême précision. Plus d’une
fois, Zach Fren dut suspendre l’interrogatoire ; puis, quand il reprenait,
Mrs. Branican lui faisait poser questions sur questions afin de savoir ce qui
s’était passé depuis neuf ans, c’est-à-dire depuis le jour où le capitaine John
et Harry Felton avaient été capturés par les indigènes du littoral. On apprit
ainsi qu’il s’agissait d’Australiens nomades… Les prisonniers avaient dû les
suivre pendant leurs incessantes pérégrinations à travers les territoires de la
Terre de Tasman, en menant l’existence la plus misérable… Pourquoi avaient-ils
été épargnés ?… Était-ce pour tirer d’eux quelques services, ou, si
l’occasion se présentait, pour en obtenir un haut prix des autorités anglaises ?
Oui – et ce dernier fait, si important, put être formellement établi par les
réponses d’Harry Felton. Ce ne serait qu’une question de rançon, si l’on
parvenait à pénétrer jusqu’à ces indigènes. Quelques autres questions permirent
de comprendre de plus que le capitaine John et Harry Felton avaient été si bien
gardés que, pendant neuf ans, ils n’avaient pu trouver la moindre possibilité
de s’enfuir.
Enfin, le moyen s’en était
présenté. Un lieu de rendez-vous avait été choisi, où les deux prisonniers
devaient se rejoindre pour s’échapper ensemble ; mais quelque circonstance,
inconnue de Harry Felton, avait empêché le capitaine John de venir à l’endroit
indiqué. Harry Felton avait attendu plusieurs jours ; ne voulant pas
s’enfuir seul, il avait cherché à rejoindre la tribu ; elle s’était
déplacée… Alors, bien résolu à revenir délivrer son capitaine, s’il parvenait à
atteindre un des villages de l’intérieur, il s’était jeté à travers les régions
du centre, se cachant pour éviter de retomber aux mains des indigènes, épuisé
par les chaleurs, mourant de faim et de fatigue… Pendant six mois, il avait
ainsi erré jusqu’au moment où il était tombé inanimé près des rives du Parru, sur
la frontière méridionale du Queensland.
C’est là, on le sait, qu’il
fut reconnu, grâce aux papiers qu’il portait sur lui. C’est de là qu’il fut ramené
à Sydney, où sa vie s’était prolongée comme par miracle, afin qu’il pût dire ce
que depuis tant d’années on cherchait vainement à savoir.
Ainsi, seul de tous ses
compagnons, le capitaine John était vivant, mais il était prisonnier d’une
tribu nomade, qui parcourait les déserts de la Terre de Tasman.
Et, lorsque Zach Fren eut
prononcé divers noms des tribus, qui fréquentent ordinairement ces territoires,
ce fut le nom des Indas que Harry Felton accueillit d’un signe affirmatif. Zach
Fren parvint même à comprendre que, pendant la saison d’hiver, cette tribu
campait le plus habituellement sur les bords de la Fitz-Roy-river, un des cours
d’eau qui se jettent dans le golfe Lévêque, au nord-ouest du continent australien.
« C’est là que nous
irons chercher John ! s’écria Mrs. Branican. C’est là que nous le
retrouverons ! »
Et Harry Felton la comprit, car
son regard s’anima à la pensée que le capitaine John serait enfin sauvé… sauvé
par elle.
Harry Felton avait maintenant
accompli sa mission… Mrs. Branican, sa dernière confidente, savait en quelle
partie du continent australien il fallait porter les investigations… Et il
avait refermé les yeux, n’ayant plus rien à dire.
Ainsi, voilà à quel état
avait été réduit cet homme si courageux et si robuste, par les fatigues, les
privations, et surtout l’influence terrible du climat australien !… Et
pour l’avoir affronté, il succombait, au moment où ses misères allaient finir !
N’était-ce pas ce qui attendait le capitaine John, s’il tentait de s’enfuir à
travers les solitudes de l’Australie centrale ? Et les mêmes dangers ne
menaçaient-ils pas ceux qui se jetteraient à la recherche de cette tribu des
Indas ?…
Mais une telle pensée ne vint
pas même à l’esprit de Mrs. Branican. Tandis que l’Orégon l’emportait vers
le continent australien, elle avait conçu et combiné le projet d’une nouvelle
campagne ; il ne s’agissait plus que de le mettre à exécution.
Harry Felton mourut vers neuf
heures du soir. Une fois encore, Dolly l’avait appelé par son nom… Une fois
encore, il l’avait entendue… Ses paupières s’étaient relevées, et ce nom
s’était enfin échappé de ses lèvres :
« John… John ! »
Puis, les soupirs du râle
gonflèrent sa poitrine, et son cœur cessa de battre…
Ce soir-là, au moment où Mrs.
Branican sortait de l’hôpital, elle fut accostée par un jeune garçon, qui
attendait sur le seuil de la porte.
C’était un novice de la
marine marchande, en service sur le Brisbane, l’un des paquebots qui
font les escales de la côte australienne entre Sydney et Adélaïde.
« Mistress Branican ?…
dit-il d’une voix émue.
– Que voulez-vous, mon enfant ?
répondit Dolly.
– Il est mort, Harry Felton ?…
– Il est mort.
– Et le capitaine John ?…
– Il est vivant… lui !…
Vivant !
– Merci, mistress Branican »,
répondit le jeune novice. Dolly avait à peine entrevu les traits de ce garçon, qui
se retira sans dire ni qui il était, ni pourquoi il avait fait ces questions.
Le lendemain eurent lieu les obsèques de Harry Felton, auxquelles assistèrent
les marins du port avec une partie de la population de Sydney. Mrs. Branican
prit place derrière le cercueil, et suivit jusqu’au cimetière celui qui avait
été le compagnon dévoué, le fidèle ami du capitaine John. Et, près d’elle, marchait
ce jeune novice qu’elle ne reconnut pas au milieu de tous ceux qui étaient
venus rendre les derniers devoirs au second du Franklin.
Du jour où M. de Lesseps
a percé l’isthme de Suez, on a été en droit de dire que du continent africain
il avait fait une île. Lorsque le canal de Panama sera achevé, il sera
également permis de donner la qualification d’îles à l’Amérique du Sud et à
l’Amérique du Nord. En effet, ces immenses territoires seront entourés d’eau de
toutes parts. Mais, comme ils conserveront le nom de continent, en égard à leur
étendue, il est logique d’appliquer ce nom à l’Australie ou Nouvelle-Hollande, qui
se trouve dans les mêmes conditions.
En effet, l’Australie mesure
trois mille neuf cents kilomètres dans sa plus grande longueur de l’est à
l’ouest, et trois mille deux cents dans sa plus grande largeur du nord au sud.
Or, le produit de ces deux dimensions constitue une superficie de quatre
millions huit cent trente mille kilomètres carrés environ – soit les sept
neuvièmes de l’aire européenne.
Le continent australien est
actuellement divisé, par les auteurs des atlas les plus récents, en sept
provinces que séparent des lignes arbitraires, se coupant à angle droit, et qui
ne tiennent aucun compte des accidents orographiques ou hydrographiques :
À l’est, dans la partie la
plus peuplée, le Queensland, capitale Brisbane – la Nouvelle-Galles du Sud, capitale
Sydney – Victoria, capitale Melbourne ;
Au centre, l’Australie
septentrionale et la Terre Alexandra, sans capitales – l’Australie méridionale,
capitale Adélaïde ;
À l’ouest, l’Australie
occidentale, qui s’étend du nord au sud, capitale Perth.
Il convient d’ajouter que les
Australiens cherchent à constituer une confédération sous le nom de « Commonwealth
of Australia ». Le gouvernement anglais repousse cette qualification, mais,
sans doute, elle sera acquise le jour où la séparation sera un fait accompli.
On verra bientôt en quelles
provinces, les plus dangereuses et les moins connues de ce continent, Mrs.
Branican allait s’aventurer avec cette espérance si vague, cette pensée presque
irréalisable, de retrouver le capitaine John, de l’arracher à la tribu qui le
retenait prisonnier depuis neuf ans. Et, d’ailleurs, n’y avait-il pas lieu de
se demander si les Indas avaient respecté sa vie, après l’évasion de Harry
Felton ?
Le projet de Mrs. Branican
était de quitter Sydney, dès que le départ serait possible. Elle pouvait
compter sur le dévouement sans bornes de Zach Fren, sur l’intelligence ferme et
pratique qui le caractérisait. Dans un long entretien, ayant la carte de l’Australie
sous les yeux, tous deux avaient discuté les mesures les plus promptes, les
plus formelles aussi, qui devaient décider le succès de cette nouvelle
tentative. Le choix du point de départ, on le comprend, était d’une extrême
importance, et voici ce qui fut définitivement arrêté :
1° Une caravane, pourvue des
meilleurs moyens de recherches et de défense, nantie de tout le matériel exigé
par un voyage à travers les déserts de l’Australie centrale, serait organisée
aux frais et par les soins de Mrs. Branican ;
2° Cette exploration devant
commencer dans un très bref délai, il convenait de se transporter par les voies
les plus rapides de terre ou de mer jusqu’au point terminus des communications
établies entre le littoral et le centre du continent.
En premier lieu, la question
de gagner le littoral nord-ouest, c’est-à-dire l’endroit de la Terre de Tasman
où avaient abordé les naufragés du Franklin, fut posée et débattue. Mais
ce détour eût occasionné une perte de temps énorme, entraîné de réelles difficultés
tant pour le personnel que pour le matériel – qui seraient l’un et l’autre
considérables. En somme, rien ne démontrait qu’en attaquant le continent australien
par l’ouest, l’expédition rencontrerait avec plus de certitude la tribu qui détenait
le capitaine John Branican, les indigènes nomades parcourant la Terre Alexandra
aussi bien que les districts de l’Australie occidentale. Il fut donc répondu
négativement à cette question.
En second lieu, on traita la
direction qu’il convenait de prendre dès le début de la campagne ; c’était
évidemment celle que Harry Felton avait dû suivre pendant son parcours de
l’Australie centrale. Cette direction, si on ne la connaissait pas d’une façon
précise, était, du moins, indiquée par le point où le second du Franklin avait
été recueilli, c’est-à-dire les bords du Parru, à la limite du Queensland et de
la Nouvelle-Galles du Sud, au nord-ouest de cette province.
Depuis 1770 – époque à
laquelle le capitaine Cook explora la Nouvelle-Galles du Sud et prit possession,
au nom du roi d’Angleterre, du continent déjà reconnu par le Portugais Manuel
Godenbho et par les Hollandais Verschoor, Hartog, Carpenter et Tasman – sa
partie orientale s’était largement colonisée, développée, civilisée. Ce fut en
1787 que, Pitt étant ministre, le commodore Philipp vint fonder la station
pénitentiaire de Botany-Bay, d’où, en moins d’un siècle, allait sortir une
nation de près de trois millions d’hommes. Actuellement, rien de ce qui fait la
grandeur et la richesse d’un pays, routes, canaux, chemins de fer, reliant les
innombrables localités du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria
et de l’Australie méridionale, lignes de paquebots desservant les ports de leur
littoral, rien ne manque à cette partie du continent. Or, puisque Mrs. Branican
se trouvait à Sydney, cette capitale opulente et peuplée lui aurait offert les
ressources indispensables à l’organisation d’une caravane, d’autant mieux
qu’avant de quitter San-Diégo, elle s’était fait ouvrir par l’intermédiaire de M. William
Andrew un crédit important sur la Central Australian Bank. Donc, elle
pouvait aisément se procurer les hommes, les véhicules, les animaux de selle, de
trait et de bât que nécessitait une expédition en Australie, peut-être même une
traversée complète de l’est à l’ouest, soit un trajet de près de deux mille
deux cents milles. Mais la ville de Sydney devait-elle être choisie
pour point de départ ?
Tout considéré, et sur l’avis
même du consul américain, qui était très au courant de l’état présent de la
géographie australienne, Adélaïde, capitale de l’Australie méridionale, parut
plus particulièrement indiquée comme base d’opérations. En suivant la ligne
télégraphique, dont les fils vont de cette cité jusqu’au golfe de Van Diémen, c’est-à-dire
du sud au nord, à peu près sur la courbe du cent trente-neuvième méridien, les
ingénieurs ont établi la première partie d’un railway, qui dépassait le
parallèle atteint par Harry Felton. Ce railway permettrait au personnel
d’aboutir plus profondément et plus rapidement à ces régions de la Terre
Alexandra et de l’Australie occidentale que peu de voyageurs avaient visitées
jusqu’à ce jour.
Ainsi, première résolution
prise, cette troisième expédition, ayant pour but la recherche du capitaine
John, serait organisée à Adélaïde et se transporterait à l’extrémité du railway,
qui décrit en montant au nord un parcours de quatre cents milles environ, soit
sept cents kilomètres.
Et maintenant, par quelle
voie Mrs. Branican se rendrait-elle de Sydney à Adélaïde ? S’il y avait eu
une voie ferrée non interrompue entre ces deux capitales, il n’y aurait pas eu
lieu d’hésiter. Il existe bien un railway, qui traverse le Murray sur la
frontière de la province de Victoria, à la station d’Albury, se continue
ensuite par Bénalla et Kilmore jusqu’à Melbourne, et qui, à partir de cette
ville, se dirige vers Adélaïde ; mais il ne franchissait pas la station de
Horscham, et, au delà, les communications mal établies auraient pu causer
d’assez longs retards.
Aussi, Mrs. Branican
résolut-elle de gagner Adélaïde par mer. C’était un trajet de quatre jours, et,
en ajoutant quarante-huit heures pour l’escale que les paquebots font à
Melbourne, elle débarquerait dans la capitale de l’Australie méridionale, après
une navigation de six jours le long des côtes. Il est vrai, on était au mois
d’août, et ce mois correspond au mois de février de l’hémisphère boréal. Mais
le temps se tenait au calme, et, les vents soufflant du nord-ouest, le steamer
serait couvert par la terre, dès qu’il aurait dépassé le détroit de Bass.
D’ailleurs, venue de San-Francisco à Sydney, Mrs. Branican n’en était pas à
s’inquiéter d’une traversée de Sydney à Adélaïde.
Précisément, le paquebot Brisbane
partait le lendemain, à onze heures du soir. Après avoir fait escale à
Melbourne, il arriverait dans le port d’Adélaïde le 27 août, au matin. Deux
cabines y furent retenues, et Mrs. Branican prit les mesures nécessaires pour
que le crédit, qui lui avait été ouvert à la banque de Sydney, fût reporté à la
banque d’Adélaïde. Les directeurs se mirent obligeamment à sa disposition, et
ce virement ne souffrit pas la moindre difficulté.
En quittant l’hôpital de la
Marine, Mrs. Branican s’était rendue à l’hôtel pour y choisir un appartement
qu’elle devait occuper jusqu’à son départ. Ses pensées se résumaient en une
seule : « John est vivant ! » Les yeux obstinément fixés
sur la carte du continent australien, le regard perdu au milieu de ces immenses
solitudes du centre et du nord-ouest, en proie au délire de son imagination, elle
le cherchait… elle le rencontrait… elle le sauvait…
Ce jour-là, à la suite de
leur entretien, Zach Fren, comprenant qu’il valait mieux la laisser seule, était
allé par les rues de Sydney qu’il ne connaissait point. Et tout d’abord – ce
qui ne peut étonner d’un marin – il voulut visiter le Brisbane, afin de
s’assurer que Mrs. Branican y serait convenablement installée. Le navire lui
parut aménagé au mieux pour les besoins d’une navigation côtière. Il demanda à
voir la cabine réservée à la passagère. Ce fut un jeune novice qui l’y conduisit,
et il fit prendre quelques dispositions en vue de rendre cette cabine plus
confortable. Brave Zach Fren ! On eût dit en vérité qu’il s’agissait d’une
traversée de long cours !
Au moment où il se disposait
à quitter le bord, le jeune novice le retint, et, d’une voix un peu émue :
« C’est bien certain, maître,
demanda-t-il, que mistress Branican s’embarquera demain pour Adélaïde ?…
– Oui, demain, répondit Zach
Fren.
– Sur le Brisbane ?…
– Sans doute.
– Puisse-t-elle réussir dans
son entreprise et retrouver le capitaine John !
– Nous ferons de notre mieux,
tu peux le croire.
– J’en suis convaincu, maître.
– Est-ce que tu es embarqué
sur le Brisbane ?…
– Oui, maître.
– Eh bien, mon garçon, à
demain. »
Les dernières heures qu’il
passa à Sydney, Zach Fren les employa à flâner dans Pitt-Street et York-Street,
bordées de belles constructions en grès jaune rougeâtre, puis à Victoria-Park, à
Hyde-Park, où s’élève le monument commémoratif du capitaine Cook. Il visita le
Jardin Botanique, promenade admirable, située sur le bord de la mer, où
s’entremêlent les diverses essences des pays chauds et tempérés, les chênes et
les araucarias, les cactus et les mangoustans, les palmiers et les oliviers. En
somme, Sydney mérite la réputation qui lui est faite. C’est la plus ancienne
des capitales australiennes, et si elle est moins régulièrement construite que
ses puînées Adélaïde et Melbourne, elle se montre plus riche de beautés imprévues
et de sites pittoresques.
Le lendemain soir, Mrs.
Branican et Zach Fren avaient pris passage à bord du paquebot. À onze heures, le
Brisbane, débouquant du port, se lançait à travers la baie de
Port-Jackson. Après avoir doublé l’Inner-South-Head, il mit le cap au sud, en
se tenant à quelques milles de la côte.
Pendant la première heure, Dolly
demeura sur le pont, assise à l’arrière, regardant les formes du littoral, qui
s’estompaient confusément au milieu de la brume. C’était donc là ce continent
dans lequel elle allait essayer de s’introduire comme dans une immense prison, d’où
John n’avait pu jusque-là s’échapper. Il y avait quatorze ans qu’ils étaient
séparés l’un de l’autre !
« Quatorze ans ! »
murmura-t-elle.
Lorsque le Brisbane passa
devant Botany-Bay et Jorris-Bay, Mrs. Branican alla prendre un peu de repos.
Mais, le lendemain, dès l’aube, elle était debout à l’heure où le mont Dromedary,
et, un peu en arrière, le mont Kosciusko, qui appartient au système des Alpes
australiennes, se dessinaient à l’horizon.
Zach Fren avait rejoint Dolly
sur le spardeck du steamer, et tous deux s’entretinrent de ce qui faisait leur
unique préoccupation.
En ce moment, un jeune novice,
hésitant et ému, s’approcha de Mrs. Branican, et vint lui demander, de la part
du capitaine, si elle n’avait besoin de rien.
« Non, mon enfant, répondit
Dolly.
– Eh ! c’est le garçon
qui m’a reçu hier, quand je suis venu visiter le Brisbane, dit Zach
Fren.
– Oui, maître, c’est moi.
– Et comment t’appelles-tu ?…
– Je m’appelle Godfrey.
– Eh bien, Godfrey, te voilà
certain, à présent, que mistress Branican est embarquée sur ton paquebot… et tu
es satisfait, j’imagine ?
– Oui, maître, et nous le
sommes tous à bord. Oui ! nous faisons tous des vœux pour que les recherches
de mistress Branican réussissent, pour qu’elle délivre le capitaine John ! »
En lui parlant, Godfrey la
regardait avec tant de respect et d’exaltation, que Dolly fut remuée dans tout
son être. Et, alors, la voix du jeune novice la frappa… Cette voix, elle
l’avait déjà entendue, et le souvenir lui revint.
« Mon enfant, dit-elle, est-ce
que ce n’est pas vous qui m’avez interrogée à la porte de l’hospice de Sydney ?…
– C’est moi.
– Vous qui m’avez demandé si
le capitaine John était toujours vivant ?…
– Moi-même, mistress.
– Vous faites donc partie de
l’équipage ?
– Oui… depuis un an, répondit
Godfrey. Mais, s’il plaît à Dieu, je l’aurai bientôt quitté. »
Et, sans doute, n’en voulant
ou n’en osant pas dire davantage, Godfrey se retira, afin d’aller donner au
commandant des nouvelles de Mrs. Branican.
« Voilà un garçon qui
m’a l’air d’avoir du sang de marin dans les veines, fit observer Zach Fren. Ça
se devine rien qu’à le voir… Il a le regard franc, clair, décidé… Sa voix est
en même temps ferme et douce…
– Sa voix ! »
murmura Dolly.
Par quelle illusion de ses
sens lui semblait-il qu’elle venait d’entendre parler John, à cela près des
adoucissements d’un organe à peine formé par l’âge. Et une autre remarque
qu’elle fit également – remarque plus significative encore. Certainement, elle
s’illusionnait, mais les traits de ce jeune garçon lui avaient rappelé les
traits de John… de John, qui n’avait pas trente ans, lorsque le Franklin l’avait
emporté loin d’elle et pour si longtemps !
« Vous le voyez, mistress
Branican, dit Zach Fren, en frottant ses bonnes grosses mains, Anglais ou
Américains, tout le monde vous est sympathique… En Australie, vous trouverez
les mêmes dévouements qu’en Amérique… Il en sera d’Adélaïde comme de San-Diégo…
Tous font les mêmes vœux que ce jeune Anglais…
– Est-ce un Anglais ? »
se demandait Mrs. Branican, profondément impressionnée.
La navigation fut très
heureuse pendant cette première journée. La mer était d’un calme absolu par ces
vents de nord-ouest, qui venaient de terre. Le Brisbane la trouverait
non moins tranquille, lorsqu’il aurait doublé le cap Howe, à l’angle du
continent australien, pour aller chercher le détroit de Bass.
Pendant cette journée, Dolly
ne quitta presque pas le spardeck. Les passagers lui montraient une extrême
déférence, et aussi un vif empressement à lui tenir compagnie. Ils étaient désireux
de voir cette femme, dont les malheurs avaient eu un tel retentissement, et qui
n’hésitait pas à braver tant de périls, à affronter tant de fatigues, dans
l’espoir de sauver son mari, si la Providence voulait qu’il survécût. Devant
elle, d’ailleurs, personne n’eût mis cette éventualité en doute. Comment
n’aurait-on pas partagé sa confiance, lorsqu’on l’entendait s’inspirer de
résolutions si viriles, lorsqu’elle disait tout ce qu’elle allait entreprendre ?
Inconsciemment, on s’aventurait à sa suite, au milieu des territoires de
l’Australie centrale. Et, de fait, plus d’un eût accepté de l’y accompagner, autrement
que par la pensée.
Mais, en leur répondant, il
arrivait que Dolly s’interrompait parfois. Son regard prenait alors une
expression singulière, une flamme s’y allumait, et Zach Fren était seul à
comprendre ce qui occupait son esprit.
C’est qu’elle venait
d’apercevoir Godfrey. La démarche du jeune novice, son attitude, ses gestes, l’insistance
avec laquelle il la suivait des yeux, cette sorte d’instinct qui semblait
l’attirer vers elle, tout cela la saisissait, l’émotionnait, la remuait à ce
point que John et lui se confondaient dans sa pensée.
Dolly n’avait pu cacher à
Zach Fren qu’elle trouvait une ressemblance frappante entre John et Godfrey.
Aussi Zach Fren ne la voyait-il pas sans inquiétude s’abandonner à cette impression
due à une circonstance purement fortuite. Il redoutait, non sans raison, que ce
rapprochement lui rappelât trop vivement le souvenir de l’enfant qu’elle avait
perdu. C’était vraiment inquiétant que Mrs. Branican fût surexcitée à ce point
par la présence de ce jeune garçon.
Cependant Godfrey n’était pas
retourné près d’elle, son service ne l’appelant point à l’arrière du paquebot, exclusivement
réservé aux passagers de première classe. Mais, de loin, leurs regards
s’étaient souvent croisés, et Dolly avait été sur le point de l’appeler… Oui !
sur un signe, Godfrey se fût empressé d’accourir… Dolly n’avait pas fait ce
signe, et Godfrey n’était pas venu.
Ce soir-là, au moment où Zach
Fren reconduisait Mrs. Branican à sa cabine, elle lui dit :
« Zach, il faudra savoir
quel est ce jeune novice… à quelle famille il appartient… le lieu de sa naissance…
Peut-être n’est-il pas d’origine anglaise…
– C’est possible, mistress, répondit
Zach Fren. Il peut se faire qu’il soit Américain. Au surplus, si vous le voulez,
je vais le demander au capitaine du Brisbane…
– Non, Zach, non, j’interrogerai
Godfrey même. »
Et le maître entendit Mrs.
Branican faire cette réflexion, à mi-voix :
« Mon enfant, mon pauvre
petit Wat aurait à peu près cet âge… à présent !
– Voilà ce que je craignais ! »
se dit Zach Fren, en regagnant sa cabine.
Le lendemain, 22 août, le Brisbane,
qui avait doublé le cap Howe pendant la nuit, continua de naviguer dans des
conditions excellentes. La côte du Gippland, l’une des principales provinces de
la colonie de Victoria, après s’être courbée vers le sud-est, se relie au
promontoire Wilson, la pointe la plus avancée que le continent projette vers le
sud. Ce littoral est moins riche en baies, ports, inlets, caps, géographiquement
dénommés, que la partie qui se dessine en ligne droite depuis Sydney jusqu’au
cap Howe. Ce sont des plaines à perte de vue, dont les dernières limites, encadrées
de montagnes, sont trop éloignées pour être aperçues de la mer.
Mrs. Branican, ayant quitté
sa cabine dès la première aube du jour, avait repris sa place à l’arrière du
spardeck. Zach Fren la rejoignit bientôt et observa un très manifeste
changement de son attitude. La terre, qui se déroulait vers le nord-ouest, n’attirait
plus ses regards. Absorbée dans ses pensées, elle répondit à peine à Zach Fren,
lorsque celui-ci lui demanda comment elle avait passé la nuit.
Le maître n’insista point.
L’essentiel, c’était que Dolly eût oublié cette singulière ressemblance de
Godfrey et du capitaine John, qu’elle ne songeât plus à le revoir, à
l’interroger. Il était possible qu’elle y eût renoncé, que ses idées eussent
pris un autre cours, et, en effet, elle ne pria pas Zach Fren de lui amener le
jeune garçon que son service retenait à l’avant du steamer.
Après le déjeuner, Mrs.
Branican rentra dans sa cabine, et elle ne reparut sur le pont qu’entre trois
et quatre heures de l’après-midi.
En ce moment, le Brisbane filait
à toute vapeur vers le détroit de Bass, qui sépare l’Australie de la Tasmanie
ou Terre de Van Diémen.
Que la découverte du
Hollandais Janssen Tasman ait été profitable aux Anglais, que cette île, dépendance
naturelle du continent, ait gagné à la domination de la race anglo-saxonne, rien
de moins contestable. Depuis 1642, date de la découverte de cette île, longue
de deux cent quatre-vingts kilomètres, où le sol est d’une extrême fertilité, dont
les forêts sont enrichies d’essences superbes, il est certain que la colonisation
a marché à grands pas. À partir du commencement de ce siècle, les Anglais ont
administré comme ils administrent, opiniâtrement, sans prendre nul souci des
races indigènes ; ils ont divisé l’île en districts, ils ont fondé des
villes importantes, la capitale Hobbart-Town, Georges-Town et nombre d’autres ;
ils ont utilisé les dentelures multiples de la côte pour créer des ports, où
leurs navires accostent par centaines. Tout cela est bien. Mais, de la population
noire, qui occupait à l’origine cette contrée, que reste-t-il ? Sans doute,
ces pauvres gens n’étaient rien moins que civilisés ; on voyait même en
eux les plus abrupts échantillons de la race humaine ; on les mettait
au-dessous des nègres d’Afrique, au-dessous des Fueggiens de la Terre de Feu.
Si l’anéantissement d’une race est le dernier mot du progrès colonial, les
Anglais peuvent se vanter d’avoir mené leur œuvre à bon terme. Mais, à la
prochaine Exposition universelle d’Hobbart-Town, qu’ils se hâtent s’ils veulent
exhiber quelques Tasmaniens… Il n’en restera plus un seul à la fin du XIXe siècle !
Le Brisbane traversa
le détroit de Bass pendant la soirée. Sous cette latitude de l’hémisphère austral,
le jour ne se prolonge guère au delà de cinq heures pendant le mois d’août. La
lune, qui entrait dans son premier quartier, disparut promptement entre les
brumes de l’horizon. L’obscurité profonde empêchait de voir les dispositions
littorales du continent.
La navigation du détroit fut
ressentie à bord par les coups de tangage qu’éprouva le paquebot sous
l’influence d’un clapotis très houleux. Les courants et contre-courants luttent
avec impétuosité dans cette étroite passe, ouverte aux eaux du Pacifique.
Le lendemain, 23 août, dès
l’aube, le Brisbane se présenta à l’entrée de la baie de Port-Phillip.
Une fois au milieu de cette baie, les navires n’ont plus rien à redouter des
mauvais temps ; mais, pour y pénétrer, il est nécessaire de manœuvrer avec
prudence et précision, surtout lorsqu’il s’agit de doubler la longue pointe
sablonneuse de Nepean d’un côté et celle de Queenscliff de l’autre. La baie, suffisamment
fermée, se découpe en plusieurs ports, où les bâtiments de fort tonnage
trouvent des mouillages excellents, Goelong, Sandrige, Williamstown – ces deux
derniers formant le port de Melbourne. L’aspect de cette côte est triste, monotone,
sans attrait. Peu de verdure sur les rives, l’aspect d’un marécage presque
desséché, qui, au lieu de lagons ou d’étangs, ne montre que des entailles aux
vases durcies et fendillées. À l’avenir de modifier la surface de ces plaines, en
remplaçant les squelettes d’arbres qui grimacent çà et là par des futaies, dont
le climat australien fera rapidement des forêts superbes.
Le Brisbane vint se
ranger à l’un des quais de Williamstown, afin d’y débarquer une partie des passagers.
Comme on devait faire escale
pendant trente-six heures, Mrs. Branican résolut de passer ce temps à
Melbourne. Non qu’elle eût affaire en cette ville, puisque ce n’était qu’à
Adélaïde qu’elle s’occuperait des préparatifs d’une expédition devant atteindre
probablement les extrêmes limites de l’Ouest-Australie. Dès lors, pourquoi en
vint-elle à quitter le Brisbane ? Craignait-elle d’être l’objet de
trop nombreuses et trop fréquentes visites ? Mais, pour y échapper, ne lui
suffisait-il pas de se confiner dans sa cabine ? D’ailleurs, à descendre
dans l’un des hôtels de la ville, où sa présence serait bientôt connue, ne
s’exposait-elle pas à de plus pressantes entrevues, à de plus inévitables
importunités ?
Zach Fren ne savait comment
expliquer la résolution de Mrs. Branican. Il le remarquait, son attitude
différait de celle qu’elle avait à Sydney. De très accueillante qu’elle se montrait
alors, elle était devenue peu communicative. Était-ce, comme l’avait observé le
maître, que la présence de Godfrey avait trop vivement rappelé en elle le
souvenir de son enfant ? Oui, et Zach Fren ne se trompait pas. La vue du
jeune novice l’avait troublée si profondément qu’elle sentait le besoin de
s’isoler. N’entrait-il plus dans sa pensée de l’interroger ? Peut-être, puisqu’elle
ne l’avait pas fait la veille, bien qu’elle en eût exprimé le désir. Mais en ce
moment, si elle voulait débarquer à Melbourne, y rester les vingt-quatre heures
de la relâche, dût-elle encourir les inconvénients d’une notoriété pour son
malheur trop réelle, c’était dans l’idée de fuir – il n’y a pas d’autre mot –
oui, de fuir ce garçon de quatorze ans, vers lequel l’attirait une force
instinctive. Pourquoi donc hésitait-elle à lui parler, à s’enquérir près de lui
de tout ce qui l’intéressait, sa nationalité, son origine, sa famille ?
Craignait-elle que ses réponses – et cela était très vraisemblable – eussent
pour résultat de détruire sans retour d’imprudentes illusions, un espoir
chimérique, auquel son imagination s’abandonnait et que son agitation avait
révélé à Zach Fren ?
Mrs. Branican, accompagnée du
maître, débarqua dès la première heure. Aussitôt qu’elle eut mis le pied sur
l’appontement, elle se retourna.
Godfrey était appuyé sur la
lisse, à l’avant du Brisbane. En la voyant s’éloigner, son visage devint
si triste, il eut un geste si expressif, il semblait vouloir d’une telle force
la retenir à bord, que Dolly fut sur le point de lui dire : « Mon
enfant… je reviendrai ! »
Elle se maîtrisa, pourtant, fit
signe à Zach Fren de la suivre, et se rendit à la gare du railway, qui met le
port en communication avec la ville.
Melbourne, en effet, est
située en arrière du littoral, sur la rive gauche de la rivière Yarra-Yarra, à
une distance de deux kilomètres – distance que les trains franchissent en
quelques minutes. Là s’élève cette cité avec sa population de trois cent mille
habitants, capitale de la magnifique colonie de Victoria, qui en compte près
d’un million, et sur laquelle, depuis 1851, on est fondé à dire que le mont
Alexandre a versé tout l’or de ses gisements.
Mrs. Branican, bien qu’elle
fût descendue dans un des hôtels les moins fréquentés de la ville, n’aurait pu
échapper à la curiosité – d’ailleurs très sympathique – qu’excitait en tous
lieux sa présence. Aussi, en compagnie de Zach Fren, préféra-t-elle parcourir
les rues de la ville, dont son regard, si étrangement préoccupé, ne devait à
peu près rien voir.
Une Américaine, en somme, n’eût
éprouvé aucune surprise ni goûté aucun plaisir à visiter une ville des plus
modernes. Quoique fondée douze ans après San-Francisco de Californie, Melbourne
lui ressemble « en moins bien », comme on dit : des rues larges,
se coupant à angle droit, des squares auxquels manquent les gazons et les
arbres, des banques par centaines, des offices où se brassent d’énormes
affaires, un quartier qui concentre le commerce de détail, des édifices publics,
églises, temples, université, musée, muséum, bibliothèque, hôpital, hôtel de
ville, écoles qui sont des palais, palais dont quelques-uns seraient insuffisants
pour des écoles, un monument élevé aux deux explorateurs Burke et Wills, qui
succombèrent en essayant de traverser le continent australien du sud au nord ;
puis, le long de ces rues et de ces boulevards, des passants assez rares en dehors
du quartier des affaires ; un certain nombre d’étrangers, surtout des
Juifs de race allemande, qui vendent de l’argent comme d’autres vendent du
bétail ou de la laine, et à un bon prix – afin de réjouir le cœur d’Israël.
Mais, cette Melbourne du
négoce, les commerçants ne l’habitent que le moins possible. C’est dans les
faubourgs, c’est aux environs de la ville que se sont multipliés les villas, les
cottages, même des habitations princières, à Saint-Kilda, à Hoam, à
Emerald-Hill, à Brighton – ce qui, au dire de M. D. Charnay, l’un des plus
intéressants voyageurs qui aient visité ce pays, donne l’avantage à Melbourne
sur San-Francisco. Et déjà les arbres d’essences si variées ont grandi, les
parcs somptueux sont couverts d’ombrages, les eaux vives assurent pendant de
longs mois une bienfaisante fraîcheur. Aussi est-il peu de villes, qui soient
placées au milieu d’un plus admirable cadre de verdure.
Mrs. Branican ne prêta qu’une
distraite attention à ces magnificences, même lorsque Zach Fren l’eut conduite
en dehors de la ville, en pleine campagne. Rien n’indiquait que telle habitation
merveilleusement disposée, tel site grandiose avec ses lointaines perspectives,
eût frappé son regard. Il semblait toujours que, sous l’obsession d’une idée
fixe, elle fût sur le point de faire à Zach Fren une demande qu’elle n’osait
formuler.
Tous deux revinrent vers
l’hôtel, à la nuit tombante. Dolly se fit servir dans son appartement un dîner
auquel elle toucha à peine. Puis elle se coucha et ne dormit que d’un
demi-sommeil, hanté par les images de son mari et de son enfant.
Le lendemain, Mrs. Branican
resta dans sa chambre jusqu’à deux heures. Elle écrivit une longue lettre à M. William
Andrew, afin de lui faire connaître son départ de Sydney et sa prochaine
arrivée dans la capitale de l’Australie méridionale. Elle lui renouvelait ses
espérances en ce qui concernait l’issue de l’expédition. Et, en recevant cette
lettre, à sa grande surprise, à son extrême inquiétude aussi, M. William
Andrew ne dut pas manquer d’observer que si Dolly parlait de John comme étant
certaine de le retrouver vivant, elle parlait de son enfant, du petit Wat, comme
s’il n’était pas mort. L’excellent homme en fut à se demander s’il n’y avait
pas lieu de craindre de nouveau pour la raison de cette femme si éprouvée.
Les passagers que le Brisbane
prenait à destination d’Adélaïde étaient presque tous embarqués, lorsque
Mrs. Branican, accompagnée de Zach Fren, revint à bord. Godfrey guettait son
retour, et, du plus loin qu’il l’aperçut, son visage s’éclaira d’un sourire. Il
se précipita vers l’appontement, et il était là, quand elle mit le pied sur la
passerelle.
Zach Fren fut on ne peut plus
contrarié, et ses gros sourcils se froncèrent. Que n’aurait-il donné pour que
le jeune novice eût quitté le paquebot, ou tout au moins pour qu’il ne se rencontrât
pas sur le chemin de Dolly, puisque sa présence ravivait les plus douloureux
souvenirs !
Mrs. Branican aperçut
Godfrey. Elle s’arrêta un instant, le pénétrant de son regard ; mais elle
ne lui parla pas, et, baissant la tête, elle vint s’enfermer dans sa cabine.
À trois heures de
l’après-midi, le Brisbane, larguant ses amarres, se dirigea vers le
goulet, et, tournant la pointe de Queenscliff, prit direction sur Adélaïde, en
élongeant à moins de trois milles la côte de Victoria.
Les passagers, embarqués à
Melbourne, étaient au nombre d’une centaine – pour la plupart, des habitants de
l’Australie méridionale, qui retournaient dans leurs districts. Il y avait
quelques étrangers parmi eux – entre autres un chinois, âgé de trente à
trente-cinq ans, l’air endormi d’une taupe, jaune comme un citron, rond comme
une potiche, gras comme un mandarin à trois boutons. Ce n’était pas un mandarin,
pourtant. Non ! un simple domestique, au service d’un personnage, dont le
physique mérite d’être dessiné avec une certaine précision.
Qu’on se figure un fils
d’Albion aussi « britannique » que possible, grand, maigre, osseux, une
vraie pièce d’ostéologie, tout en cou, tout en buste, tout en jambes. Ce type
d’Anglo-Saxon, âgé de quarante-cinq à cinquante ans, s’élevait d’environ six
pieds (anglais) au-dessus du niveau de la mer. Une barbe blonde qu’il portait
entière, une chevelure blonde de même, où s’entremêlaient quelques cheveux d’un
jaune d’or, de petits yeux fureteurs, un nez pincé aux narines, busqué en bec
de pélican ou de héron et d’une longueur peu commune, un crâne sur lequel le
moins observateur des phrénologues eût aisément découvert les bosses de la
monomanie et de la ténacité – cet ensemble formait une de ces têtes qui
attirent le regard et provoquent le sourire, lorsqu’elles sont crayonnées par
un spirituel dessinateur.
Cet Anglais était
correctement vêtu du costume traditionnel : la casquette à double visière,
le gilet boutonné jusqu’au menton, le veston à vingt poches, le pantalon en
drap quadrillé, les hautes guêtres à boutons de nickel, les souliers à clous, et
le cache-poussière blanchâtre que la brise plissait autour de son corps en
révélant sa maigreur de squelette.
Quel était cet original ?
on l’ignorait, et, sur les paquebots australiens, nul ne s’autorise des
familiarités du voyage pour s’occuper des voyageurs, savoir où ils vont, ni
d’où ils viennent. Ce sont des passagers, et comme tels, ils passent. Rien de
plus. Tout ce que le steward du bord eût pu dire, c’est que cet Anglais avait
retenu sa cabine sous le nom de Joshua Meritt – abréviativement Jos Meritt – de
Liverpool (Royaume-Uni), accompagné de son domestique, Gîn-Ghi, de Hong-Kong
(Céleste-Empire).
Du reste, une fois embarqué, Jos
Meritt alla s’asseoir sur un des bancs du spardeck, et ne le quitta qu’à
l’heure du lunch, lorsque tinta la cloche de quatre heures. Il y revint à
quatre et demi, l’abandonna à sept pour le dîner, y reparut à huit, gardant
invariablement l’attitude d’un mannequin, les deux mains ouvertes sur ses
genoux, ne tournant jamais la tête ni à droite ni à gauche, les yeux dirigés
vers la côte qui se perdait dans les brumes du soir. Puis, à dix heures, il
regagna sa cabine d’un pas géométrique que les soubresauts du roulis ne
parvenaient pas à ébranler.
Pendant une partie de la nuit,
Mrs. Branican, qui était remontée sur le pont un peu avant neuf heures, se
promena à l’arrière du Brisbane, bien que la température fût assez
froide. L’esprit obsédé, visionné même, pour employer une expression plus exacte,
elle n’aurait pu dormir. À l’étroit dans sa cabine, elle avait besoin de
respirer cet air vif, imprégné parfois des pénétrantes senteurs de « l’acacia
flagrans », qui dénoncent la terre australienne à cinquante milles en mer.
Songeait-elle à rencontrer le jeune novice, à lui parler, à l’interroger, à
savoir de lui… Savoir quoi ?… Godfrey, ayant fini son quart à dix heures, ne
devait le reprendre qu’à deux heures du matin, et, à ce moment, Dolly, très
fatiguée d’un douloureux ébranlement moral, avait dû regagner sa chambre.
Vers le milieu de la nuit, le
Brisbane doubla le cap Otway à l’extrémité du district de Polwarth. À
partir de ce point, il allait remonter franchement dans le nord-ouest jusqu’à
la hauteur de la baie Discovery, où vient s’appuyer la ligne conventionnelle, tracée
sur le cent quarante et unième méridien – ligne qui sépare les provinces de
Victoria et de la Nouvelle-Galles du sud des territoires de l’Australie
méridionale.
Dès le matin, on revit Jos
Meritt sur le banc du spardeck, à sa place habituelle, dans la même attitude, et
comme s’il ne l’eût pas quittée depuis la veille. Quant au Chinois Gîn-Ghi, il
dormait à poings fermés en quelque coin.
Zach Fren devait être
accoutumé aux manies de ses compatriotes, car les originaux ne manquent point
dans la collection des quarante-deux États fédératifs, actuellement compris
sous la rubrique U. S. A. Cependant, il ne put regarder sans un certain
ébahissement ce type si réussi de mécanique humaine.
Et quelle fut sa surprise, lorsque,
s’étant approché de ce long et immobile gentleman, il s’entendit interpeller en
ces termes d’une voix un peu grêle :
« Maître Zach Fren, je
crois ?…
– En personne, répondit Zach
Fren.
– Le compagnon de mistress
Branican ?…
– Comme vous dites. Je vois
que vous savez.
– Je sais… à la recherche de
son mari… absent depuis quatorze ans… Bien !… Oh !… Très bien !
– Comment… très bien ?…
– Oui !… Mistress
Branican… Très bien !… Moi aussi… je suis à la recherche…
– De votre femme ?…
– Oh !… pas marié !…
Très bien !… Si j’avais perdu ma femme, je ne la chercherais pas.
– Alors, c’est pour ?…
– Pour retrouver… un chapeau.
– Votre chapeau ?… Vous
avez égaré votre chapeau ?…
– Mon chapeau ?… Non !…
C’est le chapeau… je m’entends… Vous présenterez mes hommages à mistress Branican…
Bien !… Oh !… Très bien !…
Les lèvres de Jos Meritt se
refermèrent et ne laissèrent plus échapper une seule syllabe.
« C’est une espèce de
fou », se dit Zach Fren.
Et il lui sembla que ce
serait de la puérilité que de s’occuper plus longtemps de ce gentleman.
Lorsque Dolly reparut sur le
pont, le maître vint la rejoindre, et tous deux allèrent s’asseoir à peu près
en face de l’Anglais. Celui-ci ne bougea pas plus que le dieu Terme. Ayant
chargé Zach Fren de présenter ses hommages à Mrs. Branican, il pensait sans
doute qu’il n’avait point à le faire en personne.
Du reste, Dolly ne remarqua
pas la présence de ce bizarre passager. Elle eut un long entretien avec son
compagnon, touchant les préparatifs du voyage, qui seraient commencés dès leur
arrivée à Adélaïde. Pas un jour, pas une heure à perdre. Il importait que
l’expédition eût atteint et dépassé, si c’était possible, les territoires du
pays central, avant qu’ils fussent desséchés sous les intolérables chaleurs de
la zone torride. Entre les dangers de diverses sortes, inhérents à une
recherche entreprise dans ces conditions, les plus terribles seraient
probablement causés par les rigueurs du climat, et toutes précautions seraient
prises pour s’en garantir. Dolly parla du capitaine John, de son tempérament
robuste, de son indomptable énergie, qui lui avaient permis – elle n’en doutait
pas – de résister là où d’autres, moins vigoureux, moins fortement trempés, auraient
succombé. Entre temps, elle n’avait fait aucune allusion à Godfrey, et Zach
Fren pouvait espérer que sa pensée s’était détournée de ce garçon, lorsqu’elle
dit :
« Je n’ai pas encore vu
aujourd’hui le jeune novice… Ne l’avez-vous point aperçu, Zach ?
– Non, mistress, répondit le
maître, que cette question parut contrarier.
– Peut-être pourrais-je faire
quelque chose pour cet enfant ? » reprit Dolly.
Et elle affectait de n’en
parler qu’avec une sorte d’indifférence, à laquelle Zach Fren ne se méprit
point.
« Ce garçon ?…
répondit-il. Oh ! il a un bon métier, mistress… Il arrivera… Je le vois
déjà quartier-maître d’ici à quelques années… Avec du zèle et de la conduite…
– N’importe, reprit Dolly, il
m’intéresse… Il m’intéresse à un point… Mais aussi, Zach, cette ressemblance, oui !…
cette ressemblance extraordinaire entre mon pauvre John et lui… Et puis, Wat…
mon enfant… aurait son âge ! ».
Et en disant cela, Dolly
devenait pâle ; sa voix s’altérait ; son regard, qui se fixait sur
Zach Fren, était si interrogateur que le maître avait baissé les yeux.
Puis elle ajouta :
« Vous me le présenterez
dans l’après-midi, Zach… Ne l’oubliez pas… Je veux lui parler… Cette traversée
sera finie demain… Nous ne nous reverrons jamais… et, avant de quitter le Brisbane…
je désire savoir… Oui ! savoir… »
Zach Fren dut promettre à
Dolly de lui amener Godfrey, et elle se retira.
Le maître, très soucieux, très
alarmé même, continua de se promener sur le spardeck jusqu’au moment où le
steward sonna le second déjeuner. Il faillit alors se heurter contre l’Anglais,
qui semblait rythmer ses pas sur les battements de la cloche, en se dirigeant
vers l’escalier du capot.
« Bien !… Oh !…
Très bien ! fit Jos Meritt. Vous avez, sur ma demande… offert mes
compliments… Son mari disparu… Bien !… Oh !… Très bien ! »
Et il s’en alla, afin de
gagner la place qu’il avait choisie à la table du « dining-room » –
la meilleure, cela s’entend, et voisine de l’office, ce qui lui permettait de
se servir le premier et de prendre les morceaux de choix.
À trois heures, le Brisbane
naviguait à l’ouvert de Portland, le principal port du district de Normanby,
où vient aboutir le railway de Melbourne ; puis, le cap Nelson ayant été
doublé, il passait au large de la baie Discovery et remontait presque directement
vers le nord, en élongeant d’assez près la côte de l’Australie méridionale.
Ce fut à cet instant que Zach
Fren vint prévenir Godfrey que Mrs. Branican désirait lui parler.
« Me parler ? »
s’écria le jeune novice.
Et son cœur battit si fort
qu’il n’eut que le temps de se retenir à la lisse pour ne point tomber.
Godfrey, conduit par le
maître, se rendit à la cabine, où l’attendait Mrs. Branican.
Dolly le regarda quelque
temps. Il se tenait debout, devant elle, son béret à la main. Elle était assise
sur un canapé. Zach Fren, accoté près de la porte, les observait tous les deux
avec anxiété. Il savait bien ce que Dolly allait demander à Godfrey, mais il
ignorait ce que le jeune novice lui répondrait.
« Mon enfant, dit Mrs.
Branican, je voudrais avoir des renseignements sur vous… sur la famille à laquelle
vous appartenez… Si je vous interroge, c’est que je m’intéresse… à votre situation…
Voudrez-vous satisfaire à mes questions ?…
– Très volontiers, mistress, répondit
Godfrey d’une voix que l’émotion faisait trembler.
– Quel âge avez-vous ?…
demanda Dolly.
– Je ne sais pas au juste, mistress,
mais je dois avoir de quatorze à quinze ans.
– Oui… de quatorze à quinze
ans !… Et depuis quelle époque avez-vous pris la mer ?…
– Je me suis embarqué, lorsque
j’avais huit ans environ, en qualité de mousse, et voilà deux années que je
sers comme novice.
– Avez-vous fait de grandes
navigations ?…
– Oui, mistress, sur l’océan
Pacifique jusqu’en Asie… et sur l’Atlantique jusqu’en Europe.
– Vous n’êtes pas Anglais ?…
– Non, mistress, je suis
Américain.
– Et, cependant, vous servez
sur un paquebot de nationalité anglaise ?…
– Le navire sur lequel
j’étais a été dernièrement vendu à Sydney. Alors, me trouvant sans embarquement,
je suis passé sur le Brisbane, en attendant l’occasion de reprendre du
service à bord d’un navire américain.
– Bien, mon enfant », répondit
Dolly, qui fit signe à Godfrey de se rapprocher d’elle. Godfrey obéit.
« Maintenant, demanda-t-elle,
je désirerais savoir où vous êtes né ?…
– À San-Diégo, mistress.
– Oui !… à San-Diégo ! »
répéta Dolly, sans paraître surprise et comme si elle eût pressenti cette réponse.
Quant à Zach Fren, il fut
très impressionné de ce qu’il venait d’entendre.
« Oui, mistress, à
San-Diégo, reprit Godfrey. Oh ! je vous connais bien !… Oui ! je
vous connais !… Quand j’ai appris que vous veniez à Sydney, cela m’a fait
un plaisir… Si vous saviez, mistress, combien je m’intéresse à tout ce qui
concerne le capitaine John Branican ! »
Dolly prit la main du jeune
novice, et la tint quelques instants sans prononcer une parole. Puis, d’une voix
qui décelait l’égarement de son imagination :
« Votre nom ?…
demanda-t-elle.
– Godfrey.
– Godfrey est votre nom de
baptême… Mais quel est votre nom de famille ?…
– Je n’ai pas d’autre nom, mistress.
– Vos parents ?…
– Je n’ai pas de parents.
– Pas de parents !
répondit Mrs. Branican. Avez-vous donc été élevé…
– À Wat-House, répondit
Godfrey, oui ! mistress, et par vos soins. Oh ! Je vous ai aperçue
bien souvent, lorsque vous veniez visiter vos enfants de l’hospice !… Vous
ne me voyiez pas entre tous les petits, mais je vous voyais, moi… et j’aurais
voulu vous embrasser !… Puis, comme j’avais du goût pour la navigation, lorsque
j’ai eu l’âge, je suis parti mousse… Et d’autres aussi, des orphelins de
Wat-House, s’en sont allés sur des navires… et nous n’oublierons jamais ce que
nous devons à mistress Branican… à notre mère !…
– Votre mère ! »
s’écria Dolly, qui tressaillit, comme si ce nom eût retenti jusqu’au fond de
ses entrailles.
Elle avait attiré Godfrey…
Elle le couvrait de baisers… Il les lui rendait… Il pleurait… C’était entre
elle et lui un abandon familier dont ni l’un ni l’autre ne songeait à s’étonner,
tant il leur semblait naturel.
Et, dans son coin, Zach Fren,
effrayé de ce qu’il comprenait, des sentiments qu’il voyait s’enraciner dans
l’âme de Dolly, murmurait :
« La pauvre femme !…
La pauvre femme !… Où se laisse-t-elle entraîner ! »
Mrs. Branican s’était levée, et
dit :
« Allez, Godfrey !…
Allez, mon enfant !… Je vous reverrai… J’ai besoin d’être seule… »
Après l’avoir regardée une
dernière fois, le jeune novice se retira lentement. Zach Fren se préparait à le
suivre, lorsque Dolly l’arrêta d’un geste.
« Restez, Zach. »
Puis :
« Zach, dit-elle par
mots saccadés, qui dénotaient l’extraordinaire agitation de son esprit, Zach, cet
enfant a été élevé avec les enfants trouvés de Wat-House… Il est né à San-Diégo…
Il a de quatorze ans à quinze ans… Il ressemble trait pour trait à John… C’est
sa physionomie franche, son attitude résolue… Il a le goût de la mer comme lui…
C’est le fils d’un marin… C’est le fils de John… C’est le mien !… On
croyait que la baie de San-Diégo avait à jamais englouti le pauvre petit être…
Mais il n’était pas mort… et on l’a sauvé… Ceux qui l’ont sauvé ne
connaissaient pas sa mère… Et sa mère, c’était moi… moi, alors privée de raison !…
Cet enfant, ce n’est pas Godfrey qu’il se nomme… c’est Wat… c’est mon fils !…
Dieu a voulu me le rendre avant de me réunir à son père… »
Zach Fren avait écouté Mrs.
Branican sans oser l’interrompre. Il comprenait que la malheureuse femme ne pouvait
parler autrement. Toutes les apparences lui donnaient raison. Elle suivait son
idée avec l’irréfutable logique d’une mère. Et le brave marin sentait son cœur
se briser, car ces illusions, c’était son devoir de les détruire. Il fallait
arrêter Dolly sur cette pente, qui aurait pu la conduire à un nouvel abîme.
Il le fit, sans hésiter –
presque brutalement.
« Mistress Branican, dit-il,
vous vous trompez !… Je ne veux pas, je ne dois pas vous laisser croire ce
qui n’est point !… Cette ressemblance, ce n’est qu’un hasard… Votre petit
Wat est mort… oui ! mort !… Il a péri dans la catastrophe, et Godfrey
n’est pas votre fils…
– Wat est mort ?…
s’écria Mrs. Branican. Et qu’en savez-vous ?… Et qui peut l’affirmer ?…
– Moi, mistress.
– Vous ?…
– Huit jours après la
catastrophe de la baie, le corps d’un enfant a été rejeté sur la grève, à la
pointe Loma… C’est moi qui l’ai retrouvé… J’ai prévenu M. William Andrew…
Le petit Wat, reconnu par lui, a été enterré au cimetière de San-Diégo, où nous
avons souvent porté des fleurs sur sa tombe…
– Wat !… mon petit Wat…
là-bas… au cimetière !… Et on ne me l’a jamais dit !
– Non, mistress, non !
répondit Zach Fren. Vous n’aviez plus votre raison alors, et, quatre ans après,
lorsque vous l’avez recouvrée, on craignait… M. William Andrew pouvait
redouter… en renouvelant vos douleurs… et il s’est tu !… Mais votre enfant
est mort, mistress, et Godfrey ne peut pas être… n’est pas votre fils ! »
Dolly retomba sur le divan.
Ses yeux s’étaient fermés. Il lui semblait qu’autour d’elle l’ombre avait
brusquement succédé à une intense lumière.
Sur un geste qu’elle fit, Zach
Fren la laissa seule, abîmée dans ses regrets, perdue dans ses souvenirs.
Le lendemain, 26 août, Mrs.
Branican n’avait pas encore quitté sa cabine, lorsque le Brisbane, après
avoir franchi la passe de Backstairs, entre l’île Kangourou et le promontoire
Jervis, pénétra dans le golfe de Saint-Vincent et vint mouiller au port
d’Adélaïde.
Des trois capitales de l’Australie,
Sydney est l’aînée, Melbourne est la puînée, Adélaïde est la cadette. En vérité,
si la dernière est la plus jeune, on peut affirmer qu’elle est aussi la plus
jolie. Elle est née en 1853, d’une mère, l’Australie méridionale – qui n’a
d’existence politique que depuis 1837, et dont l’indépendance, officiellement
reconnue, ne date que de 1856. Il est même probable que la jeunesse d’Adélaïde
se prolongera indéfiniment sous un climat sans rival, le plus salubre du continent,
au milieu de ces territoires que n’attristent ni la phtisie, ni les fièvres
endémiques, ni aucun genre d’épidémie contagieuse. On y meurt quelquefois, cependant ;
mais, comme le fait spirituellement observer M. D. Charnay, « ce pourrait
bien être une exception ». Si le sol de l’Australie méridionale diffère de
celui de la province voisine en ce qu’il ne renferme pas de gisements aurifères,
il est riche en minerai de cuivre. Les mines de Capunda, de Burra-Burra, de
Wallaroo et de Munta, découvertes depuis une quarantaine d’années, après avoir
attiré les émigrants par milliers, ont fait la fortune de la province. Adélaïde
ne s’élève pas sur la limite littorale du golfe de Saint-Vincent. De même que
Melbourne, elle est située à une douzaine de kilomètres à l’intérieur, et un
railway la met en communication avec le port. Son jardin botanique peut
rivaliser avec celui de sa seconde sœur. Créé par Schumburg, il possède des
serres, qui ne trouveraient pas leurs égales dans le monde entier, des plantations
de roses qui sont de véritables parcs, de magnifiques ombrages sous l’abri des
plus beaux arbres de la zone tempérée, mélangés aux diverses essences de la
zone semi-tropicale.
Ni Sydney, ni Melbourne ne
sauraient entrer en comparaison avec Adélaïde pour son élégance. Ses rues sont
larges, agréablement distribuées, soigneusement entretenues. Quelques-unes
possèdent de splendides monuments en bordure, telle King-William-Street.
L’hôtel des postes et l’hôtel de ville méritent d’être remarqués au point de
vue architectonique. Au milieu du quartier marchand, les rues Hindley et
Glenell s’animent bruyamment au souffle du mouvement commercial. Là, circulent
nombre de gens affairés, mais qui ne semblent éprouver que cette satisfaction
due à des opérations sagement conduites, abondantes, faciles, sans aucun de ces
soucis qu’elles provoquent d’habitude.
Mrs. Branican était descendue
dans un hôtel de King-William-Street, où Zach Fren l’avait accompagnée. La mère
venait de subir une cruelle épreuve par l’anéantissement de ses dernières
illusions. Il y avait tant d’apparence que Godfrey pût être son fils, qu’elle
s’y était tout de suite abandonnée. Cette déception se lisait sur sa figure, plus
pâle que de coutume, au fond de ses yeux rougis par les larmes. Mais, à partir
de l’instant où son espoir avait été brisé comme sans retour, elle n’avait plus
cherché à revoir le jeune novice, elle n’avait plus parlé de lui. Il ne restait
dans son souvenir que cette surprenante ressemblance, qui lui rappelait l’image
de John.
Désormais, Dolly serait tout
à son œuvre, et s’occuperait sans arrêt des préparatifs de l’expédition. Elle
ferait appel à tous les concours, à tous les dévouements. Elle saurait dépenser,
s’il le fallait, sa fortune entière en ces nouvelles recherches, stimuler par
des primes importantes le zèle de ceux qui uniraient leurs efforts aux siens
dans une suprême tentative.
Les dévouements ne devaient
pas lui faire défaut. Cette province de l’Australie méridionale, c’est par
excellence la patrie des audacieux explorateurs. De là les plus célèbres
pionniers se sont lancés à travers les territoires inconnus du centre. De ses
entrailles sont sortis les Warburton, les John Forrest, les Giles, les Sturt, les
Lindsay, dont les itinéraires s’entrecroisent sur les cartes de ce vaste
continent – itinéraires que Mrs. Branican allait obliquement couper du sien.
C’est ainsi que le colonel Warburton, en 1874, traversa l’Australie dans toute
sa largeur sur le vingtième degré de l’est au nord-ouest jusqu’à Nichol-Bay –
que John Forrest, en la même année, se transporta en sens contraire, de Perth à
Port-Augusta – que Giles, en 1876, partit également de Perth pour gagner le
golfe Spencer sur le vingt-cinquième degré.
Il avait été convenu que les
divers éléments de l’expédition, matériel et personnel, seraient réunis, non
pas à Adélaïde, mais au point terminus du railway, qui remonte vers le nord à
la hauteur du lac Eyre. Cinq degrés franchis dans ces conditions, ce serait
gagner du temps, éviter des fatigues. Au milieu des districts sillonnés par le
système orographique des Flinders-Ranges, on trouverait à rassembler le nombre
de chariots et d’animaux nécessaires à cette campagne, les chevaux de l’escorte,
les bœufs destinés au transport des vivres et effets de campement. À la surface
de ces interminables déserts, de ces immenses steppes de sable, dépourvus de
végétation, presque sans eau, il s’agissait de pourvoir aux besoins d’une
caravane, qui comprendrait une quarantaine de personnes, en comptant les gens
de service et la petite troupe destinée à assurer la sécurité des voyageurs.
Quant à ces engagements, Dolly
s’occupa de les réaliser à Adélaïde même. Elle trouva, d’ailleurs, un constant
et ferme appui près du gouverneur de l’Australie méridionale, qui s’était mis à
sa disposition. Grâce à lui, trente hommes, bien montés, bien armés, les uns
d’origine indigène, les autres choisis parmi les colons européens, acceptèrent
les propositions de Mrs. Branican. Elle leur garantissait une solde très élevée
pour la durée de la campagne, et une prime se chiffrant par une centaine de livres
à chacun d’eux, dès qu’elle serait achevée, quel qu’en fût le résultat. Ils
seraient commandés par un ancien officier de la police provinciale, Tom Marix, un
robuste et résolu compagnon, âgé d’une quarantaine d’années, dont le gouverneur
répondait. Tom Marix avait choisi ses hommes avec soin parmi les plus vigoureux
et les plus sûrs de ceux qui s’étaient offerts en grand nombre. Dès lors il y
avait lieu de compter sur le dévouement de cette escorte, recrutée dans les
meilleures conditions.
Le personnel de service
serait placé sous les ordres de Zach Fren et il n’y aurait pas de sa faute « si
gens et bêtes ne marchaient pas carrément et rondement », ainsi qu’il le
disait volontiers.
De fait, au-dessus de Tom
Marix et de Zach Fren, le chef véritable – chef incontesté – c’était Mrs.
Branican, l’âme de l’expédition.
Par les soins des
correspondants de M. William Andrew, un crédit considérable avait été
ouvert à Mrs. Branican à la Banque d’Adélaïde, et elle pouvait y puiser à
pleines mains.
Ces préparatifs achevés, il
fut convenu que Zach Fren partirait le 30 au plus tard pour la station de
Farina-Town, où Mrs. Branican le rejoindrait avec le personnel, lorsque sa
présence ne serait plus nécessaire à Adélaïde.
« Zach, lui dit-elle, vous
tiendrez la main à ce que notre caravane soit prête à se mettre en route dès la
fin de la première semaine de septembre. Payez tout comptant, à n’importe quel
prix. Les vivres vous seront expédiés d’ici par le railway, et vous les ferez
charger sur les chariots à Farina-Town. Nous ne devons rien négliger pour assurer
le succès de notre campagne.
– Tout sera prêt, mistress
Branican, répondit le maître. Quand vous arriverez, il n’y aura plus qu’à
donner le signal du départ. »
On imagine aisément que Zach
Fren ne manqua pas de besogne pendant les derniers jours qu’il passa à
Adélaïde. En style de marin, il se « pomoya » avec tant d’activité, que
le 29 août, il put prendre son billet pour Farina-Town. Douze heures après que
le railway l’eut déposé à cette station extrême de la ligne, il prévint Mrs.
Branican par le télégraphe qu’une partie du matériel de l’expédition était déjà
réuni.
De son côté, aidée de Tom
Marix, Dolly remplit sa tâche en ce qui concernait l’escorte, son armement, son
habillement. Il importait que les chevaux fussent choisis avec soin, et la race
australienne pouvait en fournir d’excellents, rompus à la fatigue, à l’épreuve
du climat, d’une sobriété parfaite. Tant qu’ils parcourraient les forêts et les
plaines, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter de leur nourriture, l’herbe et
l’eau étant assurées sur ces territoires. Mais au delà, à travers les déserts
sablonneux, il y aurait lieu de les remplacer par des chameaux. C’est ce qui
serait fait, dès que la caravane aurait atteint la station d’Alice-Spring. C’est
à partir de ce point que Mrs. Branican et ses compagnons s’apprêteraient à
lutter contre les obstacles matériels qui rendent si redoutable une exploration
dans les régions de l’Australie centrale.
Les occupations auxquelles se
livrait cette énergique femme l’avaient quelque peu distraite des derniers
incidents de sa navigation à bord du Brisbane. Elle s’était étourdie
dans ce déploiement d’activité, qui ne lui laissait pas une heure de loisir. De
cette illusion à laquelle son imagination s’était livrée un instant, de cet
espoir éphémère que l’aveu de Zach Fren avait anéanti d’un mot, il ne lui
restait plus que le souvenir. Elle savait à présent que son petit enfant
reposait là-bas, en un coin du cimetière de San-Diégo, et qu’elle pourrait
aller pleurer sur sa tombe… Et, cependant, cette ressemblance du novice… Et
l’image de John et de Godfrey se confondant dans son esprit…
Depuis l’arrivée du paquebot,
Mrs. Branican n’avait plus revu le jeune garçon. Si celui-ci avait cherché à la
rencontrer pendant les premiers jours qui avaient suivi son débarquement, elle
l’ignorait. En tout cas, il ne semblait pas que Godfrey se fût présenté à
l’hôtel de King-William-Street. Et pourquoi l’aurait-il fait ? Après le dernier
entretien qu’il avait eu avec elle, Dolly s’était renfermée dans sa cabine et
ne l’avait point demandé. Dolly savait d’ailleurs que le Brisbane était
reparti pour Melbourne, et qu’à l’époque où le paquebot reviendrait à Adélaïde,
elle n’y serait plus.
Tandis que Mrs. Branican
activait ses préparatifs, un autre personnage s’occupait non moins opiniâtrement
d’un voyage identique. Il était descendu dans un hôtel de Hindley-Street. Un
appartement sur le devant de l’hôtel, une chambre sur la cour intérieure, réunissaient
sous le même toit ces singuliers représentants de la race aryenne et de la race
jaune, l’Anglais Jos Meritt et le Chinois Gîn-Ghi.
D’où venaient ces deux types,
empruntés à l’extrême Asie et à l’extrême Europe ? Où allaient-ils ?
Que faisaient-ils à Melbourne et que venaient-ils faire à Adélaïde ? Enfin,
en quelle circonstance ce maître et ce serviteur s’étaient-ils associés – celui-là
payant celui-ci, celui-ci servant celui-là – pour courir le monde de conserve ?
C’est ce qui va ressortir d’une conversation à laquelle prenaient part Jos Meritt
et Gîn-Ghi, dans la soirée du 5 septembre – conversation que complétera une
explication sommaire.
Et de prime abord, si
quelques traits de caractère, quelques manies, la singularité de ses attitudes,
la façon dont il s’exprimait, ont permis d’entrevoir la silhouette de cet
Anglo-Saxon, il convient de faire connaître aussi ce Céleste, à son service, qui
avait conservé les vêtements traditionnels du pays chinois, la chemisette « han
chaol », la tunique « ma coual », la robe « haol »
boutonnée sur le flanc, et le pantalon bouffant avec ceinture d’étoffe. S’il se
nommait Gîn-Ghi, il méritait ce nom, qui au sens propre signifie « homme
indolent ». Et il l’était, indolent, et à un degré rare, devant la besogne
comme devant le danger. Il n’eût pas fait dix pas pour exécuter un ordre ;
il n’en aurait pas fait vingt pour éviter un péril. Il fallait, c’est positif, que
Jos Meritt eût une prodigieuse dose de patience pour garder un tel serviteur. À
la vérité, c’était affaire d’habitude, car depuis cinq à six années, ils
voyageaient ensemble. L’un avait rencontré l’autre à San-Francisco, où les
Chinois fourmillent, et il en avait fait son domestique « à l’essai »,
avait-il dit – essai qui se prolongerait sans doute jusqu’à la séparation
suprême. À mentionner aussi, Gîn-Ghi, élevé à Hong-Kong, parlait l’anglais
comme un natif de Manchester.
Du reste, Jos Meritt ne
s’emportait guère, étant d’un tempérament essentiellement flegmatique. S’il
menaçait Gîn-Ghi des plus épouvantables tortures en usage dans le Céleste-Empire
– où le Ministère de la justice s’appelle, de son vrai nom, le Ministère des
supplices – il ne lui aurait pas donné une chiquenaude. Lorsque ses ordres
n’étaient pas exécutés, il les exécutait lui-même. Cela simplifiait la
situation. Peut-être le jour n’était-il pas éloigné où il servirait son
serviteur. Très probablement, ce Chinois inclinait à le penser, et, à son sens,
ce ne serait qu’équitable. Toutefois, en attendant cet heureux revirement de
fortune, Gîn-Ghi était contraint de suivre son maître n’importe où la vagabonde
fantaisie entraînait cet original. Là-dessus, Jos Meritt ne transigeait pas. Il
eût transporté sur ses épaules la malle de Gîn-Ghi plutôt que de laisser
Gîn-Ghi en arrière, quand le train ou le paquebot allaient partir. Bon gré mal
gré, « l’homme indolent » devait lui emboîter le pas, quitte à
s’endormir en route dans la plus parfaite indolence. C’est ainsi que l’un avait
accompagné l’autre pendant des milliers de milles sur l’ancien et le nouveau
continent, et c’est en conséquence de ce système de locomotion continue que
tous deux se trouvaient, à cette époque, dans la capitale de l’Australie
méridionale.
« Bien !… Oh !…
Très bien ! avait dit ce soir-là Jos Meritt. Je pense que nos dispositions
sont prises ?… »
Et on ne s’explique guère
pourquoi il interrogeait Gîn-Ghi à ce sujet, puisqu’il avait dû tout préparer
de ses propres mains. Mais il n’y manquait jamais – pour le principe.
« Dix mille fois
terminées, répondit le Chinois, qui n’avait pu se défaire des tournures
phraséologiques en honneur chez les habitants du Céleste-Empire.
– Nos valises ?…
– Sont bouclées.
– Nos armes ?…
– Sont en état.
– Nos caisses de vivres ?…
– C’est vous-même, mon maître
Jos, qui les avez mises en consigne à la gare. Et, d’ailleurs, est-il nécessaire
de s’approvisionner de vivres… quand on est destiné à être mangé
personnellement… un jour ou l’autre !
– Être mangé, Gîn-Ghi ?…
Bien !… Oh !… Très bien ! Vous comptez donc toujours être mangé ?
– Cela arrivera tôt ou tard, et
il s’en est fallu de peu, il y a six mois, que nous n’ayons terminé nos voyages
dans le ventre d’un cannibale… moi surtout !
– Vous, Gîn-Ghi ?…
– Oui, par l’excellente
raison que je suis gras, tandis que vous, mon maître Jos, vous êtes maigre, et
que ces gens-là me donneront sans hésiter la préférence !
– La préférence ?… Bien !…
Oh !… Très bien !
– Et puis les indigènes
australiens n’ont-ils pas un goût particulier pour la chair jaune des Chinois, laquelle
est d’autant plus délicate qu’ils se nourrissent de riz et de légumes ?
– Aussi n’ai-je cessé de vous
recommander de fumer, Gîn-Ghi, répondit le flegmatique Jos Meritt. Vous le
savez, les anthropophages n’aiment pas la chair des fumeurs. »
Et c’est ce que faisait sans
désemparer le prudent Céleste, fumant non de l’opium, mais le tabac que Jos
Meritt lui fournissait à discrétion. Les Australiens, paraît-il, de même que
leurs confrères en cannibalisme des autres pays, éprouvent une invincible
répugnance pour la chair humaine, lorsqu’elle est imprégnée de nicotine. C’est
pourquoi Gîn-Ghi travaillait en conscience à se rendre de plus en plus
immangeable.
Mais était-il bien exact que
son maître et lui se fussent déjà exposés à figurer dans un repas
d’anthropophages, et non en qualité de convives ? Oui, sur certaines
parties de la côte d’Afrique, Jos Meritt et son serviteur avaient failli
achever de cette façon leur existence aventureuse. Dix mois auparavant, dans le
Queensland, à l’ouest de Rockhampton et de Gracemère, à quelques centaines de
milles de Brisbane, leurs pérégrinations les avaient conduits au milieu des
plus féroces tribus d’aborigènes. Là, le cannibalisme est à l’état endémique, pourrait-on
dire. Aussi Jos Meritt et Gîn-Ghi, tombés entre les mains de ces noirs, eussent-ils
infailliblement péri, sans l’intervention de la police. Délivrés à temps, ils
avaient pu regagner la capitale du Queensland, puis Sydney, d’où le paquebot
venait de les ramener à Adélaïde. En somme, cela n’avait pas corrigé l’Anglais
de ce besoin d’exposer sa personne et celle de son compagnon, puisque, au dire
de Gîn-Ghi, ils se préparaient à visiter le centre du continent australien.
« Et tout cela, pour un
chapeau ! s’écria le Chinois. Ay ya… Ay ya !… Lorsque j’y
pense, mes larmes s’égrènent comme des gouttes de pluie sur les jaunes chrysanthèmes !
– Quand vous aurez fini
d’égrener… Gîn-Ghi ? répliqua Jos Meritt en fronçant son sourcil.
– Mais, ce chapeau, si vous
le retrouvez jamais, mon maître Jos, ce ne sera plus qu’une loque…
– Assez, Gîn-Ghi !… Trop
même !… Je vous défends de vous exprimer ainsi sur ce chapeau-là et sur
n’importe quel autre ! Vous m’entendez ?… Bien !… Oh !…
Très bien ! Si cela recommence, je vous ferai administrer de quarante à cinquante
coups de rotin sous la plante des pieds !
– Nous ne sommes pas en Chine,
riposta Gîn-Ghi.
– Je vous priverai de
nourriture !
– Cela me fera maigrir.
– Je vous couperai votre
natte au ras du crâne !
– Couper ma natte ?…
– Je vous mettrai à la diète
de tabac !
– Le dieu Fô me protège !
– Il ne vous protégera pas. »
Et, devant cette dernière menace,
Gîn-Ghi redevint soumis et respectueux.
En réalité, de quel chapeau
s’agissait-il, et pourquoi Jos Meritt passait-il sa vie à courir après un
chapeau ?
Cet original, on l’a dit, était
un Anglais de Liverpool, un de ces inoffensifs maniaques, qui n’appartiennent
pas en propre au Royaume-Uni. Ne s’en rencontre-t-il pas sur les bords de la
Loire, de l’Elbe, du Danube ou de l’Escaut, aussi bien que dans les contrées
arrosées par la Tamise, la Clyde ou la Tweed ? Jos Meritt était fort riche,
et très connu dans le Lancastre et comtés voisins pour ses fantaisies de
collectionneur. Ce n’étaient point des tableaux, des livres, des objets d’art, pas
même des bibelots qu’il ramassait à grand effort et à grands frais. Non !
C’étaient des chapeaux – un musée de couvre-chefs historiques – coiffures
quelconques d’hommes ou de femmes, tromblons, tricornes, bicornes, pétases, calèches,
clabauds, claques, gibus, casques, claque-oreilles, bousingots, barrettes, bourguignottes,
calottes, turbans, toques, caroches, casquettes, fez, shakos, képis, cidares, colbacks,
tiares, mitres, tarbouches, schapskas, poufs, mortiers de présidents, llautus
des Incas, hennins du moyen âge, infules sacerdotaux, gasquets de l’Orient, cornes
des doges, chrémeaux de baptême, etc., etc., des centaines et des centaines de
pièces, plus ou moins lamentables, effilochées, sans fond et sans bords. À l’en
croire, il possédait de précieuses curiosités historiques, le casque de Patrocle,
lorsque ce héros fut tué par Hector au siège de Troie, le béret de Thémistocle
à la bataille de Salamine, les barrettes de Galien et d’Hippocrate, le chapeau
de César qu’un coup de vent avait emporté au passage du Rubicon, la coiffure de
Lucrèce Borgia à chacun de ses trois mariages avec Sforze, Alphonse d’Este et
Alphonse d’Aragon, le chapeau de Tamerlan quand ce guerrier franchit le Sind, celui
de Gengis-Khan lorsque ce conquérant fit détruire Boukhara et Samarkande, la
coiffure d’Elisabeth à son couronnement, celle de Marie Stuart lorsqu’elle
s’échappa du château de Lockleven, celle de Catherine II quand elle fut sacrée
à Moscou, le suroët de Pierre-le-Grand lorsqu’il travaillait aux chantiers de
Saardam, le claque de Marlborough à la bataille de Ramilies, celui d’Olaüs, roi
de Danemark, tué à Sticklestad, le bonnet de Gessler que refusa de saluer
Guillaume Tell, la toque de William Pitt quand il entra à vingt-trois ans au
ministère, le bicorne de Napoléon Ier à Wagram, enfin cent autres non moins
curieux. Son plus vif chagrin était de ne point posséder la calotte qui
coiffait Noé le jour où l’arche s’arrêtait sur la cime du mont Ararat, et le bonnet
d’Abraham au moment où ce patriarche allait sacrifier Isaac. Mais Jos Meritt ne
désespérait pas de les découvrir un jour. Quant aux cidares que devaient porter
Adam et Ève, lorsqu’ils furent chassés du paradis terrestre, il avait renoncé à
se les procurer, des historiens dignes de foi ayant établi que le premier homme
et la première femme avaient l’habitude d’aller nu-tête.
On voit, par cet étalage très
succinct des curiosités du musée Jos Meritt, en quelles occupations vraiment
enfantines s’écoulait la vie de cet original. C’était un convaincu, il ne doutait
pas de l’authenticité de ses trouvailles, et ce qu’il lui avait fallu parcourir
de pays, visiter de villes et de villages, fouiller de boutiques et d’échoppes,
fréquenter de fripiers et de revendeurs, dépenser de temps et d’argent pour
n’atteindre, après des mois de recherches, qu’une loque qu’on ne lui vendait
qu’au poids de l’or ! C’était le monde entier qu’il réquisitionnait afin
de mettre la main sur quelque objet introuvable, et, maintenant qu’il avait
épuisé les stocks de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique, de
l’Océanie par lui-même, par ses correspondants, par ses courtiers, par ses
voyageurs de commerce, voici qu’il s’apprêtait à fouiller, jusque dans ses plus
inabordables retraites, le continent australien !
Il y avait une raison à cela
– raison que d’autres eussent sans doute regardée comme insuffisante, mais qui
lui paraissait des plus sérieuses. Ayant été informé que les nomades de
l’Australie se coiffaient volontiers de chapeaux d’homme ou de femme – en quel
état de dépenaillement, on l’imagine ! – sachant d’autre part que des cargaisons
de ces vieux débris étaient régulièrement expédiées dans les ports du littoral,
il en avait conclu qu’il y aurait peut-être là « quelque beau coup à faire »,
pour parler le langage des amateurs d’antiquailles.
Précisément, Jos Meritt était
en proie à une idée fixe, tourmenté par un désir qui l’obsédait, qui menaçait
de le rendre complètement fou, car il l’était à demi déjà. Il s’agissait, cette
fois, de retrouver un certain chapeau, qui, à l’entendre, devait être l’honneur
de sa collection.
Quelle était cette merveille ?
Par quel fabricant ancien ou moderne ce chapeau avait-il été confectionné ?
Sur quelle tête royale, noble, bourgeoise ou roturière, s’était-il posé et en
quelle circonstance ? Ce secret, Jos Meritt ne l’avait jamais confié à
personne. Quoi qu’il en soit, à la suite de précieuses indications, en suivant
une piste avec l’ardeur d’un Chingachgook ou d’un Renard-Subtil, il avait
acquis cette conviction que ledit chapeau, après une longue série de
vicissitudes, devait achever sa carrière sur le crâne de quelque notable d’une
tribu australienne, en justifiant doublement sa qualification de « couvre-chef ».
S’il réussissait à le découvrir, Jos Meritt le paierait ce que l’on voudrait, il
le volerait, si on ne voulait pas le lui vendre. Ce serait le trophée de cette
campagne, qui l’avait déjà entraîné au nord-est du continent. Aussi, n’ayant
pas réussi dans sa première tentative, se disposait-il à braver les trop réels
dangers d’une expédition en Australie centrale. Voilà pourquoi Gîn-Ghi allait
de nouveau s’exposer à finir son existence sous la dent des cannibales, et
quels cannibales ?… Les plus féroces de tous ceux dont il avait
jusqu’alors affronté la mâchoire. Au fond, il faut bien le reconnaître, le
serviteur était si attaché à son maître – l’attachement de deux canards
mandarins – autant par intérêt que par affection, qu’il n’aurait pu se séparer
de lui.
« Demain matin nous
partirons d’Adélaïde par l’express, dit Jos Meritt.
– À la deuxième veille ?…
répondit Gîn-Ghi.
– À la deuxième veille, si
vous voulez, et faites en sorte que tout soit prêt pour le départ.
– Je ferai de mon mieux, mon
maître Jos, en vous priant d’observer que je n’ai pas les dix mille mains de la
déesse Couan-in !
– Je ne sais pas si la déesse
Couan-in a dix mille mains, répondit Jos Meritt, mais je sais que vous en avez
deux, et je vous prie de les employer à mon service…
– En attendant qu’on me les
mange !
– Bien !… Oh !…
Très bien ! »
Et, sans doute, Gîn-Ghi ne se
servit pas de ses mains plus activement que d’habitude, préférant s’en rapporter
à son maître pour faire sa besogne. Donc, le lendemain les deux originaux
quittaient Adélaïde et le train les emportait à toute vapeur vers ces régions
inconnues, où Jos Meritt espérait enfin découvrir le chapeau qui manquait à sa
collection. Quelques jours plus tard, Mrs. Branican allait également quitter la
capitale de l’Australie méridionale. Tom Marix venait de compléter le personnel
de son escorte, qui comprenait quinze hommes blancs ayant fait partie des
milices locales, et quinze indigènes déjà employés au service de la province
dans la police du gouverneur. Cette escorte était destinée à protéger la
caravane contre les nomades et non à combattre la tribu des Indas. Il ne faut
point oublier ce qu’avait dit Harry Felton : il s’agissait plutôt de délivrer
le capitaine John au prix d’une rançon que de l’arracher par la force aux
indigènes qui le retenaient prisonnier.
Des vivres, en quantité
suffisante pour l’approvisionnement d’une quarantaine de personnes pendant une
année, occupaient deux fourgons du train, qui seraient déchargés à Farina-Town.
Chaque jour, une lettre de Zach Fren, datée de cette station, avait tenu Dolly
au courant de ce qui se faisait. Les bœufs et les chevaux, achetés par les
soins du maître, se trouvaient réunis avec les gens destinés à servir de conducteurs.
Les chariots, remisés à la gare, étaient prêts à recevoir les caisses de vivres,
les ballots de vêtements, les ustensiles, les munitions, les tentes, en un mot
tout ce qui constituait le matériel de l’expédition. Deux jours après l’arrivée
du train, la caravane pourrait se mettre en marche.
Mrs. Branican avait fixé son
départ d’Adélaïde au 9 septembre. Dans un dernier entretien qu’elle eut avec le
gouverneur de la province, celui-ci ne cacha point à l’intrépide femme quels périls
elle aurait à affronter.
« Ces périls sont de
deux sortes, mistress Branican, dit-il, ceux que font courir ces tribus très
farouches au milieu de régions dont nous ne sommes pas les maîtres, et ceux qui
tiennent à la nature même de ces régions. Dénuées de toutes ressources, notamment
privées d’eau, car les rivières et les puits sont déjà taris par la sécheresse,
elles vous réservent de terribles souffrances. Pour cette raison, peut-être
eût-il mieux valu n’entrer en campagne que six mois plus tard, à la fin de la
saison chaude…
– Je le sais, monsieur le
gouverneur, répondit Mrs. Branican, et je suis préparée à tout. À dater de mon
départ de San-Diégo, j’ai étudié le continent australien, en lisant et relisant
les récits des voyageurs qui l’ont visité, les Burke, les Stuart, les Giles, les
Forrest, les Sturt, les Grégorys, les Warburton. J’ai pu aussi me procurer la
relation de l’intrépide David Lindsay, qui du mois de septembre 1887 au mois
d’avril 1888 est parvenu à franchir l’Australie entre Port-Darwin au nord et
Adélaïde au sud. Non ! je n’ignore rien des fatigues ni des dangers d’une
telle campagne. Mais je vais où le devoir me commande d’aller.
– L’explorateur David Lindsay,
répondit le gouverneur, s’est borné à suivre des régions déjà reconnues, puisque
la ligne télégraphique transcontinentale sillonne leur surface. Aussi
n’avait-il emmené avec lui qu’un jeune indigène et quatre chevaux de bât. Vous,
au contraire, mistress Branican, puisque vous allez à la recherche de tribus
nomades, vous serez contrainte de diriger votre caravane en dehors de cette
ligne, de vous aventurer dans le nord-ouest du continent jusqu’aux déserts de
la Terre de Tasman ou de la Terre de Witt…
– J’irai jusqu’où cela sera
nécessaire, monsieur le gouverneur, reprit Mrs. Branican. Ce que David Lindsay
et ses prédécesseurs ont fait, c’était dans l’intérêt de la civilisation, de la
science ou du commerce. Ce que je ferai, moi, c’est pour délivrer mon mari, aujourd’hui
le seul survivant du Franklin. Depuis sa disparition, et contre
l’opinion de tous, j’ai soutenu que John Branican était vivant, et j’ai eu
raison. Pendant six mois, pendant un an, s’il le faut, je parcourrai ces
territoires avec la conviction que je le retrouverai et j’aurai raison de
nouveau. Je compte sur le dévouement de mes compagnons, monsieur le gouverneur,
et notre devise sera : Jamais en arrière !
– C’est la devise des Douglas,
mistress, et je ne doute pas qu’elle vous mène au but…
– Oui… avec l’aide de Dieu ! »
Mrs. Branican prit congé du
gouverneur, en le remerciant du concours qu’il lui avait prêté dès son arrivée
à Adélaïde. Le soir même – 9 septembre – elle quittait la capitale de
l’Australie méridionale. Les chemins de fer australiens sont établis dans
d’excellentes conditions : wagons confortables qui roulent sans secousse ;
voies dont le parfait état ne provoque que d’insensibles trépidations. Le train
se composait de six voitures, en comprenant les deux fourgons de bagages. Mrs.
Branican occupait un compartiment réservé avec une femme, nommée Harriett, d’origine
mi-saxonne mi-indigène, qu’elle avait engagée à son service. Tom Marix et les
gens de l’escorte s’étaient placés dans les autres compartiments. Le train ne
s’arrêtait que pour le renouvellement de l’eau et du combustible de la machine,
et ne faisait que des haltes très courtes aux principales stations. La durée du
parcours serait ainsi abrégée d’un quart environ. Au delà d’Adélaïde, le train
se dirigea vers Gawler en remontant le district de ce nom. Sur la droite de la
ligne se dressaient quelques hauteurs boisées qui dominent cette partie du territoire.
Les montagnes de l’Australie ne se distinguent pas par leur altitude, qui ne
dépasse guère deux mille mètres, et elles sont en général reportées à la
périphérie du continent. On leur attribue une origine géologique très reculée, leur
composition comprenant surtout le granit et les couches siluriennes. Cette
portion du district, très accidentée, coupée de gorges, obligeait la voie à
faire de nombreux détours, tantôt le long de vallées étroites, tantôt au milieu
d’épaisses forêts, où la multiplication de l’eucalyptus est vraiment
exubérante. À quelques degrés de là, lorsqu’il desservira les plaines du centre,
le railway pourra suivre l’imperturbable ligne droite qui doit être la caractéristique
du chemin de fer moderne.
À partir de Gawler, d’où se
détache un embranchement sur Great-Bend, le grand fleuve Murray décrit un coude
brusque en s’infléchissant vers le sud. Le train, après l’avoir quitté, et
avoir côtoyé la limite du district de Light, atteignit le district de Stanley à
la hauteur du trente-quatrième parallèle. S’il n’eût fait nuit, on aurait pu
apercevoir la dernière cime du mont Bryant, le plus élevé de ce nœud orographique,
qui se projette à l’est de la voie. Depuis ce point, les dénivellations du sol
se font plutôt sentir à l’ouest, et la ligne longe la base tourmentée de cette
chaîne, dont les principaux sommets sont les monts Bluff, Remarkable, Brown et
Ardon. Leurs ramifications viennent mourir sur les bords du lac Torrens, vaste
bassin en communication, sans doute, avec le golfe Spencer, qui entaille
profondément la côte australienne.
Le lendemain, au lever du
soleil, le train passa en vue de ces Flinders-Ranges, dont le mont Serle forme
l’extrême projection. À travers les vitres de son wagon, Mrs. Branican
regardait ces territoires si nouveaux pour elle. C’était donc là cette Australie
que l’on a à bon droit dénommée la « Terre des paradoxes », dont le
centre n’est qu’une vaste dépression au-dessous du niveau océanique ; où
les cours d’eau, pour la plupart sortis des sables, sont peu à peu absorbés
avant d’aboutir à la mer ; où l’humidité manque à l’air comme au sol ;
où se multiplient les plus étranges animaux qui soient au monde ; où
vivent à l’état errant ces tribus farouches qui fréquentent les régions du
centre et de l’ouest. Là-bas, au nord et à l’ouest, s’étendent ces interminables
déserts de la Terre Alexandra et de l’Australie occidentale, au milieu desquels
l’expédition allait chercher les traces du capitaine John. Sur quel indice se
guiderait-elle, lorsqu’elle aurait dépassé la zone des bourgades et des
villages, quand elle en serait réduite aux vagues indications, obtenues au
chevet de Harry Felton ?
Et, à ce propos, une
objection avait été posée à Mrs. Branican : Était-il admissible que le
capitaine John, depuis neuf ans qu’il était prisonnier de ces Australiens
nomades, n’eût jamais trouvé l’occasion de leur échapper ? À cette
objection, Mrs. Branican n’avait eu à opposer que cette réponse : c’est
que, d’après le dire de Harry Felton, à son compagnon et à lui une seule occasion
de s’enfuir s’était offerte pendant cette longue période – occasion dont John
n’avait pu profiter. Quant à l’argument fondé sur ce qu’il n’entrait pas dans
les habitudes des indigènes de respecter la vie de leurs prisonniers, vraisemblable
ou non, ce fait s’était produit pour les survivants du Franklin, et
Harry Felton en était la preuve. D’ailleurs, n’existait-il pas un précédent en
ce qui concernait l’explorateur William Classen disparu voilà trente-huit ans, et
que l’on croyait encore chez l’une des tribus de l’Australie septentrionale ?
Eh bien ! n’était-ce pas précisément le sort du capitaine John, puisque, en
dehors de simples présomptions, on avait la déclaration formelle de Harry
Felton ? Il est d’autres voyageurs qui n’ont jamais reparu, et rien ne démontre
qu’ils aient succombé. Qui sait si ces mystères ne s’éclairciront pas un jour !
Cependant le train filait
avec rapidité, sans s’arrêter aux petites stations. Si la voie ferrée eût été
reportée un peu plus vers l’ouest, elle aurait contourné les bords de ce lac
Torrens, qui se recourbe en forme d’arc – lac long et étroit, près duquel
s’accentuent les premières ondulations des Flinders-Ranges. Le temps était
chaud. Même température que dans l’hémisphère boréal au mois de mars pour les
pays que traverse le trentième parallèle, tels l’Algérie, le Mexique ou la
Cochinchine. On pouvait craindre quelques pluies ou même l’un de ces violents
orages que la caravane appellerait en vain de tous ses vœux, lorsqu’elle serait
engagée sur les plaines de l’intérieur. Ce fut en ces conditions que Mrs.
Branican atteignit, à trois heures de l’après-midi, la station de Farina-Town.
Là s’arrête le railway, et
les ingénieurs australiens s’occupent de le pousser plus avant vers le nord, dans
la direction de l’Overland-Telegraf-Line qui prolonge ses fils jusqu’au
littoral de la mer d’Arafoura. Si le chemin de fer continue de la suivre, il
devra s’incliner vers l’ouest, afin de passer entre le lac Torrens et le lac Eyre.
Au contraire, il se développera à la surface des territoires situés à l’orient
de ce lac, s’il n’abandonne pas le méridien qu’elle remonte à partir
d’Adélaïde.
Zach Fren et ses hommes
étaient réunis à la gare, lorsque Mrs. Branican descendit de son wagon. Ils
l’accueillirent avec grande sympathie et respectueuse cordialité. Le brave
maître était ému jusqu’au fond du cœur. Douze jours, douze longs jours !
sans avoir vu la femme du capitaine John, cela ne lui était pas arrivé depuis
le dernier retour du Dolly-Hope à San-Diégo. Dolly fut très heureuse de
retrouver son compagnon, son ami Zach Fren, dont le dévouement lui était
assuré. Elle sourit en lui pressant la main – elle qui avait presque oublié le
sourire !
Cette station de Farina-Town
est de création récente. Il est même des cartes modernes sur lesquelles elle ne
figure pas. On reconnaît là l’embryon d’une de ces villes que les railways anglais
ou américains « produisent » sur leur passage, comme les arbres
produisent des fruits ; mais ils mûrissent vite, ces fruits, grâce au
génie improvisateur et pratique de la race saxonne. Et telles de ces stations, qui
ne sont que des villages, montrent déjà par leur disposition générale, l’agencement
des places, des rues, des boulevards, qu’elles deviendront des villes à court
délai.
Ainsi était Farina-Town –
formant, à cette époque, le terminus du chemin de fer d’Adélaïde.
Mrs. Branican ne devait pas
séjourner dans cette station. Zach Fren s’était montré aussi intelligent
qu’actif. Le matériel de l’expédition, rassemblé par ses soins, comprenait
quatre chariots à bœufs et leurs conducteurs, deux buggys, attelés chacun de
deux bons chevaux, et les cochers chargés de les conduire. Les chariots avaient
déjà reçu divers objets de campement, qui avaient été expédiés d’Adélaïde.
Lorsque les fourgons du train auraient versé leur contenu, ils seraient prêts à
partir. Ce serait l’affaire de vingt-quatre ou trente-six heures.
Dès le jour même Mrs.
Branican examina ce matériel en détail. Tom Marix approuva les mesures prises
par Zach Fren. Dans ces conditions, on atteindrait sans peine l’extrême limite
de la région où les chevaux et les bœufs trouvent l’herbe nécessaire à leur
nourriture, et surtout l’eau, dont on rencontrerait rarement quelque filet dans
les déserts du centre.
« Mistress Branican, dit
Tom Marix, tant que nous suivrons la ligne télégraphique, le pays offrira des
ressources, et nos bêtes n’auront pas trop à souffrir. Mais, au delà, lorsque
la caravane se jettera vers l’ouest, il faudra remplacer chevaux et bœufs par
des chameaux de bât et de selle. Ces animaux peuvent seuls affronter ces
régions brûlantes, en se contentant des puits que séparent souvent plusieurs
jours de marche.
– Je le sais, Tom Marix, répondit
Dolly, et je me fierai à votre expérience. Nous reconstituerons la caravane, dès
que nous serons à la station d’Alice-Spring, où je compte arriver dans le plus
bref délai possible.
– Les chameliers sont partis
il y a quatre jours avec le convoi des chameaux, ajouta Zach Fren, et ils nous
attendront à cette station…
– Et n’oubliez pas, mistress,
dit Tom Marix, que là commenceront les véritables difficultés de la campagne…
– Nous saurons les vaincre ! »
répondit Dolly.
Ainsi, suivant le plan
minutieusement arrêté, la première partie du voyage, qui comprenait un parcours
de trois cent cinquante milles, allait s’accomplir avec les chevaux, les buggys
et les chariots à bœufs. Sur trente hommes de l’escorte, les blancs, au nombre
de quinze, devaient être montés ; mais, ces épaisses forêts, ces territoires
capricieusement accidentés, ne permettant pas de longues étapes, les noirs pourraient
sans peine suivre la caravane en piétons. Lorsqu’elle aurait été reformée à la
station d’Alice-Spring, les chameaux seraient réservés aux blancs, chargés
d’opérer des reconnaissances, soit pour recueillir des renseignements sur les
tribus errantes, soit pour découvrir les puits disséminés à la surface du
désert.
Il convient de mentionner ici
que les explorations entreprises à travers le continent australien, ne s’exécutent
pas autrement, depuis l’époque où les chameaux ont été, avec un tel avantage, introduits
en Australie. Les voyageurs du temps des Burke, des Stuart, des Giles, n’eussent
pas été soumis à de si rudes épreuves, s’ils avaient eu ces utiles auxiliaires
à leur disposition. C’est en 1866 que M. Elder en importa de l’Inde un
assez grand nombre avec leur équipe de chameliers afghans, et cette race
d’animaux a prospéré. Sans nul doute, c’est grâce à leur emploi que le colonel
Warburton a pu mener à bonne fin cette audacieuse campagne, qui avait pris
Alice-Spring pour point de départ, et Rockbonne pour point d’arrivée sur le
littoral de la Terre de Witt, à Nichol-Bay. Plus tard, si David Lindsay a
réussi à franchir le continent du nord au sud avec des chevaux de bât, c’est
parce qu’il s’est peu éloigné des régions que sillonne la ligne télégraphique, où
il trouvait en eau et en fourrage ce qui manque aux solitudes australiennes.
Et, à propos de ces hardis
explorateurs qui n’hésitent pas à braver ainsi des périls et des fatigues de
toutes sortes, Zach Fren fut conduit à dire :
« Vous ignorez, mistress
Branican, que nous sommes devancés sur la route d’Alice-Spring ?
– Devancés, Zach ?
– Oui, mistress. Ne vous
souvenez-vous pas de cet Anglais et de son domestique chinois, qui avaient pris
passage à bord du Brisbane de Melbourne à Adélaïde ?
– En effet, répondit Dolly, mais
ces passagers ont débarqué à Adélaïde. N’y sont-ils point restés ?…
– Non, mistress. Il y a trois
jours, Jos Meritt – c’est ainsi qu’il se nomme – est arrivé à Farina-Town par
le railway. Il m’a même demandé des détails circonstanciés touchant notre expédition,
la route qu’elle comptait suivre, et se contentant de répondre : « Bien !…
Oh !… Très bien ! » tandis que son Chinois, hochant la tête semblait
dire : « Mal !… Oh !… Très mal ! » Puis, le
lendemain, au petit jour, l’un et l’autre ont quitté Farina-Town en se
dirigeant vers le nord.
– Et comment voyagent-ils ?…
demanda Dolly.
– Ils voyagent à cheval ;
mais, une fois la station d’Alice-Spring atteinte, ils changeront comme qui
dirait leur bateau à vapeur pour un bateau à voiles – ce que nous ferons en
somme.
– Est-ce que cet Anglais est
un explorateur ?…
– Il n’en a point l’air, et
ressemble plutôt à une espèce de gentleman maniaque comme un vent de sud-ouest !
– Et il n’a pas dit à quel
propos il s’aventurait dans le désert australien ?
– Pas un mot de cela, mistress.
Néanmoins, seul avec son Chinois, j’imagine qu’il n’a point l’intention de
s’exposer à quelque mauvaise rencontre en dehors des régions habitées de la
province. Bon voyage je lui souhaite ! Peut-être le retrouverons-nous à
Alice-Spring ! »
Le lendemain, 11 septembre, à
cinq heures de l’après-midi, tous les préparatifs étaient terminés. Les
chariots avaient reçu leur charge d’approvisionnements en quantités suffisantes
pour les nécessités de ce long voyage. C’étaient des conserves de viande et de
légumes aux meilleures marques américaines, de la farine, du thé, du sucre et
du sel, sans compter les médicaments que renfermait la pharmacie portative. La
réserve de wiskey, de gin et d’eau-de-vie remplissait un certain nombre de tonnelets,
qui seraient placés plus tard à dos de chameaux. Un important stock de tabac
figurait parmi les objets de consommation – stock d’autant plus indispensable
qu’il servirait non seulement au personnel mais encore aux opérations d’échange
avec les indigènes chez lesquels il est en usage comme monnaie courante. Avec
du tabac et de l’eau-de-vie, on achèterait des tribus entières de l’Australie
occidentale. Une grosse réserve de ce tabac, quelques rouleaux de toile
imprimée, nombre d’objets de bimbeloterie, formaient la rançon du capitaine
John.
Quant au matériel de
campement, les tentes, les couvertures, les caisses contenant les vêtements et
le linge, tout ce qui était personnel à Mrs. Branican et à la femme Harriett, les
effets de Zach Fren et du chef de l’escorte, les ustensiles nécessaires à la
préparation des aliments, le pétrole destiné à leur cuisson, les munitions, comprenant
cartouches à balles et cartouches à plomb pour les fusils de chasse et les
armes confiées aux hommes de Tom Marix, tout ce matériel avait trouvé sa place
sur les chariots à bœufs.
Il n’y avait plus à présent
qu’à donner le signal.
Mrs. Branican, impatiente de
se mettre en route, fixa le départ au lendemain. Il fut décidé que, dès l’aube,
la caravane quitterait la station de Farina-Town, et prendrait la direction du
nord, en suivant l’Overland-Telegraf-Line. Bouviers, conducteurs, gens
d’escorte, cela faisait un effectif de quarante individus, enrôlés sous la
direction de Zach Fren et de Tom Marix. Tous furent avertis de se tenir prêts
au lever du jour.
Ce soir-là, vers neuf heures,
Dolly et la femme Harriett venaient de rentrer avec Zach Fren dans la maison
qu’elles occupaient près de la gare. La porte refermée, elles allaient chacune
regagner leur chambre, lorsqu’un léger coup fut frappé à l’extérieur.
Zach Fren revint sur le seuil,
ouvrit la porte, et ne put retenir une exclamation de surprise.
Devant lui, un petit paquet
sous le bras, son chapeau à la main, se tenait le novice du Brisbane.
En vérité, il semblait que
Mrs. Branican eût deviné que c’était lui !… Oui ! et comment
l’expliquer ?… Bien qu’elle ne s’attendît point à voir ce jeune garçon, avait-elle
conservé cette pensée qu’il chercherait à se rapprocher d’elle… Quoi qu’il en
soit, ce nom s’échappa instinctivement de ses lèvres avant qu’elle l’eût aperçu :
« Godfrey ! »
Godfrey était arrivé, une
demi-heure auparavant, par le train d’Adelaïde.
Quelques jours avant le
départ du paquebot, après avoir demandé au capitaine du Brisbane le règlement
de ses gages, le novice s’était fait débarquer. Une fois à terre, il n’avait
pas essayé de se présenter à l’hôtel de King-William-Street, où demeurait Mrs.
Branican. Mais que de fois il l’avait suivie, sans être vu d’elle, sans
chercher à lui parler ! D’ailleurs, tenu au courant, il savait que Zach
Fren était parti pour Farina-Town, afin d’organiser une caravane. Aussi, dès
qu’il eut appris que Mrs. Branican avait quitté Adélaïde, il prit le train, bien
résolu à la rejoindre.
Que voulait donc Godfrey, et
à quoi tendait cette démarche ?
Ce qu’il voulait, Dolly
allait le savoir.
Godfrey, introduit dans la
maison, se trouvait en présence de Mrs. Branican.
« C’est vous… mon enfant…
vous, Godfrey ? dit-elle en lui prenant la main.
– C’est lui, et que veut-il ?
murmura Zach Fren, avec un dépit très marqué, car la présence du novice lui
paraissait extrêmement fâcheuse.
– Ce que je veux ?…
répondit Godfrey. Je veux vous suivre, mistress, vous suivre aussi loin que
vous irez, ne plus jamais me séparer de vous !… Je veux aller avec vous à
la recherche du capitaine Branican, le retrouver, le ramener à San-Diégo, le
rendre à ses amis… à son pays… »
Dolly ne parvenait pas à se
contenir. Les traits de cet enfant, c’était tout John… son John bien-aimé, qu’ils
évoquaient à ses regards !
Godfrey, à ses genoux, les
mains tendues vers elle, d’un ton suppliant, répétait :
« Emmenez-moi… mistress…
emmenez-moi !…
– Viens, mon enfant, viens ! »
s’écria Dolly, qui l’attira sur son cœur.
Le départ de la caravane
s’effectua le 12 septembre, dès la première heure.
Le temps était beau, la
chaleur modérée avec petite brise. Quelques légers nuages atténuaient l’ardeur
des rayons solaires. Sous ce trente et unième parallèle, et à cette époque de
l’année, la saison chaude commençait à s’établir franchement dans la zone du
continent australien. Les explorateurs ne savent que trop combien ses excès
sont redoutables, alors que ni pluie ni ombrage ne peuvent les tempérer sur les
plaines du centre.
Il était à regretter que les
circonstances n’eussent pas permis à Mrs. Branican d’entreprendre sa campagne
cinq ou six mois plus tôt. Durant l’hiver, les épreuves d’un tel voyage auraient
été plus supportables. Les froids – par suite desquels le thermomètre s’abaisse
quelquefois jusqu’à la congélation de l’eau – sont moins à craindre que ces
chaleurs, qui élèvent la colonne mercurielle au delà de quarante degrés à
l’ombre. Antérieurement au mois de mai, les vapeurs se résolvent en averses
abondantes, les creeks se revivifient, les puits se remplissent. On n’a plus à
faire des journées de marche pour rechercher une eau saumâtre, sous un ciel
dévorant. Le désert australien est moins clément aux caravanes que le Sahara
africain : celui-ci offre sur celui-là l’avantage de posséder des oasis, on
peut justement l’appeler : « le pays de la soif ! »
Mais Mrs. Branican n’avait eu
à choisir ni son lieu ni son heure. Elle partait parce qu’il fallait partir, elle
braverait ces terribles éventualités du climat parce qu’il fallait les braver.
Retrouver le capitaine John, l’arracher aux indigènes, cela ne demandait aucun
retard, dût-elle succomber à la tâche comme avait succombé Harry Felton. Il est
vrai, les privations qu’avait supportées cet infortuné n’étaient pas réservées
à son expédition, organisée de manière à vaincre toutes les difficultés – autant
du moins que cela serait matériellement et moralement possible.
On connaît la composition de
la caravane, qui comptait quarante et une personnes depuis l’arrivée de
Godfrey. Voici l’ordre adopté pendant la marche au nord de Farina-Town, au
milieu des forêts et le long des creeks, où le cheminement ne présenterait
aucun obstacle sérieux.
En tête, allaient les quinze
Australiens, vêtus d’un pantalon et d’une casaque de coton rayé, coiffés d’un
chapeau de paille, pieds nus, suivant leur habitude. Armés chacun d’un fusil et
d’un revolver, la cartouchière à la ceinture, ils formaient l’avant-garde sous
la direction d’un blanc, qui faisait fonction d’éclaireur.
Après eux, dans un buggy, attelé
de deux chevaux, conduits par un cocher indigène, Mrs. Branican et la femme
Harriett avaient pris place. Une capote, adaptée à la légère voiture et susceptible
de se rabattre, leur permettrait de s’abriter en cas de pluie ou d’orage.
Dans un second buggy se
trouvaient Zach Fren et Godfrey. Quelque ennui que le maître eût ressenti de
l’arrivée du jeune novice, il ne devait pas tarder à l’avoir en grande amitié, en
le voyant si affectionné pour Mrs. Branican.
Les quatre chariots à bœufs
venaient ensuite, guidés par quatre bouviers, et la marche de la caravane
devait être réglée sur le pas de ces animaux, dont l’introduction en Australie,
de date assez récente, a fait des auxiliaires très précieux pour les transports
et les travaux de culture.
Sur les flancs et à l’arrière
de la petite troupe, se succédaient les hommes de Tom Marix, vêtus à la façon
de leur chef, pantalon enfoncé dans les bottes, casaque de laine serrée à la
taille, chapeau-casque d’étoffe blanche, portant en bandoulière un léger
manteau de caoutchouc, et armés comme leurs compagnons de race indigène. Ces
hommes, étant montés, devaient faire le service, soit pour choisir le lieu de
la halte de midi ou du campement du soir, lorsque la seconde étape de la
journée était près de finir.
Dans ces conditions, la
caravane était en mesure de faire douze à treize milles par jour, sur un sol
très cahoteux, parfois à travers d’épaisses forêts, où les chariots
n’avanceraient qu’avec lenteur. Le soir venu, le soin d’organiser la couchée
incombait à Tom Marix, qui en avait l’habitude. Puis, gens et bêtes se reposaient
toute la nuit, et l’on repartait au lever du jour.
Le parcours entre Farina-Town
et Alice-Spring – environ trois cent cinquante milles – n’offrant ni dangers graves ni grandes fatigues, exigerait
probablement une trentaine de jours. La station où il y aurait lieu de
reconstituer la caravane, en vue d’une exploration des déserts de l’ouest, ne
serait donc pas atteinte avant le premier tiers du mois d’octobre.
En quittant Farina-Town, l’expédition
put suivre pendant un certain nombre de milles les travaux entrepris pour la prolongation
du railway. Elle s’engagea dans l’ouest du groupe des Williouran-Ranges, en
prenant une direction jalonnée déjà par les poteaux de
l’Overland-Telegraf-Line.
Tout en cheminant, Mrs.
Branican demandait à Tom Marix, qui chevauchait près de son buggy, quelques
renseignements sur cette ligne télégraphique.
« C’est en 1870, mistress,
répondit Tom Marix, seize ans après la déclaration d’indépendance de
l’Australie méridionale, que les colons eurent la pensée de créer cette ligne, du
sud jusqu’au nord du continent entre Port-Adélaïde et Port-Darwin. Les travaux
furent conduits avec tant d’activité qu’ils étaient achevés au milieu de 1872.
– Mais n’avait-il pas fallu
que le continent eût été exploré sur toute cette étendue ? fit observer
Mrs. Branican.
– En effet, mistress, répondit
Tom Marix, et, dix ans auparavant, en 1860 et en 1861, Stuart, un de nos plus
intrépides explorateurs, l’avait traversé en poussant de nombreuses reconnaissances
à l’est et à l’ouest.
– Et quel a été le créateur
de cette ligne ? demanda Mrs. Branican.
– Un ingénieur aussi hardi
qu’intelligent, M. Todd, le directeur des postes et télégraphes d’Adélaïde,
un de nos concitoyens que l’Australie honore comme il le mérite.
– Est-ce qu’il a pu trouver
ici le matériel que nécessitait une pareille œuvre ?
– Non, mistress, répondit Tom
Marix, et il a dû faire venir d’Europe les isolateurs, les fils et même les
poteaux de sa ligne. Actuellement, la colonie serait en mesure de fournir aux
besoins de n’importe quelle entreprise industrielle.
– Est-ce que les indigènes
ont laissé exécuter ces travaux sans les troubler ?
– Au début, ils faisaient
mieux ou plutôt pis que de les troubler, mistress Branican. Ils détruisaient le
matériel, les fils pour se procurer du fer, les poteaux pour en fabriquer des haches.
Aussi, sur un parcours de dix-huit cent cinquante milles, y eut-il des rencontres incessantes avec les
Australiens, bien qu’elles ne fussent point à leur avantage. Ils revenaient à
la charge, et vraiment, je crois qu’il aurait fallu abandonner l’affaire, si M. Todd
n’avait eu une véritable idée d’ingénieur et même une idée de génie. Après
s’être emparé de quelques chefs de tribus, il leur fit appliquer, au moyen
d’une forte pile, un certain nombre de secousses électriques dont ils furent à
la fois si effrayés et si secoués que leurs camarades n’osèrent plus
s’approcher des appareils. La ligne put alors être achevée, elle fonctionne
maintenant d’une façon régulière.
– N’est-elle donc pas gardée
par des agents ? demanda Mrs. Branican.
– Par des agents, non, répondit
Tom Marix, mais par des escouades de la police noire, comme nous disons dans le
pays.
– Et cette police, est-ce
qu’elle ne se porte jamais jusqu’aux régions du centre et de l’ouest ?
– Jamais, ou du moins très
rarement, mistress. Il y a tant de malfaiteurs, de bushrangers et autres à
poursuivre dans les districts habités !
– Mais comment l’idée
n’est-elle pas venue de lancer cette police noire sur la trace des Indas, quand
on a su que le capitaine Branican était leur prisonnier… et cela depuis quinze
ans ?…
– Vous oubliez, mistress, que
nous ne le savons et que vous ne le savez vous-même que par Harry Felton, et il
y a quelques semaines au plus !
– C’est juste, répondit Dolly,
quelques semaines !…
– Je sais d’ailleurs, reprit
Tom Marix, que la police noire a reçu ordre d’explorer les régions de la Terre
de Tasman, qu’un fort détachement doit y être envoyé ; mais je crains bien… »
Tom Marix, s’arrêta. Mrs.
Branican ne s’était point aperçue de son hésitation.
C’est que, si décidé qu’il
fût à remplir jusqu’au bout les fonctions qu’il avait acceptées, Tom Marix, on
doit le dire, regardait comme très douteux le résultat de cette expédition. Il
savait combien ces tribus nomades de l’Australie sont difficiles à saisir.
Aussi, ne pouvait-il partager ni la foi ardente de Mrs. Branican, ni la conviction
de Zach Fren, ni la confiance instinctive de Godfrey. Cependant, on le répète, il
ferait son devoir.
Le 15 au soir, au détour des
collines Deroy, la caravane vint camper à la bourgade de Boorloo. Au nord, on
voyait poindre la cime du Mount-Attraction, au delà duquel s’étendent les Illusion-Plains.
De ce rapprochement de noms, y a-t-il lieu de conclure que, si la montagne
attire, la plaine est trompeuse ? Quoi qu’il en soit, la cartographie
australienne présente quelques-unes de ces désignations d’un sens à la fois
physique et moral.
C’est à Boorloo que la ligne
télégraphique se coude presque à angle droit en se dirigeant vers l’ouest. À
une douzaine de milles, elle traverse le Cabanna-creek. Mais, ce qui est très
simple pour des fils aériens tendus d’un poteau à l’autre, est plus difficile à
une troupe de piétons et de cavaliers. Il fut nécessaire de chercher un passage
guéable. Le jeune novice ne voulut point laisser à d’autres le soin de le
découvrir. S’étant jeté résolument dans la rivière, rapide, tumultueuse, il
trouva un haut-fond, qui permit aux chariots et aux voitures de se transporter
sur la rive gauche, sans être mouillés au delà du heurtequin de leurs roues.
Le 17, la caravane vint
camper sur les dernières ramifications du massif de ce mont North-West, qui se
dresse à une dizaine de milles au sud.
Le pays étant habité, Mrs.
Branican et ses compagnons reçurent le meilleur accueil dans une de ces vastes
fermes, dont la superficie, mise en œuvre, comprend plusieurs milliers d’acres. L’élevage des moutons en troupeaux innombrables, la
culture du blé établie sur de larges plaines sans arbres, d’importantes
cultures de sorgho et de millet, de vastes jachères préparées pour les semences
de la saison prochaine, des bois pratiquement aménagés, des plantations
d’oliviers et autres essences spéciales à ces chaudes latitudes, plusieurs
centaines d’animaux de labour et de trait, le personnel exigé par les soins de
telles exploitations – personnel soumis à une discipline quasi militaire et
dont les prescriptions réduisent l’homme presque à l’esclavage – voilà ce que
sont ces domaines, qui constituent la fortune des provinces du continent
australien. Si la caravane de Mrs. Branican n’eût été suffisamment approvisionnée
au départ, elle aurait trouvé là de quoi satisfaire à tous ses besoins, grâce à
la générosité des riches fermiers, des « freeselecters », propriétaires
de ces stations agricoles.
Du reste, ces grands
établissements industriels tendent à se multiplier. D’immenses étendues, que
l’absence d’eau rendait improductives, vont être livrées à la culture. En effet,
le sous-sol des territoires que la caravane traversait alors, à une douzaine de
milles dans le sud-ouest du lac Eyre, était sillonné de nappes liquides, et les
puits artésiens, nouvellement forés, débitaient jusqu’à trois cent mille
gallons par jour.
Le 18 septembre, Tom Marix
établit le campement du soir à la pointe méridionale du South-Lake-Eyre, qui
dépend du North-Lake-Eyre, d’une superficie considérable. On put apercevoir sur
ses rives boisées une troupe de ces curieux échassiers, dont le « jabiru »
est l’échantillon le plus remarquable, et quelques bandes de cygnes noirs, mêlés
aux cormorans, aux pélicans et aux hérons blancs, gris ou bleus de plumage.
Curieuse disposition
géographique, celle de ces lacs. Leur chapelet se déroule du sud au nord de
l’Australie, le lac Torrens, dont le railway suit la courbe, le petit lac Eyre,
le grand lac Eyre, les lacs Frome, Blanche, Amédée. Ce sont des nappes d’eau salée,
antiques récipients naturels, où se seraient conservés les restes d’une mer intérieure.
En effet, les géologues sont
portés à admettre que le continent australien fut autrefois divisé en deux îles,
à une époque qui ne doit pas être extrêmement reculée. On avait observé déjà
que la périphérie de ce continent, formé dans certaines conditions telluriques,
tend à s’élever au-dessus du niveau de la mer, et il ne semble pas douteux, d’autre
part, que le centre est soumis à un relèvement continu. L’ancien bassin se
comblera donc avec le temps, et amènera la disparition de ces lacs, échelonnés
entre les cent trentième et cent quarantième degrés de latitude.
De la pointe du
South-Lake-Eyre jusqu’à la station d’Emerald-Spring, où elle arriva le 20 septembre
au soir, la caravane franchit un espace de dix-sept milles environ à travers un
pays couvert de forêts magnifiques, dont les arbres dressaient leur ramure à
deux cents pieds de hauteur.
Si habituée que fût Dolly aux
merveilles forestières de la Californie, entre autres à ses séquoias gigantesques,
elle aurait pu admirer cette étonnante végétation, si sa pensée ne l’eût
constamment emportée dans la direction du nord et de l’ouest, au milieu de ces
arides déserts, où la dune sablonneuse nourrit à peine quelques maigres
arbrisseaux. Elle ne voyait rien de ces fougères géantes, dont l’Australie
possède les plus remarquables espèces, rien de ces énormes massifs d’eucalyptus,
au feuillage éploré, groupés sur de légères ondulations de terrain.
Observation curieuse, la
broussaille est absente du pied de ces arbres, le sol où ils vivent est nettoyé
de ronces et d’épines, leurs basses branches ne se développent qu’à douze ou
quinze pieds au-dessus des racines. Il n’y reste qu’une herbe jaune d’or, jamais
desséchée. Ce sont les animaux qui ont détruit les jeunes pousses, ce sont les
feux allumés par les squatters qui ont dévoré buissons et arbustes. Aussi, bien
qu’il n’y ait point, à parler vrai, de routes frayées à travers ces vastes
forêts, si différentes des forêts africaines où l’on marche six mois sans en
trouver la fin, la circulation n’y est-elle point embarrassée. Les buggys et
les chariots allaient pour ainsi dire à l’aise entre ces arbres largement
espacés et sous le haut plafond de leur feuillage.
De plus, Tom Marix
connaissait le pays, l’ayant maintes fois parcouru, lorsqu’il dirigeait la
police provinciale d’Adélaïde. Mrs. Branican n’aurait pu se fier à un guide
plus sûr, plus dévoué. Aucun chef d’escorte n’aurait joint tant de zèle à tant
d’intelligence.
Mais en outre, pour le
seconder, Tom Marix trouvait un auxiliaire jeune, actif, résolu, dans ce jeune
novice qui s’était à tel point attaché à la personne de Dolly, et il
s’émerveillait de ce qu’il sentait d’ardeur chez ce garçon de quatorze ans.
Godfrey parlait de se lancer seul, en cas de besoin, au milieu des régions de
l’intérieur. Si quelques traces du capitaine John étaient découvertes, il
serait difficile, impossible même de le retenir dans le rang. Tout en lui, son
enthousiasme lorsqu’il s’entretenait du capitaine, son assiduité à consulter
les cartes de l’Australie centrale, à prendre des notes, à se renseigner dans
les haltes au lieu de se livrer au repos après la longueur et la fatigue des
étapes, tout dénotait dans cette âme passionnée une effervescence que rien ne
pouvait tempérer. Très robuste pour son âge, endurci déjà aux rudes épreuves de
la vie de marin, il devançait le plus souvent la caravane, il s’éloignait hors
de vue. Restait-il à sa place, ce n’était que sur l’ordre formel de Dolly. Ni
Zach Fren, ni Tom Marix, bien que Godfrey leur témoignât grande amitié, n’auraient
pu obtenir ce qu’elle obtenait d’un regard. Aussi s’abandonnant à ses
sentiments instinctifs en présence de cet enfant, portrait physique et moral de
John, elle éprouvait pour lui une affection de mère. Si Godfrey n’était pas son
fils, s’il ne l’était pas suivant les lois de la nature, il le serait par les
lois de l’adoption, du moins. Godfrey ne la quittait plus. John partagerait
l’affection qu’elle ressentait pour cet enfant.
Un jour, après une absence qui
s’était prolongée et l’avait conduit à quelques milles en avant de la caravane :
« Mon enfant, lui
dit-elle, je veux que tu me fasses la promesse de ne jamais t’écarter sans mon
consentement. Lorsque je te vois partir je suis inquiète jusqu’à ton retour. Tu
nous laisses pendant des heures sans nouvelles…
– Mistress Dolly, répondit le
jeune novice, il faut bien que je recueille des renseignements… On avait
signalé une tribu d’indigènes nomades, qui campait sur le Warmer-creek… J’ai
voulu voir le chef de cette tribu… l’interroger…
– Et qu’a-t-il dit ?…
demanda Dolly.
– Il avait entendu parler
d’un homme blanc, qui venait de l’ouest en se dirigeant vers les districts du
Queensland.
– Quel était cet homme ?…
– J’ai fini par comprendre
qu’il s’agissait de Harry Felton et non du capitaine Branican. Nous le retrouverons,
pourtant… oui ! nous le retrouverons !… Ah ! mistress Dolly, je
l’aime comme je vous aime, vous qui êtes pour moi une mère !
– Une mère ! murmura
Mrs. Branican.
– Mais je vous connais, tandis
que lui, le capitaine John, je ne l’ai jamais vu !… Et, sans cette photographie
que vous m’avez donnée… que je porte toujours sur moi… ce portrait à qui je
parle… qui semble me répondre…
– Tu le connaîtras un jour, mon
enfant, répondit Dolly, et il t’aimera autant que je t’aime ! »
Le 24 septembre, après avoir
campé à Strangway-Spring, au delà du Warmer-creek, l’expédition vint faire
halte à William-Spring, quarante-deux milles au nord de la station d’Emerald.
On voit, par cette qualification de « spring » – mot qui signifie « sources »,
donnée aux diverses stations – que le réseau liquide est assez important à la
surface de ces territoires sillonnés par la ligne télégraphique. Déjà, cependant,
la saison chaude était suffisamment avancée pour que ces sources fussent sur le
point de se tarir, et il n’était pas difficile de trouver des gués pour les
attelages lorsqu’il s’agissait de faire passer quelque creek.
On pouvait observer, d’ailleurs,
que la puissante végétation ne tendait pas à s’amoindrir encore. Si les
villages ne se rencontraient qu’à de plus longs intervalles, les établissements
agricoles se succédaient d’étape en étape. Des haies d’acacias épineux, entremêlées
de quelques églantiers à fleurs odorantes, dont l’air était embaumé, leur
formaient des enclos impénétrables. Quant aux forêts, moins épaisses, les
arbres d’Europe, le chêne, le platane, le saule, le peuplier, le tamarinier, s’y
raréfiaient au profit des eucalyptus et surtout de ces gommiers qui sont nommés
« spotted-gums » par les Australiens.
« Quels diables d’arbres
est-ce là ? s’écria Zach Fren la première fois qu’il aperçut une
cinquantaine de ces gommiers réunis en massif. On dirait que leur tronc est
peinturluré de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
– Ce que vous appelez une couche
de peinture, maître Zach, répondit Tom Marix, c’est une couleur naturelle.
L’écorce de ces arbres se nuance suivant que la végétation avance ou retarde.
En voici qui sont blancs, d’autres roses, d’autres rouges. Tenez !
regardez ceux-là, dont le tronc est rayé de bandes bleues ou tacheté de plaques
jaunes…
– Encore une drôlerie de plus
à joindre à celles qui distinguent votre continent, Tom Marix.
– Drôlerie si vous voulez, mais
croyez bien, Zach, que vous faites un compliment à mes compatriotes en leur
répétant que leur pays ne ressemble à aucun autre. Et il ne sera parfait…
– Que lorsqu’il n’y restera
plus un seul indigène ; c’est entendu ! » répliqua Zach Fren.
Ce qu’il y avait à remarquer
également, c’est que, malgré l’insuffisant ombrage de ces arbres, les oiseaux
les recherchaient en grand nombre. C’étaient quelques pies, quelques perruches,
des cacatoès d’une blancheur éclatante, des ocelots rieurs, qui, suivant
l’observation de M. D. Charnay, mériteraient mieux le nom d’« oiseaux
sangloteurs » ; puis des « tandalas » à la gorge rouge, dont
le caquet est intarissable ; des écureuils volants, entre autres le « polatouche »
que les chasseurs attirent en imitant le cri des oiseaux nocturnes ; des
oiseaux de paradis et spécialement ce « rifle-bird » au plumage de
velours, qui passe pour le plus beau spécimen de l’ornithologie australienne ;
enfin, à la surface des lagunes ou des fonds marécageux, des couples de grues
et de ces oiseaux-lotus, auxquels la conformation de leurs pattes permet de
courir à la surface des feuilles du nénuphar.
D’autre part, les lièvres
abondaient, et on ne se faisait pas faute de les abattre, sans parler des perdrix
et des canards – ce qui permettait à Tom Marix d’économiser sur les réserves de
l’expédition. Ce gibier était tout bonnement grillé ou rôti au feu du
campement. Parfois aussi, on déterrait les œufs d’iguane, qui sont excellents, et
meilleurs que l’iguane même, dont les noirs de l’escorte se délectaient
volontiers.
Quant aux creeks, ils
fournissaient encore des perches, quelques brochets à long museau, nombre de
ces muges si alertes qu’elles sautent par-dessus la tête du pêcheur, et surtout
des anguilles par myriades. Entre temps, il fallait prendre garde aux
crocodiles, qui ne laissent pas d’être très dangereux dans leur milieu
aquatique. De tout ceci, il résulte que lignes ou filets sont des engins dont
le voyageur en Australie doit se munir, conformément à l’expresse
recommandation du colonel Warburton.
Le 29, au matin la caravane
quitta la station de Umbum et s’engagea sur un sol montueux, très rude aux
piétons. Quarante-huit heures après, à l’ouest des Denison-Ranges, elle atteignait
la station de The-Peak, récemment établie pour les besoins du service
télégraphique. Ainsi que l’apprit Mrs. Branican, grâce à un récit détaillé que
Tom Marix lui fit des voyages de Stuart, c’était de ce point que l’explorateur
était remonté vers le nord, en parcourant ces territoires presque inconnus
avant lui.
À partir de cette station, sur
un espace de soixante milles environ, la caravane eut un avant-goût des
fatigues que lui réservait la traversée du désert australien. Il fallut
cheminer sur un sol très aride jusqu’aux bords de la Macumba-river, puis, au
delà, franchir un espace à peu près égal et non moins pénible à la marche
jusqu’à la station de Lady Charlotte.
Sur ces vastes plaines
ondulées, variées çà et là par quelques bouquets d’arbres au feuillage décoloré,
le gibier, si toutefois cette qualification est exacte, ne faisait pas défaut.
Là sautaient des kangourous d’une petite espèce, des « wallabis », qui
s’enfuyaient par bonds énormes. Là couraient des opossums de cette variété des
bandicoutes et des dyasures, qui nichent – c’est le mot – à la cime des
gommiers. Puis, on apercevait quelques couples de casoars, au regard provocant
et fier comme celui de l’aigle, mais qui ont cet avantage, sur le roi des
oiseaux, de fournir une chair grasse et nourrissante, presque identique à la
chair du bœuf. Les arbres, c’étaient des « bungas-bungas », sorte
d’araucarias, qui, dans les régions méridionales centrales de l’Australie, atteignent
une hauteur de deux cent cinquante pieds. Ces pins, ici de taille plus modeste,
produisent une grosse amande assez nutritive, dont les Australiens font un
usage habituel.
Tom Marix avait eu soin de
prévenir ses compagnons de la rencontre possible de ces ours, qui élisent
domicile dans le tronc creux des gommiers. C’est même ce qui arriva ; mais
ces plantigrades, désignés sous le nom de « potorous », n’étaient
guère plus à craindre que des marsupiaux à longues griffes.
Quant aux indigènes, la
caravane en avait à peine rencontré jusqu’alors. En effet, c’est au nord, à
l’est et à l’ouest de l’Overland-Telegraf-Line, que les tribus vont de
campements en campements.
En traversant ces contrées, de
plus en plus arides, Tom Marix eut lieu de mettre à profit un instinct très
particulier des bœufs attelés aux chariots. Cet instinct, qui semble s’être développé
dans la race depuis son introduction sur le continent australien, permet à ces
animaux de se diriger vers les creeks, où ils pourront satisfaire leur soif. Il
est rare qu’ils se trompent, et le personnel n’a qu’à les suivre. En outre, leur
instinct est fort apprécié en des circonstances qui se présentent quelquefois.
En effet, dans la matinée du
7 octobre, les bœufs du chariot de tête s’arrêtèrent brusquement. Ils furent
aussitôt imités par les autres attelages. Les conducteurs eurent beau les stimuler
de leur aiguillon, ils ne parvinrent pas à les décider à avancer d’un pas.
Tom Marix, aussitôt prévenu, se
rendit près du buggy de Mrs. Branican.
« Je sais ce que c’est, mistress,
dit-il. Si nous n’avons pas encore rencontré des indigènes sur notre route, nous
croisons en ce moment un sentier qu’ils ont l’habitude de suivre, et, comme nos
bœufs ont flairé leurs traces, ils refusent d’aller au delà.
– Quelle est la raison de
cette répugnance ? demanda Dolly.
– La raison, on ne la connaît
pas au juste, répondit Tom Marix, mais le fait n’en est pas moins indiscutable.
Ce que je croirais volontiers, c’est que les premiers bœufs importés en
Australie, fort maltraités par les indigènes, ont dû garder le souvenir de ces
mauvais traitements, et que ce souvenir s’est transmis de génération en génération… »
Que cette singularité de
l’atavisme, indiquée par le chef de l’escorte, fût ou non la raison de leur défiance,
on ne put absolument pas résoudre les bœufs à continuer leur marche en avant.
Il fallut les dételer, les retourner de tête en queue, puis, à coups de fouet
et d’aiguillon, les contraindre à faire une vingtaine de pas à reculons. De la
sorte, ils enjambèrent le sentier contaminé par le passage des indigènes, et, lorsqu’ils
eurent été remis sous le joug, les chariots reprirent la direction du nord.
Lorsque la caravane atteignit
les bords de la rivière Macumba, chacun eut amplement de quoi se désaltérer. Il
est vrai, l’étiage avait déjà décru de moitié par suite des chaleurs qui
étaient fortes. Mais là où il n’y a pas assez d’eau pour faire flotter un
squiff, il en reste plus qu’il est nécessaire au désaltèrement d’une
quarantaine de personnes et d’une vingtaine de bêtes.
Le 6, l’expédition passait le
creek Hamilton sur les pierres à demi noyées qui encombraient son lit ; le
8, elle laissait dans l’est le mont Hammersley ; le 10, dans la matinée, elle
faisait halte à la station de Lady Charlotte, après avoir franchi trois cent
vingt milles depuis le départ de Farina-Town.
Mrs. Branican se trouvait
alors sur la limite qui sépare l’Australie méridionale de la Terre Alexandra, nommée
aussi Northern-Territory. C’est ce territoire qui fut reconnu par l’explorateur
Stuart en 1860, lorsqu’il remonta le cent trente et unième méridien jusqu’au
vingt et unième degré de latitude.
À la station de Lady
Charlotte, Tom Marix avait demandé à Mrs. Branican d’accorder vingt-quatre
heures de repos. Bien que le cheminement se fût effectué sans obstacles, la
chaleur avait fatigué les bêtes de trait. La route était longue jusqu’à
Alice-Spring, et il importait que les chariots, qui transportaient le matériel,
fussent assurés d’y arriver.
Dolly se rendit aux raisons
que fit valoir le chef de l’escorte, et l’on s’installa du mieux possible.
Quelques cabanes, c’était tout ce qui composait cette station, dont la caravane
allait tripler la population pendant un jour. Il fallut dès lors établir un campement.
Mais un squatter, qui dirigeait un important établissement du voisinage, vint
offrir à Mrs. Branican une hospitalité plus confortable, et ses instances
furent telles qu’elle dut accepter de se rendre à Waldek-Hill, où une
habitation assez confortable était mise à sa disposition.
Ce squatter n’était que
locataire de l’un de ces vastes domaines, appelés « runs », dans la
campagne australienne. Il est tel de ces runs qui comprend jusqu’à six cent
mille hectares, particulièrement dans la province de Victoria. Bien que celui
de Waldek-Hill n’atteignît pas cette dimension, il ne laissait pas d’être
considérable. Entouré de « paddocks », sortes de clôtures, il était
spécialement consacré à l’élevage des moutons – ce qui nécessitait un assez
grand nombre d’employés, de bergers affectés au gardiennage des troupeaux, et
de ces chiens sauvages, dont l’aboiement rappelle le hurlement du loup.
C’est la qualité du sol qui
détermine le choix de la station, lorsqu’il s’agit d’établir un run. On préfère
ces plaines où croît naturellement le « salt bush », le buisson salé.
Ces buissons aux sucs nutritifs, qui ressemblent tantôt au plant de l’asperge, tantôt
à celui de l’anis, sont avidement recherchés des moutons, qui appartiennent à
l’espèce des « pig’s faces » à têtes de porcs. Aussitôt que les
terrains ont été reconnus propres à la pâture, on s’occupe de les transformer
en herbages. On les livre d’abord aux bœufs et aux vaches qui se contentent de
leur herbe native, tandis que les moutons, plus difficiles sur la nourriture, n’acceptent
que l’herbe fine de la seconde pousse.
Qu’on ne l’oublie pas, c’est
à la laine que produit le mouton qu’est due la grande richesse des provinces
australiennes, et, actuellement, on n’y compte pas moins de cent millions de
ces représentants de la race ovine.
Sur ce run de Waldek-Hill, autour
de la maison principale et du logement des employés, de larges étangs, qu’alimentait
un creek pourvu en abondance d’eau, étaient destinés au lavage des animaux
avant l’opération de la tonte. En face s’élevaient des hangars, où le squatter
rangeait les ballots de laine qu’il devait expédier par convois sur le port
d’Adélaïde.
À cette époque, cette
opération de la tonte battait son plein au run de Waldek-Hill. Depuis plusieurs
jours, une troupe de tondeurs nomades, ainsi que cela a lieu d’habitude, était
venue y exercer sa lucrative industrie.
Lorsque Mrs. Branican, accompagnée
de Zach Fren, eut franchi les barrières, elle fut frappée de l’étonnante animation
qui régnait dans l’enclos. Les ouvriers, travaillant à leur pièce, ne perdaient
pas un moment, et, comme les plus adroits peuvent dépouiller de leur toison une
centaine de moutons par jour, ils s’assurent ainsi un gain qui peut s’élever à
une livre. Le grincement des larges ciseaux entre les mains du tondeur, les bêlements
des bêtes, lorsqu’elles recevaient quelque coup mal dirigé, les appels des
hommes entre eux, l’allée et venue des ouvriers chargés d’enlever la laine pour
la transporter sous les hangars, cela était curieux à observer. Et, au-dessus
de ce brouhaha, dominaient les clameurs de petits garçons criant : « tar !…
tar ! » lorsqu’ils apportaient des jattes de goudron liquide, afin de
panser les blessures produites par les tondeurs trop maladroits.
À tout ce monde il faut des
surveillants, si l’on veut que le travail s’accomplisse dans de bonnes
conditions. Aussi s’en trouvait-il quelques-uns au run de Waldek-Hill, indépendamment
des employés du bureau de la comptabilité, c’est-à-dire une douzaine d’hommes
et de femmes, qui obtenaient là le moyen de vivre.
Et quelle fut la surprise de
Mrs. Branican – plus que de la surprise, de la stupéfaction – lorsqu’elle
entendit son nom prononcé à quelques pas derrière elle.
Une femme venait d’accourir.
Elle s’était jetée à ses genoux, les mains tendues, le regard suppliant…
C’était Jane Burker – Jane
moins vieillie par les années que par la peine, les cheveux gris, le teint hâlé,
presque méconnaissable, mais que Dolly reconnut pourtant.
« Jane !… »
s’écria-t-elle.
Elle l’avait relevée, et les
deux cousines étaient dans les bras l’une de l’autre.
Quelle avait donc été depuis
douze ans la vie des Burker ? Une vie misérable – et même une vie
criminelle en ce qui concernait du moins l’époux de l’infortunée Jane.
En quittant San-Diégo, pressé
d’échapper aux poursuites qui le menaçaient, Len Burker s’était réfugié à
Mazatlan, l’un des ports de la côte occidentale du Mexique. On s’en souvient, il
laissait à Prospect-House la mulâtresse Nô, chargée de veiller sur Dolly
Branican qui n’avait pas recouvré la raison à cette époque. Mais, peu de temps
après, quand la malheureuse folle eut été placée dans la maison de santé du
docteur Brumley par les soins de M. William Andrew, la mulâtresse, n’ayant
plus aucun motif de rester au chalet, était partie pour rejoindre son maître, dont
elle connaissait la retraite.
C’était sous un faux nom que
Len Burker avait cherché refuge à Mazatlan, où la police californienne n’avait
pu le découvrir. D’ailleurs, il ne demeura que quatre ou cinq semaines dans
cette ville. À peine trois milliers de piastres – solde de tant de sommes
dilapidées, et, en particulier, de la fortune personnelle de Mrs. Branican –
constituaient tout son avoir. Reprendre ses affaires aux États-Unis n’était
plus possible, et il résolut de quitter l’Amérique. L’Australie lui parut un
théâtre favorable pour tenter la fortune par tous les moyens, avant d’en être
réduit à son dernier dollar.
Jane, toujours sous l’absolue
domination de son mari, n’aurait pas eu la force de lui résister. Mrs. Branican,
son unique parente, était alors privée de raison. En ce qui concernait le
capitaine John, il n’y avait plus de doute sur son sort… Le Franklin avait
péri corps et biens… John ne reviendrait jamais à San-Diégo… Rien ne pouvait
désormais arracher Jane à cette triste destinée vers laquelle l’entraînait Len
Burker, et c’est dans ces conditions qu’elle fut transportée sur le continent
australien.
C’était à Sydney que Len
Burker avait débarqué. Ce fut là qu’il consacra ses dernières ressources à se
lancer dans un courant d’affaires, où il fit de nouvelles dupes, en déployant
plus d’habileté qu’à San-Diégo. Puis, il ne tarda pas à se lancer dans des
spéculations aventureuses et n’arriva qu’à perdre les quelques gains que son travail
lui avait procurés au début.
Dix-huit mois après s’être
réfugié en Australie, Len Burker dut s’éloigner de Sydney. En proie à une gêne
qui touchait à la misère, il fut contraint de chercher fortune ailleurs. Mais
la fortune ne le favorisa pas davantage à Brisbane, d’où il s’échappa bientôt
pour se réfugier dans les districts reculés du Queensland.
Jane le suivait. Victime
résignée, elle fut réduite à travailler de ses mains, afin de subvenir aux besoins
du ménage. Rudoyée, maltraitée par cette mulâtresse qui continuait à être le
mauvais génie de Len Burker, que de fois l’infortunée eut la pensée de s’enfuir,
de briser la vie commune, d’en finir avec les humiliations et les déboires !…
Mais cela était au-dessus de son caractère faible et indécis. Pauvre chien que
l’on frappe et qui n’ose quitter la maison de son maître !
À cette époque, Len Burker
avait appris par les journaux les tentatives faites dans le but de retrouver
les survivants du Franklin. Ces deux expéditions du Dolly-Hope, entreprises
par les soins de Mrs. Branican, l’avaient mis en même temps au courant de cette
situation nouvelle : 1° Dolly avait recouvré la raison, après une période
de quatre ans, pendant laquelle elle était restée dans la maison du docteur Brumley ;
2° Au cours de cette période, son oncle Edward Starter étant mort au Tennessee,
l’énorme richesse qui lui était échue par héritage, avait permis d’organiser
ces deux campagnes dans les mers de la Malaisie et sur les côtes de l’Australie
septentrionale. Quant à leur résultat définitif, c’était la certitude acquise
que les débris du Franklin avaient été retrouvés sur les récifs de l’île
Browse, et que le dernier survivant de l’équipage avait succombé dans cette
île.
Entre la fortune de Dolly et
Jane, sa seule héritière, il n’y avait plus qu’une mère ayant perdu son enfant,
une épouse ayant perdu son mari, et dont tant de malheurs devaient avoir
compromis la santé. Ce fut ce que se dit Len Burker. Mais que pouvait-il tenter ?
Reprendre les relations de famille avec Mrs. Branican, c’était impossible. Lui
demander des secours par l’intermédiaire de Jane, il se défiait, étant sous le
coup de poursuites, à la merci d’une extradition qui aurait été obtenue contre
sa personne. Et cependant, si Dolly venait à mourir, par quel moyen empêcher sa
succession d’échapper à Jane, c’est-à-dire à lui-même ?
On ne l’a point oublié, sept
années environ s’écoulèrent entre le retour du Dolly-Hope après sa seconde
campagne, jusqu’au moment où la rencontre de Harry Felton vint remettre en
question la catastrophe du Franklin.
Pendant ce laps de temps, l’existence
de Len Burker devint plus misérable qu’elle ne l’avait encore été. Des faits
délictueux qu’il avait accomplis sans aucun remords, il glissa sur la pente des
faits criminels. Il n’eut même plus de domicile fixe, et Jane fut contrainte de
se soumettre aux exigences de sa vie nomade.
La mulâtresse Nô était morte ;
mais Mrs. Burker ne recueillit aucun bénéfice de la mort de cette femme, dont
l’influence avait été si funeste à son mari. N’étant plus que la compagne d’un
malfaiteur, celui-ci l’obligea à le suivre sur ces vastes territoires, où tant
de crimes restent impunis. Après l’épuisement des mines aurifères de la
province de Victoria et la dispersion des milliers de « diggers », qui
se trouvèrent sans ouvrage, le pays fut envahi par une population peu
accoutumée à la soumission et au respect des lois au milieu du monde interlope
des placers. Aussi s’était-il bientôt formé une classe redoutable de ces
déclassés, de ces gens sans aveu, connus dans les districts du Sud-Australie
sous le nom de « larrikins ». C’étaient eux qui couraient les
campagnes et en faisaient le théâtre de leurs criminels agissements, lorsqu’ils
étaient traqués de trop près par les polices urbaines.
Tels furent les compagnons auxquels
s’associa Len Burker, quand sa notoriété lui eut interdit l’accès des villes.
Puis, à mesure qu’il reculait à travers les régions moins surveillées, il se
liait avec des bandes de scélérats nomades, entre autres ces farouches « bushrangers »,
qui datent des premières années de la colonisation, et dont la race n’est pas
éteinte.
Voilà à quel degré de
l’échelle sociale était descendu Len Burker ! Au cours de ces dernières
années, dans quelles mesures prit-il part au pillage des fermes, aux vols de grands
chemins, à tous les crimes que la justice fut impuissante à réprimer, lui seul
eût pu le dire. Oui ! lui seul, car Jane, presque toujours abandonnée en
quelque bourgade, ne fut point mise dans le secret de ces actes abominables. Et
peut-être le sang avait-il été répandu par la main de l’homme qu’elle
n’estimait plus, et que, cependant, elle n’eût jamais voulu trahir !
Douze ans s’étaient écoulés, lorsque
la réapparition de Harry Felton vint derechef passionner l’opinion publique.
Cette nouvelle fut répandue par les journaux et notamment par les nombreuses
feuilles de l’Australie. Len Burker l’apprit en lisant un numéro du Sydney
Morning Herald, dans une petite bourgade du Queensland, où il s’était alors
réfugié, après une affaire de pillage et d’incendie, qui grâce à l’intervention
de la police, n’avait pas précisément tourné à l’avantage des bushrangers.
En même temps qu’il était
instruit des faits concernant Harry Felton, Len Burker apprenait que Mrs.
Branican avait quitté San-Diégo pour venir à Sydney, afin de se mettre en rapport
avec le second du Franklin. Presque aussitôt circulait le bruit que
Harry Felton était mort, après avoir pu donner certaines indications relatives
au capitaine John. Environ quinze jours plus tard, Len Burker était informé que
Mrs. Branican venait de débarquer à Adélaïde, à dessein d’organiser une expédition,
à laquelle elle prendrait part et qui aurait pour but de visiter les déserts du
centre et du nord-ouest de l’Australie.
Lorsque Jane connut l’arrivée
de sa cousine sur le continent, son premier sentiment fut de se sauver, de
chercher un refuge près d’elle. Mais, devant les menaces de Len Burker qui
l’avait devinée, elle n’osa donner suite à son désir.
C’est alors que le misérable
résolut d’exploiter cette situation sans temporiser. L’heure était décisive.
Rencontrer Mrs. Branican sur sa route, rentrer en grâce près d’elle, à l’aide
d’hypocrisies calculées, obtenir de l’accompagner au milieu des solitudes
australiennes, rien de moins difficile, en somme, et qui tendrait plus sûrement
à son but. Il n’était guère probable, en effet, que le capitaine John, en
admettant qu’il vécût encore, pût être retrouvé chez ces indigènes nomades, et
il était possible que Dolly succombât au cours de cette dangereuse campagne.
Toute sa fortune alors reviendrait à Jane, sa seule parente… Qui sait ?…
Il y a de ces hasards si profitables, lorsqu’on a le talent de les faire naître…
Bien entendu, Len Burker se
garda d’instruire Jane de son projet de renouer des relations avec Mrs.
Branican. Il se sépara des bushrangers, sauf à réclamer plus tard leurs bons
offices, s’il y avait lieu de recourir à quelque coup de main. Accompagné de
Jane, il quitta le Queensland, se dirigea vers la station de Lady Charlotte, dont
il n’était distant que d’une centaine de milles, et par laquelle la caravane
devait nécessairement passer en se rendant à Alice-Spring. Et voilà pourquoi
depuis trois semaines, Len Burker se trouvait au run de Waldek-Hill, où il
remplissait les fonctions de surveillant. C’est là qu’il attendait Dolly, fermement
décidé à ne reculer devant aucun crime pour devenir possesseur de son héritage.
En arrivant à la station de
Lady Charlotte, Jane ne se doutait de rien. Aussi quelle fut son émotion, l’irrésistible
et irraisonné mouvement auquel elle obéit, lorsqu’elle se trouva inopinément en
présence de Mrs. Branican. Cela, d’ailleurs, servait trop bien les projets de
Len Burker pour qu’il eût la pensée d’y faire obstacle.
Len Burker avait alors
quarante-cinq ans. Ayant peu vieilli, resté droit et vigoureux, il avait toujours
ce même regard fuyant et faux, cette physionomie empreinte de dissimulation, qui
inspirait la méfiance. Quant à Jane, elle paraissait avoir dix ans de plus que
son âge, les traits flétris, les cheveux blanchis aux tempes, le corps accablé.
Et pourtant, son regard, éteint par la misère, s’enflamma, lorsqu’il se porta
sur Dolly.
Après l’avoir serrée entre
ses bras, Mrs. Branican avait emmené Jane dans une des chambres mises à sa
disposition par le squatter de Waldek-Hill. Là, il fut loisible aux deux femmes
de s’abandonner à leurs sentiments. Dolly ne se souvenait que des soins dont
Jane l’avait entourée au chalet de Prospect-House. Elle n’avait rien à lui
reprocher, et elle était prête à pardonner à son mari, s’il consentait à ne
plus les séparer l’une de l’autre.
Toutes deux causèrent
longuement. Jane ne dit de son passé que ce qu’elle en pouvait dire sans
compromettre Len Burker, et Mrs. Branican se montra très réservée en la
questionnant à ce sujet. Elle sentait combien la pauvre créature avait souffert
et souffrait encore. Cela ne lui suffisait-il pas qu’elle fût digne de toute sa
pitié, digne de toute son affection ? La situation du capitaine John, cette
inébranlable assurance qu’elle avait de le retrouver bientôt, les efforts
qu’elle tenterait pour y réussir, voilà ce dont elle parla surtout – puis aussi
de son cher petit Wat… Et, lorsqu’elle en évoqua le souvenir toujours vivant en
elle, Jane devint si pâle, sa figure subit une altération telle que Dolly crut
que la pauvre femme allait se trouver mal.
Jane parvint à se dominer, et
il fallut qu’elle racontât sa vie depuis la funeste journée où sa cousine était
devenue folle jusqu’à l’époque où Len Burker l’avait contrainte à quitter
San-Diégo.
« Est-il possible, ma
pauvre Jane, dit alors Dolly, est-il possible, que, pendant ces quatorze mois, alors
que tu me donnais tes soins, il ne se soit jamais fait un éclaircissement dans
mon esprit ?… Est-il possible que je n’aie eu aucun souvenir de mon pauvre
John ?… Est-il possible que je n’aie jamais prononcé son nom… ni celui de
notre petit Wat ?…
– Jamais, Dolly, jamais !
murmura Jane, qui ne pouvait retenir ses larmes.
– Et toi, Jane, toi, mon amie,
toi qui es de mon sang, tu n’as pas plus avant lu dans mon âme ?… Tu ne
t’es aperçue, ni dans mes paroles ni dans mes regards, que j’eusse conscience
du passé ?…
– Non… Dolly !
– Eh bien, Jane, je vais te
dire ce que je n’ai dit à personne. Oui… lorsque je suis revenue à la raison…
oui… j’ai eu le pressentiment que John était vivant, que je n’étais pas veuve…
Et il m’a semblé aussi…
– Aussi ?… »
demanda Jane.
Les yeux empreints d’une
terreur inexplicable, le regard effaré, elle attendait ce que Dolly allait
dire.
« Oui ! Jane, reprit
Dolly, j’ai eu le sentiment que j’étais toujours mère ! »
Jane s’était relevée, ses
mains battaient l’air comme si elle eût voulu chasser quelque horrible image, ses
lèvres s’agitaient sans qu’elle parvînt à prononcer une parole. Dolly, absorbée
dans sa propre pensée, ne remarqua pas cette agitation, et Jane était parvenue
à retrouver un peu de calme à l’extérieur du moins, lorsque son mari se montra
à la porte de la chambre.
Len Burker, resté sur le
seuil, regardait sa femme et semblait lui demander :
« Qu’as-tu dit ? »
Jane retomba anéantie devant
cet homme. Invincible domination d’un esprit fort sur un esprit faible, Jane
était annihilée sous le regard de Len Burker.
Mrs. Branican le comprit. La
vue de Len Burker lui rappela son passé, et ce que Jane avait enduré près de
lui. Mais cette révolte de son cœur ne dura qu’un instant. Dolly était résolue
à écarter ses récriminations, à dompter ses répulsions, afin de ne plus être
séparée de la malheureuse Jane.
« Len Burker, dit-elle, vous
savez pourquoi je suis venue en Australie. C’est un devoir auquel je me
dévouerai jusqu’au jour où je reverrai John, car John est vivant. Puisque le
hasard vous a placé sur ma route, puisque j’ai retrouvé Jane, la seule parente
qui me reste, laissez-la-moi, et permettez qu’elle m’accompagne comme elle le
désire… »
Len Burker fit attendre sa
réponse. Sentant quelles préventions existaient contre lui, il voulait que Mrs.
Branican complétât sa proposition en le priant de se joindre à la caravane.
Toutefois, devant le silence que gardait Dolly, il crut devoir s’offrir lui-même.
« Dolly, dit-il, je
répondrai sans détours à votre demande, et j’ajouterai que je m’y attendais. Je
ne refuserai pas, et je consens très volontiers à ce que ma femme reste près de
vous. Ah ! la vie nous a été dure à tous deux depuis que la mauvaise
chance m’a forcé d’abandonner San-Diégo ! Nous avons beaucoup souffert
pendant les quatorze ans qui viennent de s’écouler, et, vous le voyez, la
fortune ne m’a guère favorisé sur la terre australienne, puisque j’en suis
réduit à gagner ma vie au jour le jour. Lorsque l’opération de la tonte sera
terminée au run de Waldek-Hill, je ne saurai où me procurer d’autre travail.
Aussi, comme, en même temps, il me serait pénible de me séparer de Jane, je
sollicite de vous à mon tour la permission de me joindre activement à votre
expédition. Je connais les indigènes de l’intérieur avec lesquels j’ai déjà eu
parfois des rapports, et je serai en mesure de vous rendre des services. Vous
n’en doutez pas, Dolly, je serais heureux d’associer mes efforts à ceux que
vous et vos compagnons ferez pour délivrer John Branican… »
Dolly comprit bien que
c’était là une condition formelle imposée par Len Burker pour qu’il consentît à
lui laisser Jane. Il n’y avait pas à discuter avec un pareil homme. D’ailleurs,
s’il était de bonne foi, sa présence pouvait ne pas être inutile, puisque, pendant
nombre d’années, sa vie errante l’avait conduit à travers les régions centrales
du continent. Mrs. Branican se borna donc à répondre – assez froidement, il est
vrai :
« C’est convenu Len Burker,
vous serez des nôtres, et soyez prêt à partir, car dès demain nous quitterons
la station de Lady Charlotte à la première heure…
– Je serai prêt », répondit
Len Burker, qui se retira sans avoir osé tendre la main à Mrs. Branican.
Lorsque Zach Fren apprit que
Len Burker ferait partie de l’expédition, il s’en montra peu satisfait. Il
connaissait l’homme, il savait par M. William Andrew comment ce triste
personnage avait abusé de ses fonctions pour dissiper le patrimoine de Dolly.
N’ignorant pas dans quelles conditions ce tuteur infidèle, ce courtier véreux, avait
dû s’esquiver de San-Diégo, il se doutait bien qu’il y avait lieu de suspecter
son existence pendant ces quatorze ans qu’il venait de passer en Australie…
Toutefois, il ne fit aucune observation, regardant, en effet, comme une circonstance
heureuse que Jane fût près de Dolly. Mais, en son for intérieur, il se promit
de ne pas perdre de vue Len Burker.
Cette journée se termina sans
autre incident. Len Burker, qu’on ne revit pas, s’occupait de ses préparatifs
de départ, après avoir réglé sa situation avec le squatter de Waldek-Hill. Ce règlement
ne pouvait donner lieu à aucune difficulté, et le squatter se chargea même de
procurer un cheval à son ancien employé, afin qu’il fût en état de suivre la caravane
jusqu’à la station d’Alice-Spring, où elle devait être réorganisée.
Dolly et Jane restèrent
l’après-midi et la soirée ensemble dans la maison de Waldek-Hill. Dolly évitait
de parler de Len Burker, elle n’émettait aucune allusion à ce qu’il avait fait
depuis son départ de San-Diégo, sentant bien qu’il y avait des choses que Jane
ne pouvait dire.
Pendant cette soirée, ni Tom
Marix ni Godfrey, chargés de recueillir des renseignements chez les indigènes
sédentaires, dont les hameaux avoisinaient la station de Lady Charlotte, ne
vinrent au run de Waldek-Hill. Ce fut le lendemain seulement que Mrs. Branican
eut l’occasion de présenter Godfrey à Jane, en lui disant qu’il était son
enfant d’adoption.
Jane fut extraordinairement
frappée, elle aussi, de la ressemblance qui existait entre le capitaine John et
le jeune novice. Son impression fut même si profonde que c’est à peine si elle
osait le regarder. Et comment exprimer ce qu’elle éprouva, lorsque Dolly lui
fit connaître ce qui concernait Godfrey, les circonstances dans lesquelles elle
l’avait rencontré à bord du Brisbane… C’était un enfant trouvé dans les
rues de San-Diégo… Il avait été élevé à Wat-House… Il avait quatorze ans
environ…
Jane, d’une pâleur de morte, le
cœur battant à peine sous l’étreinte de l’angoisse, avait écouté ce récit, muette,
immobile…
Et, lorsque Dolly l’eut
laissée seule, elle tomba à genoux, les mains jointes. Puis, ses traits
s’animèrent… sa physionomie fut comme transfigurée…
« Lui !… lui !
s’écria-t-elle d’une voix éclatante. Lui… près d’elle !… Dieu l’a donc
voulu !… »
Un instant après, Jane avait
quitté la maison de Waldek-Hill, et, traversant la cour intérieure, elle se
précipitait vers la case qui lui servait d’habitation pour tout dire à son
mari.
Len Burker était là, rangeant
dans un portemanteau les quelques effets d’habillement et autres objets qu’il
allait emporter pour son voyage. L’arrivée de Jane, dans cet extraordinaire
état de trouble, le fit tressaillir.
« Qu’y a-t-il ? lui
demanda-t-il brusquement. Parle donc !… Parleras-tu ?… Qu’y a-t-il ?…
– Il est vivant, s’écria Jane…
il est ici… près de sa mère… lui que nous avons cru…
– Près de sa mère… vivant…
lui ?… » répondit Len Burker, qui resta foudroyé par cette
révélation.
Il n’avait que trop compris à
qui ce mot « lui ! » pouvait s’appliquer.
« Lui… répéta Jane, lui…
le second enfant de John et de Dolly Branican ! »
Une courte explication
suffira pour faire connaître ce qui s’était passé quinze ans auparavant à
Prospect-House.
Un mois après leur installation
au chalet de San-Diégo, M. et Mrs. Burker s’étaient aperçus que Dolly, privée
de raison depuis le cruel événement, était dans une situation qu’elle ignorait
elle-même. Étroitement surveillée par la mulâtresse Nô, Dolly, malgré les
supplications de Jane, fut pour ainsi dire séquestrée, soustraite à la vue de
ses amis et de ses voisins sous prétexte de maladie. Sept mois plus tard, toujours
folle et sans qu’il en fût resté trace dans sa mémoire, elle avait mis au monde
un second enfant. À cette époque, la mort du capitaine John étant généralement
admise, la naissance de cet enfant venait déranger les plans de Len Burker
relatifs à la fortune future de Dolly. Aussi avait-il pris la résolution de
tenir cette naissance secrète. C’est en vue de cette éventualité que, depuis
plusieurs mois, les domestiques avaient été renvoyés du chalet et les visiteurs
éconduits, sans que Jane, contrainte de se courber devant les criminelles
exigences de son mari, eût pu s’y opposer. L’enfant, né de quelques heures, abandonné
par Nô sur la voie publique, fut par bonheur recueilli par un passant, puis
transporté dans un hospice. Plus tard, après la fondation de Wat-House, c’est
de là qu’il sortit pour être embarqué en qualité de mousse à l’âge de huit ans.
Et maintenant, tout s’explique – cette ressemblance de Godfrey avec le
capitaine John, son père, ces pressentiments instinctifs que Dolly ressentait
toujours – Dolly mère sans le savoir !
« Oui, Len, s’écria Jane,
c’est lui !… C’est son fils !… Et il faut tout avouer… »
Mais, à la pensée d’une
reconnaissance qui eût compromis le plan sur lequel reposait son avenir, Len
Burker fit un geste de menace, et des jurons s’échappèrent de sa bouche.
Prenant la malheureuse Jane par la main et la regardant dans les yeux, il lui
dit d’une voix sourde :
« Dans l’intérêt de
Dolly… comme dans l’intérêt de Godfrey, je te conseille de te taire ! »
Aucune erreur n’était
possible, Godfrey était bien le second enfant de John et de Dolly Branican.
Cette affection que Dolly éprouvait pour lui n’était due qu’à l’instinct
maternel. Mais elle ignorait que le jeune novice fût son fils, et comment
pourrait-elle jamais l’apprendre, puisque Jane, épouvantée des menaces de Len
Burker, allait être contrainte à se taire pour assurer le salut de Godfrey.
Parler, c’était mettre cet enfant à la merci de Len Burker, et le misérable, qui
l’avait livré à l’abandon une première fois, saurait bien s’en défaire au cours
de cette périlleuse expédition… Il importait dès lors que la mère et le fils
n’apprissent jamais quel lien les rattachait l’un à l’autre.
Du reste, en voyant Godfrey, en
rapprochant les faits relatifs à sa naissance, en constatant cette ressemblance
frappante avec John, Len Burker n’eut pas un doute sur son identité. Ainsi, alors
qu’il regardait la perte de John Branican comme définitive, voilà que la
naissance de son second fils venait de se révéler. Eh bien ! malheur à cet
enfant, si Jane s’avisait de parler ! Mais Len Burker était tranquille ;
Jane ne parlerait pas.
Le 11 octobre, la caravane se
remit en route, après vingt-quatre heures de repos. Jane avait pris place dans
le buggy, occupé par Mrs. Branican. Len Burker, montant un assez bon cheval, allait
et venait, tantôt en avant, tantôt en arrière, s’entretenant volontiers avec
Tom Marix au sujet des territoires qu’il avait déjà parcourus le long de la
ligne télégraphique. Il ne recherchait point la compagnie de Zach Fren, qui lui
témoignait une antipathie très marquée. D’autre part, il évitait de rencontrer
Godfrey, dont le regard gênait le sien. Lorsque le jeune novice arrivait pour
se mêler à la conversation de Dolly et de Jane, Len Burker se retirait, afin de
ne point se trouver avec lui.
À mesure que l’expédition
gagnait vers l’intérieur, le pays se modifiait graduellement. Çà et là quelques
fermes, où le travail se réduisait à l’élevage des moutons, de larges prairies
s’étendant à perte de vue, des massifs d’arbres, gommiers ou eucalyptus, ne
formant plus que des groupes isolés, qui ne rappelaient en rien les forêts de
l’Australie méridionale.
Le 12 octobre, à six heures
du soir, après une longue étape que la chaleur avait rendue très fatigante, Tom
Marix vint camper sur le bord de la Finke-river, non loin du mont Daniel, dont
la cime se profilait à l’ouest.
Les géographes sont d’accord
aujourd’hui sur la question de considérer cette rivière Finke – appelée
Larra-Larra par les indigènes – comme étant le principal cours d’eau du centre
de l’Australie. Pendant la soirée, Tom Marix attira l’attention de Mrs. Branican
sur ce sujet, alors que Zach Fren, Len et Jane Burker lui tenaient compagnie
sous une des tentes.
« Il s’agissait, dit Tom
Marix, de savoir si la Finke-river déversait ses eaux dans ce vaste lac Eyre
que nous avons contourné au delà de Farina-Town. Or, c’est précisément à
résoudre cette question que l’explorateur David Lindsay consacra la fin de
l’année 1885. Après avoir atteint la station de The-Peak que nous avons
dépassée, il suivit la rivière jusqu’à l’endroit où elle se perd sous les
sables, au nord-est de Dalhousie. Mais il a été porté à croire que, lors des
grandes crues de la saison des pluies, l’écoulement de ses eaux doit se
propager jusqu’au lac Eyre.
– Et quel développement
aurait la Finke-river ? demanda Mrs. Branican.
– On ne l’estimerait pas à
moins de neuf cents milles, répondit Tom Marix.
– Devons-nous longtemps la
suivre ?…
– Quelques jours seulement, car
elle fait de nombreux crochets et finit par remonter dans la direction de
l’ouest à travers le massif des James-Ranges.
– Mais ce David Lindsay dont
vous parlez, je l’ai connu, dit alors Len Burker.
– Vous l’avez connu ?…
répéta Zach Fren d’un ton qui dénotait une certaine incrédulité.
– Et qu’y a-t-il d’étonnant à
cela ? répondit Len Burker. J’ai rencontré Lindsay à l’époque où il venait
d’atteindre la station de Dalhousie. Il se rendait à la frontière ouest du
Queensland, que je visitais pour le compte d’une maison de Brisbane.
– En effet, reprit Tom Marix,
c’est bien là l’itinéraire qu’il a choisi. Puis, ayant regagné Alice-Spring et
contourné les Mac-Donnell-Ranges par leur base, il opéra une reconnaissance
assez complète de la rivière Herbert, remonta vers le golfe de Carpentarie, où
il acheva son second voyage du sud au nord à travers le continent australien.
– J’ajouterai, dit Len Burker,
que David Lindsay était accompagné d’un botaniste allemand du nom de Diétrich.
Leur caravane ne se servait que de chameaux pour bêtes de transport. C’est
ainsi, je crois, Dolly, que vous avez l’intention de composer la vôtre au delà
d’Alice-Spring, et je suis certain que vous réussirez comme a réussi David
Lindsay…
– Oui, nous réussirons, Len !
dit Mrs. Branican.
– Et personne n’en doute ! »
ajouta Zach Fren.
En somme, il paraissait avéré
que Len Burker avait rencontré David Lindsay dans les circonstances qu’il
venait de rappeler – ce que Jane confirma d’ailleurs. Mais, si Dolly lui eût
demandé pour quelle maison de Brisbane il voyageait alors, peut-être cette
question l’aurait-elle embarrassé. Pendant les quelques heures que Mrs.
Branican et ses compagnons passèrent sur le bord de la Finke-river, on eut indirectement
des nouvelles de l’Anglais Jos Meritt et de Gîn-Ghi, son domestique chinois.
L’un et l’autre précédaient encore la caravane d’une douzaine d’étapes ;
toutefois, elle gagnait chaque jour sur eux en suivant le même itinéraire. Ce
fut par l’intermédiaire des indigènes que l’on sut ce qu’était devenu ce fameux
collectionneur de chapeaux. Cinq jours avant, Jos Meritt et son serviteur
avaient séjourné dans le village de Kilna, situé à un mille de la station.
Kilna compte plusieurs centaines de noirs – hommes, femmes et enfants – qui
vivent sous d’informes huttes d’écorce. Ces huttes sont appelées « villums »
en langage australien, et il y a lieu de remarquer la singulière analogie de ce
mot indigène avec les mots « villes » et « villages » des langues
d’origine latine. Ces aborigènes, dont quelques-uns présentent de remarquables
types, hauts de taille, sculpturalement proportionnés, robustes et souples, d’un
tempérament infatigable, méritent d’être observés. Pour la plupart, ils sont
caractérisés par cette conformation, spéciale aux races sauvages, de l’angle
facial déprimé ; ils ont la crête des sourcils proéminente, la chevelure
ondulée sinon crépue, un front étroit qui fuit sous ses boucles, le nez épaté à
larges narines, la bouche énorme à forte denture comme celle des fauves. Quant
aux gros ventres, aux membres grêles, cette difformité de nature ne se remarque
pas chez les échantillons qu’on vient de citer – ce qui est une exception assez
rare parmi les nègres australiens.
D’où sont issus les indigènes
de cette cinquième partie du monde ? Existait-il autrefois, ainsi que
plusieurs savants – trop savants peut-être ! – ont prétendu l’établir, un
continent du Pacifique, dont il ne reste que les sommets sous forme d’îles, dispersées
à la surface de ce vaste bassin ? Ces Australiens sont-ils les descendants
des nombreuses races qui peuplèrent ce continent à une époque reculée ? De
telles théories demeureront vraisemblablement à l’état d’hypothèses. Mais, si
l’explication était admise, il faudrait en conclure que la race autochtone a
singulièrement dégénéré au moral autant qu’au physique. L’Australien est resté
sauvage de mœurs et de goûts, et, par ses habitudes indéracinables de
cannibalisme – au moins chez certaines tribus – il est au dernier degré de
l’échelle humaine, presque au rang des carnassiers. Dans un pays où il ne se rencontre
ni lions, ni tigres, ni panthères, on pourrait dire qu’il les remplace au point
de vue anthropophagique. Ne cultivant pas le sol qui est ingrat, à peine vêtu
d’une loque, manquant des plus simples ustensiles de ménage, n’ayant que des
armes rudimentaires, la lance à pointe durcie, la hache de pierre, le « nolla-nolla »,
sorte de massue en bois très dur, et le fameux « boomerang » que sa
forme hélicoïdale oblige à revenir en arrière après qu’il a été projeté par une
main vigoureuse – le noir australien, on le répète, est un sauvage dans toute
l’acception du mot.
À de tels êtres, la nature a
donné la femme qui leur convient, la « lubra » assez vigoureusement
constituée pour résister aux fatigues de la vie nomade, se soumettre aux
travaux les plus pénibles, porter les enfants en bas âge et le matériel de campement.
Ces malheureuses créatures sont vieilles à vingt-cinq ans, et non seulement
vieilles, mais hideuses, chiquant les feuilles du « pituri », qui les
surexcite pendant les interminables marches, et les aide parfois à endurer de
longues abstinences.
Eh bien, le croirait-on ?
Celles qui se trouvent en rapport avec les colons européens dans les bourgades
commencent à suivre les modes européennes. Oui ! Il leur faut des robes et
des queues à ces robes ! Il leur faut des chapeaux et des plumes à ces
chapeaux ! Les hommes ne sont même pas indifférents au choix de leurs
propres coiffures, et ils épuisent, pour satisfaire ce goût, le fond des
revendeurs.
Sans nul doute, Jos Meritt
avait eu connaissance du remarquable voyage exécuté par Carl Lumholtz en
Australie. Et comment n’aurait-il pas retenu ce passage du hardi voyageur
norvégien, dont le séjour se prolongea au delà de six mois chez les farouches
cannibales du nord-est ?
« Je rencontrai à
mi-chemin mes deux indigènes… Ils s’étaient faits très beaux : l’un se
pavanait en chemise, l’autre s’était coiffé d’un chapeau de femme. Ces
vêtements, fort appréciés par les nègres australiens, passent d’une tribu à
l’autre, des plus civilisées qui vivent à proximité des colons, à celles qui
n’ont jamais aucun rapport avec les blancs. Plusieurs de mes hommes (des
indigènes) empruntèrent le chapeau ; ils mettaient une sorte de fierté à
se parer tour à tour de cette coiffure. L’un de ceux qui me précédaient, in
puris naturalibus, suant sous le poids de mon fusil, était vraiment drôle à
voir, coiffé de ce chapeau de femme posé de travers. Quelles péripéties avait
dû traverser cette capote au cours de son long voyage du pays des blancs aux
montagnes des sauvages ! »
C’était bien ce que savait
Jos Meritt, et peut-être serait-ce au milieu d’une tribu australienne, sur la
tête d’un chef des territoires du nord ou du nord-ouest, qu’il rencontrerait
cet introuvable chapeau, dont la conquête l’avait déjà entraîné, au péril de sa
vie, chez les anthropophages du continent australien. Ce qu’il faut d’ailleurs
observer, c’est que, s’il n’avait pas réussi chez ces peuplades du Queensland, il
ne semblait pas qu’il eût réussi davantage parmi les indigènes de Kilna, puisqu’il
s’était remis en campagne et continuait son aventureuse pérégrination en
remontant vers les déserts du centre.
Le 13 octobre, au lever du
soleil, Tom Marix donna le signal du départ. La caravane reprit son ordre de
marche habituel. C’était une véritable satisfaction pour Dolly d’avoir Jane
près d’elle, une grande consolation pour Jane d’avoir retrouvé Mrs. Branican.
Le buggy, qui les transportait toutes les deux, et dans lequel elles pouvaient
s’isoler, leur permettait d’échanger bien des pensées, bien des confidences.
Pourquoi fallait-il que Jane n’osât pas aller jusqu’au bout dans cette voie, qu’elle
fût contrainte à se taire ? Parfois, en voyant cette double affection
maternelle et filiale, qui se manifestait à tout moment par un regard, par un
geste, par un mot, entre Dolly et Godfrey, il lui semblait que son secret
allait lui échapper… Mais les menaces de Len Burker lui revenaient à l’esprit, et,
dans la crainte de perdre le jeune novice, elle affectait même à son égard une
quasi-indifférence que Mrs. Branican ne remarquait pas sans quelque chagrin.
Et l’on s’imaginera aisément
ce qu’elle dut éprouver, lorsque Dolly lui dit un jour :
« Tu dois me comprendre,
Jane, avec cette ressemblance qui m’avait si vivement frappée, avec ces
instincts que je sentais persister en moi, j’ai pu croire que mon enfant avait
échappé à la mort, que ni M. William Andrew ni personne de mes amis ne
l’avaient su… Et de là, à penser que Godfrey était notre fils, à John et à moi…
Mais non !… Le pauvre petit Wat repose maintenant dans le cimetière de
San-Diégo !
– Oui !… C’est là que
nous l’avons porté, chère Dolly, répondit Jane. C’est là qu’est sa tombe… au
milieu des fleurs !
– Jane !… Jane !…
s’écria Dolly, puisque Dieu ne m’a pas rendu mon enfant, qu’il me rende son
père, qu’il me rende John ! »
Le 15 octobre, à six heures
du soir, après avoir laissé en arrière le mont Humphries, la caravane s’arrêta
sur le bord du Palmer-creek, un des affluents de la Finke-river. Ce creek était
presque à sec, n’étant alimenté, ainsi que la plupart des rios de ces régions, que
par les eaux pluviales. Il fut donc très aisé de le franchir, ainsi que l’on
fit du Hughes-creek, à trois jours de là, trente-quatre milles plus au nord.
En cette direction, l’Overland-Telegraf-Line
tendait toujours ses fils aériens au-dessus du sol – ces fils d’Ariane qu’il
suffisait de suivre de station en station. On rencontrait çà et là quelques
groupes de maisons, plus rarement des fermes, où Tom Marix, en payant bien, se
procurait de la viande fraîche. Godfrey et Zach Fren, eux, allaient aux
informations. Les squatters s’empressaient de les renseigner sur les tribus
nomades qui parcouraient ces territoires. N’avaient-ils point entendu parler
d’un blanc, retenu prisonnier chez les Indas du nord ou de l’ouest ?
Savaient-ils si des voyageurs s’étaient récemment aventurés à travers ces
lointains districts ? Réponses négatives. Aucun indice, si vague qu’il fût,
ne pouvait mettre sur les traces du capitaine John. De là, nécessité de se
hâter, afin d’atteindre Alice-Spring, dont la caravane était encore éloignée
d’au moins quatre-vingts milles.
À partir de Hughes-creek, le
cheminement devint plus difficile, et la moyenne de marche, obtenue jusqu’à ce
jour, fut notablement diminuée. Le pays était très montueux. D’étroites gorges
se succédaient, coupées de ravins à peine praticables, qui sinuaient entre les
ramifications des Water-House-Ranges. En tête, Tom Marix et Godfrey
recherchaient les meilleures passes. Les piétons et les cavaliers y trouvaient
facilement passage, même les buggys que leurs chevaux enlevaient sans trop de
peine, et il n’y avait pas lieu de s’en préoccuper ; mais, pour les
chariots chargés lourdement, les bœufs ne les traînaient qu’au prix d’extrêmes
fatigues. L’essentiel était d’éviter les accidents, tels qu’un bris de roue ou
d’essieu, qui eût nécessité de longues réparations, sinon même l’abandon
définitif du véhicule.
C’était le 19 octobre, dès le
matin, que la caravane s’était engagée sur ces territoires, où les fils télégraphiques
ne pouvaient plus conserver une direction rectiligne. Aussi la disposition du
sol avait-elle obligé de les incliner vers l’ouest – direction que Tom Marix
dut imposer à son personnel. Entre temps, si cette région présentait de
capricieux accidents de terrain, impropres à une allure rapide et régulière, elle
était redevenue très boisée, grâce au voisinage des massifs montagneux. Il
fallait incessamment contourner ces « brigalows-scrubs », sortes de
fourrés impénétrables, où domine la prolifique famille des acacias. Sur les
bords des ruisseaux se dressaient des groupes de casuarinas, aussi dépouillés
de feuilles que si le vent d’hiver eût secoué leurs branches. À l’entrée des
gorges poussaient quelques-uns de ces calebassiers, dont le tronc s’évase en
forme de bouteille, et que les Australiens nomment « bottle-trees ».
À la façon de l’eucalyptus, qui vide un puits lorsque ses racines y plongent, le
calebassier pompe toute l’humidité du sol, et son bois spongieux en est
tellement imprégné que l’amidon qu’il contient peut servir à la nourriture des
bestiaux. Les marsupiaux vivaient en assez grand nombre sous ces
brigalows-scrubs, entre autres les wallabys si rapides à la course que le plus
souvent les indigènes, lorsqu’ils veulent s’en emparer, sont contraints de les
enfermer dans un cercle de flamme en mettant le feu aux herbes. En de certains
endroits abondaient les kangourous-rats, et ces kangourous géants, que les
blancs ne poursuivent guère que par plaisir cynégétique, car il faut être nègre
– et nègre australien – pour consentir à se nourrir de leur chair coriace. Tom
Marix et Godfrey ne parvinrent à frapper d’une balle que deux ou trois couples
de ces animaux, dont la vitesse égale celle d’un cheval au galop. Il faut dire
que la queue de ces kangourous fournit un potage excellent, dont chacun
apprécia les qualités au repas du soir.
Cette nuit-là, il y eut une
alerte. Le campement fut troublé par une de ces invasions de rats, comme il ne
s’en voit qu’en Australie, à l’époque où émigrent ces rongeurs. Personne
n’aurait pu dormir, sans risquer d’être déchiqueté, et on ne dormit pas.
Mrs. Branican et ses
compagnons repartirent le lendemain, 22 octobre, en maudissant ces vilaines
bêtes. Au coucher du soleil, la caravane avait atteint les dernières
ramifications des Mac-Donnell-Ranges. Le voyage allait désormais s’effectuer
dans des conditions infiniment plus favorables. Encore une quarantaine de milles,
et la première partie de la campagne prendrait fin à la station d’Alice-Spring.
Le 23, l’expédition eut à
parcourir d’immenses plaines se déroulant à perte de vue. Quelques ondulations
les vallonnaient çà et là. Des bouquets d’arbres en relevaient le monotone aspect.
Les chariots suivaient sans difficulté l’étroite route, tracée au pied des
poteaux télégraphiques, et desservant les stations, établies assez loin les
unes des autres. Il était certes incroyable que la ligne, peu surveillée en ces
contrées désertes, fût respectée des indigènes.
Et aux observations qu’on lui
faisait à ce propos, Tom Marix dut répondre :
« Ces nomades, je l’ai
dit, ayant été châtiés électriquement par notre ingénieur, se figurent que le
tonnerre court sur ces fils, et ils se gardent bien d’y toucher.
Ils croient même que leurs
deux bouts se rattachent au soleil et à la lune et que ces grosses boules leur
tomberaient sur la tête, s’ils s’avisaient de tirer dessus. »
À onze heures, suivant
l’habitude, la grande halte de la journée eut lieu. La caravane s’installa près
d’un massif d’eucalyptus dont le feuillage, tombant comme les pendeloques de
cristal d’un lustre, ne donnait que peu ou point d’ombre. Là coulait un creek
ou plutôt un filet d’eau, à peine suffisant pour mouiller les cailloux de son
lit. Sur la rive opposée, le sol se relevant par un brusque épaulement, barrait
la surface de la plaine sur une longueur de plusieurs milles de l’est à
l’ouest. En arrière, on saisissait encore le lointain profil des
Mac-Donnell-Ranges au-dessus de l’horizon.
Ce repos durait d’habitude
jusqu’à deux heures. On évitait ainsi de cheminer pendant la partie la plus
chaude de la journée. À vrai dire, ce n’était qu’une halte et non un campement.
Tom Marix ne faisait alors ni dételer les bœufs, ni débrider les chevaux. Ces
animaux mangeaient sur place. On ne dressait point les tentes, on n’allumait
point les feux. La venaison froide et les conserves composaient ce second repas,
qui avait été précédé d’un premier déjeuner au lever du soleil.
Chacun vint, comme à
l’ordinaire, s’asseoir ou s’étendre sur l’herbe dont l’épaulement était revêtu.
Une demi-heure écoulée, les bouviers et les gens de l’escorte, noirs ou blancs,
leur faim apaisée, dormaient en attendant le départ.
Mrs. Branican, Jane et
Godfrey formaient un groupe à part. La servante indigène Harriett leur avait
apporté un panier contenant quelques provisions. Tout en déjeunant, ils
s’entretenaient de leur prochaine arrivée à la station d’Alice-Spring.
L’espérance qui n’avait jamais abandonné Dolly, le jeune novice la partageait
absolument, et, lors même qu’il n’y aurait pas eu motif d’espérer, rien n’eût
ébranlé leurs convictions. Tous, d’ailleurs, étaient pleins de foi dans le
succès de la campagne, leur résolution formelle étant de ne plus quitter la
terre australienne tant qu’ils ne seraient pas fixés sur le sort du capitaine
John.
Il va de soi que Len Burker, affectant
de nourrir ces mêmes idées, ne ménageait point ses encouragements, lorsqu’il en
trouvait l’occasion. Cela entrait dans son jeu ; car il avait intérêt à ce
que Mrs. Branican ne retournât pas en Amérique, puisqu’il était interdit à lui
d’y revenir. Dolly, ne soupçonnant rien de ses odieuses trames, lui savait gré
de ce qu’il l’appuyait.
Pendant cette halte, Zach
Fren et Tom Marix s’étaient mis à causer de la réorganisation qu’il
conviendrait de donner à la caravane, avant de quitter la station
d’Alice-Spring. Grave question. N’était-ce pas alors que commenceraient les
véritables difficultés d’une expédition à travers l’Australie centrale ?
Il était une heure et demie
environ, lorsqu’un bruit sourd se fit entendre dans la direction du nord. On
eût dit un tumulte prolongé, un roulement continu, dont les lointaines rumeurs
se propageaient jusqu’au campement.
Mrs. Branican, Jane et
Godfrey qui s’étaient relevés, prêtaient l’oreille.
Tom Marix et Zach Fren
venaient de s’approcher d’eux, et, le regard tendu, écoutaient.
« D’où peut provenir ce
bruit ? demanda Dolly.
– Un orage, sans doute ?
dit le maître.
– On dirait plutôt le ressac
des lames sur une grève », fit observer Godfrey.
Cependant il n’y avait aucun
symptôme d’orage, et l’atmosphère ne décelait aucune saturation électrique.
Quant à quelque déchaînement d’eaux furieuses, il n’aurait pu être produit que
par une subite inondation, due au trop-plein des creeks. Mais lorsque Zach Fren
voulut donner cette explication au phénomène :
« Une inondation dans
cette partie du continent, à cette époque et après une telle sécheresse ?…
répondit Tom Marix. Soyez certain que c’est impossible ! »
Et il avait raison. Qu’à la
suite de violents orages, il survienne parfois des crues provoquées par
l’excessive abondance des eaux pluviales, que les nappes liquides se répandent
à la surface des terrains en contre-bas, cela se voit quelquefois pendant la
mauvaise saison. Mais, à la fin d’octobre, l’explication était inadmissible.
Tom Marix, Zach Fren et Godfrey, s’étaient hissés sur le rebord de l’épaulement
et portaient un regard inquiet dans le sens du nord et de l’est. Rien en vue
sur toute l’immense étendue des plaines mornes et désertes. Toutefois, au-dessus
de l’horizon, se déroulait un nuage de forme bizarre qu’on ne pouvait confondre
avec ces vapeurs que les longues chaleurs accumulent à la ligne périphérique de
la terre et du ciel. Ce n’était point un amas de brumes à l’état vésiculaire ;
c’était plutôt une agglomération de ces volutes aux contours nets que
produisent les décharges de l’artillerie. Quant au bruit qui s’échappait de cet
amoncellement poussiéreux – comment douter que ce fût un énorme rideau de
poussière ? – il s’accroissait rapidement, semblable à quelque piétinement
cadencé, une sorte de chevauchement colossal, répercuté par le sol élastique de
l’immense prairie. D’où venait-il ?
« Je sais… j’ai déjà été
témoin… Ce sont des moutons ! s’écria Tom Marix.
– Des moutons ?…
répliqua Godfrey en riant. Si ce ne sont que des moutons…
– Ne riez pas, Godfrey !
répondit le chef de l’escorte. Il y a peut-être là des milliers et des milliers
de moutons, qui auront été saisis de panique… Si je ne me suis pas trompé, ils
vont passer comme une avalanche, détruisant tout sur leur passage ! »
Tom Marix n’exagérait pas.
Lorsque ces animaux sont affolés pour une cause ou pour une autre – ce qui
arrive quelquefois à l’intérieur des runs – rien ne peut les retenir, ils
renversent les barrières, et s’échappent. Un vieux dicton dit que « devant
les moutons s’arrête la voiture du roi… » et il est vrai qu’un troupeau de
ces stupides bêtes se laisse plutôt écraser que de céder la place ; mais
si elles se laissent écraser elles écrasent aussi, lorsqu’elles se précipitent
en masse énorme. Et c’était bien le cas. À voir le nuage de poussière qui
s’arrondissait sur un espace de deux à trois lieues, on ne pouvait estimer à
moins de cent mille les moutons qu’une panique aveugle lançait sur le chemin de
la caravane. Emportés du nord au sud, ils se déroulaient comme un mascaret à la
surface de la plaine et ne s’arrêteraient qu’au moment où ils tomberaient, épuisés
par cette course folle.
« Que faire ?
demanda Zach Fren.
– S’abriter tant bien que mal
au pied de l’épaulement », répondit Tom Marix.
Il n’y avait pas d’autre
parti à prendre, et tous trois redescendirent. Si insuffisantes que pussent
être les précautions indiquées par Tom Marix, elles furent aussitôt mises à
exécution. L’avalanche des moutons n’était pas à deux milles du campement. Le
nuage montait en grosses volutes dans l’air, et de ce nuage sourdait un tumulte
formidable de bêlements.
Les chariots furent mis à
l’abri contre le talus. Quant aux chevaux et aux bœufs, leurs cavaliers et
leurs conducteurs les obligèrent à s’étendre sur le sol, afin de mieux résister
à cet assaut qui passerait peut-être au-dessus d’eux sans les atteindre. Les
hommes s’accotèrent contre le talus. Godfrey se plaça près de Dolly, afin de la
protéger plus efficacement, et on attendit.
Cependant Tom Marix venait de
remonter sur l’arête de l’épaulement. Il voulait observer une dernière fois la
plaine, qui « moutonnait » comme fait la mer sous une violente brise.
Le troupeau arrivait à grand fracas et à grande vitesse, s’étendant sur un
tiers de l’horizon. Ainsi que l’avait dit Tom Marix, les moutons devaient s’y
chiffrer par une centaine de mille. En moins de deux minutes, ils seraient sur
le campement.
« Attention ! Les
voici ! » cria Tom Marix. Et il se laissa rapidement glisser le long
du talus jusqu’à l’endroit où Mrs. Branican, Jane, Godfrey et Zach Fren étaient
blottis les uns contre les autres. Presque aussitôt, le premier rang de moutons
apparut sur la crête. Il ne s’arrêta pas, il n’aurait pu s’arrêter. Les animaux
de tête tombèrent – quelques centaines qui s’empilèrent, lorsque le sol vint à
leur manquer. Aux bêlements se mêlaient les hennissements des chevaux, les
beuglements des bœufs, saisis d’épouvante. Tout s’était effacé, au milieu de
l’épais nuage de poussière, tandis que l’avalanche se déchaînait au delà de
l’épaulement dans une impulsion irrésistible – un véritable torrent de bêtes.
Cela dura cinq minutes, et
les premiers qui se relevèrent, Tom Marix, Godfrey, Zach Fren, aperçurent
l’effrayante masse, dont les dernières lignes ondulaient vers le sud.
« Debout !… Debout ! »
cria le chef de l’escorte.
Tous se remirent sur pied.
Quelques contusions, un peu de dégât dans les chariots, c’est à cela que se
bornait le dommage subi par le personnel et le matériel, grâce à l’abri du
talus.
Tom Marix, Godfrey, Zach Fren,
remontèrent aussitôt sur sa partie supérieure.
Vers le sud, la troupe
fuyante disparaissait derrière un rideau de poussière sableuse. Du côté nord
s’étendait à perte de vue la plaine, profondément piétinée à sa surface.
Mais voici que Godfrey
s’écrie :
« Là-bas… là-bas…
regardez ! »
À une cinquantaine de pas du
talus, deux corps gisaient sur le sol – deux indigènes, sans doute, entraînés, renversés
et probablement écrasés par cette irruption de moutons…
Tom Marix et Godfrey
coururent vers ces corps…
Quelle fut leur surprise !
Jos Meritt et son serviteur Gîn-Ghi étaient là, immobiles, inanimés…
Ils respiraient pourtant, et
des soins empressés les eurent bientôt remis de ce rude assaut. À peine
eurent-ils ouvert les yeux que, si contusionnés qu’ils fussent, l’un et l’autre
se redressèrent.
« Bien !… Oh !…
Très bien ! » fit Jos Meritt.
Puis se retournant :
« Et Gîn-Ghi ?…
demanda-t-il.
– Gîn-Ghi est là… ou du moins
ce qu’il en reste ! répondit le Chinois en se frottant les reins. Décidément,
trop de moutons, mon maître Jos, mille et dix mille fois trop !
– Jamais trop de gigots, jamais
trop de côtelettes, Gîn-Ghi, donc jamais trop de moutons ! répondit le
gentleman. Ce qui est fâcheux, c’est de n’avoir pu en attraper un seul au
passage…
– Consolez-vous, monsieur
Meritt, répondit Zach Fren. Au bas du talus, il y en a des centaines à votre
service.
– Très bien !… Oh !…
Très bien ! » conclut gravement le flegmatique personnage. Puis, s’adressant
à son serviteur, lequel, après s’être frotté les reins, se frottait les épaules :
« Gîn-Ghi ?…
– Mon maître Jos ?…
– Deux côtelettes pour ce soir, dit-il, deux côtelettes…
saignantes ! »
Jos Meritt et Gîn-Ghi
racontèrent alors ce qui s’était passé. Ils cheminaient à trois milles en avant
de la caravane, lorsqu’ils avaient été surpris par cette charge de bêtes
ovines. Leurs chevaux avaient pris la fuite, en dépit de leurs efforts pour les
retenir. Renversés, piétinés, ce fut miracle qu’ils n’eussent pas été écrasés, et
bonne chance aussi que Mrs. Branican et ses compagnons fussent arrivés à temps
pour les secourir.
Tout le monde avait échappé à
ce très sérieux danger, on s’était remis en route, et vers six heures du soir
la caravane atteignit la station d’Alice-Spring.
Le lendemain, 24 octobre, Mrs.
Branican s’occupa de réorganiser l’expédition en vue d’une campagne, qui serait
probablement longue, pénible, périlleuse, puisqu’elle aurait pour théâtre ces
régions à peu près inconnues de l’Australie centrale.
Alice-Spring n’est qu’une
station de l’Overland-Telegraf-Line – quelque vingtaine de maisons, dont
l’ensemble mériterait à peine le nom de village.
En premier lieu, Mrs.
Branican se rendit auprès du chef de cette station, M. Flint. Peut-être
possédait-il des renseignements sur les Indas ?… Est-ce que cette tribu, chez
laquelle le capitaine John était retenu prisonnier, ne descendait pas parfois
de l’Australie occidentale jusque dans les régions du centre ?
M. Flint ne put rien
dire de précis à cet égard, si ce n’est que ces Indas parcouraient de temps à autre
la partie ouest de la Terre Alexandra. Jamais il n’avait entendu parler de John
Branican. Quant à Harry Felton, ce qu’il en savait, c’est qu’il avait été
recueilli à quatre-vingts milles dans l’est de la ligne télégraphique, sur la
frontière du Queensland. Selon lui, le mieux était de s’en rapporter aux
renseignements assez précis que l’infortuné avait fournis avant de mourir ;
il s’engageait à poursuivre cette campagne en coupant obliquement vers les
districts de l’Australie occidentale. Il espérait d’ailleurs qu’elle aurait une
heureuse issue, et que Mrs. Branican réussirait là où lui, Flint, avait échoué,
lorsqu’il s’était lancé, six ans auparavant, à la recherche de Leichhardt –
projet que des guerres de tribus indigènes l’avaient bientôt contraint
d’abandonner. Il se mettait à la disposition de Mrs. Branican pour lui procurer
toutes les ressources qu’offrait la station. C’était, ajouta-t-il, ce qu’il
avait fait pour David Lindsay, lorsque ce voyageur s’arrêta à Alice-Spring en
1886, avant de se diriger vers le lac Nash et le massif oriental des
Mac-Donnell-Ranges.
Voici ce qu’était, à cette époque,
la partie du continent australien que l’expédition se préparait à explorer en
remontant vers le nord-ouest.
À deux cent soixante milles
de la station d’Alice-Spring, sur le cent vingt-septième méridien, se développe
la frontière rectiligne, qui, du sud au nord, sépare l’Australie méridionale, la
Terre Alexandra et l’Australie septentrionale de cette province désignée sous
le nom d’Australie occidentale, dont Perth est la capitale. Elle est la plus
vaste, la moins connue et la moins peuplée des sept grandes divisions du
continent. En réalité, elle n’est déterminée géographiquement que sur le
périmètre de ses côtes, qui comprennent les Terres de Nuyts, de Lieuwin, de
Wlaming, d’Endrack, de Witt et de Tasman.
Les cartographes modernes
indiquent à l’intérieur de ce territoire, dont les indigènes nomades sont seuls
à parcourir les lointaines solitudes, trois déserts distincts :
1° Au sud, le désert, compris
entre les trentième et vingt-huitième degrés de latitude, qu’explora Forrest en
1869, depuis le littoral jusqu’au cent vingt-troisième méridien, et que Giles
traversa, dans son entier en 1875.
2° Le Gibson-Desert, compris
entre les vingt-huitième et vingt-troisième degrés, dont le même Giles
parcourut les immenses plaines pendant l’année 1876.
3° Le Great-Sandy-Desert, compris
entre le vingt-troisième degré et la côte septentrionale, que le colonel
Warburton parvint à franchir de l’est au nord-ouest en 1873, et au prix de
quels dangers, on le sait.
Or, c’était précisément sur
ce territoire que l’expédition de Mrs. Branican allait opérer ses recherches.
L’itinéraire du colonel Warburton, c’était celui auquel il convenait de se
tenir, d’après les renseignements donnés par Harry Felton. De la station
d’Alice-Spring jusqu’au littoral de l’océan Indien, le voyage de cet audacieux
explorateur n’avait pas exigé moins de quatre mois, soit quinze mois de durée
totale entre septembre 1872 et janvier 1874. Combien de temps coûterait celui
que Mrs. Branican et ses compagnons se préparaient à entreprendre ?…
Dolly recommanda à Zach Fren
et à Tom Marix de ne pas perdre un jour, et, très activement secondés par M. Flint,
ils purent se conformer à ses ordres.
Depuis une quinzaine de jours,
trente chameaux, achetés à haut prix pour le compte de Mrs. Branican, avaient
été réunis à la station d’Alice-Spring, sous la conduite de chameliers afghans.
L’introduction des chameaux
en Australie ne datait que de trente ans. C’est en 1860 que M. Elder en
fit importer de l’Inde une certaine quantité. Ces utiles animaux, sobres et
robustes, de complexion très rustique, sont capables de porter une charge de
cent cinquante kilogrammes et de faire quarante kilomètres par vingt-quatre heures,
« en allant toujours leur pas », comme on dit vulgairement. En outre,
ils peuvent rester une semaine sans manger, et, sans boire, six jours l’hiver
et trois jours l’été. Aussi sont-ils appelés à rendre sur cet aride continent
les mêmes services que dans les régions brûlantes de l’Afrique. Là comme ici
ils subissent presque impunément les privations provenant du manque d’eau et
des chaleurs excessives. Le désert du Sahara et le Great-Sandy-Desert ne
sont-ils pas traversés par les méridiens correspondants des deux hémisphères ?
Mrs. Branican disposait de
trente chameaux, vingt de selle et dix de bât. Le nombre des mâles était plus
considérable que celui des femelles. La plupart étaient jeunes, mais dans de bonnes
conditions de force et de santé. De même que l’escorte avait pour chef Tom
Marix, de même ces animaux avaient pour chef un chameau mâle, le plus âgé, auquel
les autres obéissaient volontiers. Il les dirigeait, les rassemblait aux haltes,
les empêchait de s’enfuir avec les chamelles. Lui mort ou malade, la troupe
risquerait de se débander, et les conducteurs seraient impuissants à maintenir
le bon ordre. Il allait de soi que ce précieux animal fût attribué à Tom Marix,
et ces deux chefs – l’un portant l’autre – avaient leur place indiquée en tête
de la caravane.
Il fut convenu que les
chevaux et les bœufs, qui avaient transporté le personnel depuis la station de
Farina-Town jusqu’à la station d’Alice-Spring, seraient laissés aux bons soins
de M. Flint. On les retrouverait au retour avec les buggys et les chariots.
Toutes les probabilités, en effet, étaient que l’expédition reprît en revenant
vers Adélaïde la route jalonnée par les poteaux de l’Overland-Telegraf-Line.
Dolly et Jane occuperaient
ensemble une « kibitka », sorte de tente à peu près identique à celle
des Arabes, et que portait l’un des plus robustes chameaux de la troupe. Elles
pourraient s’y abriter des rayons du soleil derrière d’épais rideaux et même se
protéger contre ces pluies, que de violents orages déversent – trop rarement, il
est vrai – sur les plaines centrales du continent.
Harriett, la femme au service
de Mrs. Branican, habituée aux longues marches des nomades, préférait suivre à
pied. Ces grandes bêtes à deux bosses lui paraissaient plutôt destinées à
transporter des colis que des créatures humaines.
Trois chameaux de selle
étaient réservés à Len Burker, à Godfrey et à Zach Fren, qui sauraient
s’accoutumer à leur marche dure et cahotante. D’ailleurs, il n’était pas
question de prendre une autre allure que le pas régulier de ces animaux, puisqu’une
partie du personnel ne serait pas monté. Le trot ne deviendrait nécessaire que
si l’obligation se présentait de devancer la caravane, afin de découvrir un
puits ou une source pendant le parcours du Great-Sandy-Desert.
Quant aux blancs de l’escorte,
c’était à eux qu’étaient destinés les quinze autres chameaux de selle. Les noirs
préposés à la conduite des dix chameaux de bât, devaient faire à pied les douze
à quatorze milles que comprendraient les deux étapes quotidiennes ; cela
ne serait pas excessif pour eux.
Ainsi fut réorganisée la
caravane en vue des épreuves inhérentes à cette seconde période du voyage. Tout
avait été combiné, avec approbation de Mrs. Branican, pour suffire aux exigences
de la campagne, si longue qu’elle dût être, en ménageant les bêtes et les
hommes. Mieux pourvue de moyens de transport, mieux fournie de vivres et
d’effets de campement, fonctionnant dans des conditions plus favorables
qu’aucun des précédents explorateurs du continent australien, il y avait lieu
d’espérer qu’elle atteindrait son but.
Il reste à dire ce que
deviendrait Jos Meritt. Ce gentleman et son domestique Gîn-Ghi allaient-ils
demeurer à la station d’Alice-Spring ? S’ils la quittaient, serait-ce pour
continuer à suivre la ligne télégraphique dans la direction du nord ? Ne
se porteraient-ils pas plutôt soit vers l’est, soit vers l’ouest, à la recherche
des tribus indigènes ? C’était là, en effet, que le collectionneur aurait
chance de découvrir l’introuvable couvre-chef dont il suivait depuis si
longtemps la piste. Mais, à présent qu’il était privé de monture, dépossédé de
bagages, démuni de vivres, comment parviendrait-il à continuer sa route ?
À plusieurs reprises, depuis
qu’ils étaient rentrés en relation, Zach Fren avait interrogé Gîn-Ghi à cet
égard. Mais le Céleste avait répondu qu’il ne savait jamais ce que déciderait
son maître, attendu que son maître ne le savait pas lui-même. Ce qu’il pouvait
affirmer, pourtant, c’est que Jos Meritt ne consentirait point à revenir en
arrière, tant que sa monomanie ne serait pas satisfaite, et que lui, Gîn-Ghi, originaire
de Hong-Kong, n’était pas près de revoir le pays « où les jeunes Chinoises,
vêtues de soie, cueillent de leurs doigts effilés la fleur du nénuphar ».
Cependant, on était à la
veille du départ, et Jos Meritt n’avait encore rien dit de ses projets, lorsque
Mrs. Branican fut avisée par Gîn-Ghi que le gentleman sollicitait la faveur
d’un entretien particulier.
Mrs. Branican, très désireuse
de rendre service à cet original dans la mesure du possible, fit répondre
qu’elle priait l’honorable Jos Meritt de vouloir bien se rendre à la maison de M. Flint,
où elle demeurait depuis son arrivée à la station.
Jos Meritt s’y transporta
aussitôt – c’était dans l’après-midi du 25 octobre – et dès qu’il fut assis en
face de Dolly, il entra en matière en ces termes :
« Mistress Branican…
Bien !… Oh !… Très bien ! Je ne doute pas, non… je ne doute pas
un instant que vous ne retrouviez le capitaine John… Et je voudrais être aussi
certain de mettre la main sur ce chapeau à la découverte duquel tendent tous
les efforts d’une existence déjà très mouvementée… Bien !… Oh !… Très
bien ! Vous devez savoir pourquoi je suis venu fouiller les plus secrètes
régions de l’Australie ?
– Je le sais, monsieur Meritt,
répondit Mrs. Branican, et, de mon côté, je ne doute pas que vous ne soyez un
jour payé de tant de persévérance.
– Persévérance… Bien !…
Oh !… Très bien !… C’est que, voyez-vous, mistress, ce chapeau est unique
au monde !
– Il manque à votre
collection ?…
– Regrettablement… et je
donnerais ma tête pour pouvoir le mettre dessus !
– C’est un chapeau d’homme ?
demanda Dolly, qui s’intéressait plutôt par bonté que par curiosité aux
innocentes fantaisies de ce maniaque.
– Non, mistress, non… Un
chapeau de femme… Mais de quelle femme !… Vous m’excuserez si je tiens à
garder le secret sur son nom et sa qualité… de crainte d’exciter la concurrence…
Songez donc, mistress… si quelqu’autre…
– Enfin avez-vous un indice ?…
– Un indice ?… Bien !…
Oh !… Très bien ! Ce que j’ai appris à grand renfort de
correspondances, d’enquêtes, de pérégrinations, c’est que ce chapeau a émigré
en Australie, après d’émouvantes vicissitudes, et que, parti de haut… oui, de
très haut !… il doit orner maintenant la tête d’un souverain de tribu indigène…
– Mais cette tribu ?…
– C’est l’une de celles qui
parcourent le nord ou l’ouest du continent. Bien !… Oh !… Très bien !
S’il le faut, je les visiterai toutes… je les fouillerai toutes… Et, puisqu’il
est indifférent que je commence par l’une ou par l’autre, je vous demande la permission
de suivre votre caravane jusque chez les Indas.
– Très volontiers, monsieur
Meritt, répondit Dolly, et je vais donner l’ordre que l’on se procure, s’il est
possible, deux chameaux supplémentaires…
– Un seul suffira, mistress, un
seul pour mon domestique et pour moi… d’autant mieux que je me propose de monter
la bête et que Gîn-Ghi se contentera d’aller à pied.
– Vous savez que nous devons
partir demain matin, monsieur Meritt ?
– Demain ?… Bien !…
Oh !… Très bien ! Ce n’est pas moi qui vous retarderai, mistress
Branican. Mais il est entendu, n’est-il pas vrai, que je ne m’occupe aucunement
de ce qui concerne le capitaine John… Cela, c’est votre affaire… Je ne m’occupe
que de mon chapeau…
– De votre chapeau, c’est
convenu, monsieur Meritt ! » répondit Dolly.
Là-dessus, Jos Meritt se
retira en déclarant que cette intelligente, énergique et généreuse femme
méritait de retrouver son mari autant, à tout le moins, qu’il méritait, lui, de
mettre la main sur le joyau, dont la conquête compléterait sa collection de
coiffures historiques.
Gîn-Ghi, avisé d’avoir à se
tenir prêt pour le lendemain, dut s’occuper de mettre en ordre les quelques
objets qui avaient été sauvés du désastre, après l’affaire des moutons. Quant à
l’animal que le gentleman devait partager avec son serviteur – de la manière
qu’il a été dit ci-dessus – M. Flint parvint à se le procurer. Cela lui
valut un : « Bien !… Oh !… Très bien ! » de la
part de son très reconnaissant Jos Meritt.
Le lendemain, 26 octobre, le
signal du départ fut donné, après que Mrs. Branican eut pris congé du chef de
la station. Tom Marix et Godfrey précédaient les blancs de l’escorte qui
étaient montés. Dolly et Jane s’installèrent dans la kibitka, ayant Len Burker
d’un côté, Zach Fren de l’autre. Puis venait, majestueusement achevalé entre
les deux bosses de sa monture, Jos Meritt, suivi de Gîn-Ghi. Arrivaient ensuite
les chameaux de bât et les noirs formant la seconde moitié de l’escorte.
À six heures du matin, l’expédition,
laissant à sa droite l’Overland-Telegraf-Line et la station d’Alice-Spring, disparaissait
derrière un des contreforts des Mac-Donnell-Ranges.
Au mois d’octobre, en
Australie, la chaleur est déjà excessive. Aussi Tom Marix avait-il conseillé de
ne voyager que pendant les premières heures du jour – de quatre à neuf heures –
et pendant l’après-midi – de quatre à huit heures. Les nuits mêmes commençaient
à être suffocantes, et de longues haltes étaient nécessaires pour acclimater la
caravane aux fatigues des régions centrales.
Ce n’était pas encore le
désert, avec l’aridité de ses interminables plaines, ses creeks entièrement à
sec, ses puits qui ne contiennent plus qu’une eau saumâtre, lorsque la
sécheresse du sol ne les a pas complètement taris. À la base des montagnes
s’étendait cette région accidentée où s’enchevêtrent les ramifications des
Mac-Donnell et des Strangways-Ranges, et que sillonne la ligne télégraphique en
se courbant vers le nord-ouest. Cette direction, la caravane dut l’abandonner, afin
de se porter plus décidément à l’ouest, presque sur le parallèle qui se confond
avec le tropique du Capricorne. C’était à peu près la même route que Giles
avait suivie en 1872, et qui coupait celle de Stuart à vingt-cinq milles au
nord d’Alice-Spring.
Les chameaux ne marchaient
qu’à petite allure sur ces terrains très accidentés. De rares filets de creeks
les arrosaient çà et là. Les gens pouvaient y trouver à l’abri des arbres une
eau courante, assez fraîche, et dont les bêtes faisaient provision pour
plusieurs heures.
En longeant ces halliers
clairsemés, les chasseurs de la caravane, chargés de l’approvisionner de venaison,
purent abattre diverses pièces de gibier d’espèce comestibles – entre autres
des lapins.
On n’ignore pas que le lapin
est à l’Australie ce que la sauterelle est à l’Afrique. Ces trop prolifiques
rongeurs finiront par tout ronger, si l’on n’y prend garde. Jusqu’alors, le
personnel de la caravane les avait un peu dédaignés au point de vue alimentaire,
parce que ce qui constitue le vrai gibier abondait dans les plaines et les
forêts de l’Australie méridionale. Il serait toujours temps de se rassasier de
cette chair un peu fade, lorsque les lièvres, les perdrix, les outardes, les
canards, les pigeons et autres bêtes de poil et de plume feraient défaut. Mais,
sur cette région riveraine des Mac-Donnell-Ranges, il fallait bien se contenter
de ce que l’on trouvait, c’est-à-dire des lapins qui pullulaient à sa surface.
Et, à propos, dans la soirée
du 31 octobre, Godfrey, Jos Meritt et Zach Fren étant réunis, la conversation
tomba sur cette engeance qu’il est urgent de détruire. Et Godfrey ayant demandé
s’il y avait toujours eu des lapins en Australie :
« Non, mon garçon, répondit
Tom Marix. Leur importation ne remonte qu’à une trentaine d’années. Un joli
cadeau qu’on nous a fait là ! Ces animaux se sont tellement multipliés
qu’ils dévastent nos campagnes. Certains districts en sont infestés à ce point
qu’on ne peut plus y élever ni moutons ni bestiaux. Les champs sont troués par
les terriers comme une écumoire, et l’herbe y est rongée jusqu’à la racine.
C’est une ruine absolue, et je finis par croire que ce ne sont pas les colons
qui mangeront les lapins, mais les lapins qui mangeront les colons.
– N’a-t-on pas employé des
moyens puissants pour s’en délivrer ? fit observer Zach Fren.
– Disons des moyens
impuissants, répondit Tom Marix, puisque leur quantité augmente au lieu de
diminuer. Je connais un propriétaire, qui a dû affecter quarante mille livres à la destruction des lapins qui ravageaient son run.
Le gouvernement a mis leur tête à prix, comme on fait pour les tigres et les serpents
dans l’Inde anglaise. Bah ! semblables à celles de l’hydre, les têtes
repoussent à mesure qu’on les coupe et même en plus grand nombre. On a fait
usage de la strychnine, qui en a empoisonné par centaines de mille, ce qui a
failli donner la peste au pays. Rien n’a réussi.
– N’ai-je pas entendu dire, demanda
Godfrey, qu’un savant français, M. Pasteur, avait proposé de détruire ces
rongeurs en leur donnant le choléra des poules ?
– Oui, et peut-être le moyen
serait-il efficace ? Mais il aurait fallu… l’employer, et il ne l’a pas
été, bien qu’une prime de vingt mille livres ait été offerte dans ce but. Aussi
le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud viennent-ils d’établir un grillage
long de huit cents milles, afin de protéger l’est du continent contre l’invasion
des lapins. C’est une véritable calamité.
– Bien !… Oh !…
Très bien ! Véritable calamité… repartit Jos Meritt, de même que les types
de la race jaune, qui finiront par envahir les cinq parties du monde. Les
Chinois sont les lapins de l’avenir. »
Heureusement Gîn-Ghi n’était
pas là, car il n’eût pas laissé passer sans protestation cette comparaison
offensante à l’égard des Célestes. Ou, tout au moins, aurait-il haussé les
épaules en riant de ce rire particulier à sa race et qui n’est qu’une longue et
bruyante aspiration.
« Ainsi, dit Zach Fren, les
Australiens renonceraient à continuer la lutte ?…
– Et de quelle façon
pourraient-ils s’y prendre ?… répondit Tom Marix.
– Il me semble pourtant, dit
Jos Meritt, qu’il y aurait un moyen sûr d’anéantir ces lapins.
– Et lequel ? demanda
Godfrey.
– Ce serait d’obtenir du
Parlement britannique un décret ainsi conçu : « Il ne sera plus porté
que des chapeaux de castor dans tout le Royaume-Uni et les colonies qui en
dépendent. Or, comme le chapeau de castor n’est jamais fait qu’avec du poil de
lapin… Bien !… Oh !… Très bien ! »
Et c’est ainsi que Jos Meritt
acheva sa phrase par son exclamation habituelle.
Quoi qu’il en soit, et en
attendant que ledit décret fût rendu par le Parlement, le mieux était de se
nourrir des lapins abattus en route. C’en serait autant de moins pour
l’Australie, et on ne se fit pas faute de leur donner la chasse. Quant aux
autres animaux, ils n’auraient pu servir à l’alimentation ; mais on
aperçut quelques mammifères d’une espèce particulière, et des plus intéressantes
pour les naturalistes. L’un était un échidné de la famille des monotrèmes, au
museau en forme de bec avec des lèvres cornées, au corps hérissé de piquants
comme un hérisson, et dont la principale nourriture se compose des insectes
qu’il happe avec sa langue filiforme, tendue hors de son terrier. L’autre était
un ornithorynque, avec des mandibules de canard, des poils d’un brun roux, couvrant
un corps déprimé qui mesure un pied de longueur. Les femelles de ces deux
espèces possèdent cette particularité d’être ovovivipares ; elles pondent
des œufs, mais les petits qui en sortent, elles les allaitent.
Un jour, Godfrey, qui se
distinguait parmi les chasseurs de la caravane, fut assez heureux pour
apercevoir et tirer un « iarri », sorte de kangourou d’allure très
sauvage, qui, n’ayant été que blessé, parvint à s’enfuir sous les fourrés du
voisinage. Le jeune novice n’en fut pas autrement chagriné, car à en croire Tom
Marix, ce mammifère n’a de valeur que par la difficulté qu’on éprouve à
l’atteindre, et non par ses propriétés comestibles. Il en fut de même d’un « bungari »,
animal de grande taille à pelage noirâtre, qui se faufile entre les hautes
ramures à la façon des marsupiaux, s’accrochant avec ses griffes de chat, balançant
sa longue queue. Cet être, essentiellement noctambule, se cache si adroitement
entre les branches qu’il est malaisé de l’y reconnaître.
Par exemple, Tom Marix fit
observer que le bungari fournit un gibier excellent, dont la chair est très
supérieure à celle du kangourou, lorsqu’on la fait rôtir sur des braises. On
eut d’autant plus de regret de n’en pouvoir juger, et il était probable que les
bungaris cesseraient de se montrer aux approches du désert. Évidemment, en
s’avançant à l’ouest, la caravane serait réduite à ne vivre que de ses propres
ressources.
Cependant, malgré les
difficultés du sol, Tom Marix parvenait à maintenir la moyenne réglementaire de
douze à quatorze milles par vingt-quatre heures – moyenne sur laquelle était basée
la marche de l’expédition. Bien que la chaleur fût déjà très forte – trente à
trente-cinq degrés à l’ombre – le personnel la supportait assez convenablement.
Durant le jour, il est vrai, on trouvait encore quelques groupes d’arbres au
pied desquels le campement pouvait être dressé dans des conditions acceptables.
D’ailleurs, l’eau ne manquait pas, bien qu’il n’y eût plus que quelques filets
dans le lit des creeks. Les haltes qui avaient régulièrement lieu de neuf
heures à quatre heures de l’après-midi, dédommageaient suffisamment hommes et
bêtes de la fatigue des marches.
La contrée était inhabitée.
Les derniers runs avaient été laissés en arrière. Plus de paddocks, plus
d’enclos, plus de ces nombreux moutons qu’une herbe courte et desséchée n’aurait
pu nourrir. À peine rencontrait-on de rares indigènes, qui se dirigeaient vers
les stations de l’Overland-Telegraf-Line.
Le 7 novembre, dans
l’après-midi, Godfrey, qui s’était éloigné d’un demi-mille en avant, revint en
signalant la présence d’un homme à cheval. Ce cavalier suivait une étroite
sente au pied des Mac-Donnell-Ranges, dont la base est formée de quartz et de
grès métamorphiques. Ayant aperçu la caravane, il piqua des deux et l’eut
rejointe en un temps de galop.
Le personnel venait de
s’installer sous de maigres eucalyptus, un bouquet de deux à trois arbres, qui
donnaient à peine d’ombre. Là sinuait un petit creek, alimenté par les sources
que renferme la chaîne centrale, et dont toute l’eau avait été bue par les
racines de ces eucalyptus.
Godfrey amena l’homme en
présence de Mrs. Branican. Elle lui fit d’abord donner une large rasade de
wiskey, et il se montra très reconnaissant de cette aubaine.
C’était un blanc australien
âgé de trente-cinq ans environ, un de ces excellents cavaliers, habitués à la
pluie qui glisse sur leur peau luisante comme sur un taffetas ciré, habitués au
soleil qui n’a plus rien à cuire sur leur teint absolument rissolé. Il était
courrier de son état, et remplissait ses fonctions avec zèle et bonne humeur, parcourant
les districts de la province, distribuant les lettres, colportant les nouvelles
de station en station, et aussi dans les villages disséminés à l’est ou à
l’ouest de la ligne télégraphique. Il revenait alors d’Emu-Spring, poste de la
pente méridionale des Bluff-Ranges, après avoir traversé la région qui s’étend
jusqu’au massif des Mac-Donnell.
Ce courrier, qui appartenait
à la classe des « roughmen », on aurait pu le comparer au type bon garçon
des anciens postillons de France. Il savait endurer la faim, endurer la soif.
Certain d’être cordialement accueilli partout où il s’arrêtait, même quand il
n’avait pas à tirer une lettre de sa sacoche, résolu, courageux, vigoureux, le
revolver à la ceinture, le fusil en bandoulière, une monture rapide et
vigoureuse entre les jambes, il allait jour et nuit, sans craindre les
mauvaises rencontres.
Mrs. Branican eut plaisir à
le faire causer, à lui demander des renseignements sur les tribus aborigènes
avec lesquelles il s’était trouvé en rapport.
Ce brave courrier répondit
obligeamment et simplement. Il avait entendu parler – comme tout le monde – de
la catastrophe du Franklin ; toutefois, il ignorait qu’une
expédition, organisée par la femme de John Branican, eût quitté Adélaïde pour
explorer les régions centrales du continent australien. Mrs. Branican lui
apprit aussi que, d’après les révélations de Harry Felton, c’était parmi les
peuplades de la tribu des Indas que le capitaine John était retenu depuis
quatorze ans.
« Et, dans vos courses, demanda-t-elle,
avez-vous eu des relations avec les indigènes de cette tribu ?
– Non, mistress, bien que ces
Indas se soient parfois rapprochés de la Terre Alexandra, répondit le courrier,
et que j’aie souvent entendu parler d’eux.
– Peut-être pourriez-vous
nous dire où ils se trouvent actuellement ? demanda Zach Fren.
– Avec ces nomades, ce serait
difficile… Une saison, ils sont ici, une autre, ils sont là-bas…
– Mais, en dernier lieu ?…
reprit Mrs. Branican, qui insista sur cette question.
– Je crois pouvoir affirmer, mistress,
répondit le courrier, que ces Indas étaient, il y a six mois, dans le
nord-ouest de l’Australie orientale, du côté de la rivière Fitz-Roy. Ce sont
les territoires que fréquentent volontiers les peuplades de la Terre de Tasman.
Mille diables ! vous savez que pour atteindre ces territoires, il faut
traverser les déserts du centre et de l’ouest, et je n’ai pas à vous apprendre
à quoi on s’expose !… Après tout, avec du courage et de l’énergie, on va
loin… Donc, faites-en provision, et bon voyage, mistress Branican ! »
Le courrier accepta encore un
grand verre de wiskey, et même quelques boîtes de conserves qu’il glissa dans
ses fontes. Puis, remontant à cheval, il disparut en contournant la dernière
pointe des Mac-Donnell-Ranges.
Deux jours après, la caravane
dépassait les extrêmes contreforts de cette chaîne que domine la cime du mont
Liebig. Elle était enfin arrivée sur la limite du désert, à cent trente milles
au nord-ouest d’Alice-Spring.
Ce que le mot « désert »
évoque à l’esprit, c’est le Sahara, avec ses immenses plaines sablonneuses, coupées
de fraîches et verdoyantes oasis. Toutefois les régions centrales du continent
australien n’ont rien de commun avec les régions septentrionales de l’Afrique, si
ce n’est la rareté de l’eau. « L’eau s’est mise à l’ombre », disent
les indigènes, et le voyageur est réduit à errer de puits en puits, situés pour
la plupart à des distances considérables. Cependant bien que le sable, soit
qu’il s’étende en couches, soit qu’il se relève en dunes, recouvre en grande partie
le sol australien, ce sol n’est pas absolument aride. Des arbrisseaux, agrémentés
de fleurettes, quelques arbres de loin en loin, gommiers, acacias ou eucalyptus,
cela est moins attristant que la nudité du Sahara. Mais ces arbres, ces
arbrisseaux, ne fournissent ni fruits ni feuilles comestibles aux caravanes, qui
sont obligées d’emporter leurs vivres, et c’est à peine si la vie animale est
représentée au milieu de ces solitudes par le vol des oiseaux de passage.
Mrs. Branican tenait avec une
régularité et une exactitude parfaite son journal de voyage. Quelques notes de
ce journal feront connaître, plus nettement que les montrerait un simple récit,
les incidents de ce cheminement si pénible. Elles diront mieux aussi ce
qu’était l’âme ardente de Dolly, sa fermeté au milieu des épreuves, son
inébranlable ténacité à ne point désespérer, même lorsque le moment arriva où
la plupart de ses compagnons désespérèrent autour d’elle. On y verra enfin ce
dont une femme est capable, quand elle se dévoue à l’accomplissement d’un
devoir.
…………………
10 novembre. – Nous avons quitté notre campement du mont Liebig à
quatre heures du matin. Ce sont de précieux renseignements que nous a fournis
ce courrier. Ils concordent avec ceux de ce pauvre Felton. Oui, c’est au
nord-ouest et plus spécialement du côté de la rivière Fitz-Roy qu’il faut
chercher la tribu des Indas. Près de huit cents milles à franchir !… Nous
les franchirons. J’arriverai, dussé-je arriver seule, dussé-je devenir
prisonnière de cette tribu. Du moins, je le serais avec John !
Nous remontons vers le
nord-ouest, à peu près sur la route du colonel Warburton. Notre itinéraire se
confondra sensiblement avec le sien jusqu’à la Fitz-Roy river. Puissions-nous
ne pas subir les épreuves qu’il a subies, ni laisser en arrière quelques-uns de
nos compagnons, morts d’épuisement ! Par malheur, les circonstances sont
moins favorables. C’est au mois d’avril que le colonel Warburton a quitté
Alice-Spring – ce que serait le mois d’octobre dans le Nord-Amérique, c’est-à-dire
vers la fin de la saison chaude. Notre caravane, au contraire, n’est partie
d’Alice-Spring qu’à la fin d’octobre, et nous sommes en novembre, c’est-à-dire
au commencement de l’été australien. Aussi la chaleur est-elle déjà excessive, trente-cinq
degrés centigrades à l’ombre, lorsqu’il y a de l’ombre. Et nous ne pouvons en
attendre que d’un nuage qui passe sur le soleil, d’un abri que nous offre un
bouquet d’arbres…
L’ordre de marche adopté par
Tom Marix est très pratique. La durée et les heures des étapes sont également
bien proportionnées. Entre quatre et huit heures du matin, première étape, puis
halte jusqu’à quatre heures. Seconde étape de quatre heures à huit heures du
soir, et repos toute la nuit. Nous évitons ainsi de cheminer pendant la
brûlante méridienne. Mais que de temps perdu ! que de retards ! En admettant
qu’il ne survienne aucun obstacle, c’est à peine si nous serons dans trois mois
d’ici sur les bords de la Fitz-Roy river…
Je suis très satisfaite des
services de Tom Marix. Zach Fren et lui sont deux hommes résolus, sur lesquels
je puis compter en toutes circonstances.
Godfrey m’effraie par sa
nature passionnée. Il est toujours en avant, et souvent nous le perdons de vue.
J’ai de la peine à le retenir près de moi, et, pourtant, cet enfant m’aime
autant que s’il était mon fils. Tom Marix lui a fait des observations sur sa
témérité. J’espère qu’il en tiendra compte.
Len Burker presque toujours à
l’arrière de la caravane semble plutôt rechercher la compagnie des noirs de
l’escorte que celle des blancs. Il connaît de longue date leurs goûts, leurs
instincts, leurs habitudes. Lorsque nous rencontrons des indigènes, il nous est
très utile, car il parle leur langue assez pour les comprendre et en être
compris. Puisse le mari de ma pauvre Jane s’être sérieusement amendé, mais je
crains !… Son regard n’a pas changé – un de ces regards sans franchise, qui
se détournent…
…………………
13 novembre. – Il n’y a rien eu de nouveau pendant ces trois jours.
Quel soulagement et quelle consolation j’éprouve à voir Jane près de moi !
Que de propos nous échangeons dans la kibitka, où nous sommes renfermées toutes
les deux ! J’ai fait partager ma conviction à Jane, elle ne met plus en
doute que je retrouverai John. Mais la pauvre femme est toujours triste. Je ne
la presse point de questions sur son passé depuis le jour où Len Burker l’a
forcée de le suivre en Australie. Je comprends qu’elle ne puisse se livrer tout
entière. Il me semble quelquefois qu’elle va dire des choses… On croirait que
Len Burker la surveille… Quand elle l’aperçoit, quand il s’approche, son
attitude change, son visage se décompose… Elle en a peur… Il est certain que
cet homme la domine, et que, sur un geste de lui, elle l’accompagnerait au bout
du monde.
Jane paraît avoir de
l’affection pour Godfrey, et pourtant, lorsque ce cher enfant vient près de
notre kibitka dans l’intention de causer, elle n’ose lui adresser la parole, ni
même lui répondre… Ses yeux se détournent, elle baisse la tête… On dirait
qu’elle souffre de sa présence.
Aujourd’hui, nous traversons
une longue plaine marécageuse pendant l’étape du matin. Il s’y rencontre
quelques flaques d’eau, une eau saumâtre, presque salée. Tom Marix nous dit que
ces marais sont des restes d’anciens lacs, qui se reliaient autrefois au lac
Eyre et au lac Torrens pour former une mer en dédoublant le continent. Par
bonheur, nous avions pu faire une provision d’eau à notre halte de la veille, et
nos chameaux se sont désaltérés abondamment.
On trouve, paraît-il, plusieurs
de ces lagunes, non seulement dans les parties déprimées du sol, mais aussi au
milieu des régions plus élevées.
Le terrain est humide ;
le pied des montures y fait apparaître une boue visqueuse, après avoir écrasé
la couche saline qui recouvre les flaques. Quelquefois la croûte résiste
davantage à la pression, et, lorsque le pied s’y enfonce brusquement, il
jaillit une éclaboussure de vase liquide.
Nous avons eu grand-peine à
franchir ces marécages, qui s’étendent sur une dizaine de milles vers le
nord-ouest.
Rencontré déjà des serpents
depuis notre départ d’Adélaïde. Ils sont assez répandus en Australie, et en
plus grand nombre à la surface de ces lagunes, semées d’arbrisseaux et
d’arbustes. Un de nos hommes de l’escorte a même été mordu par un de ces
venimeux reptiles, longs d’au moins trois pieds, de couleur brune, et dont le
nom scientifique est, m’a-t-on dit, le Trimesurus ikaheca. Tom Marix a
aussitôt cautérisé la blessure avec une pincée de poudre versée sur le bras de
cet homme, et qu’il a enflammée. L’homme – c’était un blanc – n’a pas même
poussé un cri. Je lui tenais le bras pendant l’opération. Il m’a remerciée. Je
lui ai fait donner un supplément de wiskey. Nous avons lieu de croire que la
blessure n’aura pas de suite fâcheuse.
Il faut prendre garde où l’on
met le pied. D’être hissé sur un chameau ne vous met pas complètement à l’abri
de ces serpents. Je crains toujours que Godfrey ne commette quelque imprudence
et je tremble, lorsque j’entends les noirs crier : « Vin’dohe ! »,
mot qui veut dire « serpent » en langue indigène.
Le soir, au moment où l’on
installait les tentes pour la nuit, deux de nos indigènes ont encore tué un
reptile de grande taille. Tom Marix dit que, si les deux tiers de serpents qui
fourmillent en Australie sont venimeux, il n’y a que cinq espèces dont le venin
soit dangereux pour l’homme. Le serpent que l’on vient de tuer mesure une
douzaine de pieds de long. C’est une sorte de boa. Nos Australiens ont voulu
l’accommoder pour leur repas du soir. Il n’y avait qu’à les laisser faire.
Voici comment ils s’y prennent :
Un trou ayant été creusé dans
le sable, un indigène y place des pierres préalablement chauffées au milieu
d’un brasier, et sur lesquelles sont étendues des feuilles odorantes. Le
serpent, dont la tête et la queue ont été coupées, est exposé au fond du trou
et recouvert du même feuillage, qui est maintenu par des pierres chaudes. Le
tout reçoit une couche de terre piétinée, assez épaisse pour que la vapeur de
la cuisson ne puisse s’échapper au dehors.
Nous assistons à cette
opération culinaire, non sans quelque dégoût ; mais, lorsque le serpent, suffisamment
cuit, a été retiré de ce four improvisé, il faut convenir que sa chair exhale
un fumet délicieux. Ni Jane ni moi, n’en voulûmes goûter, bien que Tom Marix
assurât que, si la chair blanchâtre de ces reptiles est assez insipide, leur
foie est considéré comme un manger des plus savoureux.
« On peut le comparer, dit-il,
à ce qu’il y a de plus fin en fait de gibier et particulièrement à la gélinotte.
– Gélinotte !… Bien !…
Oh !… Très bien ! Délicieux, la gélinotte ! » s’écria Jos
Meritt.
Et après s’être fait servir
un petit morceau du foie, il en redemanda un plus gros, et il eût fini par le
dévorer tout entier. Que voulez-vous ? Le sans-façon britannique.
Quant à Gîn-Ghi, il ne s’est
pas fait prier. Une belle tranche fumante de la chair du serpent, qu’il a
dégustée en gourmet, l’a mis de belle humeur.
« Ay ya ! s’est-il
écrié non sans un long soupir de regret, avec quelques huîtres de Ning-Po et
une fiole de vin de Tao-Ching, on se croirait au Tié-Coung-Yuan ! »
Et Gîn-Ghi voulut bien
m’apprendre que c’était là le fameux débit de thé de l’Arc de fer à
Pékin.
Godfrey et Zach Fren, surmontant
leur répugnance, s’offrirent des bribes de serpent. C’était très mangeable à
leur avis. J’ai préféré les en croire sur parole.
Il va sans dire que le
reptile fut dévoré jusqu’à la dernière bouchée par les indigènes de l’escorte.
Ils ne laissèrent même pas perdre le quelque peu de graisse que l’animal avait
rendu pendant la cuisson.
Durant la nuit, notre sommeil
a été troublé par de sinistres hurlements qui se sont fait entendre à une
certaine distance. C’était une troupe de « dingos ». Le dingo
pourrait être appelé le chacal de l’Australie, car il tient du chien et du
loup. Il possède une fourrure jaunâtre ou d’un rouge brun, et une longue queue
très fournie. Fort heureusement, ces fauves se bornèrent à hurler et
n’attaquèrent point le campement. En très grand nombre, ils auraient pu être
redoutables.
…………………
19 novembre.
– La chaleur est de plus en
plus accablante, et les creeks que nous rencontrons encore sont presque
entièrement desséchés. Il est nécessaire de creuser leur lit, si l’on veut
recueillir de cette eau dont nous remplissons nos tonnelets. Avant peu, nous ne
pourrons plus compter que sur les puits ; les creeks auront disparu.
Je suis bien obligée de
reconnaître qu’il existe une antipathie vraiment inexplicable, on la dirait
même instinctive, entre Len Burker et Godfrey. Jamais l’un n’adresse la parole
à l’autre. Il est certain qu’ils s’évitent le plus qu’ils peuvent.
Je m’en suis entretenue un
jour avec Godfrey.
« Tu n’aimes pas Len
Burker ? lui ai-je dit.
– Non, mistress Dolly, m’a-t-il
répondu, et ne me demandez pas de l’aimer…
– Mais il est allié à ma
famille, ai-je repris. C’est mon parent, Godfrey, et puisque tu m’aimes…
– Mistress Dolly, je vous
aime, mais je ne l’aimerai jamais. »
Cher Godfrey, quel est donc
le pressentiment, la raison secrète, qui le fait parler ainsi ?
…………………
27 novembre. – Aujourd’hui s’étendent devant nos yeux de larges
espaces, d’immenses steppes monotones, couverts de spinifex. C’est une herbe
épineuse que l’on a justement nommée « herbe porc-épic ». Il faut
circuler entre des touffes qui s’élèvent quelquefois jusqu’à cinq pieds
au-dessus du sol, et dont les pointes très aiguës risquent de blesser nos
montures. Déjà les pousses de spinifex ont cette teinte particulière qui suffit
à indiquer qu’elles sont impropres à l’alimentation des bêtes. Lorsque ces
pousses sont encore jaunes ou vertes, les chameaux ne refusent point de s’en
nourrir. Mais ce n’est plus le cas, et ils ne se préoccupent que de ne point
s’y frôler en passant.
Dans ces conditions, la
marche devient extrêmement pénible. C’est un parti à prendre, car nous aurons
des centaines de milles à franchir au milieu de ces plaines de spinifex. C’est
l’arbuste du désert, le seul qui puisse végéter sur les arides territoires du
centre de l’Australie.
La chaleur s’accroît sans
cesse, l’ombre manque partout. Nos piétons souffrent à l’excès de cette
température violente. Et croirait-on que, cinq mois plus tôt, ainsi que l’a
constaté le colonel Warburton, le thermomètre s’abaisse quelquefois bien
au-dessous de zéro, et les creeks sont emprisonnés sous une couche de glace
épaisse d’un pouce ?
Les creeks se multiplient à
cette époque ; mais, à présent, quelle que soit la profondeur à laquelle
on creuserait leur lit, il ne s’y trouverait pas une seule goutte d’eau.
Tom Marix a donné l’ordre à
ceux des gens de l’escorte qui sont montés, de céder de temps à autre leurs
montures à ceux qui ne le sont pas. Cette mesure a été prise dans le but de donner
satisfaction aux réclamations des noirs. Je vois avec regret que Len Burker
s’est fait leur porte-parole en cette circonstance. Certainement ces hommes
sont à plaindre : s’en aller pieds nus au milieu des touffes de spinifex, par
une température qui est à peine supportable, même le soir, même le matin, c’est
extrêmement pénible. En tout cas, ce n’est pas à Len Burker d’exciter leur
jalousie contre l’escouade des blancs. Il se mêle de ce qui ne le regarde pas.
Je le prie de s’observer.
« Ce que j’en fais, Dolly,
me répond-il, c’est dans l’intérêt commun.
– Je veux le croire, ai-je
répliqué.
– Il importe de répartir
justement les charges…
– Laissez-moi ce soin, monsieur
Burker, dit Tom Marix, qui est intervenu dans la discussion. Je prendrai les
mesures nécessaires. »
Je le vois bien, Len Burker
se retire avec un dépit mal déguisé, et il nous a lancé un mauvais regard. Jane
s’en est aperçue, au moment où les yeux de son mari se sont fixés sur elle, et
la pauvre femme a détourné la tête.
Tom Marix me promet de faire
tout ce qui dépendra de lui, afin que les hommes de l’escorte, blancs ou noirs,
n’aient à se plaindre en aucune façon.
…………………
5 décembre. – Pendant nos haltes, nous avons beaucoup à souffrir du
fait des fourmis blanches. C’est par myriades que nous assaillent ces insectes.
Invisibles sous le sable fin, il suffit de la pression du pied pour qu’ils
apparaissent à la surface.
« J’ai la peau dure et
coriace, me dit Zach Fren, une vraie peau de requin, et pourtant ces maudites
bêtes n’en font pas fi ! »
La vérité est que le cuir des
animaux n’est pas même assez épais pour résister à la morsure de leurs
mandibules. Nous ne pouvons plus nous étendre à terre, sans en être aussitôt couverts.
Pour échapper à ces insectes, il faudrait s’exposer aux rayons du soleil, dont
ils ne peuvent supporter l’ardeur. Ce ne serait que changer un mal pour un
pire.
Celui de nous qui semble être
le moins maltraité par ces fourmis, c’est le Chinois. Est-il trop paresseux
pour que ces importunes piqûres triomphent de son indolence ? je ne sais ;
mais, tandis que nous changeons de place, nous débattant, à demi enragés, le
privilégié Gîn-Ghi, étalé à l’ombre d’une touffe de spinifex, reste immobile et
dort paisiblement, comme si ces malfaisantes bêtes respectaient sa peau jaune.
Jos Meritt, au surplus, se
montre aussi patient que lui. Bien que son long corps offre à ces assaillants
un vaste champ à dévorer, il ne se plaint pas. D’un mouvement automatique et
régulier, ses deux bras se lèvent, retombent, écrasent machinalement des
milliers de fourmis, et il se contente de dire, en regardant son serviteur
indemne de toute morsure :
« Ces Chinois sont
vraiment des êtres exceptionnellement favorisés de la nature.
– Gîn-Ghi ?…
– Mon maître Jos ?
– Il faudra que nous
changions de peau ?…
– Volontiers, répond le
Céleste, si, en même temps, nous changeons de condition.
– Bien… Oh !… Très bien !
Mais, pour opérer ce changement de peau, il conviendra d’abord d’écorcher l’un
de nous, et ce sera par vous que l’on commencera…
– Nous reparlerons de cette
affaire à la troisième lune », répond Gîn-Ghi.
Et il se rendort jusqu’à la
cinquième veille, pour employer son poétique langage, c’est-à-dire jusqu’au
moment où la caravane va se remettre en route.
…………………
10 décembre. – Ce supplice ne cesse qu’après le départ effectué sur
le signal donné par Tom Marix. Il est heureux que les fourmis ne s’avisent pas
de grimper aux jambes des chameaux. Quant à nos piétons, ils ne sont pas
absolument délivrés de ces insupportables insectes.
En outre, pendant la marche
nous ne laissons pas d’être en butte aux attaques d’ennemis d’un autre genre, et
non moins désagréables ; ce sont les moustiques, qui constituent l’un des
plus redoutables fléaux de l’Australie. Sous leur aiguillon, surtout à l’époque
des pluies, les bestiaux, comme s’ils étaient frappés par une épidémie, maigrissent,
dépérissent, meurent même, sans qu’on puisse les préserver.
Et, cependant, que n’aurions-nous
donné pour être alors dans la saison des pluies ? Il n’est rien, en vérité,
ce fléau des fourmis ou des moustiques, auprès des tortures de la soif que
provoquent les chaleurs du mois de décembre australien. Le manque d’eau finit
par amener l’anéantissement de toutes les facultés intellectuelles, de toutes
les forces physiques. Et voilà que nos réserves s’épuisent, que nos tonnelets
sonnent le creux ! Après avoir été remplis au dernier creek, ce qu’ils
contiennent n’est qu’un liquide échauffé, épais, troublé par les secousses, qui
ne suffit plus à étancher la soif. Notre situation sera bientôt celle des
chauffeurs arabes à bord des steamers qui traversent la Mer Rouge : les
malheureux tombent à demi pâmés devant le foyer de leurs chaudières.
Ce qui est non moins alarmant,
c’est que nos chameaux commencent à se traîner, au lieu de garder cette allure
du pas relevé, qui leur est familière. Leurs cous se tendent vers l’horizon
tracé autour de la longue et large plaine rase, sans un accident du sol, sans une
ondulation de terrain. Toujours l’immense steppe, recouvert de l’aride spinifex,
que ses profondes racines maintiennent dans le sable. Il n’y a pas un arbre en
vue, pas un indice auquel on puisse reconnaître la présence d’un puits ou d’une
source.
…………………
16 décembre. – En deux étapes, notre caravane n’a pas franchi neuf
milles aujourd’hui. Au reste, depuis plusieurs jours j’ai constaté que notre
moyenne de marche a baissé dans une proportion notable. Malgré leur vigueur, nos
bêtes n’avancent que d’un pas languissant, surtout celles qui transportent le matériel,
Tom Marix entre en fureur, lorsqu’il voit ses hommes s’arrêter brusquement, avant
qu’il ait donné le signal de la halte. Il s’approche des chameaux de bât, et il
les frappe de sa cravache, dont les cinglements, après tout, n’ont que peu
d’action sur le cuir de ces rustiques animaux.
Ce qui amène Jos Meritt à
dire, avec ce flegme dont il ne se départ jamais :
« Bien !… Oh !…
Très bien, monsieur Marix ! Mais, que je vous donne un bon conseil :
ce n’est pas sur le chameau qu’il faut taper, c’est sur son conducteur. »
Et, certainement il n’aurait
pas déplu à Tom Marix de se ranger à cet avis, si je ne fusse intervenue pour
l’en empêcher. Aux fatigues que nos gens éprouvent, ayons la prudence, à tout
le moins, de ne pas joindre les mauvais traitements. Quelques-uns d’entre eux
finiraient par déserter, je crains que cela arrive, principalement si l’idée en
vient aux noirs de l’escorte, bien que Tom Marix ne cesse de me rassurer à cet
égard.
…………………
Du 17 au 27 décembre. – Le voyage se poursuit dans ces conditions.
Pendant les premiers jours de
la semaine, le temps s’est modifié avec le vent qui souffle plus vivement.
Quelques nuages sont montés du nord, présentant des volutes arrondies. On dirait
de grosses bombes qu’une étincelle suffirait à faire éclater.
Ce jour-là – 23 – l’étincelle
a jailli, un éclair a sillonné l’espace. Les éclats stridents de la foudre se
sont produits avec une intensité rare, mais sans être suivis de ces roulements
prolongés que les échos se renvoient dans les pays montagneux. En même temps, les
courants atmosphériques se sont déchaînés d’une telle violence que nous n’avons
pu tenir sur nos bêtes. Il a fallu en descendre et même s’étendre sur le sol.
Zach Fren, Godfrey, Tom Marix et Len Burker ont eu beaucoup de peine à protéger
notre kibitka contre l’impétuosité des rafales. Quant à camper sous de tels assauts,
à dresser nos tentes entre les touffes de spinifex, impossible d’y songer. En
un instant, tout le matériel eût été dispersé, lacéré, mis hors d’usage.
« Cela n’est rien, dit
Zach Fren en se frottant les mains. Un orage est bientôt passé.
– Vive l’orage, s’il donne de
l’eau ! » s’écria Godfrey.
Godfrey a raison : de
l’eau ! de l’eau ! c’est notre cri… Mais pleuvra-t-il ?… Toute
la question est là ?… Oui, c’est toute la question car une pluie abondante,
ce serait pour nous la manne du désert. Par malheur, l’air était si sec – ce
qui se reconnaissait à la singulière brièveté des coups de tonnerre – que l’eau
des nuages pourrait bien rester à l’état de vapeur et ne point se résoudre en
pluie. Et pourtant, il eût été difficile d’imaginer un plus violent orage, un
plus assourdissant échange de détonations et d’éclairs.
Je pus observer alors ce qui
m’avait été dit de l’attitude des aborigènes australiens en présence de ces
météores. Ils ne craignent pas d’être frappés du tonnerre, ils ne ferment pas
les yeux devant l’éclair, ils ne frémissent pas aux éclats de la foudre. En
effet, c’étaient des exclamations de joie que poussaient les noirs de notre
escorte. Ils ne subissaient en aucune façon cette impression physique que
ressent tout être vivant, lorsque l’espace est chargé d’électricité, au moment
où ce fluide se manifeste par le déchirement des nues dans les hauteurs du ciel
en feu.
Décidément, l’appareil
nerveux est peu sensible chez ces êtres primitifs. Après tout, peut-être saluaient-ils
dans cet orage le déluge qu’il pouvait contenir ? Et en vérité, cette
attente était le supplice de Tantale dans toute son âpreté.
« Mistress Dolly…
mistress Dolly, me disait Godfrey, c’est pourtant de l’eau, de la bonne eau
pure, de l’eau du ciel, qui est suspendue sur notre tête ! Voilà des
éclairs qui crèvent ces nuages, et il n’en tombe rien !
– Un peu de patience, mon
enfant, lui répondis-je, ne nous désespérons pas…
– En effet, dit Zach Fren, les
nuages s’épaississent et s’abaissent en même temps. Ah ! si le vent
voulait s’apaiser, tout ce vacarme finirait en cataractes ! »
De fait, ce qu’il y avait le
plus à craindre, c’était que l’ouragan n’emportât cet amas de vapeurs vers le
sud, sans nous verser une goutte d’eau…
Vers trois heures de
l’après-midi, il semble que l’horizon au nord commence à se dégager, que
l’orage aura bientôt pris fin. Ce sera une cruelle déception !
« Bien !… Oh !…
Très bien ! »
C’est Jos Meritt qui vient de
lancer son exclamation habituelle. Jamais cette locution approbative n’a été
plus justifiée. Notre Anglais, la main étendue, constate qu’elle s’est mouillée
de quelques larges gouttes.
Le déluge ne se fit pas
attendre. Il fallut nous abriter étroitement sous nos vêtements de caoutchouc.
Puis, sans perdre une minute, tous les récipients que comprenait le matériel furent
disposés sur le sol, de manière à recevoir cette bienfaisante averse. On
étendit même des linges, des toiles, des couvertures, dont il suffirait
d’exprimer l’eau, quand elles seraient imbibées – ce qui servirait à désaltérer
les bêtes.
D’ailleurs, sur l’heure même,
les chameaux purent apaiser la soif qui les torturait. Des ruisselets et des
mares s’étaient rapidement formés entre les touffes de spinifex. La plaine menaçait
de se transformer en un vaste marécage. Il y eut de l’eau, et pour tout le
monde. Nous nous étions d’abord délectés à cette source abondante, que la terre
desséchée allait absorber comme ferait une éponge, et dont le soleil, qui reparaissait
à l’horizon, ne tarderait pas à vaporiser les dernières larmes.
Enfin, c’était notre réserve
assurée pour plusieurs jours. C’était la possibilité de reprendre nos étapes
quotidiennes avec un personnel ranimé de corps et d’âme, et des animaux solidement
remis sur pied. Les tonnelets furent remplis jusqu’aux bondes. Tout ce qui
était étanche fut employé comme récipient. Quant aux chameaux, ils ne
négligèrent point de garnir la poche intérieure dont la nature les a pourvus, et
dans laquelle ils peuvent s’approvisionner d’eau pour un certain temps. Et
dût-on en être surpris, cette poche contient environ quinze gallons.
Malheureusement ils sont
rares, les orages qui désaltèrent la surface du continent australien, du moins
à cette époque de l’année où la chaleur estivale est dans toute sa puissance.
C’est donc une éventualité favorable sur laquelle il serait imprudent de
compter pour l’avenir. Cet orage avait duré trois heures à peine, et le lit brûlant
des creeks aurait bientôt absorbé ce qu’il leur avait versé des eaux du ciel.
Les puits, il est vrai, en profiteraient dans une plus large mesure, et nous
n’aurons qu’à nous en féliciter, si cet orage n’a pas été local. Espérons qu’il
aura rafraîchi sur quelques centaines de milles la plaine australienne.
…………………
29 décembre. – C’est dans ces conditions, et en nous raccordant de
très près à l’itinéraire du colonel Warburton, que nous avons atteint sans
nouvel incident Waterloo-Spring, à cent quarante milles du mont Liebig. Notre
expédition touchait alors le cent vingt-sixième degré de longitude, que Tom
Marix et Godfrey ont relevé sur la carte. Elle venait de franchir la limite
conventionnelle, établie par un trait rectiligne, tiré du sud au nord, entre
les provinces avoisinantes et cette vaste portion du continent qui porte le nom
d’Australie occidentale.
Waterloo-Spring n’est point
une bourgade, pas même un village. Quelques huttes d’indigènes abandonnées en
ce moment, rien de plus. Les nomades ne s’y arrêtent qu’à l’époque où la saison
des pluies alimente les cours d’eau de cette région – ce qui leur permet de s’y
fixer pour un certain temps. Waterloo ne justifiait en aucune façon cette
adjonction du mot « spring », qui est commun à toutes les stations du
désert. Nulle source ne s’épanchait hors du sol, et, ainsi qu’il a été dit, s’il
se rencontre dans le Sahara de fraîches oasis, abritées d’arbres, arrosées
d’eaux courantes, c’est en vain qu’on les chercherait au milieu du désert
australien.
Telle est l’observation
consignée du journal de Mrs. Branican, dont quelques extraits vont encore être
reproduits. Mieux que la plus précise description, ils sont de nature à faire
connaître le pays, à montrer dans toute leur horreur les épreuves réservées aux
audacieux qui s’y aventurent. Ils permettront aussi d’apprécier la force morale,
l’indomptable énergie de leur auteur, son intraitable résolution d’atteindre le
but, au prix de n’importe quels sacrifices.
…………………
30 décembre. – Il faut séjourner quarante-huit heures à
Waterloo-Spring. Ces retards me désolent, quand je songe à la distance qui nous
sépare encore de la vallée où coule la Fitz-Roy. Et sait-on s’il ne sera pas
nécessaire de chercher au delà de cette vallée la tribu des Indas ? Depuis
le jour où Harry Felton l’a quitté, quelle a été l’existence de mon pauvre John ?…
Les indigènes ne se seront-ils pas vengés sur lui de la fuite de son compagnon ?…
Il ne faut pas que je pense à cela… Cette pensée me tuerait !…
Zach Fren essaie de me
rassurer.
« Puisque, durant tant
d’années, le capitaine John et Harry Felton ont été les prisonniers de ces Indas,
me dit-il, c’est que ceux-ci avaient intérêt à les conserver. Harry Felton vous
l’a fait comprendre, mistress. Ces indigènes ont reconnu dans le capitaine un
chef blanc de grande valeur et ils attendent toujours l’occasion de le rendre
contre une rançon proportionnée à son importance. À mon sens, la fuite de son
compagnon ne doit pas avoir empiré la situation du capitaine John. »
Dieu veuille qu’il en soit
ainsi !
…………………
31 décembre. – Aujourd’hui s’est achevée cette année 1890. Il y a
quinze ans, le Franklin partait du port de San-Diégo… Quinze ans !…
Et c’est depuis quatre mois et cinq jours seulement que notre caravane a quitté
Adélaïde ! Cette année qui débute pour nous dans le désert, comment finira-t-elle ?
…………………
1er janvier. – Mes compagnons n’ont pas voulu laisser passer ce jour
sans m’apporter leurs compliments de nouvelle année. Ma chère Jane m’a embrassée,
en proie à la plus vive émotion, et je l’ai longtemps retenue entre mes bras.
Zach Fren et Tom Marix ont voulu me serrer la main. Je sais que j’ai en eux
deux amis qui se sacrifieraient jusqu’à la mort. Tous nos gens m’ont entourée
en m’adressant leurs félicitations bien affectueuses. Je dis tous, à
l’exclusion cependant des noirs de l’escorte, dont le mécontentement se
manifeste à chaque occasion. Il est clair que Tom Marix ne les maintient pas
sans peine dans le rang.
Len Burker m’a parlé avec sa
froideur habituelle en m’assurant du succès de notre entreprise. Il ne doute
pas que nous n’arrivions au but. Toutefois, il se demande si c’est suivre la
bonne route que de marcher vers la rivière Fitz-Roy. Les Indas, à son avis, sont
des nomades que l’on rencontre plus fréquemment dans les régions voisines du
Queensland, c’est-à-dire à l’est du continent. Il est vrai, ajoute-t-il, que
nous allons vers l’endroit où Harry Felton a laissé son capitaine… mais qui
peut assurer que les Indas ne se sont pas déplacés… etc.
Tout cela est dit de ce ton
qui ne saurait inspirer la confiance, ce ton que certaines gens prennent, quand
ils parlent sans vous regarder.
Mais c’est Godfrey, dont
l’attention m’a le plus vivement touchée. Il avait fait un bouquet de ces petites
fleurs sauvages qui poussent entre les touffes de spinifex. Il me l’a offert de
si bonne grâce, il m’a dit des choses si tendres, que les larmes me sont venues
aux yeux. Comme je l’ai embrassé, mon Godfrey, et comme ses baisers répondaient
aux miens…
Pourquoi la pensée me
revient-elle que mon petit Wat aurait son âge… qu’il serait bon comme lui…
Jane se trouvait là… Elle
était si émue, elle est devenue si pâle en présence de Godfrey… J’ai cru
qu’elle allait perdre connaissance. Mais elle a pu se remettre, et son mari l’a
emmenée… Je n’ai pas osé la retenir.
Nous avons repris la route, ce
jour-là, à quatre heures du soir, par un temps couvert. La chaleur était un peu
plus supportable. Les chameaux de selle et de bât, suffisamment reposés de
leurs fatigues, ont marché d’un pas plus soutenu. Il a même fallu les modérer, afin
que les hommes à pied pussent les suivre.
…………………
15 janvier. – Pendant quelques jours, nous avons conservé cette
allure rapide. Deux ou trois fois, il y a eu encore des pluies abondantes. Nous
n’avons pas souffert de la soif, et notre réserve a été refaite au complet.
Elle est la plus grave de toutes, cette question de l’eau, la plus effrayante
aussi, lorsqu’il s’agit d’un voyage au milieu de ces déserts. Elle exige une
constante préoccupation. En effet, les puits paraissent être rares sur
l’itinéraire que nous suivons. Le colonel Warburton l’a bien reconnu lors de
son voyage, qui s’est terminé à la côte ouest de la Terre de Tasman.
Nous vivons désormais sur nos
provisions – uniquement. Il n’y a pas lieu de faire entrer en compte le
rendement de la chasse. Le gibier a fui ces mornes solitudes. À peine
aperçoit-on quelques bandes de pigeons que l’on ne peut approcher. Ils ne se
reposent entre les touffes de spinifex, qu’après un long vol, lorsque leurs
ailes n’ont plus la force de les soutenir. Néanmoins notre alimentation est
assurée pour plusieurs mois, et, de ce côté, je suis tranquille. Zach Fren
veille scrupuleusement à ce que la nourriture, conserves, farine, thé, café
soit distribuée avec méthode et régularité. Nous-mêmes, nous sommes soumis au
sort commun. Il n’y a d’exception pour personne. Les noirs de l’escorte ne
peuvent se plaindre que nous soyons mieux traités qu’eux.
Çà et là voltigent aussi
quelques moineaux, égarés à la surface de ces régions ; mais ils ne valent
pas la peine que l’on se fatigue à les poursuivre.
Toujours des myriades de
fourmis blanches, rendant très douloureuses nos heures de halte. Quant aux
moustiques, la contrée est trop sèche pour que nous en soyons gênés. « Nous
les retrouverons dans les lieux humides », a fait observer Tom Marix. Eh
bien, mieux vaut encore subir leurs morsures. Ce ne sera pas payer trop cher
l’eau qui les attire.
Nous avons atteint
Mary-Spring, à quatre-vingt-dix milles de Waterloo, dans la journée du 23 janvier.
Un groupe de maigres arbres
se dresse en cet endroit. Ce sont quelques eucalyptus, qui ont épuisé tout le
liquide du sol et sont à demi flétris.
« Leur feuillage pend
comme des langues desséchées par la soif », dit Godfrey.
Et cette comparaison est très
juste.
J’observe que ce jeune garçon,
ardent et résolu, n’a rien perdu de la gaieté de son âge. Sa santé n’est point
altérée, ce que je pouvais craindre, car il est à une époque où l’adolescent se
forme. Et cette incroyable ressemblance qui me trouble… C’est le même regard, quand
ses yeux se fixent sur moi ; ce sont les mêmes intonations quand il me
parle… Et il a une manière de dire les choses, d’exprimer ses pensées, qui me
rappelle mon pauvre John !
Un jour, j’ai voulu attirer
l’attention de Len Burker sur cette particularité.
« Mais non, Dolly, m’a-t-il
répondu, c’est pure illusion de votre part. Je vous l’avoue, je ne suis aucunement
frappé de cette ressemblance. À mon sens, elle n’existe que dans votre imagination.
Peu importe, après tout, et si c’est pour ce motif que vous portez intérêt à ce
garçon…
– Non, Len, ai-je repris, et
si j’ai ressenti une vive affection pour Godfrey, c’est que je l’ai vu se passionner
pour ce qui est l’unique but de ma vie… retrouver et sauver John. Il m’a suppliée
de l’emmener, et, touchée de ses instances, j’ai consenti. Et puis, c’est un de
mes enfants de San-Diégo, l’un de ces pauvres êtres sans famille, qui ont été
élevés à Wat-House… Godfrey est comme un frère de mon petit Wat…
– Je sais… je sais, Dolly, a
répliqué Len Burker, et je vous comprends dans une certaine mesure. Fasse le
ciel que vous n’ayez pas à vous repentir d’un acte où votre sensibilité a plus
de part que votre raison.
– Je n’aime pas à vous
entendre parler ainsi, Len Burker, ai-je repris avec vivacité. De telles observations
me blessent. Qu’avez-vous à reprocher à Godfrey ?…
– Oh ! rien… rien
jusqu’ici. Mais, qui sait… plus tard… peut-être voudra-t-il abuser de votre
affection un peu trop prononcée à son égard ?… Un enfant trouvé… on ne
sait d’où il vient… ce qu’il est… quel sang coule dans ses veines…
– C’est le sang de braves et
honnêtes gens, j’en réponds ! me suis-je écriée. À bord du Brisbane, il
était aimé de tous, de ses chefs et de ses camarades, et, d’après ce que m’a
dit le capitaine, Godfrey n’a jamais encouru un seul reproche ! Zach Fren,
qui s’y connaît, l’apprécie comme moi ! Me direz-vous, Len Burker, pourquoi
vous n’aimez pas cet enfant ?
– Moi… Dolly !… Je ne
l’aime ni ne l’aime pas… Il m’est indifférent, voilà tout. Quant à mon amitié, je
ne la donne pas ainsi au premier venu, et je ne pense qu’à John, à l’arracher
aux indigènes… »
Si c’est une leçon que Len
Burker a voulu me donner, je ne l’accepte pas ; elle porte à faux. Je
n’oublie pas mon mari pour cet enfant ; mais je suis heureuse de penser
que Godfrey aura joint ses efforts aux miens. J’en suis certaine, John approuvera
ce que j’ai fait et ce que je compte faire pour l’avenir de ce jeune garçon.
Lorsque j’ai rapporté cette
conversation à Jane, la pauvre femme a baissé la tête et n’a rien répondu.
À l’avenir, je n’insisterai
plus. Jane ne veut pas, elle ne peut pas donner tort à Len Burker. Je comprends
cette réserve ; c’est son devoir.
…………………
29 janvier. – Nous sommes arrivés sur le bord d’un petit lac, une
sorte de lagon, que Tom Marix croit être le White-Lake. Il justifie son nom de « lac
blanc », car, à la place de l’eau qui s’est évaporée, c’est une couche de
sel qui occupe le fond de ce bassin. Encore un reste de cette mer intérieure
qui séparait autrefois l’Australie en deux grandes îles.
Zach Fren a renouvelé notre
provision de sel ; nous aurions préféré trouver de l’eau potable.
Il y a dans les environs une
grande quantité de rats, plus petits que le rat ordinaire. Il faut se prémunir
contre leurs attaques. Ce sont des animaux si voraces qu’ils rongent tout ce
qu’on laisse à leur portée.
Du reste, les noirs n’ont
point trouvé que ce fût là un gibier à dédaigner. Ayant réussi à attraper
quelques douzaines de ces rats, ils les ont apprêtés, les ont fait cuire, et se
sont régalés de cette chair assez répugnante. Il faudrait que nous fussions
bien à court de vivres pour nous résigner à cette nourriture. Dieu veuille que
nous n’en soyons jamais réduits là !
Nous voici maintenant à la
limite du désert compris sous le nom de Great-Sandy-Desert.
Pendant les derniers vingt
milles, le terrain s’est graduellement modifié. Les touffes de spinifex sont
moins serrées, et cette maigre verdure tend à disparaître. Le sol est-il donc
si aride qu’il ne puisse suffire à cette végétation si peu exigeante ? Qui
ne le croirait en voyant l’immense plaine, ondulée de monticules de sable rouge,
et sans qu’il y ait trace d’un lit de creek. Cela donne à supposer qu’il ne
pleut jamais sur ces territoires dévorés de soleil – pas même dans la saison
d’hiver.
Devant cette aridité
lamentable, cette sécheresse inquiétante, il n’est pas un de nous qui ne se
sente saisi des plus tristes pressentiments. Tom Marix me montre sur la carte
ces solitudes désolées : c’est un espace laissé en blanc que sillonnent
les itinéraires de Giles et de Gibson. Vers le nord, celui du colonel Warburton
indique bien les incertitudes de sa marche par les multiples tours et détours
que nécessite la recherche des puits. Ici ses gens malades, affamés, sont à
bout de forces… Là ses bêtes sont décimées, son fils est mourant… Mieux
vaudrait ne pas lire le récit de son voyage, si l’on veut le recommencer après
lui… Les plus hardis reculeraient… Mais je l’ai lu, et je le relis… Je ne me
laisserai pas effrayer… Ce que cet explorateur a bravé pour étudier les régions
inconnues du continent australien, je le brave, moi, pour retrouver John… Le
seul but de ma vie est là, et je l’atteindrai !
…………………
3 février. – Depuis cinq jours, nous avons dû diminuer encore la
moyenne de nos étapes. Autant de perdu sur la longueur du chemin à parcourir.
Rien n’est plus regrettable. Notre caravane, retardée par les accidents de
terrain, est incapable de suivre la droite ligne. Le sol est fortement
accidenté, ce qui nous oblige à monter et à descendre des pentes parfois très
raides. En maint endroit, il est coupé de dunes, entre lesquelles les chameaux
sont contraints de circuler, puisqu’ils ne peuvent les franchir. Il y a aussi
des collines sablonneuses qui s’élèvent jusqu’à cent pieds, et que séparent des
intervalles de six à sept cents. Les piétons enfoncent dans ce sable, et la
marche devient de plus en plus pénible.
La chaleur est accablante. On
ne saurait se figurer avec quelle intensité le soleil darde ses rayons. Ce sont
des flèches de feu, qui vous percent en mille places. Jane et moi, c’est à
peine s’il nous est possible de demeurer sous l’abri de notre kibitka. Ce que
doivent souffrir nos compagnons pendant les étapes du matin ou du soir !
Zach Fren, si robuste qu’il soit, est très éprouvé par les fatigues ; mais
il ne se plaint pas, il n’a rien perdu de sa bonne humeur, cet ami dévoué, dont
l’existence est liée à la mienne !
Jos Meritt supporte ces
épreuves avec un courage tranquille, une résistance aux privations qu’on est
tenté de lui envier. Gîn-Ghi, moins patient, se plaint, sans parvenir à
émouvoir son maître. Et, quand on songe que cet original se soumet à de
pareilles épreuves pour conquérir un chapeau !
« Bien !… Oh !…
Très bien ! répond-il lorsqu’on lui en fait l’observation. Mais aussi quel
rarissime chapeau !…
– Un vieux galurin de
saltimbanque ! murmure Zach Fren en haussant les épaules.
– Une guenille, riposte
Gîn-Ghi, une guenille qu’on ne voudrait même pas porter en savates ! »
Au cours de la journée, entre
huit heures et quatre heures, il serait impossible de faire un pas. On campe
n’importe où, on dresse deux ou trois tentes. Les gens de l’escorte, blancs et
noirs, s’étendent comme ils le peuvent à l’ombre des chameaux. Ce qui est
effrayant, c’est que l’eau va bientôt manquer. Que devenir, si nous ne rencontrons
que des puits à sec ? Je sens que Tom Marix est extrêmement inquiet, quoiqu’il
cherche à me dissimuler son anxiété. Il a tort, il ferait mieux de ne me rien cacher.
Je puis tout entendre, et je ne faiblirai pas…
…………………
14 février. – Onze jours se sont écoulés, pendant lesquels nous
n’avons eu que deux heures de pluie. C’est à peine si nous avons pu remplir nos
tonnelets, si les hommes ont recueilli de quoi apaiser leur soif, si les bêtes
ont refait leur provision d’eau. Nous sommes arrivés à Emily-Spring, où la
source est absolument tarie. Nos bêtes sont épuisées. Jos Meritt ne sait plus
quel moyen employer pour faire avancer sa monture. Il ne la frappe pas, cependant,
et cherche à la prendre par les sentiments. Je l’entends qui lui dit :
« Voyons, si tu as de la
peine, du moins n’as-tu pas de chagrin, ma pauvre bête ! »
La pauvre bête ne paraît
point comprendre cette distinction.
Nous reprenons notre route, plus
inquiets que nous ne l’avons jamais été.
Deux animaux sont malades.
Ils se traînent, et ne pourront continuer le voyage. Les vivres que portait le
chameau de bât ont dû être placés sur un chameau de selle, lequel a été repris
à l’un des hommes de l’escorte.
Estimons-nous heureux que le
chameau mâle monté par Tom Marix ait jusqu’à présent conservé toute sa vigueur.
Sans lui, les autres, plus particulièrement les chamelles, se débanderaient, et
rien ne pourrait les retenir.
Il y a nécessité d’achever
les pauvres bêtes abattues par la maladie. Les laisser mourir de faim, de soif,
en proie à une longue agonie, ce serait plus inhumain que de terminer d’un coup
leurs misères.
La caravane s’éloigne et
contourne une colline de sable… Deux détonations retentissent… Tom Marix revient
nous rejoindre, et le voyage se poursuit.
Ce qui est plus alarmant, c’est
que la santé de deux de nos gens me donne de vives inquiétudes. Ils sont pris
de fièvre, et on ne leur épargne pas le sulfate de quinine, dont la pharmacie
portative est abondamment fournie. Mais une soif ardente les dévore. Notre
provision d’eau est tarie, et rien n’indique que nous soyons à proximité d’un
puits.
Les malades sont étendus
chacun sur le dos d’un chameau que leurs compagnons conduisent à la main. On ne
peut abandonner des hommes comme on abandonne les bêtes. Nous leur donnerons
nos soins, c’est notre devoir, et nous n’y faillirons pas… Mais cette
impitoyable température les dévore peu à peu…
Tom Marix, si habitué qu’il
soit à ces épreuves du désert, et bien qu’il ait souvent mis son expérience à
profit pour soigner ses compagnons de la police provinciale, ne sait plus que
faire… De l’eau… de l’eau !… C’est ce que nous demandons aux nuages, puisque
le sol est incapable de nous en fournir.
Ceux qui résistent le mieux
aux fatigues, qui supportent sans en trop souffrir ces excessives chaleurs, ce
sont les noirs de l’escorte.
Cependant, s’ils sont moins
éprouvés, leur mécontentement s’accroît de jour en jour. En vain Tom Marix
s’emploie-t-il à les calmer. Les plus excités se tiennent à l’écart aux heures
de halte, se concertent, se montent, et les symptômes d’une prochaine révolte
sont manifestes.
Dans la journée du 21, tous, d’un
commun accord, ont refusé de continuer le voyage dans la direction du
nord-ouest, donnant pour raison qu’ils meurent de soif. La raison n’est, hélas !
que trop sérieuse. Depuis douze heures, il n’y a plus une seule goutte d’eau
dans nos tonnelets. Nous en sommes réduits aux boissons alcooliques, dont
l’effet est déplorable, car elles portent à la tête.
J’ai dû intervenir en
personne au milieu de ces indigènes butés dans leur idée. Il s’agissait de les
amener à comprendre que s’arrêter en de telles circonstances, n’était pas le
moyen de mettre un terme aux souffrances qu’ils subissaient.
« Aussi, me répond l’un
d’eux, ce que nous voulons, c’est revenir en arrière.
– En arrière ?… Et
jusqu’où ?…
– Jusqu’à Mary-Spring.
– À Mary-Spring, il n’y a
plus d’eau, ai-je répondu, et vous le savez bien.
– S’il n’y a plus d’eau à
Mary-Spring, réplique l’indigène, on en trouvera un peu au-dessus du côté du
mont Wilson, dans la direction du Sturt-creek.
Je regarde Tom Marix. Il va
chercher la carte spéciale où figure le Great-Sandy-Desert. Nous la consultons.
En effet, dans le nord de Mary-Spring, il existe un cours d’eau assez important,
qui n’est peut-être pas entièrement desséché. Mais comment l’indigène a-t-il pu
connaître l’existence de ce cours d’eau ? Je l’interroge à ce sujet. Il
hésite d’abord et finit par me répondre que c’est M. Burker qui leur en a
parlé. C’est même de lui qu’est venue la proposition de remonter vers le
Sturt-creek.
Je suis on ne peut plus
contrariée de ce que Len Burker ait eu l’imprudence – n’est-ce que de
l’imprudence ? – de provoquer une partie de l’escorte à retourner dans
l’est. Il en résulterait non seulement des retards, mais une sérieuse
modification à notre itinéraire, laquelle nous écarterait de la rivière
Fitz-Roy.
Je m’en explique nettement
avec lui.
« Que voulez-vous, Dolly ?
me répond-il. Mieux vaut s’exposer à des retards ou à des détours que de
s’obstiner à suivre une route où les puits font défaut.
– En tout cas, monsieur
Burker, dit vivement Zach Fren, c’est à mistress Branican et non aux indigènes
que vous auriez dû faire votre communication.
– Vous agissez de telle façon
avec nos noirs, ajoute Tom Marix, que je ne puis plus les tenir. Est-ce vous
qui êtes leur chef, monsieur Burker, ou est-ce moi ?…
– Je trouve vos observations
inconvenantes, Tom Marix ! réplique Len Burker.
– Inconvenantes ou non, elles
sont justifiées par votre conduite, monsieur, et vous voudrez bien en tenir
compte !
– Je n’ai d’ordres à recevoir
de personne ici, si ce n’est de mistress Branican…
– Soit, Len Burker, ai-je
répondu. Dorénavant, si vous avez quelques critiques à présenter, je vous prie
de me les adresser et non à d’autres.
– Mistress Dolly, dit alors
Godfrey, voulez-vous que je me porte en avant de la caravane à la recherche
d’un puits ?… Je finirai par rencontrer…
– Des puits sans eau ! »
murmure Len Burker, qui s’éloigne en haussant les épaules.
J’imagine aisément ce qu’a dû
souffrir Jane, qui assistait à cette discussion. La façon d’agir de son mari, si
dommageable pour le bon accord qui doit régner dans notre personnel, peut nous
créer les plus graves difficultés. Il fallut que je me joignisse à Tom Marix
pour obtenir des noirs de ne pas persévérer dans leur intention de revenir en
arrière. Nous n’y réussîmes pas sans peine. Toutefois, ils déclarèrent que si
nous n’avions pas trouvé un puits avant quarante-huit heures, ils retourneraient
à Mary-Spring, afin de gagner le Sturtcreek.
…………………
23 février. – Quelles indicibles souffrances pendant les deux jours
qui suivirent ! L’état de nos deux compagnons malades avait empiré. Trois
chameaux tombèrent encore pour ne plus se relever, la tête allongée sur le
sable, les reins gonflés, incapables de faire un mouvement. Il fut nécessaire
de les abattre. C’étaient deux bêtes de selle et une bête de bât. Actuellement
quatre blancs de l’escorte sont réduits à continuer en piétons ce voyage déjà
si fatigant pour des gens montés.
Et pas une créature humaine
dans ce Great-Sandy-Desert ! Pas un Australien de ces régions de la Terre
de Tasman, qui puisse nous renseigner sur la situation des puits ! Évidemment,
notre caravane s’est écartée de l’itinéraire du colonel Warburton, car le
colonel n’a jamais franchi d’aussi longues étapes, sans avoir pu refaire sa
provision d’eau. Trop souvent, il est vrai, les puits à demi taris ne
contenaient qu’un liquide épais, échauffé, à peine potable. Mais nous nous en
contenterions…
Aujourd’hui, enfin, au terme
de la première étape, nous avons pu apaiser notre soif… C’est Godfrey qui a
découvert un puits à une faible distance.
Dès le matin du 23, le brave
enfant s’est porté à quelques milles en avant, et deux heures après, nous
l’avons aperçu qui revenait en toute hâte.
« Un puits !… un
puits ! » s’est-il écrié du plus loin que nous avons pu l’entendre.
À ce cri, notre petit monde
s’est ranimé. Les chameaux se sont remis sur leurs jambes. Il semble que celui
que montait Godfrey leur ait dit en arrivant :
« De l’eau… de l’eau ! »
Une heure après, la caravane
s’arrêtait sous un bouquet d’arbres à la ramure desséchée, qui ombrageaient le
puits. Heureusement, ce sont des gommiers et non de ces eucalyptus, qui
l’auraient asséché jusqu’à la dernière goutte !
Mais les rares puits, creusés
à la surface du continent australien, il faut bien reconnaître qu’une troupe
d’hommes un peu nombreuse les viderait en un instant. L’eau n’y est point abondante,
et encore faut-il aller la puiser sous les couches de sable. C’est que ces
puits ne sont pas l’œuvre de la main de l’homme ; ce ne sont que des
cavités naturelles, qui se forment à l’époque des pluies d’hiver. À peine dépassent-elles
cinq à six pieds en profondeur – ce qui suffit pour que l’eau, abritée des
rayons solaires, échappe à l’évaporation et se conserve même pendant les
longues chaleurs de l’été.
Quelquefois, ces réservoirs
ne se signalent pas à la surface de la plaine par un groupe d’arbres, et il
n’est que trop facile de passer à proximité sans les reconnaître. Il importe
donc d’observer la contrée avec grand soin : c’est une recommandation qui
est faite et très justement faite par le colonel Warburton. Aussi avons-nous
soin d’en tenir compte.
Cette fois, Godfrey avait eu
la main heureuse. Le puits, près duquel notre campement a été établi dès onze
heures du matin, contenait plus d’eau qu’il n’en fallait pour abreuver nos chameaux
et refaire complètement notre réserve. Cette eau restée limpide car elle était
filtrée par les sables, avait gardé sa fraîcheur, la cavité, située au pied
d’une haute dune, ne recevant pas directement les rayons du soleil.
C’est avec délices que chacun
de nous s’est rafraîchi en puisant à cette sorte de citerne. Il fallut même
engager nos compagnons à n’en boire que modérément ; ils auraient fini par
se rendre malades.
On ne saurait s’imaginer les
effets bienfaisants de l’eau, à moins d’avoir été longtemps torturé par la
soif. Le résultat est immédiat ; les plus abattus se relèvent, les forces
reviennent instantanément, le courage avec les forces. C’est plus qu’être ranimé ;
c’est renaître !
Le lendemain, dès quatre
heures du matin, nous avons repris notre route en nous dirigeant vers le
nord-ouest, afin d’atteindre par le plus court Joanna-Spring, à cent
quatre-vingt-dix milles environ de Mary-Spring.
…………………
Ces quelques notes, extraites
du journal de Mrs. Branican, suffiront à démontrer que son énergie ne l’a pas
abandonnée un instant. Il convient, maintenant, de reprendre le récit de ce
voyage, auquel l’avenir réservait encore tant d’éventualités, impossibles à
prévoir et si graves par leurs conséquences.
Ainsi que l’ont fait
connaître les dernières lignes du journal de Mrs. Branican, le courage et la
confiance étaient revenus au personnel de la caravane. Jamais la nourriture
n’avait fait défaut, et elle était assurée pour plusieurs mois. L’eau seule
avait manqué pendant quelques étapes ; mais le puits, découvert par
Godfrey, en avait fourni au delà des besoins, et l’on repartait délibérément.
Il est vrai, il s’agissait
toujours d’affronter une chaleur accablante, de respirer un air embrasé à la
surface de ces interminables plaines, sans arbres et sans ombre. Et ils sont
bien peu nombreux, les voyageurs qui peuvent impunément supporter ces
températures dévorantes, lorsqu’ils ne sont pas originaires du pays australien.
Où l’indigène résiste, l’étranger succombe. Il faut être fait à ce climat
meurtrier.
Toujours la région des dunes
et des sables rouges avec leurs ondulations de longues rides symétriques. On
dirait d’un sol incendié, dont la coloration intensive, accentuée par les
rayons solaires, ne cesse de brûler les yeux. Le sol était chaud au point qu’il
eût été impossible à des blancs d’y marcher pieds nus. Quant aux noirs, leur
épiderme endurci le leur permettait impunément, et ils n’auraient pas dû voir
là une occasion de se plaindre. Ils se plaignaient pourtant ; leur mauvais
vouloir se manifestait sans cesse d’une façon plus apparente. Si Tom Marix
n’avait pas tenu à conserver son escorte au complet, pour le cas où il y aurait
lieu de se défendre contre quelque tribu nomade, il eût assurément prié Mrs.
Branican de congédier les Australiens engagés à son service.
Du reste, Tom Marix voyait
s’accroître les difficultés inhérentes à une telle expédition, et, quand il se
disait que ces fatigues étaient subies et ces dangers bravés en pure perte, il
fallait qu’il fût bien maître de lui pour ne rien laisser paraître de ses
pensées. Seul, Zach Fren l’avait deviné et lui en voulait de ce qu’il ne
partageait pas sa confiance.
« Vraiment, Tom, lui
dit-il un jour, je ne vous aurais pas cru homme à vous décourager !
– Me décourager ?… Vous
vous trompez, Zach, en ce sens du moins, que le courage ne me manquera pas pour
accomplir ma mission jusqu’au bout. Ce n’est pas de traverser ces déserts que
j’appréhende, c’est, après les avoir traversés, d’être contraints de revenir
sur nos pas sans avoir réussi.
– Croyez-vous donc, Tom, que
le capitaine John ait succombé depuis le départ de Harry Felton ?
– Je n’en sais rien, Zach, et
vous ne le savez pas davantage.
– Si, je le sais, comme je
sais qu’un navire abat sur tribord quand on met sa barre à bâbord !
– Vous parlez là, Zach, comme
parle Mrs. Branican ou Godfrey, et vous prenez vos espérances pour des
certitudes. Je souhaite que vous ayez raison. Mais le capitaine John, s’il est
vivant, est au pouvoir des Indas, et ces Indas où sont-ils ?
– Ils sont où ils sont, Tom, et
c’est là que la caravane ira, quand elle devrait bouliner pendant six mois
encore. Que diable ! lorsqu’on ne peut pas virer vent debout, on vire vent
arrière, et on rattrape toujours sa route…
– Sur mer, oui, Zach, lorsqu’on
sait vers quel port on se dirige. Mais, à travers ces territoires, sait-on où
l’on va ?
– Ce n’est pas en désespérant
qu’on l’apprendra.
– Je ne désespère pas, Zach !
– Si, Tom, et, ce qui est
plus grave, c’est que vous finirez par le laisser voir. Celui qui ne cache pas
son inquiétude fait un mauvais capitaine et incite son équipage au
mécontentement. Prenez garde à votre visage, Tom, non pour Mrs. Branican, que
rien ne pourrait ébranler, mais pour les blancs de notre escorte ! S’ils
allaient faire cause commune avec les noirs…
– Je réponds d’eux comme de
moi…
– Et comme moi, je réponds de
vous, Tom ! Aussi ne parlons pas d’amener notre pavillon tant que les mâts
sont debout !
– Qui en parle, Zach, si ce
n’est Len Burker ?…
– Oh ! celui-là, Tom, si
j’étais le commandant, il y a longtemps qu’il serait à fond de cale, avec un
boulet à chaque pied ! Mais, qu’il y fasse attention, car je ne le perds
pas de vue ! »
Zach Fren avait raison de
surveiller Len Burker. Si le désarroi se mettait dans l’expédition, ce serait à
lui qu’on le devrait. Ces noirs, sur lesquels Tom Marix croyait pouvoir compter,
il les excitait au désordre. C’était là une des causes qui risquaient
d’empêcher le succès de la campagne. Mais n’eût-elle pas existé, que Tom Marix
ne conservait guère d’illusion sur la possibilité de rencontrer les Indas et de
délivrer le capitaine John.
Cependant, bien que la
caravane n’allât pas tout à fait à l’aventure, en se dirigeant vers les
environs de la Fitz-Roy, il se pouvait qu’une circonstance eût obligé les Indas
à quitter la Terre de Tasman ; peut-être des éventualités de guerre. Il
est rare que la paix règne entre tribus, qui peuvent compter de deux cent
cinquante à trois cents âmes. Il y a des haines invétérées, des rivalités qui
exigent du sang, et elles s’exercent avec d’autant plus de passion que, chez ces
cannibales, la guerre, c’est la chasse. À vrai dire, l’ennemi n’est pas
seulement l’ennemi, il est le gibier, et le vainqueur mange le vaincu. De là
des luttes, des poursuites, des déplacements, qui entraînent parfois les
indigènes à de grandes distances. Il y aurait donc eu intérêt à savoir si les
Indas n’avaient pas abandonné leurs territoires, et on ne le saurait qu’en
s’emparant d’un Australien venu du nord-ouest.
C’est à cela que tendaient
les efforts de Tom Marix, assidûment secondé par Godfrey, qui, malgré les
recommandations et même les injonctions de Mrs. Branican, se laissait souvent
emporter à une distance de plusieurs milles. Quand il n’allait pas à la
recherche de quelque puits, il se lançait à la recherche de quelque indigène, mais,
jusqu’alors sans résultat. La contrée était déserte. Et, en vérité, quel être
humain, de telle rustique nature fût-il, aurait pu y subvenir aux plus strictes
nécessités de l’existence ? S’y aventurer aux abords de la ligne
télégraphique, cela se pouvait faire à la rigueur, et encore voit-on à quelles
épreuves on était exposé.
Enfin, le 9 mars, vers neuf
heures et demie du matin, on entendit un cri retentir à courte distance – un
cri formé de ces deux mots : coo-eeh !
« Il y a des indigènes
dans les environs, dit Tom Marix.
– Des indigènes ?…
demanda Dolly.
– Oui, mistress, c’est leur
façon de s’appeler.
– Tâchons de les rejoindre »,
répondit Zach Fren. La caravane avança d’une centaine de pas, et Godfrey
signala deux noirs entre les dunes. S’emparer de leurs personnes ne devait pas
être facile, car les Australiens fuient les blancs du plus loin qu’ils les
entrevoient. Ceux-ci cherchaient à se dissimuler derrière une haute dune
rougeâtre, entre des touffes de spinifex. Mais les gens de l’escorte parvinrent
à les cerner, et ils furent amenés devant Mrs. Branican. L’un était âgé d’une
cinquantaine d’années ; l’autre, son fils, d’environ vingt ans. Tous deux
se rendaient à la station du lac Woods, qui appartient au service du réseau
télégraphique. Divers présents en étoffes, et principalement quelques livres de
tabac, les eurent bientôt amadoués, et ils se montrèrent disposés à répondre
aux questions qui leur furent faites par Tom Marix – réponses que celui-ci
traduisait immédiatement pour Mrs. Branican, Godfrey, Zach Fren et leurs compagnons.
Les Australiens avaient d’abord dit où ils allaient – ce qui n’intéressait que
médiocrement. Mais Tom Marix leur demanda d’où ils venaient, ce qui méritait
une sérieuse attention.
« Nous venons de par là…
loin… très loin, répondit le père en montrant le nord-ouest.
– De la côte ?…
– Non… de l’intérieur.
– De la Terre de Tasman ?
– Oui… de la rivière
Fitz-Roy. »
C’était précisément vers
cette rivière, on le sait, que se dirigeait la caravane.
« De quelle tribu
êtes-vous ? dit Tom Marix.
– De la tribu des Goursis.
– Est-ce que ce sont des
nomades ?… »
L’indigène ne parut pas
comprendre ce que voulait dire le chef de l’escorte.
« Est-ce une tribu qui
va d’un campement à l’autre, reprit Tom Marix, une tribu qui n’habite pas un
village ?…
– Elle habite le village de
Goursi, répondit le fils, qui semblait être assez intelligent.
– Et ce village est-il près
de la Fitz-Roy ?…
– Oui, à dix grandes journées
de l’endroit où elle va se jeter à la mer. »
C’est dans le Golfe du Roi
que se déverse la Fitz-Roy river, et c’était là, précisément, que la deuxième
campagne du Dolly-Hope avait pris fin en 1883. Les dix journées, indiquées
par le jeune homme, démontraient que le village de Goursi devait être situé à
une centaine de milles du littoral.
C’est ce qui fut relevé par
Godfrey sur la carte à grands points de l’Australie occidentale – carte qui
portait le tracé de la rivière Fitz-Roy pendant un parcours de deux cent
cinquante milles, depuis son origine au milieu des régions vagues de la Terre
de Tasman.
« Connaissez-vous la
tribu des Indas ? » demanda alors Tom Marix aux indigènes.
Les regards du père et du
fils parurent s’enflammer, lorsque ce nom fut prononcé devant eux.
« Évidemment, ce sont
deux tribus ennemies, ces Indas et ces Goursis, deux tribus qui sont en guerre,
fit observer Tom Marix, en s’adressant à Mrs. Branican.
– C’est vraisemblable, répondit
Dolly, et, très probablement, ces Goursis savent où se trouvent actuellement
les Indas. Interrogez-les à ce sujet, Tom Marix, et tâchez d’obtenir une
réponse aussi précise que possible. De cette réponse dépend peut-être le succès
de nos recherches. »
Tom Marix posa la question, et
le plus âgé des indigènes affirma, sans hésiter, que la tribu des Indas
occupait alors le haut cours de la Fitz-Roy.
« À quelle distance se
trouvent-ils du village de Goursi ? demanda Tom Marix.
– À vingt journées en se
dirigeant vers le soleil levant », répondit le jeune garçon.
Cette distance, reportée sur
la carte, mettait le campement des Indas à deux cent quatre-vingts milles
environ de l’endroit alors atteint par la caravane. Quant à ces renseignements,
ils concordaient avec ceux qui avaient été précédemment donnés par Harry
Felton.
« Votre tribu, reprit
Tom Marix, est-elle souvent en guerre avec la tribu des Indas ?
– Toujours ! »
répondit le fils.
Et son accent, son geste, indiquaient
la violence de ces haines de cannibales.
« Et nous les
poursuivrons, ajouta le père, dont les mâchoires claquaient de désirs sensuels,
et ils seront battus, lorsque le chef blanc ne sera plus là pour leur donner
ses conseils. »
On imagine quelle fut
l’émotion de Mrs. Branican et de ses compagnons, dès que Tom Marix eut traduit
cette réponse. Ce chef blanc depuis tant d’années prisonnier des Indas, pouvait-on
douter que ce ne fût le capitaine John ?
Et, sur les instances de
Dolly, Tom Marix pressa de questions les deux indigènes. Ils ne purent fournir
que des informations très indécises sur ce chef blanc. Ce qu’ils affirmèrent, toutefois,
c’est que, trois mois auparavant, lors de la dernière lutte entre les Goursis
et les Indas, il était encore au pouvoir de ces derniers.
« Et sans lui, s’écria
le jeune Australien, les Indas ne seraient plus que des femmes ! »
Qu’il y eût là exagération de
la part de ces indigènes, peu importait. On savait d’eux tout ce que l’on
voulait en savoir. John Branican et les Indas se trouvaient à moins de trois
cents milles dans la direction du nord-ouest… Il fallait les rejoindre sur les
bords de la Fitz-Roy.
Au moment où le campement
allait être levé, Jos Meritt retint un instant les deux hommes que Mrs.
Branican venait de congédier avec de nouveaux présents. Et alors l’Anglais pria
Tom Marix de leur adresser une question relativement aux chapeaux de cérémonie
que portaient les chefs de la tribu des Goursis et les chefs de la tribu des
Indas.
En vérité, tandis qu’il
attendait leur réponse, Jos Meritt était non moins ému que l’avait été Dolly
pendant l’interrogatoire des indigènes.
Il eut lieu d’être satisfait,
le digne collectionneur, et les « Bien… Oh !… Très bien ! »
éclatèrent entre ses lèvres, quand il apprit que les chapeaux de fabrication
étrangère n’étaient point rares parmi les peuplades du nord-ouest. Dans les
grandes cérémonies, les chapeaux coiffaient habituellement la tête des
principaux chefs australiens.
« Vous comprenez, mistress
Branican, fit observer Jos Meritt, retrouver le capitaine John, c’est très bien !…
Mais, de mettre la main sur le trésor historique que je poursuis à travers les
cinq parties du monde, c’est encore mieux…
– Évidemment ! »
répondit Mrs. Branican.
Et n’était-elle pas faite aux
monomanies de son bizarre compagnon de voyage.
« Vous avez entendu, Gîn-Ghi ?
ajouta Jos Meritt, en se tournant vers son serviteur.
– J’ai entendu, mon maître Jos,
répondit le Chinois. Et quand nous aurons trouvé ce chapeau…
– Nous reviendrons en
Angleterre, nous rentrerons à Liverpool, et là, Gîn-Ghi, élégamment coiffé
d’une calotte noire, vêtu d’une robe de soie rouge, drapé d’un macoual en soie
jaune, vous n’aurez plus d’autre fonction que de montrer ma collection aux
amateurs. Êtes-vous satisfait ?…
– Comme la fleur haïtang, qui
va s’épanouir sous la brise, lorsque le lapin de Jade est descendu vers
l’Occident », répondit le poétique Gîn-Ghi.
Toutefois, il secouait la
tête d’un air aussi peu convaincu de son bonheur à venir que si son maître lui
eût affirmé qu’il serait nommé mandarin à sept boutons.
Len Burker avait assisté à la
conversation de Tom Marix et des deux indigènes dont il comprenait le langage, mais
sans y prendre part. Pas une question relative au capitaine John n’était venue
de lui. Il écoutait attentivement, notant dans sa mémoire les détails qui se
rapportaient à la situation actuelle des Indas. Il regardait sur la carte
l’endroit que la tribu occupait probablement alors vers le cours supérieur de
la rivière Fitz-Roy. Il calculait la distance que la caravane aurait à
parcourir pour s’y transporter, et le temps qu’elle emploierait à traverser ces
régions de la Terre de Tasman.
En réalité ce serait
l’affaire de quelques semaines, si aucun obstacle ne surgissait, que les moyens
de locomotion ne fissent pas défaut, que les fatigues de la route, les
souffrances dues à l’ardeur de la température, fussent heureusement surmontées.
Aussi Len Burker, sentant que la précision de ces renseignements allait
redonner du courage à tous, en éprouvait-il une rage sourde. Quoi ! la
délivrance du capitaine John s’accomplirait, et, grâce à la rançon qu’elle
apportait, Dolly parviendrait à l’arracher aux mains des Indas ?
Tandis que Len Burker
réfléchissait à cet enchaînement d’éventualités, Jane voyait son front
s’obscurcir, ses yeux s’injecter, sa physionomie réfléchir les détestables
pensées qui l’agitaient. Elle en fut épouvantée, elle eut le pressentiment
d’une catastrophe prochaine, et, au moment où les regards de son mari se
fixèrent sur les siens, elle se sentit défaillir…
La malheureuse femme avait
compris ce qui se passait dans l’âme de cet homme, capable de tous les crimes
pour s’assurer la fortune de Mrs. Branican.
En effet, Len Burker se
disait que si John et Dolly se rejoignaient, c’était l’écroulement de tout son
avenir. Ce serait tôt ou tard la reconnaissance de la situation de Godfrey
vis-à-vis d’eux. Ce secret finirait par échapper à sa femme, à moins qu’il ne
la mît dans l’impossibilité de parler, et, pourtant, l’existence de Jane lui
était nécessaire pour que la fortune lui arrivât par elle, après la mort de
Mrs. Branican.
Donc, il fallait séparer Jane
de Dolly, puis, dans le but de faire disparaître John Branican, devancer la
caravane chez les Indas.
Avec un homme sans conscience
et résolu tel que Len Burker, ce plan n’était que trop réalisable, et, d’ailleurs,
les circonstances ne devaient pas tarder à lui venir en aide.
Ce jour-là, à quatre heures
du soir, Tom Marix donna le signal du départ, et l’expédition se remit en
marche dans l’ordre habituel. On oubliait les fatigues passées. Dolly avait
communiqué à ses compagnons l’énergie qui l’animait. On approchait du but… Le
succès paraissait hors de doute… Les noirs de l’escorte semblaient eux-mêmes se
soumettre plus volontiers, et, peut-être, Tom Marix aurait-il pu compter sur
leur concours jusqu’au terme de l’expédition, si Len Burker n’eût été là pour
leur souffler l’esprit de trahison et de révolte.
La caravane, enlevée d’un bon
pas, avait à peu près repris l’itinéraire du colonel Warburton. Cependant la
chaleur s’était accrue, et les nuits étaient étouffantes. Sur cette plaine sans
un seul bouquet d’arbres on ne trouvait d’ombre qu’à l’abri des hautes dunes, et
encore cette ombre était-elle très réduite par la presque verticalité des
rayons solaires.
Et pourtant, sous cette
latitude plus basse que celle du Tropique, c’est-à-dire en pleine zone torride,
ce n’était pas des excès du climat australien que les hommes avaient le plus à
souffrir. La bien autrement grave question de l’eau se représentait chaque
jour. Il fallait aller chercher des puits à de grandes distances, et cela dérangeait
l’itinéraire, qui s’allongeait de nombreux détours. Le plus souvent, c’était Godfrey,
toujours prêt, Tom Marix, toujours infatigable, qui se dévouaient. Mrs.
Branican ne les voyait pas s’éloigner sans un serrement de cœur. Mais il n’y
avait plus rien à espérer des orages, qui sont d’une rareté extrême à cette époque
de l’année. Sur le ciel, rasséréné d’un horizon à l’autre, on ne voyait pas un
lambeau de nuage. L’eau ne pouvait venir que du sol.
Lorsque Tom Marix et Godfrey
avaient découvert un puits, c’était vers ce point qu’on se dirigeait. On
reprenait l’étape, on pressait le pas des bêtes, on se hâtait sous cet
aiguillon de la soif, et que trouvait-on le plus souvent ?… Un liquide
bourbeux, au fond d’une cavité où fourmillaient les rats. Si les noirs et les
blancs de l’escorte n’hésitaient pas à s’en abreuver, Dolly, Jane, Godfrey, Zach
Fren, Len Burker, avaient la prudence d’attendre que Tom Marix eût fait
déblayer le puits, rejeter la couche souillée de sa surface, creuser les sables
pour en extraire une eau moins impure. Ils se désaltéraient alors. On remplissait
ensuite les tonnelets qui devaient suffire jusqu’au puits prochain.
Tel fut le voyage pendant une
huitaine de jours – du 10 au 17 mars – sans autre incident, mais avec un
accroissement de fatigues qui ne pouvait plus se prolonger. L’état des deux malades
ne s’améliorait point, au contraire, et il y avait lieu de craindre une issue
fatale. Privé de cinq chameaux, Tom Marix était embarrassé pour faire face aux
nécessités du transport.
Le chef de l’escorte
commençait à être extrêmement inquiet. Mrs. Branican ne l’était pas moins, bien
qu’elle n’en laissât rien paraître. La première en marche, la dernière à la
halte, elle donnait l’exemple du plus extraordinaire courage, uni à une
confiance que rien n’aurait pu ébranler.
Et à quels sacrifices
n’eût-elle pas consenti pour éviter ces retards incessants, pour abréger cet interminable
voyage !
Un jour, elle demanda à Tom
Marix pourquoi il ne ralliait pas directement le haut cours de la rivière
Fitz-Roy, où les renseignements des indigènes plaçaient le dernier campement
des Indas.
« J’y ai songé, répondit
Tom Marix, mais c’est toujours la question de l’eau qui me retient et me
préoccupe, mistress Branican. En allant vers Joanna-Spring, nous ne pouvons
manquer de rencontrer un certain nombre de ces puits que le colonel Warburton a
signalés.
– Est-ce qu’il ne s’en trouve
pas sur les territoires du nord ? demanda Dolly.
– Peut-être, mais je n’en ai
pas la certitude, dit Tom Marix. Et d’ailleurs, il faut admettre la possibilité
que ces puits soient desséchés maintenant, tandis qu’en continuant notre marche
vers l’ouest, nous sommes assurés d’atteindre la rivière d’Okaover, où le
colonel Warburton a fait halte. Or, cette rivière, c’est de l’eau courante, et
nous aurons toute facilité d’y refaire notre provision avant de gagner la vallée
de la Fitz-Roy.
– Soit, Tom Marix, répondit
Mrs. Branican ; puisqu’il le faut, dirigeons-nous sur Joanna-Spring. »
C’est ce qui fut fait, et les
fatigues de cette partie du voyage dépassèrent toutes celles que la caravane
avait supportées jusqu’alors. Quoiqu’on fût déjà au troisième mois de la saison
d’été, la température conservait une moyenne intolérable de quarante degrés
centigrades à l’ombre, et, par ce mot, il faut entendre l’ombre de la nuit. En
effet, on aurait vainement cherché un nuage dans les hautes zones du ciel, un
arbre à la surface de cette plaine. Le cheminement s’opérait au milieu d’une atmosphère
suffocante. Les puits ne contenaient pas l’eau nécessaire aux besoins du personnel.
On faisait à peine une dizaine de milles par étape. Les piétons se traînaient.
Les soins que Dolly, assistée de Jane et de la femme Harriett, bien affaiblies
elles-mêmes, donnaient aux deux malades, ne parvenaient pas à les soulager. Il
aurait fallu s’arrêter, camper dans quelque village, prendre un repos de longue
durée, attendre que la température fût devenue plus clémente… Et rien de tout
cela n’était possible.
Dans l’après-midi du 17 mars,
on perdit encore deux chameaux de bât, et précisément l’un de ceux qui
transportaient les objets d’échange, destinés aux Indas. Tom Marix dut faire passer
leur charge sur des chameaux de selle – ce qui nécessita de démonter deux
autres blancs de l’escorte. Ces braves gens ne se plaignirent pas et
acceptèrent sans mot dire ce surcroît de souffrance. Quelle différence avec les
noirs, qui réclamaient sans cesse, et causaient à Tom Marix les plus sérieux
ennuis ! N’était-il pas à craindre que, un jour ou l’autre, ces noirs ne
fussent tentés d’abandonner la caravane, probablement après quelque scène de
pillage ?…
Enfin, dans la soirée du 19
mars, près d’un puits dont l’eau était enfouie à six pieds sous les sables, la
caravane s’arrêta à cinq milles environ de Joanna-Spring. Il n’y avait pas eu
moyen d’allonger l’étape au-delà.
Le temps était d’une lourdeur
extraordinaire. L’air brûlait les poumons, comme s’il se fût échappé d’une
fournaise. Le ciel, très pur, d’un bleu cru, tel qu’il apparaît dans certaines
régions méditerranéennes au moment d’un déchaînement de mistral, offrait un
aspect étrange et menaçant.
Tom Marix regardait cet état
de l’atmosphère d’un air d’anxiété qui n’échappa point à Zach Fren.
« Vous flairez quelque
chose, lui dit le maître, et quelque chose qui ne vous va pas ?…
– Oui, Zach, répondit Tom
Marix. Je m’attends à un coup de simoun, dans le genre de ceux qui ravagent les
déserts de l’Afrique.
– Et bien… du vent… ce serait
de l’eau, sans doute ? fit observer Zach Fren.
– Non point, Zach, ce serait
une sécheresse plus effroyable encore, et ce vent-là, dans le centre de
l’Australie, on ne sait pas ce dont il est capable ! »
Cette observation, venant
d’un homme si expérimenté, était de nature à causer une profonde inquiétude à
Mrs. Branican et ses compagnons.
Les précautions furent donc
prises en vue d’un « coup de temps », pour employer une expression
familière aux marins. Il était neuf heures du soir. Les tentes n’avaient point
été dressées – ce qui était inutile par ces nuits brûlantes – au milieu des dunes
sablonneuses de la plaine. Après avoir apaisé sa soif à l’eau des tonnelets, chacun
prit sa part de vivres que Tom Marix venait de faire distribuer. C’est à peine
si l’on songeait à satisfaire sa faim. Ce qu’il aurait fallu, c’était de l’air
frais ; l’estomac souffrait moins que les organes de la respiration.
Quelques heures de sommeil auraient fait plus de bien à ces pauvres gens que
quelques bouchées de nourriture. Mais était-il loisible de dormir au milieu
d’une atmosphère si étouffante qu’on eût pu la croire raréfiée !
Jusqu’à minuit, il ne se
produisit rien d’anormal. Tom Marix, Zach Fren et Godfrey veillaient tour à
tour. Tantôt l’un, tantôt l’autre se relevait, afin d’observer l’horizon vers
le nord. Cet horizon était d’une clarté et même d’une pureté sinistre. La lune,
couchée en même temps que le soleil, avait disparu derrière les dunes de
l’ouest. Des centaines d’étoiles brillaient autour de la Croix du Sud qui
étincelle au pôle antarctique du globe.
Un peu avant trois heures, cette
illumination du firmament s’effaça. Une soudaine obscurité enveloppa la plaine
d’un horizon à l’autre.
« Alerte !… Alerte !…
cria Tom Marix.
– Qu’y a-t-il ? »
demanda Mrs. Branican, qui s’était brusquement relevée.
Auprès d’elle, Jane et la
femme Harriett, Godfrey et Zach Fren, cherchaient à se reconnaître à travers
cette obscurité. Les bêtes, étendues sur le sol, redressaient leurs têtes, s’effaraient
en poussant des cris rauques d’épouvante.
« Mais qu’y a-t-il ?…
redemanda Mrs. Branican.
– Le simoun ! »
répondit Tom Marix.
Et ce furent les dernières
paroles qui purent être entendues. L’espace s’était empli d’un tel tumulte, que
l’oreille ne parvenait pas plus à y percevoir un son que les yeux à saisir une
lueur au milieu de ces ténèbres.
C’était bien le simoun, ainsi
que l’avait dit Tom Marix, un de ces ouragans subits, qui bouleversent les
déserts australiens sur de vastes étendues. Un nuage énorme s’était levé du sud,
et s’abattait sur la plaine – nuage formé non seulement de sable, mais des
cendres arrachées à ces terrains calcinés par la chaleur.
Autour du campement, les
dunes, se mouvant comme fait la houle de mer, déferlaient, non en embruns
liquides, mais en poussière impalpable. Cela aveuglait, assourdissait, étouffait.
On eût dit que la plaine allait se niveler sous cette rafale, déchaînée au ras
du sol. Si les tentes eussent été dressées, il n’en serait pas resté un
lambeau.
Tous sentaient l’irrésistible
torrent d’air et de sable passer sur eux comme le cinglement d’une mitraille.
Godfrey tenait Dolly à deux mains, ne voulant pas être séparé d’elle, si ce formidable
assaut balayait la caravane vers le nord.
C’est bien ce qui arriva, en
effet, et aucune résistance n’eût été possible.
Pendant cette tourmente d’une
heure – une heure qui suffit à changer l’aspect de la contrée, en déplaçant les
dunes, en modifiant le niveau général du sol – Mrs. Branican et ses compagnons,
y compris les deux malades de l’escorte, furent traînés sur un espace de quatre
à cinq milles, se relevant pour retomber, roulés parfois comme des brins de
paille au milieu d’un tourbillon. Ils ne pouvaient ni se voir ni s’entendre, et
risquaient de ne plus se retrouver. Et c’est ainsi qu’ils atteignirent les environs
de Joanna-Spring, près des rives de l’Okaover-creek, au moment où, dégagé des
dernières brumailles, le jour se refaisait sous les rayons du soleil levant.
Tous étaient-ils présents à
l’appel ?… Tous ?… Non.
Mrs. Branican, la femme
Harriett, Godfrey, Jos Meritt, Gîn-Ghi, Zach Fren, Tom Marix, les blancs restés
à leur poste, étaient là, et avec eux quatre chameaux de selle. Mais les noirs
avaient disparu !… Disparus aussi les vingt autres chameaux – ceux qui
portaient les vivres et ceux qui portaient la rançon du capitaine John !…
Et, lorsque Dolly appela Jane,
Jane ne répondit pas.
Len et Jane Burker n’étaient
plus là.
Cette disparition des noirs, des
bêtes de selle et des bêtes de bât, constituait pour Mrs. Branican ainsi que
pour ceux qui lui étaient restés fidèles une situation presque désespérée.
Trahison fut le mot que
prononça tout d’abord Zach Fren – le mot que répéta Godfrey. La trahison
n’était que trop évidente, étant données les circonstances dans lesquelles la
disparition d’une partie du personnel s’était produite. Tel fut aussi l’avis de
Tom Marix, qui n’ignorait rien de l’influence funeste, exercée par Len Burker
sur les indigènes de l’escorte…
Dolly voulait douter encore.
Elle ne pouvait croire à tant de duplicité, à tant d’infamie !
« Len Burker ne peut-il
avoir été entraîné comme nous l’étions nous-mêmes ?…
– Comme ça, juste avec les
noirs, fit observer Zach Fren, en même temps que les chameaux qui portent nos
vivres !…
– Et ma pauvre Jane !
murmura Dolly. Séparée de moi, sans que je m’en sois aperçue !
– Len Burker n’a pas même
voulu qu’elle restât près de vous, mistress, dit Zach Fren. Le misérable !…
– Misérable ?… Bien !…
Oh !… Très bien ! ajouta Jos Meritt. Si tout cela n’est pas de la
coquinerie, je consens à ne jamais retrouver le chapeau… historique… dont… »
Puis, se tournant vers le
Chinois :
« Et que pensez-vous de
l’affaire, Gîn-Ghi ?
– Ai ya, mon maître
Jos ! Je pense que j’aurais mille et dix mille fois mieux fait de ne
jamais mettre le pied dans un pays si peu confortable !
– Peut-être ! »
répliqua Jos Meritt.
La trahison était tellement
caractérisée, en somme, que Mrs. Branican dut se rendre.
« Mais pourquoi m’avoir
trompée ? se demandait-elle. Qu’ai-je fait à Len Burker ?… N’avais-je
pas oublié le passé ?… Ne les ai-je point accueillis comme mes parents, sa
malheureuse femme et lui ?… Et il nous abandonne, il nous laisse sans ressources,
et il me vole le prix de la liberté de John !… Mais pourquoi ? »
Personne ne connaissait le
secret de Len Burker, et personne n’aurait pu répondre à Mrs. Branican. Seule, Jane
eût été à même de révéler ce qu’elle savait des abominables projets de son mari,
et Jane n’était plus là. Il n’était que trop vrai, cependant, Len Burker venait
de mettre à exécution un plan préparé de longue main, un plan qui semblait
avoir toutes les chances de réussite. Sous la promesse d’être bien payés, les
noirs de l’escorte s’étaient facilement prêtés à ses vues. Au plus fort de la
tourmente, tandis que deux des indigènes entraînaient Jane, sans qu’il eût été
possible d’entendre ses cris, les autres avaient poussé vers le nord les
chameaux dispersés autour du campement.
Personne ne les avait aperçus
au milieu d’une obscurité profonde, épaissie par les tourbillons de poussière, et,
avant le jour, Len Burker et ses complices étaient déjà à quelques milles dans
l’est de Joanna-Spring.
Jane étant séparée de Dolly, son
mari n’avait plus à craindre que, pressée par ses remords, elle en vint à
trahir le secret de la naissance de Godfrey. D’ailleurs, dépourvus de vivres et
de moyens de transport, il avait tout lieu de croire que Mrs. Branican et ses
compagnons périraient au milieu des solitudes de Great-Sandy-Desert.
En effet, à Joanna-Spring, la
caravane ne se trouvait guère à moins de trois cents milles de la Fitz-Roy. Au
cours de ce long trajet, comment Tom Marix pourvoirait-il aux besoins du personnel,
si réduit qu’il fût à présent ?
L’Okaover-creek est un des
principaux affluents du fleuve Grey, lequel va se jeter par un des estuaires de
la Terre de Witt dans l’océan Indien.
Sur les bords de cette
rivière, que les chaleurs excessives ne tarissent jamais, Tom Marix retrouva
les mêmes ombrages, les mêmes sites, dont le colonel Warburton fait l’éloge
avec une explosion de joie si intense.
De la verdure, des eaux
courantes, après les interminables plaines sablonneuses de dunes et de spinifex,
quel heureux changement ! Mais, si le colonel Warburton, arrivé à ce point,
était presque assuré d’atteindre son but, puisqu’il n’avait plus qu’à
redescendre le creek jusqu’aux établissements de Rockbonne sur le littoral, il
n’en était pas ainsi de Mrs. Branican. La situation, au contraire, allait
s’empirer en traversant les arides régions qui séparent l’Okaover de la rivière
Fitz-Roy.
La caravane ne se composait
plus que de vingt-deux personnes sur quarante-trois qu’elle comptait au départ
de la station d’Alice-Spring : Dolly et la femme indigène Harriett, Zach
Fren, Tom Marix, Godfrey, Jos Meritt, Gîn-Ghi, et avec eux les quinze blancs de
l’escorte, dont deux étaient gravement malades. Pour montures, quatre chameaux
seulement, les autres ayant été emmenés par Len Burker, y compris le mâle qui
leur servait de guide et celui qui portait la kibitka. La bête, dont Jos Meritt
appréciait fort les qualités, avait également disparu – ce qui obligerait
l’Anglais à voyager à pied comme son domestique. En fait de vivres, il ne
restait qu’un très petit nombre de boîtes de conserves, retrouvées dans une
caisse qu’une des chamelles avait laissé choir. Plus de farine, ni de café, ni
de thé, ni de sucre, ni de sel ; plus de boissons alcooliques ; plus
rien de la pharmacie de voyage ! Et comment Dolly pourrait-elle soigner
les deux hommes dévorés par la fièvre ? C’était le dénuement absolu, au
milieu d’une contrée qui n’offrait aucune ressource.
Aux premières lueurs de
l’aube, Mrs. Branican rassembla son personnel. Cette vaillante femme n’avait
rien perdu de son énergie, vraiment surhumaine, et, par ses paroles encourageantes,
elle parvint à ranimer ses compagnons. Ce qu’elle leur fit voir, c’était le but
si près d’être atteint.
Le voyage fut repris et dans
des conditions tellement pénibles que le plus confiant des hommes n’aurait pu
espérer de le mener à bonne fin. Des quatre chameaux qui restaient, deux
avaient dû être réservés aux malades qu’on ne pouvait abandonner à
Joanna-Spring, une de ces stations inhabitées comme le colonel Warburton en
signale plusieurs sur son itinéraire. Mais ces pauvres gens auraient-ils la
force de supporter le transport jusqu’à la Fitz-Roy, d’où il serait peut-être
possible de les expédier à quelque établissement de la côte ?… C’était douteux,
et le cœur de Mrs. Branican se brisait à l’idée que deux nouvelles victimes
s’ajouteraient à celles que comptait déjà la catastrophe du Franklin…
Et pourtant Dolly ne
renoncerait pas à ses projets ! Non ! elle ne suspendrait pas ses
recherches ! Rien ne l’arrêterait dans l’accomplissement de son devoir –
dût-elle rester seule !
En quittant la rive droite de
l’Okaover-creek, dont le lit avait été passé à gué un mille en amont de
Joanna-Spring, la caravane se dirigea au nord-nord-est. À prendre cette
direction, Tom Marix espérait rejoindre la Fitz-Roy, au point le plus rapproché
de la courbe irrégulière qu’elle trace, avant de s’infléchir vers le Golfe du
Roi.
La chaleur était plus
supportable. Il avait fallu les plus vives instances – presque des injonctions
– de la part de Tom Marix et de Zach Fren, pour que Dolly acceptât un des
chameaux comme bête de selle. Godfrey et Zach Fren ne cessaient de marcher d’un
bon pas. Pareillement Jos Meritt, dont les longues jambes avaient la rigidité
d’une paire d’échasses. Et, lorsque Mrs. Branican lui offrait de prendre sa monture,
il déclinait l’offre, disant :
« Bien !… Oh !…
Très bien ! Un Anglais est un Anglais, mistress, mais un Chinois n’est
qu’un Chinois, et je ne vois aucun inconvénient à ce que vous fassiez cette
proposition à Gîn-Ghi… Seulement, je lui défends d’accepter. »
Aussi Gîn-Ghi allait-il à
pied, non sans récriminer en songeant aux lointaines délices de Sou-Tchéou, la
cité des bateaux-fleurs, la ville adorée des Célestes.
Le quatrième chameau servait
soit à Tom Marix, soit à Godfrey, quand il s’agissait de se porter en avant. La
provision d’eau, puisée à l’Okaover-creek, ne tarderait pas à être consommée, et
c’est alors que la question des puits redeviendrait des plus graves.
En quittant les rives du
creek, on chemina vers le nord sur une plaine légèrement ondulée, à peine
sillonnée de dunes sablonneuses, qui s’étendait jusqu’aux extrêmes limites de
l’horizon. Les touffes de spinifex y formaient des bouquets plus serrés, et
divers arbrisseaux, jaunis par l’automne, donnaient à la région un aspect moins
monotone. Peut-être une chance favorable permettrait-elle d’y rencontrer un peu
de gibier. Tom Marix, Godfrey, Zach Fren, qui ne se séparaient jamais de leurs
armes, avaient heureusement conservé fusils et revolvers, et ils sauraient en
faire bon emploi, le cas échéant. Il est vrai, les munitions, fort restreintes,
ne devaient être employées qu’avec ménagement.
On alla ainsi plusieurs jours,
une étape le matin, une étape le soir. Le lit des creeks qui sillonnaient ce
territoire, n’était semé que de cailloux calcinés entre les herbes décolorées
par la sécheresse. Le sable ne décelait pas la moindre trace d’humidité. Il
était donc nécessaire de découvrir des puits, d’en découvrir un par
vingt-quatre heures, puisque Tom Marix n’avait plus de tonnelets à sa
disposition.
Aussi Godfrey se lançait-il à
droite ou à gauche de l’itinéraire, dès qu’il se croyait sur une piste.
« Mon enfant, lui
recommandait Mrs. Branican, ne fais pas d’imprudence !… Ne t’expose pas…
– Ne pas m’exposer, quand il
s’agit de vous, mistress Dolly, de vous et du capitaine John ! » répondait
Godfrey.
Grâce à son dévouement, grâce
aussi à une sorte d’instinct qui le guidait, divers puits furent découverts, en
s’écartant parfois de plusieurs milles dans le nord ou dans le sud.
Donc, si les souffrances de
la soif ne furent pas absolument épargnées, du moins ne furent-elles pas
excessives sur cette portion de la Terre de Tasman, comprise entre
l’Okaover-creek et la Fitz-Roy river. Maintenant, ce qui mettait le comble aux
fatigues, c’était l’insuffisance des moyens de transport, le rationnement de la
nourriture, réduite à de faibles restes de conserves, le manque de thé et de
café, la privation de tabac, si pénible aux gens de l’escorte, l’impossibilité
d’additionner une eau à demi saumâtre de la moindre goutte d’alcool. Après deux
heures de marche, les plus énergiques tombaient de lassitude, d’épuisement, de
misère.
Et puis, les bêtes trouvaient
à peine de quoi manger au milieu de cette brousse, qui ne leur donnait ni une
tige ni une feuille comestible. Plus de ces acacias nains, dont la résine, assez
nutritive, est recherchée des indigènes aux époques de disette. Rien que les
épines des maigres mimosas, mélangées aux touffes de spinifex. Les chameaux, la
tête allongée, les reins ployants, traînaient les pieds, tombaient sur les
genoux, et ce n’était pas sans grands efforts que l’on parvenait à les remettre
debout.
Le 25, dans l’après-midi, Tom
Marix, Godfrey et Zach Fren parvinrent à se procurer un peu de nourriture
fraîche. Il y avait eu un passage de pigeons, d’allure sauvage, qui voletaient
en troupes. Très fuyards, très rapides à s’échapper des touffes de mimosas, ils
ne se laissaient pas approcher aisément. Toutefois, on finit par en abattre un
certain nombre. Ils n’eussent pas été excellents – et ils l’étaient en réalité
– que de malheureux affamés les auraient appréciés comme un gibier des plus
savoureux. On se contentait de les faire griller devant un feu de racines sèches,
et, pendant deux jours, Tom Marix put économiser les conserves.
Mais ce qui suffisait à
nourrir les hommes ne suffisait pas à nourrir les animaux. Aussi, dans la matinée
du 26, l’un des chameaux qui servait au transport des malades tomba-t-il lourdement
sur le sol. Il fallut l’abandonner sur place, car il n’aurait pu se remettre en
marche.
À Tom Marix revint la tâche
de l’achever d’une balle dans la tête. Puis, ne voulant rien perdre de cette
chair, qui représentait plusieurs jours de nourriture, bien que la bête fût
extrêmement amaigrie par les privations, il s’occupa de la dépecer, suivant la
méthode australienne.
Tom Marix n’ignorait pas que
le chameau peut être utilisé dans son entier et servir à l’alimentation. Avec
les os et une partie de la peau qu’il fit bouillir dans l’unique récipient qui
lui restait, il obtint un bouillon, qui fut bien reçu de ces estomacs affamés.
Quant à la cervelle, à la langue, aux joues de l’animal, ces morceaux, convenablement
préparés, fournirent une nourriture plus solide. De même, la chair, coupée en
lanières minces, et rapidement séchée au soleil, fut conservée, ainsi que les
pieds, qui forment la meilleure partie de la bête. Ce qui était très regrettable,
c’est que le sel faisait défaut, car cette chair salée se fût conservée plus
facilement.
Le voyage se continuait dans
ces conditions, à raison de quelques milles par jour. Par malheur, l’état des
malades ne s’améliorait pas, faute de remèdes, sinon faute de soins. Tous
n’arriveraient pas à ce but auquel tendaient les efforts de Mrs. Branican, à
cette rivière Fitz-Roy, où les misères seraient peut-être atténuées dans une
certaine mesure !
Et en effet, le 28 mars, puis
le lendemain 29, les deux blancs succombèrent aux suites d’un épuisement trop
prolongé. C’étaient des hommes originaires d’Adélaïde, l’un ayant à peine vingt-cinq
ans, l’autre plus âgé d’une quinzaine d’années, et la mort vint les frapper
l’un et l’autre sur cette route du désert australien.
Pauvres gens ! c’étaient
les premiers qui périssaient à la tâche, et leurs compagnons en furent très
péniblement affectés. N’était-ce pas le sort qui les attendait tous, depuis la
trahison de Len Burker, maintenant abandonnés au milieu de ces régions où les
animaux eux-mêmes ne trouvent pas à vivre ?
Et qu’aurait pu répondre Zach
Fren, lorsque Tom Marix lui dit :
« Deux hommes morts pour
en sauver un, sans compter ceux qui succomberont encore !… »
Mrs. Branican donna libre
cours à sa douleur, à laquelle chacun prit part. Elle pria pour ces deux victimes,
et leur tombe fut marquée d’une petite croix que les ardeurs du climat allaient
bientôt faire tomber en poussière.
La caravane se remit en
route.
Des trois chameaux qui
restaient, les hommes les plus fatigués durent se servir à tour de rôle, afin
de ne pas retarder leurs compagnons, et Mrs. Branican refusa d’affecter une de
ces bêtes à son service. Pendant les haltes, ces animaux étaient employés à la
recherche des puits, tantôt par Godfrey, tantôt par Tom Marix, car on ne
rencontrait pas un seul indigène près duquel il eût été possible de se
renseigner. Cela semblait indiquer que les tribus s’étaient reportées vers le
nord-est de la Terre de Tasman. Dans ce cas, il faudrait suivre la trace des
Indas jusqu’au fond de la vallée de la FitzRoy – circonstance très fâcheuse, puisque
ce serait accroître le voyage de plusieurs centaines de milles.
Dès le commencement d’avril, Tom
Marix reconnut que la provision de conserves touchait à sa fin. Il y avait donc
nécessité de sacrifier un des trois chameaux. Quelques jours de nourriture
assurés, cela permettrait sans doute d’atteindre la Fitz-Roy river, dont la
caravane ne devait plus être éloignée que d’une quinzaine d’étapes.
Ce sacrifice étant
indispensable, il fallut s’y résigner. On choisit la bête qui paraissait le
moins en état de faire son service. Elle fut abattue, dépecée, réduite en
lanières qui, séchées au soleil, possédaient des qualités assez nutritives, après
qu’elles avaient subi une longue cuisson. Quant aux autres portions de l’animal,
sans oublier le cœur et le foie, elles furent soigneusement mises en réserve.
Entre temps, Godfrey parvint
à tuer plusieurs couples de pigeons – faible contingent, il est vrai, lorsqu’il
s’agissait de pourvoir à l’alimentation de vingt personnes. Tom Marix reconnut
aussi que les touffes d’acacias commençaient à reparaître sur la plaine, et il
fut possible d’employer comme nourriture leurs graines préalablement grillées
sur le feu.
Oui ! il était temps
d’atteindre la vallée de la Fitz-Roy, d’y trouver les ressources qu’on eût vainement
demandées à cette contrée maudite. Un retard de quelques jours, et la plupart
de ces pauvres gens n’auraient pas la force d’y arriver.
À la date du 5 avril, il ne
restait plus rien des conserves, rien de la viande fournie par le dépeçage des
chameaux. Une poignée de graines d’acacias, voilà à quoi Mrs. Branican et ses
compagnons étaient réduits.
En effet, Tom Marix hésitait
à sacrifier les deux dernières bêtes qui avaient survécu. En songeant au chemin
qu’il fallait encore parcourir, il ne pouvait s’y résoudre. Il dut en venir là,
pourtant, et dès le soir même, car personne n’avait mangé depuis quinze heures.
Mais au moment de la halte, un
des hommes accourut en criant :
« Tom Marix… Tom Marix…
les deux chameaux viennent de tomber.
– Essayez de les relever…
– C’est impossible.
– Alors qu’on les tue sans
attendre…
– Les tuer ?… répondit
l’homme. Mais ils vont mourir, s’ils ne sont morts déjà !
– Morts ! » s’écria
Tom Marix.
Et il ne put retenir un geste
de désespoir, car, une fois morts, la chair de ces animaux ne serait plus
mangeable. Suivi de Mrs. Branican, de Zach Fren, de Godfrey et de Jos Meritt, Tom
Marix se rendit à l’endroit où les deux bêtes venaient de s’abattre. Là, couchées
sur le sol, elles s’agitaient convulsivement, l’écume à la bouche, les membres
contractés, la poitrine haletante. Elles allaient mourir, et non de mort
naturelle.
« Que leur est-il donc
arrivé ? demanda Dolly. Ce n’est pas la fatigue… ce n’est pas l’épuisement…
– Non, répondit Tom Marix, je
crains que ce ne soit l’effet de quelque herbe malfaisante !
– Bien !… Oh !…
Très bien ! Je sais ce que c’est ! répondit Jos Meritt. J’ai déjà vu
cela dans les provinces de l’est… dans le Queensland ! Ces chameaux ont
été empoisonnés…
– Empoisonnés ?… répéta
Dolly.
– Oui, dit Tom Marix, c’est
le poison !
– Eh bien, reprit Jos Meritt,
puisque nous n’avons plus d’autres ressources, il n’y a plus qu’à prendre
exemple sur les cannibales… à moins de mourir de faim !… Que voulez-vous ?…
Chaque pays a ses usages, et le mieux est de s’y conformer ! »
Le gentleman disait ces
choses avec un tel accent d’ironie que, les yeux agrandis par le jeûne, plus
maigre qu’il ne l’avait jamais été, il faisait peur à voir.
Ainsi donc les deux chameaux
venaient de mourir empoisonnés. Et cet empoisonnement – Jos Meritt ne se
trompait pas – était dû à une espèce d’ortie vénéneuse, assez rare pourtant
dans ces plaines du nord-ouest : c’est la « moroïdes laportea »
qui produit une sorte de framboise et dont les feuilles sont garnies de
piquants acérés. Rien que leur contact provoque des douleurs très vives et très
durables. Quant au fruit, il est mortel, si on ne le combat avec le jus du « colocasia
macrorhiza », autre plante qui pousse le plus souvent sur les mêmes
terrains que l’ortie vénéneuse.
L’instinct, qui empêche les
animaux de toucher aux substances nuisibles, avait été vaincu cette fois, et
les pauvres bêtes, n’ayant pu résister au besoin de dévorer ces orties, venaient
de succomber dans d’horribles souffrances.
Comment se passèrent les deux
jours suivants, ni Mrs. Branican ni aucun de ses compagnons n’en ont gardé le
souvenir. Il avait fallu abandonner les deux animaux morts, car, une heure
après, ils étaient en état de complète décomposition, tant est rapide l’effet
de ce poison végétal. Puis, la caravane, se traînant dans la direction de la
Fitz-Roy, cherchait à découvrir les mouvements de terrains qui encadrent la
vallée… Pourraient-ils l’atteindre tous ?… Non, et quelques-uns
demandaient déjà qu’on les tuât sur place, afin de leur épargner une plus
effroyable agonie…
Mrs. Branican allait de l’un
à l’autre… Elle essayait de les ranimer… Elle les suppliait de faire un dernier
effort… Le but n’était plus éloigné… Quelques marches, les dernières… était le
salut… Mais qu’aurait-elle pu obtenir là-bas de ces infortunés !
Le 8 avril au soir, personne
n’eut la force d’établir le campement. Les malheureux rampaient au pied des
spinifex pour en mâcher les feuilles poussiéreuses. Ils ne pouvaient plus
parler… ils ne pouvaient plus aller au delà… Tous tombèrent à cette dernière
halte.
Mrs. Branican résistait
encore. Agenouillé près d’elle, Godfrey l’enveloppait d’un suprême regard… Il
l’appelait « mère !… mère !… » comme un enfant qui supplie
celle dont il est né de ne pas le laisser mourir…
Et Dolly, debout au milieu de
ses compagnons, parcourait l’horizon du regard, en criant :
« John !… John !… »
Comme si c’était du capitaine
John qu’un dernier secours eût pu lui venir !
La tribu des Indas, composée
de plusieurs centaines d’indigènes, hommes, femmes, enfants, occupait à cette
époque les bords de la Fitz-Roy, à cent quarante milles environ de son
embouchure. Ces indigènes revenaient des régions de la Terre de Tasman, arrosées
par le haut cours de la rivière. Depuis quelques jours, les hasards de leur vie
nomade les avaient précisément ramenés à vingt-cinq milles de cette partie du
Great-Sandy-Desert, où la caravane venait d’achever sa dernière halte, après un
enchaînement de misères qui dépassaient la limite des forces humaines.
C’était chez ces Indas que le
capitaine John et son second Harry Felton avaient vécu pendant neuf années. À
la faveur des événements qui vont suivre, il a été possible de reconstituer
leur histoire durant cette longue période, en complétant le récit fait par
Harry Felton à son lit de mort.
Entre ces deux années 1875 et
1881 – on ne l’a point oublié – l’équipage du Franklin avait eu pour
refuge une île de l’océan Indien, l’île Browse, située à deux cent cinquante
milles environ de York-Sund, le point le plus rapproché de ce littoral qui
s’arrondit au nord-ouest du continent australien. Deux des matelots ayant péri
pendant la tempête, les naufragés, au nombre de douze, avaient vécu six ans
dans cette île, sans aucun moyen de pouvoir se rapatrier, lorsqu’une chaloupe
en dérive vint atterrir sur la côte.
Le capitaine John, voulant
employer cette chaloupe au salut commun, la fit mettre en état d’atteindre la
terre australienne, et l’approvisionna pour une traversée de quelques semaines.
Mais cette chaloupe ne pouvant contenir que sept passagers, le capitaine John
et Harry Felton s’y embarquèrent avec cinq de leurs compagnons, laissant les
cinq autres sur l’île Browse, où ils devaient attendre qu’un navire leur fût
expédié. On sait comment ces infortunés succombèrent avant d’avoir été
recueillis, et dans quelles conditions le capitaine Ellis retrouva leurs restes,
lors de la deuxième campagne du Dolly-Hope en 1883.
Après une traversée
périlleuse au milieu de ces détestables parages de l’océan Indien, la chaloupe
accosta le continent à la hauteur du cap Lévêque, et parvint à pénétrer dans le
golfe même où se jette la rivière Fitz-Roy. Mais la mauvaise fortune voulut que
le capitaine John fut attaqué par les indigènes – attaque pendant laquelle
quatre de ses hommes furent tués en se défendant.
Ces indigènes, appartenant à
la tribu des Indas, entraînèrent vers l’intérieur le capitaine John, le second
Harry Felton et le dernier matelot échappé au massacre. Ce matelot, qui avait
été blessé, ne devait pas guérir de ses blessures. Quelques semaines plus tard,
John Branican et Harry Felton étaient les seuls survivants de la catastrophe du
Franklin.
Alors commença pour eux une
existence qui, dans les premiers jours, fut sérieusement menacée. On l’a dit, ces
Indas, ainsi que toutes les tribus errantes ou sédentaires de l’Australie
septentrionale, sont farouches et sanguinaires. Les prisonniers qu’ils font
dans leurs guerres incessantes de tribus à tribus, ils les tuent impitoyablement
et les dévorent. Il n’existe pas de coutume plus profondément invétérée que le
cannibalisme chez ces aborigènes, de véritables bêtes fauves.
Pourquoi le capitaine John et
Harry Felton furent-ils épargnés ? Cela tint aux circonstances.
On n’ignore pas que, parmi
les indigènes de l’intérieur et du littoral, l’état de guerre se perpétue de
générations en générations. Les sédentaires s’attaquent de village à village, se
détruisent et se repaissent des prisonniers qu’ils ont faits. Mêmes coutumes
chez les nomades : ils se poursuivent de campement en campement, et la
victoire finit toujours par d’épouvantables scènes d’anthropophagie. Ces
massacres amèneront inévitablement la destruction de la race australienne, et
aussi sûrement que les procédés anglo-saxons, bien qu’en certaines circonstances,
ces procédés aient été d’une barbarie inavouable. Comment qualifier autrement
de pareils actes – les noirs, chassés par les blancs comme un gibier, avec
toutes les émotions raffinées que peut procurer ce genre de sport ; les
incendies propagés largement, afin que les habitants ne soient pas plus
épargnés que les « gunyos » d’écorce, qui leur servent de demeures ?
Les conquérants ont même été jusqu’à se servir de l’empoisonnement en masse par
la strychnine, ce qui permettait d’obtenir une destruction plus rapide. Aussi
a-t-on pu citer cette phrase, échappée à la plume d’un colon australien :
« Tous les hommes que je
rencontre sur mes pâturages, je les tue à coups de fusil, parce que ce sont des
tueurs de bétail ; toutes les femmes, parce qu’elles mettent au monde des
tueurs de bétail, et tous les enfants, parce qu’ils deviendraient des tueurs de
bétail ! »
On comprend dès lors la haine
que les Australiens ont vouée à leurs bourreaux – haine conservée par voie
d’atavisme. Il est rare que les blancs qui tombent entre leurs mains ne soient
pas massacrés sans merci. Pourquoi donc les naufragés du Franklin avaient-ils
été épargnés par les Indas ?
Très probablement, s’il ne
fût mort peu de temps après avoir été fait prisonnier, le matelot aurait subi
le sort commun. Mais le chef de la tribu, un indigène nommé Willi, ayant eu des
relations avec les colons du littoral, les connaissait assez pour avoir
remarqué que le capitaine John et Harry Felton étaient deux officiers, dont il
aurait peut-être à tirer un double parti. En sa qualité de guerrier, Willi pourrait
mettre leurs talents à profit dans ses luttes avec les tribus rivales ; en
sa qualité de négociant, qui s’entendait aux choses du négoce, il entrevoyait
une lucrative affaire, c’est-à-dire une belle et bonne rançon, que lui vaudrait
la délivrance des deux prisonniers. Ceux-ci eurent donc la vie sauve, mais
durent se plier à cette existence des nomades qui leur fut d’autant plus
pénible que les Indas les soumettaient à une surveillance incessante. Gardés à
vue jour et nuit, ne pouvant s’éloigner des campements, ils avaient vainement
tenté deux ou trois fois de s’évader, ce qui avait failli même leur coûter la
vie.
Entre temps, lors de ces
fréquentes rencontres de tribus à tribus, ils étaient mis en demeure
d’intervenir au moins par leurs conseils – conseils réellement précieux, et
dont Willi tira grand avantage, puisque la victoire lui fut désormais assurée…
Grâce à ses succès, cette tribu était actuellement l’une des plus puissantes de
celles qui fréquentent les divers territoires de l’Australie occidentale.
Ces populations du nord-ouest
appartiennent vraisemblablement aux races mélangées des Australiens et des
indigènes de la Papouasie. À l’exemple de leurs congénères, les Indas portent
les cheveux longs et bouclés ; leur teint est moins foncé que celui des
indigènes des provinces méridionales, qui semblent former une race plus
vigoureuse ; leur taille, de proportion plus modeste, se tient dans la
moyenne d’un mètre trente. Les hommes sont physiquement mieux constitués que
les femmes ; si leur front est un peu fuyant, il domine des arcades
sourcilières assez proéminentes – ce qui est signe d’intelligence, à en croire
les ethnologistes ; leurs yeux, dont l’iris est foncé, ont la pupille
enflammée d’un feu ardent ; leurs cheveux, de couleur très brune, ne sont
pas crépus comme ceux des nègres africains ; toutefois leur crâne est peu
volumineux, et la nature n’y a pas généreusement prodigué la matière cérébrale.
On les appelle des « noirs », bien qu’ils ne soient point d’un noir
de Nubiens : ils sont « chocolatés », s’il est permis de fabriquer
ce mot, qui donne exactement la nuance de leur coloration générale.
Le nègre australien est doué
d’un odorat extraordinaire, qui rivalise avec celui des meilleurs chiens de
chasse. Il reconnaît les traces d’un être humain ou d’un animal rien qu’en humant
le sol, en flairant les herbes et les broussailles. Son nerf auditif est
également d’une extrême sensibilité, et il peut percevoir, paraît-il, le bruit
des fourmis qui travaillent au fond d’une fourmilière. Quant à ranger ces indigènes
dans l’ordre des grimpeurs, cette classification ne manquerait pas de justesse,
car il n’est pas de gommier si haut et si lisse, dont ils ne puissent atteindre
la cime en se servant d’un roseau de rotang flexible auquel ils donnent le nom
de « kâmin » et grâce à la conformation légèrement préhensile de
leurs orteils.
Ainsi que cela a été noté
déjà à propos des indigènes de la Finke-river, la femme australienne vieillit
vite et n’atteint guère la quarantaine, que les hommes dépassent communément
d’une dizaine d’années en certaine partie du Queensland. Ces malheureuses
créatures ont pour fonction d’accomplir les plus rudes travaux du ménage ;
ce sont des esclaves, courbées sous le joug de maîtres d’une impitoyable dureté,
contraintes de porter les fardeaux, les ustensiles, les armes, de chercher les
racines comestibles, les lézards, les vers, les serpents, qui servent à la subsistance
de la tribu. Mais, s’il en est reparlé ici, c’est pour dire qu’elles soignent
avec affection leurs enfants, dont les pères se soucient médiocrement, car un
enfant est une charge pour sa mère, qui ne peut plus s’adonner exclusivement
aux soins de cette existence nomade, dont la responsabilité repose sur elle.
Aussi, chez certaines peuplades, a-t-on vu les nègres obliger leurs femmes à se
couper les seins, afin de se mettre dans l’impossibilité de nourrir. Et, cependant
– coutume horrible et qui semble en désaccord avec cette précaution prise pour
en diminuer le nombre – ces petits êtres, en temps de disette, sont mangés dans
diverses tribus indigènes, où le cannibalisme est encore porté aux derniers
excès.
C’est que, chez ces nègres
australiens – à peine dignes d’appartenir à l’humanité – la vie est concentrée
sur un acte unique. « Ammeri !… Ammeri ! » ce mot revient
incessamment dans la langue indigène, et il signifie : faim. Le geste le
plus fréquent de ces sauvages consiste à se frapper le ventre, car leur ventre
n’est que trop souvent vide.
Dans ces pays sans gibier et
sans culture, on mange à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, lorsque
l’occasion se présente, avec cette préoccupation constante d’un jeûne prochain
et prolongé. Et, en effet, de quoi peuvent se nourrir ces indigènes – les plus
misérables indubitablement de tous ceux que la nature a dispersés à la surface
des continents ? D’une sorte de grossière galette, nommée « damper »,
faite d’un peu de blé sans levain, cuite non pas au four, mais sous des cendres
brûlantes – du miel, qu’ils récoltent parfois, à la condition d’abattre l’arbre
au sommet duquel les abeilles ont établi leur ruche – de ce « kadjerah »,
espèce de bouillie blanche, obtenue par l’écrasement des fruits du palmier
vénéneux, dont le poison a été extrait à la suite d’une délicate manipulation –
de ces œufs de poules de jungle, enfouis dans le sol et que la chaleur fait
éclore artificiellement – de ces pigeons particuliers à l’Australie, qui
suspendent leurs nids à l’extrémité des branches d’arbres. Enfin, ils utilisent
encore certaines sortes de larves coléoptères, les unes recueillies entre la
ramure des acacias, les autres déterrées au milieu des pourritures ligneuses, qui
encombrent le dessous des fourrés… Et, c’est tout.
Voilà pourquoi, dans cette
lutte de chaque heure pour l’existence, le cannibalisme s’explique avec toutes
ses horribles monstruosités. Ce n’est pas même l’indice d’une férocité innée, ce
sont les conséquences d’un besoin impérieux que la nature pousse le noir
australien à satisfaire, car il meurt de faim. Aussi, dans ces conditions, que
se passe-t-il ?
Sur le cours inférieur du
Murray et chez les peuples de la région du nord, la coutume est de tuer les
enfants pour s’en repaître, et même on coupe aux mères une phalange du doigt à
chaque enfant qu’elle est contrainte de livrer à ces festins d’anthropophages.
Détail épouvantable : lorsqu’elle n’a plus rien à manger, la mère va
jusqu’à dévorer le petit être sorti de ses entrailles, et des voyageurs ont
entendu ces malheureuses parler de cette abomination comme de l’acte le plus
simple !
Toutefois, ce n’est pas
uniquement la faim qui pousse les Australiens au cannibalisme : ils ont un
goût très prononcé pour la chair humaine – cette chair qu’ils appellent « talgoro »,
« la viande qui parle », suivant une de leurs expressions d’un effrayant
réalisme. S’ils ne s’abandonnent pas à ce désir entre gens de la même tribu, ils
n’en font pas moins la chasse à l’homme. Grâce à ces guerres incessantes, ces expéditions
n’ont d’autre but que de se procurer le talgoro, aussi bien celui que l’on
mange fraîchement tué que celui qui est mis en réserve. Et, voici ce qu’affirme
le docteur Carl Lumholtz : pendant son audacieux voyage à travers les
provinces du nord-est, les noirs de son escorte ne cessaient de traiter cette
question de nourriture, disant : « Pour les Australiens, rien ne vaut
la chair humaine. » Et encore faut-il que ce ne soit pas la chair des
blancs, car ils lui trouvent un arrière-goût de sel fort désagréable.
Il y a d’ailleurs un autre
motif qui prédispose ces tribus à s’entre-détruire. Les Australiens sont
extraordinairement crédules. Ils s’effraient de la voix du « kvin’gan’ »,
du mauvais esprit, qui court les campagnes et fréquente les gorges des contrées
montagneuses, bien que cette voix ne soit que le chant mélancolique d’un
charmant oiseau, l’un des plus curieux de l’ornithologie australienne.
Cependant, s’ils admettent l’existence d’un être supérieur et méchant, d’après
les voyageurs les plus autorisés, jamais un indigène ne fait une prière et
nulle part on ne trouve des vestiges de pratiques religieuses.
En réalité, ils sont très
superstitieux, et, comme ils ont cette ferme croyance que leurs ennemis peuvent
les faire périr par sortilèges, ils se hâtent de les tuer – ce qui, joint aux
habitudes de cannibalisme, soumet ces contrées à un régime de destruction sans
limites.
On notera, en passant, que
les Australiens ont le respect des morts. Ils ne les mettent point en contact
avec la terre ; ils entourent les corps de bandelettes de feuillage ou
d’écorce, et les déposent dans des fosses peu profondes, les pieds tournés vers
le levant, à moins qu’ils ne les enterrent debout, ainsi que cela se pratique
chez certaines tribus. La tombe d’un chef est alors recouverte d’une hutte, dont
l’entrée est orientée vers l’est. Il faut aussi ajouter que, parmi les moins
sauvages, on relève cette croyance bizarre : c’est que les morts doivent
renaître sous la forme d’hommes blancs, et, suivant l’observation de Carl
Lumholtz, la langue du pays emploie le même mot pour désigner « l’esprit
et l’homme de couleur blanche ». Selon une autre superstition indigène, les
animaux auraient été antérieurement des créatures humaines – ce qui est de la
métempsycose à rebours.
Telles sont ces tribus du
continent australien, destinées sans doute à disparaître un jour comme ont
disparu les habitants de la Tasmanie. Tels étaient ces Indas, entre les mains
desquels étaient tombés John Branican et Harry Felton.
Après la mort du matelot, John
Branican et Harry Felton avaient dû suivre les Indas dans leurs pérégrinations
continues au milieu des régions du centre et du nord-ouest. Tantôt attaquant
les tribus hostiles, tantôt attaqués par elles, ils obtenaient une
incontestable supériorité sur leurs ennemis, grâce à ces conseils de leurs
prisonniers dont Willi tenait bon compte. Des centaines de milles furent
franchis depuis le Golfe du Roi jusqu’au golfe de Van Diémen, entre la vallée
de la Fitz-Roy river et la vallée de la Victoria, et jusqu’aux plaines de la
Terre Alexandra. C’est ainsi que le capitaine John et son second traversèrent
ces contrées inconnues des géographes, restées en blanc sur les cartes modernes,
dans l’est de la Terre de Tasman, de la Terre d’Arnheim et des territoires du
Great-Sandy-Desert.
Si ces interminables voyages
leur paraissaient extrêmement pénibles, les Indas ne s’en préoccupaient même pas.
Leur habitude est de vivre ainsi, sans souci des distances ni même du temps, dont
ils ont à peine une notion exacte. En effet, sur tel événement qui ne doit
s’accomplir que dans cinq ou six mois par exemple, l’indigène répond de très
bonne foi qu’il arrivera dans deux, dans trois jours… ou la semaine prochaine.
L’âge qu’il a, il l’ignore ; l’heure qu’il est, il ne le sait pas
davantage. Il semble que l’Australien soit d’une espèce spéciale dans l’échelle
des êtres – comme le sont plusieurs animaux de son pays.
C’est à de telles mœurs que
John Branican et Harry Felton furent contraints de se conformer. Ces fatigues, provoquées
par des déplacements quotidiens, ils durent les subir. Cette nourriture, si
insuffisante quelquefois, si répugnante toujours, ils durent s’en contenter. Et
cela, sans parler des épouvantables scènes de cannibalisme dont ils ne purent
jamais empêcher les horreurs, après ces batailles où les ennemis étaient tombés
par centaines.
En se soumettant ainsi, l’intention
bien arrêtée du capitaine John et de Harry Felton était d’endormir la vigilance
de la tribu, afin de s’enfuir dès que l’occasion s’en présenterait. Et pourtant,
ce qu’une évasion au milieu des déserts du nord-ouest présente de mauvaises
chances, on l’a vu en ce qui concerne le second du Franklin. Mais les
deux prisonniers étaient surveillés de si près que les occasions de fuir furent
extrêmement rares, et c’est à peine si, dans le cours de neuf ans, John et son
compagnon purent essayer de les mettre à profit. Une seule fois – c’était
l’année même qui avait précédé l’expédition de Mrs. Branican en Australie – une
seule fois, l’évasion aurait pu réussir. Voici dans quelles circonstances.
À la suite de combats avec
des tribus de l’intérieur, les Indas occupaient alors un campement sur les
bords du lac Amédée, au sud-ouest de la Terre Alexandra. Il était rare qu’ils
se fussent aussi profondément engagés dans le centre du continent. Le capitaine
John et Harry Felton, sachant qu’ils n’étaient qu’à trois cents milles de
l’Overland-Telegraf-Line, crurent l’occasion favorable et résolurent d’en
profiter. Après réflexion, il leur parut convenable de s’évader séparément, quitte
à se rejoindre quelques milles au delà du campement. Après avoir déjoué la
surveillance des indigènes, Harry Felton fut assez heureux pour gagner
l’endroit où il devait attendre son compagnon. Par malheur, John venait d’être
mandé près de Willi, qui réclamait ses soins à propos d’une blessure, reçue
dans la dernière rencontre. John ne put donc s’éloigner, et Harry Felton
l’attendit vainement pendant quelques jours… Alors, dans la pensée que s’il
parvenait à gagner une des bourgades de l’intérieur ou du littoral, il pourrait
organiser une expédition en vue de délivrer son capitaine, Harry Felton prit la
direction du sud-est. Mais ce qu’il eut à supporter de fatigues, de privations,
de misères, fut tel que, quatre mois après son départ, il vint tomber mourant
sur le bord du Parru, dans le district d’Ulakarara de la Nouvelle-Galles du
Sud. Ramené à l’hôpital de Sydney, il y avait langui pendant plusieurs semaines,
puis il était mort, après avoir pu dire à Mrs. Branican tout ce qui concernait
le capitaine John.
Terrible épreuve pour John de
n’avoir plus son compagnon près de lui, et il fallait que son énergie morale
fût à la hauteur de son énergie physique pour qu’il ne s’abandonnât pas au désespoir.
À qui parlerait-il désormais de ce qui lui était si cher, de son pays, de
San-Diégo, des êtres adorés qu’il avait laissés là-bas, de sa courageuse femme,
de son fils Wat qui grandissait loin de lui et qu’il ne connaîtrait jamais
peut-être, de M. William Andrew, de tous ses amis enfin ?… Depuis
neuf ans déjà, John était prisonnier des Indas, et combien d’années
s’écouleraient, avant que la liberté lui fût rendue ? Cependant, il ne
perdit pas espoir, étant soutenu par cette pensée que s’il réussissait à gagner
une des villes du littoral australien, Harry Felton ferait tout ce qu’il est
humainement possible de faire pour délivrer son capitaine…
Pendant les premiers temps de
sa captivité, John avait appris à parler la langue indigène, qui, par la
logique de sa grammaire, la précision de ses termes, la délicatesse de ses
expressions, semble témoigner que l’indigénat australien aurait joui autrefois
d’une réelle civilisation. Aussi avait-il souvent entretenu Willi des avantages
qu’il aurait à laisser ses prisonniers libres de retourner au Queensland ou
dans l’Australie méridionale, d’où ils seraient en mesure de lui faire parvenir
telle rançon qu’il exigerait. Mais, de nature très défiante, Willi n’avait rien
voulu entendre à ce propos. Si la rançon arrivait, il rendrait la liberté au
capitaine John et à son second. Quant à s’en rapporter à leurs promesses, jugeant
probablement les autres d’après lui-même, jamais il n’avait voulu y consentir.
Il s’ensuit donc que
l’évasion de Harry Felton, qui lui causa une violente irritation, rendit Willi
plus sévère encore envers le capitaine John. On lui interdit d’aller et de
venir pendant les haltes ou pendant les marches, et il dut subir la garde d’un
indigène qui en répondait sur sa tête.
De longs mois s’écoulèrent
sans que le prisonnier eût reçu aucune nouvelle de son compagnon. Et n’était-il
pas fondé à croire que Harry Felton avait succombé en route ? Si le
fugitif eût réussi à gagner le Queensland ou la province d’Adélaïde, est-ce
qu’il n’aurait pas déjà fait une tentative pour l’arracher aux mains des Indas ?
Pendant le premier trimestre
de l’année 1891 – c’est-à-dire au début de l’été australien – la tribu était
revenue vers la vallée de la Fitz-Roy, où Willi passait habituellement la
partie la plus chaude de la saison, et dans laquelle il trouvait les ressources
nécessaires à sa tribu.
C’est là que les Indas se
trouvaient encore dans les premiers jours d’avril, et leur campement occupait un
coude de la rivière, à un endroit où venait se jeter un petit affluent, qui descendait
des plaines du nord.
Depuis que la tribu était
fixée en cet endroit, le capitaine John, n’ignorant pas qu’il devait être assez
rapproché du littoral, avait songé à l’atteindre. S’il y parvenait, il ne lui
serait peut-être pas impossible de se réfugier dans les établissements situés
plus au sud, là où le colonel Warburton avait pu terminer son voyage.
John était décidé à tout
risquer pour en finir avec cette odieuse existence, fût-ce par la mort.
Malheureusement, une
modification, apportée aux projets des Indas, vint mettre à néant les espérances
que le prisonnier avait pu concevoir. En effet, dans la seconde quinzaine
d’avril, il fut manifeste que Willi se préparait à partir, afin de reporter son
campement d’hiver sur le haut cours du fleuve.
Que s’était-il passé, et à
quelles causes fallait-il attribuer ce changement des habitudes de la tribu ?
Le capitaine John parvint à
le savoir, mais ce ne fut pas sans peine : si la tribu cherchait à
remonter le cours d’eau plus à l’est, c’est que la police noire venait d’être
signalée sur le cours inférieur de la Fitz-Roy.
On n’a pas oublié ce que Tom
Marix avait dit de cette police noire, qui, depuis les révélations fournies par
Harry Felton sur le capitaine John, avait reçu ordre de se transporter sur les
territoires du nord-ouest.
Cette police, très redoutée
des indigènes, déploie un acharnement dont on ne peut se faire idée, quand elle
a lieu de les poursuivre. Elle est commandée par un capitaine, appelé « mani »,
ayant sous ses ordres un sergent, une trentaine d’agents de race blanche et
quatre-vingts agents de race noire, montés sur de bons chevaux, armés de fusils,
de sabres et de pistolets. Cette institution, connue sous le nom de « native
police », suffit à garantir la sécurité des habitants dans les régions
qu’elle visite à diverses époques. Impitoyable dans les répressions qu’elle
exerce sur les indigènes, si elle est blâmée par les uns au nom de l’humanité, elle
est approuvée par les autres au nom de la sécurité publique. Le service qu’elle
fait est très actif, et son personnel se transporte avec une rapidité
incroyable d’un point du territoire à l’autre. Aussi les tribus nomades
redoutent-elles de la rencontrer, et voilà pourquoi Willi, ayant appris qu’elle
se trouvait dans le voisinage, se disposait à remonter le cours de la Fitz-Roy.
Mais ce qui était un danger
pour les Indas, pouvait être le salut pour le capitaine John. S’il parvenait à
rejoindre un détachement de cette police, c’était sa délivrance assurée, son
rapatriement infaillible. Or, pendant la levée du campement, peut-être ne lui
serait-il pas impossible de tromper la surveillance des indigènes ?
Willi se douta-t-il des
projets de son prisonnier, on pourrait le croire, puisque le matin du 20 avril,
la porte de la hutte où John était enfermé ne s’ouvrit pas à l’heure
habituelle. Un indigène était de garde près de cette hutte. Aux questions que
John adressa, on ne fit aucune réponse. Lorsqu’il demanda à être conduit près
de Willi, on refusa d’accéder à sa demande, et le chef ne vint même pas lui
rendre visite.
Qu’était-il donc arrivé ?
Les Indas faisaient-ils en hâte leurs préparatifs pour quitter le campement ?
C’était probable, et John entendait les allées et venues tumultueuses autour de
sa hutte, où Willi s’était contenté de lui envoyer quelques aliments.
Un jour entier s’écoula, puis
un autre. Nul changement ne se produisit dans la situation. Le prisonnier était
toujours étroitement surveillé. Mais, pendant la nuit du 22 au 23 avril, il put
constater que les rumeurs du dehors avaient cessé, et il se demanda si les
Indas ne venaient pas d’abandonner définitivement le campement de la Fitz-Roy
river.
Le lendemain, dès l’aube, la
porte de la hutte s’ouvrit brusquement.
Un homme – un blanc – parut
devant le capitaine John. C’était Len Burker.
Il y avait trente-deux jours
– depuis la nuit du 22 au 23 mars – que Len Burker s’était séparé de Mrs.
Branican et de ses compagnons. Ce simoun, si fatal à la caravane, lui avait
fourni l’occasion d’exécuter ses projets. Entraînant Jane, et suivi des noirs
de l’escorte, il avait poussé devant lui les chameaux valides et entre autres
ceux qui portaient la rançon du capitaine John.
Len Burker se trouvait dans
des conditions plus favorables que Dolly pour rejoindre les Indas dans la
vallée arrosée par la Fitz-Roy. Déjà, pendant sa vie errante, il avait eu de
fréquents rapports avec les Australiens nomades, dont il connaissait la langue
et les habitudes. La rançon volée lui assurait bon accueil de Willi. Le
capitaine John, une fois délivré, serait en son pouvoir, et, cette fois…
Après avoir abandonné la
caravane, Len Burker s’était hâté de prendre la direction du nord-ouest, et au
lever du jour, ses compagnons et lui étaient à une distance de plusieurs
milles.
Jane voulut alors implorer
son mari, le supplier de ne point abandonner Dolly et les siens au milieu de ce
désert, lui rappeler que c’était un crime ajouté au crime commis à la naissance
de Godfrey, le prier de racheter son abominable conduite en rendant cet enfant
à sa mère, en joignant ses efforts à ceux qu’elle faisait pour retrouver le
capitaine John…
Jane n’obtint rien. Ce fut en
vain. Empêcher Len Burker de marcher à son but, cela n’était au pouvoir de
personne. Encore quelques jours, et il l’aurait atteint. Dolly et Godfrey morts
de privations et de misères, John Branican disparu, l’héritage d’Edward Starter
passerait entre les mains de Jane, c’est-à-dire entre les siennes, et, de ces
millions, il saurait faire bon usage !
Il n’y avait rien à attendre
de ce misérable. Il imposa silence à sa femme, qui dut se courber sous ses
menaces, sachant bien que, s’il n’avait eu besoin d’elle pour entrer en
possession de la fortune de Dolly, il l’aurait abandonnée depuis longtemps, et
peut-être pis encore. Quant à s’enfuir, à tenter de rejoindre la caravane, comment
aurait-elle pu y songer ? Seule, que serait-elle devenue ? D’ailleurs,
deux des noirs ne devaient pas la quitter d’un instant.
Il n’y a pas lieu d’insister
sur les incidents qui marquèrent le voyage de Len Burker. Ni les bêtes de somme
ni les vivres ne lui faisaient défaut. Dans ces conditions, il put fournir de
longues étapes en se rapprochant de la Fitz-Roy, avec des gens habitués à cette
existence et qui avaient été moins éprouvés que les blancs depuis le départ
d’Adélaïde.
En dix-sept jours, à la date
du 8 avril, Len Burker eut atteint la rive gauche de la rivière, précisément le
jour où Mrs. Branican et ses compagnons tombaient à leur dernière halte.
En cet endroit, Len Burker
fit la rencontre de quelques indigènes, et il obtint d’eux des renseignements
sur la situation actuelle des Indas. Ayant appris que la tribu avait suivi la
vallée plus à l’ouest, il résolut de la redescendre, afin de se mettre en
rapport avec Willi.
Le cheminement n’offrait plus
aucune difficulté. Pendant ce mois d’avril, dans la province de l’Australie
septentrionale, le climat de ces régions est moins excessif, quelque bas
qu’elle soit située en latitude. Il était évident que si la caravane de Mrs.
Branican avait pu atteindre la Fitz-Roy, elle eût été au terme de ses misères.
Quelques jours après, elle serait entrée en communication avec les Indas, car
c’est à peine si quatre-vingt-cinq milles séparaient alors John et Dolly l’un
de l’autre.
Lorsque Len Burker eut la
certitude qu’il n’était plus qu’à deux ou trois journées de marche, il prit le
parti de s’arrêter. Emmener Jane avec lui chez les Indas, la mettre en présence
du capitaine John, courir le risque d’être dénoncé par elle, cela ne pouvait
lui convenir. Par ses ordres, une halte fut organisée sur la rive gauche, et
malgré ses supplications, c’est là que la malheureuse femme fut abandonnée à la
garde des deux noirs.
Cela fait, Len Burker, suivi
de ses compagnons, continua de se diriger vers l’ouest, avec les chameaux de
selle et les deux bêtes chargées des objets d’échange.
Ce fut le 20 avril que Len
Burker rencontra la tribu, alors que les Indas se montraient si inquiets du
voisinage de la police noire, dont la présence avait été signalée à une dizaine
de milles en aval. Déjà même Willi se préparait à quitter son campement, afin
de chercher refuge dans les hautes régions de cette Terre d’Arnheim, qui appartient
à la province de l’Australie septentrionale.
En ce moment, sur les
injonctions de Willi, et dans le but de prévenir toute tentative d’évasion de
sa part, John était enfermé dans une hutte. Aussi ne devait-il rien apprendre
des négociations qui allaient s’établir préalablement entre Len Burker et le
chef des Indas.
Ces négociations ne donnèrent
lieu à aucune difficulté. Antérieurement, Len Burker avait été en rapport avec
ces indigènes. Il connaissait leur chef, et n’eut qu’à traiter la question de
rachat du capitaine John.
Willi se montra très disposé
à rendre son prisonnier contre rançon. L’étalage que lui fit Len Burker des
étoffes, des bimbeloteries, et surtout la provision de tabac qui lui était
offerte, l’impressionnèrent favorablement. Toutefois, en négociant avisé, il
fit valoir qu’il ne se séparerait pas sans regret d’un homme aussi important
que le capitaine John qui depuis tant d’années vivait au milieu de la tribu et
lui rendait de réels services, etc., etc. D’ailleurs, il savait que le
capitaine était Américain, et n’ignorait même pas qu’une expédition avait été
formée en vue d’opérer sa délivrance – ce que Len Burker confirma en disant
qu’il était précisément le chef de cette expédition. Puis, lorsque celui-ci
apprit que Willi s’inquiétait de la présence de la police noire sur le cours
inférieur de la Fitz-Roy river, il profita de cette circonstance pour l’engager
à traiter sans retard. En effet, dans son intérêt à lui, Burker, il importait
que la délivrance du capitaine demeurât secrète, et, en éloignant les Indas, il
y avait toute probabilité que ses agissements resteraient ignorés. La
disparition définitive de John Branican ne pourrait jamais lui être imputée, si
les gens de son escorte se taisaient à cet égard, et il saurait s’assurer leur
silence.
Il suit de là que la rançon
ayant été acceptée par Willi, ce marché fut terminé dans la journée du 22
avril. Le soir même, les Indas abandonnèrent leur campement et remontaient le
cours de la Fitz-Roy river.
Voilà ce qu’avait fait Len
Burker, voilà comment il était arrivé à son but, et, maintenant, on va voir
quel parti il allait tirer de cette situation.
C’était vers huit heures du
matin, le 23, que la porte de la hutte s’était ouverte. John Branican venait de
se trouver en présence de Len Burker.
Quinze ans s’étaient écoulés
depuis le jour où le capitaine lui avait serré une dernière fois la main au
départ du Franklin du port de San-Diégo. Il ne le reconnut pas, mais Len
Burker fut frappé de ce que John eût si peu changé relativement. Vieilli, sans
doute – il avait quarante-trois ans alors – mais moins qu’on aurait pu le
croire après un si long séjour chez les indigènes, il avait toujours ses traits
accentués, ce regard résolu dont le feu ne s’était point éteint, son épaisse
chevelure, blanchie il est vrai. Resté solide et robuste, John, mieux que Harry
Felton peut-être, eût supporté les fatigues d’une évasion à travers les déserts
australiens – fatigues auxquelles son compagnon avait succombé.
En apercevant Len Burker, le
capitaine John recula tout d’abord. C’était la première fois qu’il se trouvait
en face d’un blanc depuis qu’il était prisonnier des Indas. C’était la première
fois qu’un étranger allait lui adresser la parole.
« Qui êtes-vous ?
demanda-t-il.
– Un Américain de San-Diégo.
– De San-Diégo ?…
– Je suis Len Burker…
– Vous ! »
Le capitaine John s’élança
vers Len Burker, il lui prit les mains, il l’entoura de ses bras… Quoi ?…
Cet homme était Len Burker… Non !… c’était impossible… Il n’y avait là
qu’une apparence… John avait mal entendu… Il était sous l’influence d’une hallucination…
Len Burker… le mari de Jane… Et, en ce moment, le capitaine John ne songeait
guère à l’antipathie que Len Burker lui inspirait autrefois, à l’homme qu’il
avait si justement suspecté !
« Len Burker !
répéta-t-il.
– Moi-même, John.
– Ici… dans cette région !…
Ah !… vous aussi, Len… vous avez été fait prisonnier… »
Comment John aurait-il pu
s’expliquer autrement la présence de Len Burker au campement des Indas ?
« Non, se hâta de
répondre Len Burker, non, John, et je ne suis venu que pour vous racheter au
chef de cette tribu… pour vous délivrer…
– Me délivrer ! »
Le capitaine John ne parvint
à se dominer qu’au prix d’un violent effort. Il lui semblait qu’il allait
devenir fou, que sa raison était sur le point de l’abandonner…
Enfin, lorsqu’il fut redevenu
maître de lui, il eut la pensée de se jeter hors de la hutte… Il n’osa pas… Len
Burker lui avait parlé de sa délivrance !… Mais était-il libre ?… Et
Willi !… Et les Indas ?…
« Parlez, Len, parlez ! »
dit-il, après s’être croisé les bras, comme s’il eût voulu empêcher sa poitrine
d’éclater.
Alors Len Burker, fidèle au
plan qu’il avait formé de ne dire qu’une partie des choses et de s’attribuer
tout le mérite de cette campagne, allait raconter les faits à sa façon, lorsque
John, d’une voix étranglée par l’émotion, s’écria :
« Et Dolly ?… Dolly ?…
– Elle est vivante, John.
– Et Wat… mon enfant ?…
– Vivants… tous deux… et tous
deux… à San-Diégo.
– Ma femme… mon fils !… »
murmura John, dont les yeux se noyèrent de larmes.
Puis il ajouta :
« Maintenant, parlez…
Len… parlez !… J’ai la force de vous entendre ! »
Et Len Burker, poussant
l’effronterie jusqu’à le regarder en face, lui dit :
« John, il y a quelques
années, lorsque personne ne pouvait plus mettre en doute la perte du Franklin,
ma femme et moi nous dûmes quitter San-Diégo et l’Amérique. De graves
intérêts m’appelaient en Australie, et je me rendis à Sydney, où j’avais fondé
un comptoir. Depuis notre départ, Jane et Dolly ne cessèrent jamais de rester
en correspondance, car vous savez quelle affection les unissait l’une à l’autre,
affection que ni le temps ni la distance ne pouvaient affaiblir.
– Oui… je sais !
répondit John. Dolly et Jane étaient deux amies, et la séparation a dû être
cruelle !
– Très cruelle, John, reprit
Len Burker, mais, après quelques années, le jour était arrivé où cette
séparation allait prendre fin. Il y a onze mois environ, nous nous préparions à
quitter l’Australie pour retourner à San-Diégo, lorsqu’une nouvelle inattendue
suspendit nos projets de départ. On venait d’apprendre ce qu’était devenu le Franklin,
en quels parages il s’était perdu, et, en même temps, le bruit se répandait
que le seul survivant du naufrage était prisonnier d’une tribu australienne, que
c’était vous, John…
– Mais comment a-t-on pu
savoir, Len ?… Est-ce que Harry Felton ?…
– Oui, cette nouvelle avait
été rapportée par Harry Felton. Presque au terme de son voyage, votre compagnon
avait été recueilli sur les bords du Parru, dans le sud du Queensland, et
transporté à Sydney…
– Harry… mon brave
Harry !… s’écria le capitaine John. Ah !
je savais bien qu’il ne m’oublierait pas !… Dès qu’il a été rendu à Sydney,
il a organisé une expédition…
– Il est mort, répondit Len
Burker, mort des fatigues qu’il avait éprouvées !
– Mort !… répéta John.
Mon Dieu… mort !… Harry Felton… Harry ! »
Et des larmes coulèrent de
ses yeux.
« Mais, avant de mourir,
reprit Len Burker, Harry Felton avait pu raconter les événements qui suivirent
la catastrophe du Franklin, le naufrage sur les récifs de l’île Browse, dire
comment vous aviez atteint l’ouest du continent… C’est à son chevet que moi…
j’ai tout appris de sa bouche… tout !… Puis, ses yeux se sont fermés, John,
tandis qu’il prononçait votre nom…
– Harry !… mon pauvre
Harry !… » murmurait John, à la pensée de ces effroyables misères auxquelles
avait succombé ce fidèle compagnon qu’il ne devait plus revoir.
« John, reprit Len
Burker, la perte du Franklin, dont on était sans nouvelles depuis
quatorze ans, avait eu un retentissement considérable. Vous jugez de l’effet
qui se produisit, lorsque le bruit se répandit que vous étiez vivant… Harry
Felton vous avait laissé, quelques mois auparavant, prisonnier d’une tribu du
nord… Je fis immédiatement passer un télégramme à Dolly, en la prévenant que
j’allais me mettre en route pour vous retirer des mains des Indas, car ce ne
devait être qu’une question de rançon, d’après ce qu’avait dit Harry Felton.
Puis, ayant organisé une caravane dont j’ai pris la direction, Jane et moi nous
avons quitté Sydney. Voilà de cela sept mois… Il ne nous a pas fallu moins que
ce temps pour atteindre la Fitz-Roy… Enfin, Dieu aidant, nous sommes arrivés au
campement des Indas…
– Merci, Len, merci !…
s’écria le capitaine John. Ce que vous avez fait pour moi…
– Vous l’auriez fait pour moi
en pareilles circonstances, répondit Len Burker.
– Certes !… Et votre
femme, Len, cette courageuse Jane, qui n’a pas craint de braver tant de fatigues,
où est-elle ?…
– À trois jours de marche en
amont, avec deux de mes hommes, répondit Len Burker.
– Je vais donc la voir…
– Oui, John, et si elle n’est
pas ici, c’est que je n’ai pas voulu qu’elle m’accompagnât, ne sachant trop
quel accueil les indigènes feraient à notre petite caravane…
– Mais vous n’êtes pas venu
seul ? demanda le capitaine John.
– Non, j’ai là mon escorte, composée
d’une douzaine de noirs. Il y a deux jours que je suis arrivé dans cette vallée…
– Deux jours ?…
– Oui, et je les ai employés
à conclure mon marché. Ce Willi tenait à vous, mon cher John… Il connaissait
votre importance… ou plutôt votre valeur. Il a fallu longuement discuter pour
obtenir qu’il vous rendît la liberté contre rançon…
– Alors je suis libre ?…
– Aussi libre que je le suis
moi-même.
– Mais les indigènes ?…
– Ils sont partis avec leur
chef, et il n’y a plus que nous au campement.
– Partis ?… s’écria
John.
– Voyez ! »
Le capitaine John s’élança
d’un bond hors de la hutte.
En ce moment, sur le bord de
la rivière, il n’y avait que les noirs de l’escorte de Len Burker : les Indas
n’étaient plus là.
On voit ce qu’il y avait de
vrai et de mensonger dans le récit de Len Burker. De la folie de mistress
Branican, il n’avait rien dit. De la fortune qui était échue à Dolly par la
mort d’Edward Starter, il n’avait pas parlé. Rien, non plus, des tentatives
faites par le Dolly-Hope à travers les parages de la mer des Philippines
et le détroit de Torrès pendant les années 1879 et 1882. Rien de ce qui s’était
passé entre Mrs. Branican et Harry Felton à son lit de mort. Rien enfin de
l’expédition organisée par cette intrépide femme, maintenant abandonnée au
milieu du Great-Sandy-Desert, et dont lui, l’indigne Burker, s’attribuait le mérite.
C’était lui qui avait tout fait, c’était, lui qui, au risque de sa vie, avait
délivré le capitaine John !
Et comment John aurait-il pu
mettre en doute la véracité de ce récit ? Comment n’aurait-il pas remercié
avec effusion celui qui, après tant de périls, venait de l’arracher aux Indas, celui
qui allait le rendre à sa femme et à son enfant ?
C’est ce qu’il fit, et en
termes qui auraient touché un être moins dénaturé. Mais le remords n’avait plus
prise sur la conscience de Len Burker, et rien ne l’empêcherait d’aller jusqu’à
l’accomplissement de ses criminels projets. Maintenant John Branican se
hâterait de le suivre jusqu’au campement où Jane l’attendait… Pourquoi eût-il
hésité ?… Et, pendant ce trajet, Len Burker trouverait l’occasion de le
faire disparaître, sans être soupçonné des noirs de son escorte, qui ne
pourraient témoigner ultérieurement contre lui…
Le capitaine John étant
impatient de partir, il fut convenu que le départ s’effectuerait le jour même.
Son plus vif désir était de revoir Jane, l’amie dévouée de sa femme, de lui
parler de Dolly et de leur enfant, de M. William Andrew, de tous ceux
qu’il retrouverait à San-Diégo…
On se mit en route dans
l’après-midi du 23 avril. Len Burker avait des vivres pour quelques jours.
Pendant le voyage, la Fitz-Roy devait fournir l’eau nécessaire à la petite
caravane. Les chameaux, qui servaient de montures à John et à Len Burker, leur
permettraient au besoin de devancer leur escorte de quelques étapes. Cela faciliterait
les desseins de Len Burker… Il ne fallait pas que le capitaine John arrivât au
campement… et il n’y arriverait pas.
À huit heures du soir, Len
Burker s’établit sur la rive gauche de la rivière pour y passer la nuit. Il
était encore trop éloigné, pour mettre à exécution son projet de devancer
l’escorte, au milieu de ces régions où quelques mauvaises rencontres étaient
toujours à craindre.
Aussi, le lendemain, dès l’aube,
reprit-il sa marche avec ses compagnons.
La journée suivante se
partagea en deux étapes, qui ne furent interrompues que par une halte de deux
heures. Il n’était pas toujours facile de suivre le cours de la Fitz-Roy, dont
les berges étaient tantôt coupées de profondes entailles, tantôt barrées par
des massifs inextricables de gommiers et d’eucalyptus, ce qui obligeait à faire
de longs détours.
La journée avait été très
dure, et, après leur repas, les noirs s’endormirent.
Quelques instants plus tard, le
capitaine John était plongé dans un profond sommeil.
Il y avait peut-être là une
occasion dont Len Burker aurait pu profiter, car il ne dormait pas, lui.
Frapper John, traîner son cadavre à une vingtaine de pas, le précipiter dans la
rivière, il semblait même que les circonstances se réunissaient pour faciliter
la perpétration de ce crime. Puis, le lendemain, au moment du départ, on aurait
vainement cherché le capitaine John…
Vers les deux heures du matin,
Len Burker, se relevant sans bruit, rampa vers sa victime, un poignard à la
main, et il allait le frapper, lorsque John se réveilla.
« J’avais cru vous
entendre m’appeler ? dit Len Burker.
– Non, mon cher Len, répondit
John. Au moment où je me suis réveillé, je rêvais de ma chère Dolly et de notre
enfant ! »
À six heures, le capitaine
John et Len Burker reprirent leur route le long de la Fitz-Roy.
Pendant la halte de midi, Len
Burker, décidé à en finir puisqu’il devait arriver le soir même au campement, proposa
à John de devancer leur escorte.
John accepta, car il lui
tardait d’être près de Jane, de pouvoir lui parler plus intimement qu’il
n’avait pu le faire avec Len Burker.
Tous deux allaient donc
partir, lorsqu’un des noirs signala, à quelques centaines de pas, un blanc qui
s’avançait, non sans prendre certaines précautions.
Un cri échappa à Len Burker…
Il avait reconnu Godfrey.
Poussé par une sorte
d’instinct, sans presque avoir conscience de ce qu’il faisait, le capitaine
John venait de se précipiter au-devant du jeune garçon.
Len Burker était resté
immobile, comme si ses pieds eussent été cloués au sol.
Godfrey en face de lui…
Godfrey, le fils de Dolly et de John ! Mais la caravane de Mrs. Branican
n’avait donc pas succombé ?… Elle était donc là… à quelques milles… à
quelques centaines de pas… à moins que Godfrey fût le seul survivant de ceux
que le misérable avait abandonnés ?
Quoi qu’il en soit, cette
rencontre si inattendue pouvait anéantir tout le plan de Len Burker. Si le
jeune novice parlait, il dirait que Mrs. Branican était à la tête de cette
expédition… Il dirait que Dolly avait affronté mille fatigues, mille dangers au
milieu des déserts australiens pour porter secours à son mari… Il dirait
qu’elle était là… qu’elle le suivait en remontant le cours de la Fitz-Roy…
Et cela était, en effet.
Le matin du 22 mars, après
l’abandon de Len Burker, la petite caravane s’était remise en marche dans la
direction du nord-ouest. Le 8 avril, on le sait, ces pauvres gens, épuisés par
la faim, torturés par la soif, étaient tombés à demi morts.
Soutenue par une force
supérieure, Mrs. Branican avait essayé de ranimer ses compagnons, les suppliant
de se remettre en marche, de faire un dernier effort pour atteindre cette
rivière où ils pourraient trouver quelques ressources… C’était comme si elle se
fût adressée à des cadavres, et Godfrey lui-même avait perdu connaissance.
Mais l’âme de l’expédition
survivait en Dolly, et Dolly fit ce que ses compagnons ne pouvaient plus faire.
C’était vers le nord-ouest qu’ils se dirigeaient, c’était de ce côté que Tom Marix
et Zach Fren avaient tendu leurs bras défaillants… Dolly s’élança dans cette
direction.
À travers la plaine qui se
développait à perte de vue vers le couchant, sans vivres, sans moyens de
transport, qu’espérait cette énergique femme ?… Son but était-il de gagner
la Fitz-Roy, d’aller chercher assistance soit chez les blancs du littoral, soit
chez les indigènes nomades ?… Elle ne savait, mais elle fit ainsi quelques
milles – une vingtaine en trois jours. Pourtant, ses forces la trahirent, elle
tomba à son tour, et elle serait morte, si un secours ne lui fût arrivé –
providentiellement, on peut le dire.
Vers cette époque, la police
noire battait l’estrade sur la limite du Great-Sandy-Desert. Après avoir laissé
une escouade près de la Fitz-Roy, son chef, le mani, était venu opérer une reconnaissance
dans cette partie de la province avec une soixantaine d’hommes.
Ce fut lui qui rencontra Mrs.
Branican. Dès qu’elle eut repris connaissance, elle put dire où étaient ses
compagnons, et on la ramena vers eux. Le mani et ses hommes parvinrent à ranimer
ces pauvres gens, dont pas un n’eût été retrouvé vivant vingt-quatre heures
plus tard.
Tom Marix, qui avait
autrefois connu le mani dans la province du Queensland, lui fit le récit de ce
qui s’était passé depuis le départ d’Adélaïde. Cet officier n’ignorait pas dans
quel but une caravane, dirigée par Mrs. Branican, était engagée à travers les
lointaines régions du nord-ouest, et, puisque la Providence voulait qu’il pût
la secourir, il lui offrit de se joindre à elle. Et, quand Tom Marix eut parlé
des Indas, le mani répondit que cette tribu occupait en ce moment les bords de
la Fitz-Roy, à moins de soixante milles.
Il n’y avait pas de temps à
perdre, si l’on voulait déjouer les projets de Len Burker, que le mani avait
déjà eu mission de poursuivre, lorsqu’il courait avec une bande de bushrangers
la province du Queensland. Il n’était pas douteux que si Len Burker parvenait à
délivrer le capitaine John, qui n’avait aucune raison de se défier de lui, il
serait impossible de retrouver leurs traces ?
Mrs. Branican pouvait compter
sur le mani et sur ses hommes, qui partagèrent leurs vivres avec ses compagnons
et leur prêtèrent leurs chevaux. La troupe partit le soir même, et dans
l’après-midi du 21 avril, les hauteurs de la vallée se montraient à peu près
sur la limite du dix-septième parallèle.
En cet endroit, le mani
retrouva ceux de ses agents qui étaient restés en surveillance le long de la
Fitz-Roy. Ils lui apprirent que les Indas étaient alors campés à une centaine
de milles sur le cours supérieur de la rivière. Ce qui importait, c’était de
les rejoindre au plus tôt, bien que Mrs. Branican n’eût plus rien des objets
d’échange destinés à la rançon du capitaine. D’ailleurs, le mani, renforcé de
toute sa brigade, aidé de Tom Marix, de Zach Fren, de Godfrey, de Jos Meritt et
de leurs compagnons, n’hésiterait pas à employer la force pour arracher John
aux Indas. Mais, lorsqu’on eut remonté la vallée jusqu’au campement des
indigènes, ceux-ci l’avaient déjà abandonné. Le mani les suivit d’étape en
étape, et c’est ainsi que, dans l’après-midi du 25 avril, Godfrey, qui s’était
porté d’un demi-mille en avant, se trouva soudain en présence du capitaine
John.
Cependant Len Burker était
parvenu à se remettre, regardant Godfrey, sans prononcer un mot, attendant ce
que le jeune novice allait faire, ce qu’il allait dire.
Godfrey ne l’avait pas même
aperçu. Ses regards ne pouvaient se détacher du capitaine. Bien qu’il ne l’eût
jamais vu, il connaissait ses traits d’après le portrait photographique que
Mrs. Branican lui avait donné. Nul doute possible… Cet homme était le capitaine
John.
De son côté, John regardait
Godfrey avec une émotion non moins extraordinaire. Bien qu’il ne pût deviner
quel était ce jeune garçon, il le dévorait des yeux… il lui tendait ses mains…
il l’appelait d’une voix tremblante… oui ! il l’appelait comme si c’eût
été son fils.
Godfrey se précipita dans ses
bras, en s’écriant :
« Capitaine John !
– Oui… moi… c’est moi !
répondit le capitaine John. Mais… toi… mon enfant… qui es-tu ?… D’où
viens-tu ?… Comment sais-tu mon nom ?… »
Godfrey ne put répondre. Il
était devenu effroyablement pâle en apercevant Len Burker, et, ne pouvant
maîtriser l’horreur qu’il éprouvait à la vue de ce misérable :
« Len Burker ! »
s’écria-t-il.
Len Burker, après avoir
réfléchi aux suites de cette rencontre, ne pouvait que s’en féliciter.
N’était-ce pas le plus heureux des hasards, qui lui livrait à la fois Godfrey
et John ? N’était-ce pas une incroyable chance que d’avoir à sa merci le
père et l’enfant ? Aussi, s’étant retourné vers les noirs, leur fit-il
signe de séparer Godfrey et John, de les saisir…
« Len Burker !…
répéta Godfrey !
– Oui, mon enfant, répondit
John, c’est Len Burker… celui qui m’a sauvé…
– Sauvé ! s’écria
Godfrey. Non, capitaine John, non, Len Burker ne vous a pas sauvé !… Il a
voulu vous perdre, il nous a abandonnés, il a volé votre rançon à mistress
Branican… »
À ce nom, John répondit par
un cri, et, saisissant la main de Godfrey :
« Dolly ?… Dolly ?…
répétait-il.
– Oui… mistress Branican, capitaine
John, votre femme… qui est près d’ici !…
– Dolly ?… s’écria John.
– Ce garçon est fou !…
dit Len Burker, en s’approchant de Godfrey…
– Oui !… fou !…
murmura le capitaine John. Le pauvre enfant est fou !
– Len Burker, reprit Godfrey,
qui tremblait de colère, vous êtes un traître… vous êtes un assassin !… Et
si cet assassin est ici, capitaine John, c’est qu’il veut se défaire de vous, après
avoir abandonné mistress Branican et ses compagnons…
– Dolly !…
Dolly !… s’écria le capitaine John. Non…
Tu n’es pas un fou, mon enfant !… Je te crois… je te crois !… Viens !…
viens ! »
Len Burker et ses hommes se
précipitèrent sur John et sur Godfrey, qui, prenant un revolver à sa ceinture, frappa
un des noirs en pleine poitrine. Mais John et lui furent saisis, et les noirs
les entraînèrent vers la rivière.
Heureusement, la détonation
avait été entendue. Des cris lui répondirent à quelques centaines de pas en
aval, et presque aussitôt, le mani et ses agents, Tom Marix et ses compagnons, Mrs.
Branican, Zach Fren, Jos Meritt, Gîn-Ghi, se précipitaient de ce côté.
Len Burker et les noirs
n’étaient pas en force pour résister, et, un instant après, John était entre
les bras de Dolly.
La partie était perdue pour
Len Burker. Si l’on s’emparait de lui, il n’avait aucune grâce à attendre, et, suivi
de ses noirs, il prit la fuite en remontant le cours d’eau.
Le mani, Zach Fren, Tom Marix,
Jos Meritt et une douzaine d’agents se lancèrent à sa poursuite.
Comment peindre les
sentiments, comment rendre l’émotion qui débordait du cœur de Dolly et de John ?
Ils pleuraient, et Godfrey se mêlait à leurs étreintes, à leurs baisers, à
leurs larmes.
Tant de joie fit alors sur
Dolly ce que tant d’épreuves n’avaient pu faire. Ses forces l’abandonnèrent, et
elle tomba sans connaissance.
Godfrey, agenouillé près
d’elle, aidait Harriett à la ranimer. John l’ignorait, mais ils savaient, eux, qu’une
première fois Dolly avait perdu la raison sous l’excès de la douleur… Allait-elle
donc la perdre une seconde fois sous l’excès contraire ?
« Dolly… Dolly ! »
répétait John.
Et Godfrey, prenant les mains
de Mrs. Branican, s’écriait :
« Ma mère… ma mère ! »
Les yeux de Dolly se
rouvrirent, sa main serra la main de John, dont la joie débordait et qui tendit
ses bras à Godfrey, en disant :
« Viens… Wat !…
Viens, mon fils ! »
Mais Dolly ne pouvait le
laisser dans cette erreur, lui laisser croire que Godfrey fût son enfant…
« Non, John, dit-elle, non…
Godfrey n’est pas notre fils !… Notre pauvre petit Wat est mort… mort peu
de temps après ton départ !…
– Mort ! » s’écria
John, qui, cependant, ne cessait de regarder Godfrey.
Dolly allait lui dire quel
malheur l’avait frappée quinze années auparavant, lorsqu’une détonation retentit
du côté où le mani et ses compagnons s’étaient mis à la poursuite de Len
Burker.
Est-ce que justice avait été
faite du misérable, ou était-ce un nouveau crime que Len Burker avait eu le
temps de commettre ?
Presque aussitôt, tous
reparurent en groupe sur la rive de la Fitz-Roy. Deux des agents rapportaient
une femme, dont le sang s’échappait d’une large blessure et rougissait le sol.
C’était Jane.
Voici ce qui s’était passé.
Malgré la rapidité de sa
fuite, ceux qui poursuivaient Len Burker ne l’avaient point perdu de vue, et
quelques centaines de pas les séparaient encore de lui, lorsqu’il s’arrêta en
apercevant Jane.
Depuis la veille, cette
infortunée, étant parvenue à s’échapper, descendait le long de la Fitz-Roy.
Elle allait comme au hasard et quand les premières détonations se firent entendre,
elle n’était pas à un quart de mille de l’endroit où John et Godfrey venaient
de se retrouver. Elle hâta sa course, et se vit bientôt en présence de son mari
qui fuyait de ce côté.
Len Burker, l’ayant saisie
par le bras, voulut l’emmener.
À la pensée que Jane
rejoindrait Dolly, qu’elle lui dévoilerait le secret de la naissance de Godfrey,
sa fureur fut portée au comble. Et, comme Jane résistait, il la renversa d’un
coup de poignard.
À ce moment, éclata un coup
de fusil, qui fut accompagné de ces mots – tout à fait en situation, cette fois :
« Bien !… Oh !…
Très bien ! »
C’était Jos Meritt qui, après
avoir tranquillement ajusté Len Burker, venait de le faire rouler dans les eaux
de la Fitz-Roy.
Telle fut la fin de ce
misérable, frappé d’une balle au cœur par la main du gentleman.
Tom Marix s’élança vers Jane
qui respirait encore, mais bien faiblement. Deux agents prirent la malheureuse
femme entre leurs bras, et la rapportèrent près de Mrs. Branican.
En voyant Jane dans cet état,
Dolly poussa un cri déchirant. Penchée sur la mourante, elle cherchait à
entendre les battements de son cœur, à surprendre le souffle qui s’échappait de
sa bouche. Mais la blessure de Jane était mortelle, le poignard lui ayant
traversé la poitrine.
« Jane… Jane !… »
répéta Dolly d’une voix forte.
À cette voix, qui lui
rappelait les seules affections qu’elle eût jamais connues, Jane rouvrit les
yeux, regarda Dolly, et lui sourit en murmurant :
« Dolly !… Chère
Dolly ! »
Soudain son regard s’anima.
Elle venait d’apercevoir le capitaine John.
« John… vous… John !
dit-elle, mais si bas qu’on put à peine l’entendre.
– Oui… Jane, répondit le
capitaine, c’est moi… moi que Dolly est venu sauver…
– John… John est là !…
murmura-t-elle.
– Oui… près de nous, ma Jane !
dit Dolly. Il ne nous quittera plus… nous le ramènerons avec toi… avec toi…
là-bas… »
Jane n’écoutait plus. Ses
yeux semblaient chercher quelqu’un… et elle prononça ce nom :
« Godfrey !…
Godfrey ! »
Et l’angoisse se peignit sur
ses traits déjà décomposés par l’agonie. Mrs. Branican fit signe à Godfrey, qui
s’approcha.
« Lui !… lui… enfin ! »
s’écria Jane, en se redressant dans un dernier effort.
Puis, saisissant la main de
Dolly :
« Approche… approche, Dolly,
reprit-elle. John et toi, écoutez ce que j’ai encore à dire ! »
Tous deux se penchèrent sur
Jane de manière à ne pas perdre une seule de ses paroles.
« John, Dolly,
dit-elle, Godfrey… Godfrey qui est là… Godfrey
est votre enfant…
– Notre enfant ! »
murmura Dolly.
Et elle devint aussi pâle que
l’était la mourante, tant le sang lui reflua violemment au cœur.
« Nous n’avons plus de
fils ! dit John. Il est mort…
– Oui, répondit Jane, le
petit Wat… là-bas… dans la baie de San-Diégo… Mais vous avez eu un second enfant,
et cet enfant… c’est Godfrey ! »
En quelques phrases, entrecoupées
par les hoquets de la mort, Jane put dire ce qui s’était passé après le départ
du capitaine John, la naissance de Godfrey à Prospect-House, Dolly, privée de
raison, devenue mère sans le savoir, le petit être exposé par ordre de Len
Burker, recueilli quelques heures après, puis élevé plus tard à l’hospice de
Wat-House sous le nom de Godfrey…
Et Jane ajouta :
« Si je suis coupable de
n’avoir pas eu le courage de tout t’avouer, ma Dolly, pardonne-moi… pardonnez-moi,
John !
– As-tu besoin de pardon, Jane…
toi qui viens de nous rendre notre enfant…
– Oui… votre enfant !
s’écria Jane. Devant Dieu… John, Dolly, je le jure… Godfrey est votre enfant ! »
Et pendant que tous deux
pressaient Godfrey dans leurs bras, Jane eut un sourire de bonheur, qui
s’éteignit dans son dernier soupir.
Il est inutile de s’attarder
aux incidents qui terminèrent cet aventureux voyage à travers le continent
australien, et dans quelles conditions si différentes se fit ce retour vers la
province d’Adélaïde.
Tout d’abord avait été
discutée une question : Devait-on gagner les établissements du littoral, en
descendant la rivière Fitz-Roy – entre autres ceux de Rockbonne – ou se diriger
vers le port du Prince-Frederik, dans le York-Sund. Mais bien du temps se fût
écoulé, avant qu’un navire pût être expédié vers ce littoral, et il parut
préférable de reprendre la route déjà parcourue. Escortée par les agents de la
police noire, abondamment pourvue de vivres par les soins du mani, ayant à sa
disposition les chameaux de selle et de bât repris à Len Burker, la caravane
n’aurait rien à craindre des mauvaises rencontres.
Avant le départ, le corps de
Jane Burker fut déposé dans une tombe, creusée au pied d’un groupe de gommiers.
Dolly s’agenouilla sur cette tombe et pria pour l’âme de cette pauvre femme.
Le capitaine John, sa femme
et leurs compagnons quittèrent le campement de la Fitz-Roy river à la date du
25 avril, sous la direction du mani qui avait offert de l’accompagner jusqu’à
la plus proche station de l’Overland-Telegraf-Line.
Tous étaient si heureux que
l’on ne sentait même pas les fatigues du voyage, et Zach Fren, dans sa joie, répétait
à Tom Marix :
« Eh bien, Tom, nous
l’avons retrouvé le capitaine !
– Oui, Zach, mais à quoi cela
a-t-il tenu ?
– À un bon coup de barre que
la Providence a donné à propos, Tom, et il faut toujours compter sur la
Providence !… »
Cependant, il y avait un
point noir à l’horizon de Jos Meritt. Si Mrs. Branican avait retrouvé le capitaine
John, le célèbre collectionneur n’avait point retrouvé le chapeau, dont la
recherche lui coûtait tant de peines et tant de sacrifices. Être allé jusque
chez les Indas, et ne pas être entré en communication avec ce Willi, qui se coiffait
peut-être du couvre-chef historique, quelle malchance ! Ce qui consola un
peu Jos Meritt, il est vrai, ce fut d’apprendre par le mani que la mode des
coiffures européennes n’était pas parvenue chez les peuplades du nord-ouest, contrairement
à ce que Jos Meritt avait observé déjà chez les peuplades du nord-est. Donc, son
desideratum n’aurait pu se réaliser parmi les indigènes de l’Australie septentrionale.
En revanche, il pouvait se féliciter du maître coup de fusil qui avait
débarrassé la famille Branican « de cet abominable Len Burker ! »
comme disait Zach Fren.
Le retour s’opéra aussi
rapidement que possible. La caravane n’eut pas trop à souffrir de la soif, car
les puits étaient déjà remplis sous les larges averses de l’automne, et la
température se maintenait à un degré supportable. D’ailleurs, sur l’avis du
mani, on gagna en ligne droite les régions traversées par la ligne télégraphique,
où ne manquent ni les stations bien approvisionnées, ni les moyens de communication
avec la capitale de l’Australie méridionale. Grâce au télégraphe, on sut bientôt
dans le monde entier que Mrs. Branican avait mené à bonne fin son audacieuse
expédition.
Ce fut à la hauteur du lac
Wood que John, Dolly et leurs compagnons atteignirent l’une des stations de
l’Overland-Telegraf-Line. Là, le mani et les agents de la police noire durent
prendre congé de John et de Dolly Branican. Ils ne s’en séparèrent pas sans
avoir reçu les chaleureux remerciements qu’ils méritaient – en attendant les
récompenses que le capitaine leur fit parvenir dès son arrivée à Adélaïde.
Il n’y avait plus qu’à
descendre les districts de la Terre Alexandra jusqu’à la station d’Alice-Spring,
où la caravane s’arrêta dans la soirée du 19 juin, après sept semaines de
voyage.
Là, sous la garde de M. Flint,
le chef de la station, Tom Marix retrouva le matériel qu’il y avait laissé, les
bœufs, les chariots, les buggys, les chevaux destinés aux étapes qui restaient
à parcourir.
Il s’ensuit donc que, le 3
juillet, tout le personnel atteignit le railway de Farina-Town, et le lendemain
la gare d’Adélaïde.
Quel accueil fut fait au
capitaine John et à sa courageuse compagne ! Il y eut concours de toute la
ville pour les recevoir, et lorsque le capitaine John Branican parut entre sa
femme et son fils au balcon de l’hôtel de King-WilliamStreet, les hips et les
hurrahs éclatèrent avec une telle intensité que, suivant Gîn-Ghi, on avait dû
les entendre de l’extrémité du Céleste-Empire.
Le séjour à Adélaïde ne fut
pas de longue durée. John et Dolly Branican avaient hâte d’être de retour à
San-Diégo, de revoir leurs amis, de retrouver leur chalet de Prospect-House, où
le bonheur allait rentrer avec eux. On prit alors congé de Tom Marix et de ses
hommes, qui furent généreusement récompensés, et dont on ne devait jamais oublier
les services.
On n’oublierait pas non plus
cet original de Jos Meritt, qui se décida, lui aussi, à quitter l’Australie
toujours suivi de son fidèle serviteur.
Mais enfin puisque « son
chapeau » ne s’y trouvait pas, où donc se trouvait-il ?
Où ?… Dans une demeure
royale, où il était conservé avec tout le respect qui lui était dû. Oui !
Jos Meritt, égaré sur de fausses pistes, avait inutilement parcouru les cinq
parties du monde, pour conquérir ce chapeau… qui se trouvait au château de
Windsor, ainsi qu’on l’apprit six mois plus tard. C’était le chapeau que
portait Sa Gracieuse Majesté lors de sa visite au roi Louis-Philippe en 1845, et
il fallait être fou, à tout le moins, pour imaginer que ce chef-d’œuvre d’une
modiste parisienne aurait pu achever sa carrière sur le crâne crépu d’un
sauvage de l’Australie !
Il résulta de cela que les
pérégrinations de Jos Meritt cessèrent enfin à l’extrême joie de Gîn-Ghi, mais
à l’extrême déplaisir du célèbre bibelomane, qui revint à Liverpool, très
dépité de n’avoir pu compléter sa collection par l’acquisition de ce chapeau
unique au monde.
Trois semaines après avoir
quitté Adélaïde, où ils s’étaient embarqués sur l’Abraham-Lincoln, John,
Dolly et Godfrey Branican, accompagnés de Zach Fren et de la femme Harriett, arrivèrent
à San-Diégo.
C’est là que M. William
Andrew et le capitaine Ellis les reçurent au milieu des habitants de cette généreuse
cité, fière d’avoir retrouvé le capitaine John et de saluer en lui l’un de ses
plus glorieux enfants.
* 1863 Cinq
semaines en ballon
* 1864
Voyage au centre de la Terre
* 1865 De la
terre à la Lune
* 1866
Voyages et Aventures du Capitaine Hatteras
* 1868 Les
enfants du capitaine Grant
* 1870 Vingt
Mille lieues sous les mers
* 1870
Autour de la Lune
* 1871 Une
Ville flottante
* 1872
Aventures de trois Russes et de trois Anglais
* 1873 Le
pays des fourrures
* 1873 Le
tour du monde en 80 jours
* 1874 Le
Docteur Ox
* 1874 L'Île mystérieuse
* 1875 Le
« Chancellor »
* 1876
Michel Strogoff
* 1877 Les
Indes noires
* 1878 Un
capitaine de quinze ans
* 1879 Les
tribulations d'un Chinois en Chine
* 1879 Les
Cinq cents millions de la Bégum
* 1880 La
maison à vapeur
* 1881 La
Jangada
* 1882
L'école des Robinsons
* 1882 Le
Rayon vert
* 1883
Kéraban le têtu
* 1884 L'archipel en feu
* 1884 L'Étoile du sud
* 1885
Mathias Sandorf
* 1886 Robur
le conquérant
* 1886 Un
billet de loterie
* 1887 Nord
contre Sud
* 1887 Le
chemin de France
* 1888 Deux
ans de vacances
* 1889
Famille sans nom
* 1889 Sans
dessus dessous
* 1890 César
Cascabel
* 1891
Mistress Branican
* 1892 Le
Château des Carpathes
* 1892
Claudius Bombarnac
* 1893 P'tit
Bonhomme
* 1894
Mirifiques Aventures de Maître Antifer
* 1895 L'Île à Hélice
* 1896 Face
au drapeau
* 1896
Clovis Dardentor
* 1897 Le
Sphinx des Glaces
* 1898 Le
superbe Orénoque
* 1899 Le
testament d'un excentrique
* 1900
Seconde Patrie
* 1901 Le
village aérien
* 1901 Les
histoires de Jean-Marie Cabidoulin
* 1902 Les
frères Kip
* 1903
Bourses de voyages
* 1904 Un
drame en Livonie
* 1904
Maître du monde
* 1905 L'invasion de la mer
* 1905 Le
phare du bout du monde
* 1906 Le
Volcan d'or
* 1907 L'agence Thompson and Co.
* 1908 La Chasse au Météor
* 1908 Le
pilote du Danube
* 1909 Les
naufragés du Jonathan
* 1910 Le
secret de Wilhem Storitz
* 1910 Hier
et demain
* 1919 L'étonnante aventure de la mission Barsac
Inédits
* 1989
Voyage à reculons en Angleterre et en Écosse
* 1991 L'oncle Robinson
* 1992 Un
prêtre en 1829
* 1993
San-Carlos et autres récits
* 1994 Paris
au XXe siècle