Jules Verne
Le village aérien
(Chapitre XIV-XVIII)
38 dessins par George Roux, un carte
Imprimerie Gauthier-Villars
Collection Hetzel
© Andrzej Zydorczak
Les Wagddis
![]() a Majesté Msélo-Tala-Tala, roi de cette peuplade des Wagddis, gouvernant ce village aérien, voilà, n’était-il pas vrai, ce qui devait suffire à réaliser les desiderata de Max Huber. Dans la furia française de son imagination, n’avait-il pas entrevu, sous les profondeurs de cette mystérieuse forêt de l’Oubanghi, des générations nouvelles, des cités inconnues, tout un monde extraordinaire dont personne ne soupçonnait l’existence?… Eh bien, il était servi à souhait.
a Majesté Msélo-Tala-Tala, roi de cette peuplade des Wagddis, gouvernant ce village aérien, voilà, n’était-il pas vrai, ce qui devait suffire à réaliser les desiderata de Max Huber. Dans la furia française de son imagination, n’avait-il pas entrevu, sous les profondeurs de cette mystérieuse forêt de l’Oubanghi, des générations nouvelles, des cités inconnues, tout un monde extraordinaire dont personne ne soupçonnait l’existence?… Eh bien, il était servi à souhait.
Il fut le premier à s’applaudir d’avoir vu si juste et ne s’arrêta que devant cette non moins juste observation de John Cort:
«C’est entendu, mon cher ami, vous êtes, comme tout poète, doublé d’un devin, et vous avez deviné…
– Juste, mon cher John, mais quelle que soit cette tribu demi-humaine des Wagddis, mon intention n’est pas de finir mon existence dans leur capitale…
– Eh! mon cher Max, il faut y séjourner assez pour étudier cette race au point de vue ethnologique et anthropologique, afin de publier là-dessus un fort in-quarto qui révolutionnera les instituts des deux continents…
– Soit, répliqua Max Huber, nous observerons, nous comparerons, nous piocherons toutes les thèses relatives à la question de l’anthropomorphie, à deux conditions toutefois…
– La première?…
– Qu’on nous laissera, j’y compte bien, la liberté d’aller et de venir dans ce village…
– Et la seconde?
– Qu’après avoir circulé librement, nous pourrons partir quand cela nous conviendra…
– Et à qui nous adresser?… demanda Khamis.
– A Sa Majesté le père Miroir, répondit Max Huber. Mais, au fait, pourquoi ses sujets l’appellent-ils ainsi?…
– Et en langue congolaise?… répliqua John Cort.
– Est-ce donc que Sa Majesté est myope ou presbyte… et porte des lunettes? reprit Max Huber.
– Et, d’abord, ces lunettes, d’où viendraient-elles?… ajouta John Cort.
– N’importe, continua Max Huber, lorsque nous serons en état de causer avec ce souverain, soit qu’il ait appris notre langue, soit que nous ayons appris la sienne, nous lui offrirons de signer un traité d’alliance offensive et défensive avec l’Amérique et la France et il ne pourra faire moins que de nous nommer grands-croix de l’ordre wagddien…»
Max Huber ne se prononçait-il pas trop affirmativement, en comptant qu’ils auraient toute liberté dans ce village, puis qu’ils le quitteraient à leur convenance? Or, si John Cort, Khamis et lui ne reparaissaient pas à la factorerie, qui s’aviserait de venir les chercher dans ce village de Ngala au plus profond de la grande forêt?… En ne voyant plus revenir personne de la caravane, qui douterait qu’elle n’eût péri tout entière dans les régions du haut Oubanghi?…
Quant à la question de savoir si Khamis et ses compagnons resteraient ou non prisonniers dans cette case, elle fut presque aussitôt tranchée. La porte tourna sur ses attaches de liane et Li-Maï parut.
Tout d’abord, le petit alla droit à Llanga et lui prodigua mille caresses que celui-ci rendit de bon cœur. John Cort avait donc l’occasion d’examiner plus attentivement cette singulière créature. Mais, comme la porte était ouverte, Max Huber proposa de sortir et de se mêler à la population aérienne.
Les voici donc dehors, guidés par le petit sauvage – ne peut-on le qualifier ainsi? – qui donnait la main à son ami Llanga. Ils se trouvèrent alors au centre d’une sorte de carrefour où passaient et repassaient des Wagddiens «allant à leurs affaires».
Ce carrefour était planté d’arbres ou plutôt ombragé de têtes d’arbres dont les robustes troncs supportaient cette construction aérienne. Elle reposait à une centaine de pieds au-dessus du sol sur les maîtresses branches de ces puissants bauhinias, bombax, baobabs. Faite de pièces transversales solidement reliées par des chevilles et des lianes, une couche de terre battue s’étendait à sa surface, et, comme les points d’appui étaient aussi solides que nombreux, le sol factice ne tremblait pas sous le pied. Et, même alors que les violentes rafales soufflaient à travers ces hautes cimes, c’est à peine si le bâti de cette superstructure en ressentait un léger frémissement.
Par les interstices du feuillage pénétraient les rayons solaires. Le temps était beau, ce jour-là. De larges plaques de ciel bleu se montraient au-dessus des dernières branches. Une brise, chargée de pénétrantes senteurs, rafraîchissait l’atmosphère.
Tandis que déambulait le groupe des étrangers, les Wagddis, hommes, femmes, enfants, les regardaient sans manifester aucune surprise. Ils échangeaient entre eux divers propos, d’une voix rauque, phrases brèves prononcées précipitamment et mots inintelligibles. Toutefois, le foreloper crut entendre quelques expressions de la langue congolaise, et il ne fallait pas s’en étonner, puisque Li-Maï s’était plusieurs fois servi du mot «ngora». Cela pourtant semblait inexplicable. Mais, ce qui l’était bien davantage, c’est que John Cort fut frappé par la répétition de deux ou trois mots allemands, – entre autres celui de «vater2», et il fit connaître cette particularité à ses compagnons.
«Que voulez-vous, mon cher John?… répondit Max Huber. Je m’attends à tout, même à ce que ces êtres-là me tapent sur le ventre, en disant: «Comment va… mon vieux?»
De temps en temps, Li-Maï, abandonnant la main de Llanga, allait à l’un ou à l’autre, en enfant vif et joyeux. Il paraissait fier de promener des étrangers à travers les rues du village. Il ne le faisait pas au hasard, – cela se voyait, – il les menait quelque part, et il n’y avait qu’à le suivre, ce guide de cinq ans.
Ces primitifs – ainsi les désignait John Cort – n’étaient pas complètement nus. Sans parler du pelage roussâtre qui leur couvrait en partie le corps, hommes et femmes se drapaient d’une sorte de pagne d’un tissu végétal, à peu près semblable, quoique plus grossièrement fabriqué, à ceux d’agoulie en fils d’acacia, qui s’ourdissent communément à Porto-Novo dans le Dahomey.
Ce que John Cort remarqua spécialement, c’est que ces têtes wagddiennes, arrondies, réduites aux dimensions du type microcéphalique très rapprochées de l’angle facial humain, présentaient peu de prognathisme. En outre, les arcades sourcilières n’offraient aucune de ces saillies qui sont communes à toute la race simienne. Quant à la chevelure, c’était la toison lisse des indigènes de l’Afrique équatoriale, avec la barbe peu fournie.
«Et pas de pied préhensif…, déclara John Cort.
– Et pas d’appendice caudal, ajouta Max Huber, pas le moindre bout de queue!
– En effet, répondit John Cort, et c’est déjà un signe de supériorité. Les singes anthropomorphes n’ont ni queue, ni bourses à joues, ni callosités. Ils se déplacent horizontalement ou verticalement à leur gré. Mais une observation a été faite, c’est que les quadrumanes qui marchent debout ne se servent point de la plante du pied et s’appuient sur le dos des doigts repliés. Or, il n’en est pas ainsi des Wagddis, et leur marche est absolument celle de l’homme, il faut bien le reconnaître.»
Très juste, cette remarque, et, nul doute, il s’agissait d’une race nouvelle. D’ailleurs, en ce qui concerne le pied, certains anthropologistes admettent qu’il n’y a aucune différence entre celui du singe et celui de l’homme, et ce dernier aurait même le pouce opposable si le sous-pied n’était déformé par l’usage de la chaussure.
Il existe en outre des similitudes physiques entre les deux races. Les quadrumanes qui possèdent la station humaine sont les moins pétulants, les moins grimaçants, en un mot, les plus graves, les plus sérieux de l’espèce. Or, précisément, ce caractère de gravité se manifestait dans l’attitude comme dans les actes de ces habitants de Ngala. De plus, lorsque John Cort les examinerait attentivement, il pourrait constater que leur système dentaire était identique à celui de l’homme.
Ces ressemblances ont donc pu jusqu’à lin certain point engendrer la doctrine de la variabilité des espèces, l’évolution ascensionnelle préconisée par Darwin. On les a même regardées comme décisives, par comparaison entre les échantillons les plus élevés de l’échelle simienne et les primitifs de l’humanité. Linné a soutenu cette opinion qu’il y avait eu des hommes troglodytes, expression qui, en tous cas, n’aurait pu s’appliquer aux Wagddis, lesquels vivent dans les arbres. Vogt a même été jusqu’à prétendre que l’homme est sorti de trois grands singes: l’orang, type brachycéphale au long pelage brun, serait d’après lui l’ancêtre des négritos; le chimpanzé, type dolichocéphale, aux mâchoires moins massives, serait l’ancêtre des nègres; enfin, du gorille, spécialisé par le développement du thorax, la forme du pied, la démarche qui lui est propre, le caractère ostéologique du tronc et des extrémités, descendrait l’homme blanc. Mais, à ces similitudes, on peut opposer des dissemblances d’une importance capitale dans l’ordre intellectuel et moral, – dissemblances qui doivent faire justice des doctrines darwiniennes.
Il convient donc, en prenant les caractères distinctifs de ces trois quadrumanes, sans admettre toutefois que leur cerveau possède les douze millions de cellules et les quatre millions de fibres du cerveau humain, de croire qu’ils appartiennent à une race supérieure dans l’animalité. Mais on n’en pourra jamais conclure que l’homme soit un singe perfectionné ou le singe un homme en dégénérescence.
Quant au microcéphale, dont on veut faire un intermédiaire entre l’homme et le singe, espèce vainement prédite par les anthropologistes et vainement cherchée, cet anneau qui manque pour rattacher le règne animal au règne «hommal3», y avait-il lieu d’admettre qu’il fût représenté par ces Wagddis?… Les singuliers hasards de leur voyage avaient-ils réservé à ce Français et à cet Américain de le découvrir?…
Et, même si cette race inconnue se rapprochait physiquement de la race humaine, encore faudrait-il que les Wagddis eussent ces caractères de moralité, de religiosité spéciaux à l’homme, sans parler de la faculté de concevoir des abstractions et des généralisations, de l’aptitude pour les arts, les sciences et les lettres. Alors seulement, il serait possible de se prononcer d’une façon péremptoire entre les thèses des monogénistes et des polygénistes.
Une chose certaine, en somme, c’est que les Wagddis parlaient. Non bornés aux seuls instincts, ils avaient des idées, – ce que suppose l’emploi de la parole, – et des mots dont la réunion formait le langage. Mieux que des cris éclairés par le regard et le geste, ils employaient une parole articulée, ayant pour base une série de sons et de figures conventionnels qui devaient avoir été légués par atavisme.
Et c’est ce dont fut le plus frappé John Cort. Cette faculté, qui implique la participation de la mémoire, indiquait une influence congénitale de race.
Cependant, tout en observant les mœurs et les habitudes de cette tribu sylvestre, John Cort, Max Huber et Khamis s’avançaient à travers les rues du village.
Était-il grand, ce village?… En réalité, sa circonférence ne devait pas être inférieure à cinq kilomètres.
«Et, comme le dit Max Huber, si ce n’est qu’un nid, c’est du moins un vaste nid!»
Construite de la main des Wagddis, cette installation dénotait un art supérieur à celui des oiseaux, des abeilles, des castors et des fourmis. S’ils vivaient dans les arbres, ces primitifs, qui pensaient et exprimaient leurs pensées, c’est que l’atavisme les y avait poussés.
«Dans tous les cas, fit remarquer John Cort, la nature, oui ne se trompe jamais, a eu ses raisons pour porter ces Wagddis a adopter l’existence aérienne. Au lieu de ramper sur un sol malsain que le soleil ne pénètre jamais de ses rayons, ils vivent dans le milieu salutaire des cimes de cette forêt.»
La plupart des cases, fraîches et verdoyantes, disposées en forme de ruches, étaient largement ouvertes. Les femmes s’y adonnaient avec activité aux soins très rudimentaires de leur ménage. Les enfants se montraient nombreux, les tout jeunes allaités par leurs mères. Quant aux hommes, les uns faisaient entre les branches la récolte des fruits, les autres descendaient par l’escalier pour vaquer à leurs occupations habituelles. Ceux-ci remontaient avec quelques pièces de gibier, ceux-là rapportaient les jarres qu’ils avaient remplies au lit du rio.
«Il est fâcheux, dit Max Huber, que nous ne sachions pas la langue de ces naturels!… Jamais nous ne pourrons converser ni prendre une connaissance exacte de leur littérature… Du reste, je n’ai pas encore aperçu la bibliothèque municipale… ni le lycée de garçons ou de filles!»
Cependant, puisque la langue wagddienne, après ce qu’on avait entendu de Li-Maï, se mélangeait de mots indigènes, Khamis essaya de quelques-uns des plus usuels en s’adressant à l’enfant.
Mais, si intelligent que parût Li-Maï, il sembla ne point comprendre. Et pourtant, devant John Cort et Max Huber, il avait prononcé le mot «ngora», alors qu’il était couché sur le radeau. Et, depuis, Llanga affirmait avoir appris de son père que le village s’appelait Ngala et le chef Msélo-Tala-Tala.
Enfin, après une heure de promenade, le foreloper et ses compagnons atteignirent l’extrémité du village. Là s’élevait une case plus importante. Établie entre les branches d’un énorme bombax, la façade treillissée de roseaux, sa toiture se perdait dans le feuillage.
Cette case, était-ce le palais du roi, le sanctuaire des sorciers, le temple des génies, tels qu’en possèdent la plupart des tribus sauvages, en Afrique, en Australie, dans les îles du Pacifique?…
L’occasion se présentait de tirer de Li-Maï quelques renseignements plus précis. Aussi, John Cort, le prenant par les épaules et le tournant vers la case, lui dit:
«Msélo-Tala-Tala?…»
Un signe de tête fut toute la réponse qu’il obtint.
Donc, là demeurait le chef du village de Ngala, Sa Majesté Wagddienne.
Et, sans autre cérémonie, Max Huber se dirigea délibérément vers la susdite case.
Changement d’attitude de l’enfant, qui le retint en manifestant un véritable effroi.
Nouvelle insistance de Max Huber, qui répéta à plusieurs reprises: «Msélo-Tala-Tala?…»
Mais, au moment où Max Huber allait atteindre la case, le petit courut à lui, l’empêcha d’aller plus avant.
Il était donc défendu d’approcher de l’habitation royale?…
En effet, deux sentinelles Wagddis venaient de se lever et, brandissant leurs armes, une sorte de hache en bois de fer et une sagaie, défendirent l’entrée.
«Allons, s’écria Max Huber, ici comme ailleurs, dans la grande forêt de l’Oubanghi comme dans les capitales du monde civilisé, des gardes du corps, des cent-gardes, des prétoriens en faction devant le palais, et quel palais… celui d’une Majesté homo-simienne.
– Pourquoi s’en étonner, mon cher Max?…
– Eh bien, déclara celui-ci, puisque nous ne pouvons voir ce monarque, nous lui demanderons une audience par lettre…
– Bon, répliqua John Cort; s’ils parlent, ces primitifs, ils n’en sont pas arrivés à savoir lire et écrire, j’imagine!… Encore plus sauvages que les indigènes du Soudan et du Congo, les Founds, les Chiloux, les Denkas, les Monbouttous, ils ne semblent pas avoir atteint ce degré de civilisation qui implique la préoccupation d’envoyer leurs enfants à l’école…
– Je m’en doute un peu, John. Au surplus, comment correspondre par lettre avec des gens dont on ignore la langue?…
– Laissons-nous conduire par ce petit, dit Khamis.
– Est-ce que tu ne reconnais pas la case de son père et de sa mère?… demanda John Cort au jeune indigène.
– Non, mon ami John, répondit Llanga, mais… sûrement… Li-Maï nous y mène… Il faut le suivre.»
Et alors, s’approchant de l’enfant et tendant la main vers la gauche:
«Ngora… ngora?…» répéta-t-il.
A n’en pas douter, l’enfant comprit, car sa tête s’abaissa et se releva vivement.
«Ce qui indique, fit observer John Cort, que le signe de dénégation et d’affirmation est instinctif et le même chez tous les humains… une preuve de plus que ces primitifs touchent de très près à l’humanité…»
Quelques minutes après, les visiteurs arrivaient dans un quartier du village plus ombragé où les cimes enchevêtraient étroitement leur feuillage.
Li-Maï s’arrêta devant une paillote proprette, dont le toit était fait des larges feuilles de l’enseté, ce bananier si répandu dans la grande forêt, ces mêmes feuilles que le foreloper avait employées pour le taud du radeau. Une sorte de pisé formait les parois de cette paillote à laquelle on accédait par une porte ouverte en ce moment.
De la main, l’enfant la montra à Llanga qui la reconnut.
«C’est là», dit-il.
A l’intérieur, une seule chambre. Au fond, une literie d’herbes sèches, qu’il était facile de renouveler. Dans un coin, quelques pierres servant d’âtre où brûlaient des tisons. Pour uniques ustensiles, deux ou trois calebasses, une jatte de terre pleine d’eau et deux pots de même substance. Ces sylvestres n’en étaient pas encore aux fourchettes et mangeaient avec leurs doigts. Çà et là, sur une planchette fixée aux parois, des fruits, des racines, un morceau de viande cuite, une demi-douzaine d’oiseaux plumés pour le prochain repas et, pendues à de fortes épines, des bandes d’étoffe d’écorce et d’agoulie.
Un Wagddi et une Wagddienne se levèrent au moment où Khamis et ses compagnons pénétrèrent dans la paillote.
«Ngora!… ngora!… Lo-Maï… La-Maï!» dit l’enfant.
Et le premier d’ajouter, comme s’il eût pensé qu’il serait mieux compris:
«Vater… vater!…»
Ce mot de «père», il le prononçait en allemand, fort mal. D’ailleurs, quoi de plus extraordinaire qu’un mot de cette langue dans la bouche de ces Wagddis?…
A peine entré, Llanga était allé près de la mère et celle-ci lui ouvrait ses bras, le pressait contre elle, le caressait de la main, témoignant toute sa reconnaissance pour le sauveur de son enfant.
Voici ce qu’observa plus particulièrement John Cort:
Le père était de haute taille, bien proportionné, d’apparence vigoureuse, les bras un peu plus longs que n’eussent été des bras humains, les mains larges et fortes, les jambes légèrement arquées, la plante des pieds entièrement appliquée sur le sol.
Il avait le teint presque clair de ces tribus d’indigènes qui sont plus carnivores qu’herbivores, une barbe floconneuse et courte, une chevelure noire et crépue, une sorte de toison qui lui recouvrait tout le corps. Sa tête était de moyenne grosseur, ses mâchoires peu proéminentes; ses yeux, à la pupille ardente, brillaient d’un vif éclat.
Assez gracieuse, la mère, avec sa physionomie avenante et douce, son regard qui dénotait une grande affectuosité, ses dents bien rangées et d’une remarquable blancheur, et – chez quels individus du sexe faible la coquetterie ne se manifeste-t-elle pas? – des fleurs dans sa chevelure, et aussi – détail en somme inexplicable – des grains de verre et des perles d’ivoire. Cette jeune Wagddienne rappelait le type des Cafres du Sud, avec ses bras ronds et modelés, ses poignets délicats, ses extrémités fines, des mains potelées, des pieds à faire envie à plus d’une Européenne. Sur son pelage laineux était jetée une étoffe d’écorce qui la serrait à la ceinture. A son cou pendait la médaille du docteur Johausen, semblable à celle que portait l’enfant.
Converser avec Lo-Maï et La-Maï n’était pas possible, au vif déplaisir de John Cort. Mais il fut visible que ces deux primitifs cherchèrent à remplir tous les devoirs de l’hospitalité wagddienne. Le père offrit quelques fruits qu’il prit sur une tablette, des matofés de pénétrante saveur et qui proviennent d’une liane.
Les hôtes acceptèrent les matofés et en mangèrent quelques-uns, à l’extrême satisfaction de la famille.
Et alors il y eut lieu de reconnaître la justesse de ces remarques faites depuis longtemps déjà: c’est que la langue wagddienne, à l’exemple des langues polynésiennes, offrait des parallélismes frappants avec le babil enfantin, – ce qui a autorisé les philologues à prétendre qu’il y eut pour tout le genre humain une longue période de voyelles antérieurement à la formation des consonnes. Ces voyelles, en se combinant à l’infini, expriment des sens très variés, tels ori oriori, oro oroora, orurna, etc… Les consonnes sont le k, le t, le p, les nasales sont ng et m. Rien qu’avec les voyelles ha, ra, on forme une séné de vocables, lesquels, sans consonances réelles, rendent toutes les nuances d’expression et jouent le rôle des noms, prénoms, verbes, etc.
Dans la conversation de ces Wagddis, les demandes et les réponses étaient brèves, deux ou trois mots, qui commençaient presque tous par les lettres ng, mgou, ms, comme chez les Congolais. La mère paraissait moins loquace que le père et probablement sa langue n’avait pas, ainsi que les langues féminines des deux continents, la faculté de faire douze mille tours à la minute.
A noter aussi – ce dont John Cort fut le plus surpris – que ces primitifs employaient certains termes congolais et allemands, presque défigurés d’ailleurs par la prononciation.
Au total, il est vraisemblable que ces êtres n’avaient d’idées que ce qu’il leur en fallait pour les besoins de l’existence et, de mots, que ce qu’il en fallait pour exprimer ces idées. Mais, à défaut de la religiosité, qui se rencontre chez les sauvages les plus arriérés et qu’ils ne possédaient pas, sans doute, on pouvait tenir pour sûr qu’ils étaient doués de qualités affectives. Non seulement ils avaient pour leurs enfants ces sentiments dont les animaux ne sont pas dépourvus tant que leurs soins sont nécessaires à la conservation de l’espèce, mais ces sentiments se continuaient au-delà, ainsi que le père et la mère le montraient pour Li-Maï. Puis la réciprocité existait. Échange entre eux de caresses paternelles et filiales… La famille existait.
Après un quart d’heure passé à l’intérieur de cette paillote, Khamis, John Cort et Max Huber en sortirent sous la conduite de Lo-Maï et de son enfant. Ils regagnèrent la case où ils avaient été enfermés et qu’ils allaient occuper pendant… Toujours cette question, et peut-être ne s’en rapporterait-on pas à eux seuls pour la résoudre.
Là, on prit congé les uns des autres. Lo-Maï embrassa une dernière fois le jeune indigène et tendit, non point sa patte comme l’eût pu faire un chien, ou sa main comme l’eût pu faire un quadrumane, mais ses deux mains que John Cort et Max Huber serrèrent avec plus de cordialité que Khamis.
«Mon cher Max, dit alors John Cort, un de vos grands écrivains a prétendu que dans tout homme il y avait moi et l’autre… Eh bien, il est probable que l’un des deux manque à ces primitifs…
– Et lequel, John?…
– L’autre, assurément… En tout cas, pour les étudier à fond, il faudrait vivre des années parmi eux!… Or, dans quelques jours, j’espère bien que nous pourrons repartir…
– Cela, répondit Max Huber, dépendra de Sa Majesté, et qui sait si le roi Msélo-Tala-Tala ne veut pas faire de nous des chambellans de la cour wagddienne?»
![]()
Trois semaines d’études
![]() t, maintenant, combien de temps John Cort, Max Huber, Khamis et Llanga resteraient-ils dans ce village?… Un incident viendrait-il modifier une situation qui ne laissait pas d’être inquiétante?… Ils se sentaient très surveillés, ils n’auraient pu s’enfuir. Et, d’ailleurs, à supposer qu’ils parvinssent à s’évader, au milieu de cette impénétrable région de la grande forêt, comment en rejoindre la lisière, comment retrouver le cours du rio Johausen?…
t, maintenant, combien de temps John Cort, Max Huber, Khamis et Llanga resteraient-ils dans ce village?… Un incident viendrait-il modifier une situation qui ne laissait pas d’être inquiétante?… Ils se sentaient très surveillés, ils n’auraient pu s’enfuir. Et, d’ailleurs, à supposer qu’ils parvinssent à s’évader, au milieu de cette impénétrable région de la grande forêt, comment en rejoindre la lisière, comment retrouver le cours du rio Johausen?…
Après avoir tant désiré l’extraordinaire, Max Huber estimait que la situation perdrait singulièrement de son charme à se prolonger. Aussi allait-il se montrer le plus impatient, le plus désireux de revenir vers le bassin de l’Oubanghi, de regagner la factorerie de Libreville, d’où John Cort et lui ne devaient attendre aucun secours.
Pour son compte, le foreloper enrageait de cette malchance qui les avait fait tomber entre les pattes – dans son opinion, c’étaient des pattes – de ces types inférieurs. Il ne dissimulait pas le parfait mépris qu’ils lui inspiraient, parce qu’ils ne se différenciaient pas sensiblement des tribus de l’Afrique centrale. Khamis en éprouvait une sorte de jalousie instinctive, inconsciente, que les deux amis apercevaient très bien. A vrai dire, il était non moins pressé que Max Huber de quitter Ngala, et, tout ce qu’il serait possible de faire à ce propos, il le ferait.
C’était John Cort qui marquait le moins de hâte. Étudier ces primitifs l’intéressait de façon toute spéciale. Approfondir leurs mœurs, leur existence dans tous ses détails, leur caractère ethnologique, leur valeur morale, savoir jusqu’à quel point ils redescendaient vers l’animalité, quelques semaines y eussent suffi. Mais pouvait-on affirmer que le séjour chez les Wagddis ne durerait pas au-delà – des mois, des années peut-être?… Et quelle serait l’issue d’une si étonnante aventure?…
En tout cas, il ne semblait pas que John Cort, Max Huber et Khamis fussent menacés de mauvais traitements. A n’en pas douter, ces sylvestres reconnaissaient leur supériorité intellectuelle. En outre, inexplicable singularité, ils n’avaient jamais paru surpris en voyant des représentants de la race humaine. Toutefois, si ceux-ci voulaient employer la force pour s’enfuir, ils s’exposeraient à des violences que mieux valait éviter.
«Ce qu’il faut, dit Max Huber, c’est entrer en pourparlers avec le père Miroir, le souverain à lunettes, et obtenir de lui qu’il nous rende la liberté.»
En somme, il ne devait pas être impossible d’avoir une entrevue avec S. M. Msélo-Tala-Tala, à moins qu’il ne fût interdit à des étrangers de contempler son auguste personne. Mais, si l’on arrivait en sa présence, comment échanger demandes et réponses?… Même en langue congolaise, on ne se comprendrait pas!… Et puis qu’en résulterait-il?… L’intérêt des Wagddis n’était-il pas, en retenant ces étrangers, de s’assurer le secret de cette existence d’une race inconnue dans les profondeurs de la forêt oubanghienne?
Et pourtant, à en croire John Cort, cet emprisonnement au village aérien avait des circonstances atténuantes, puisque la science de l’anthropologie comparée en retirerait profit, que le monde savant serait ému par cette découverte d’une race nouvelle. Quant à savoir comment cela finirait…
«Du diable, si je le sais!» répétait Max Huber, qui n’avait pas en lui l’étoffe d’un Garner ou d’un Johausen.
Lorsque tous trois, suivis de Llanga, furent rentrés dans leur case, ils remarquèrent plusieurs modifications de nature à les satisfaire.
Et, d’abord, un Wagddi était occupé à «faire la chambre», si l’on peut employer cette locution trop française. Au surplus, John Cort avait déjà noté que ces primitifs avaient des instincts de propreté dont la plupart des animaux sont dépourvus. S’ils faisaient leur chambre, ils faisaient aussi leur toilette. Des brassées d’herbes sèches avaient été déposées au fond de la case. Or, comme Khamis et ses compagnons n’avaient jamais eu d’autre literie depuis la destruction de la caravane, cela ne changerait rien à leurs habitudes.
En outre, divers objets étaient placés à terre, le mobilier ne comprenant ni tables ni chaises, – seulement quelques ustensiles grossiers, pots et jarres de fabrication wagddienne. Ici des fruits de plusieurs sortes, là un quartier d’oryx qui était cuit. La chair crue ne convient qu’aux animaux carnivores, et il est rare de trouver au plus bas degré de l’échelle des êtres dont ce soit invariablement la nourriture.
«Or, quiconque est capable de faire du feu, déclara John Cort, s’en sert pour la cuisson de ses aliments. Je ne m’étonne donc pas que les Wagddis se nourrissent de viande cuite.»
Aussi la case possédait-elle un âtre, composé d’une pierre plate, et la fumée se perdait à travers le branchage du cail-cédrat qui l’abritait.
Au moment où tous quatre arrivèrent devant la porte, le Wagddi suspendit son travail.
C’était un jeune garçon d’une vingtaine d’années, aux mouvements agiles, à la physionomie intelligente. De la main, il désigna les objets qui venaient d’être apportés. Parmi ces objets, Max Huber, John Cort et Khamis – non sans une extrême satisfaction – aperçurent leurs carabines, un peu rouillées, qu’il serait aisé de remettre en état.
«Parbleu, s’écria Max Huber, elles sont les bienvenues… et à l’occasion…
– Nous en ferions usage, ajouté John Cort, si nous avions notre caisse à cartouches…
– La voici», répondit le foreloper.
Et il montra la caisse métallique disposée à gauche près de la porte.
Cette caisse, ces armes, on se le rappelle, Khamis avait eu la présence d’esprit de les lancer sur les roches du barrage, au moment où le radeau venait s’y heurter, et hors de l’atteinte des eaux. C’est là que les Wagddis les trouvèrent pour les rapporter au village de Ngala.
«S’ils nous ont rendu nos carabines, fit observer Max Huber, est-ce qu’ils savent à quoi servent les armes à feu?…
– Je l’ignore, répondit John Cort, mais ce qu’ils savent, c’est qu’il ne faut pas garder ce qui n’est pas à soi, et cela prouve déjà en faveur de leur moralité.»
N’importe, la question de Max Huber ne laissait pas d’être importante.
«Kollo… Kollo!…»
Ce mot, prononcé clairement, retentit à plusieurs reprises, et, en le prononçant, le jeune Wagddi levait la main à la hauteur de son front, puis se touchait la poitrine, semblant dire:
«Kollo… c’est moi!»
John Cort présuma que ce devait être le nom de leur nouveau domestique, et, lorsqu’il l’eut répété cinq ou six fois, Kollo témoigna sa joie par un rire prolongé.
Car ils riaient, ces primitifs, et il y avait lieu d’en tenir compte au point de vue anthropologique. En effet, aucun être ne possède cette faculté, si ce n’est l’homme. Parmi les plus intelligents, – chez le chien par exemple, – si l’on surprend quelques indices du rire ou du sourire, c’est seulement dans les yeux, et peut-être aux commissures des lèvres. En outre, ces Wagddis ne se laissaient point aller à cet instinct, commun à presque tous les quadrupèdes, de flairer leur nourriture avant d’y goûter, de commencer par manger ce qui leur plaît le plus.
Voici donc en quelles conditions allaient vivre les deux amis, Llanga et le foreloper. Cette case n’était pas une prison. Ils en pourraient sortir à leur gré. Quant à quitter Ngala, nul doute qu’ils en seraient empêchés – à moins qu’ils n’eussent obtenu cette autorisation de S. M. Msélo-Tala-Tala.
Donc, nécessité, provisoirement peut-être, de ronger son frein, de se résigner à vivre au milieu de ce singulier monde sylvestre dans le village aérien.
Ces Wagddis semblaient d’ailleurs doux par nature, peu querelleurs, et – il y a lieu d’y insister – moins curieux, moins surpris de la présence de ces étrangers que ne l’eussent été les plus arriérés des sauvages de l’Afrique et de l’Australie. La vue de deux blancs et de deux indigènes congolais ne les étonnait pas autant qu’elle eût étonné un indigène de l’Afrique. Elle les laissait indifférents, et ils ne se montraient point indiscrets. Chez eux aucun symptôme de badaudisme ni de snobisme. Par exemple, en fait d’acrobatie, pour grimper dans les arbres, voltiger de branche en branche, dégringoler l’escalier de Ngala, ils en eussent remontré aux Billy Hayden, aux Joe Bib, aux Foottit, qui détenaient à cette époque le record de la gymnastique circenséenne.
En même temps qu’ils déployaient ces qualités physiques, les Wagddis montraient une extraordinaire justesse de coup d’oeil. Lorsqu’ils se livraient à la chasse des oiseaux, ils les abattaient avec de petites flèches. Leurs coups ne devaient pas être moins assurés quand ils poursuivaient les daims, les élans, les antilopes, et aussi les buffles et les rhinocéros dans les futaies voisines. C’est alors que Max Huber eût voulu les accompagner – autant pour admirer leurs prouesses cynégétiques que pour tenter de leur fausser compagnie.
Oui! s’enfuir, c’est à cela que les prisonniers songent sans cesse. Or, la fuite n’était praticable que par l’unique escalier, et, sur le palier supérieur, se tenaient en faction des guerriers dont il eût été difficile de tromper la surveillance.
Plusieurs fois, Max Huber eut le désir de tirer les volatiles qui abondaient dans les arbres, sou-mangas, tête-chèvres, pintades, huppes, griots, et nombre d’autres, dont ces sylvestres faisaient grande consommation. Mais ses compagnons et lui étaient quotidiennement fournis de gibier, particulièrement de la chair de diverses antilopes, oryx, inyalas, sassabys, waterbucks, si nombreux dans la forêt de l’Oubanghi. Leur serviteur Kollo ne les laissait manquer de rien; il renouvelait chaque jour la provision d’eau fraîche pour les besoins du ménage, et la provision de bois sec pour l’entretien du foyer.
Et puis, à faire usage des carabines comme armes de chasse, il y aurait eu l’inconvénient d’en révéler la puissance. Mieux valait garder ce secret et, le cas échéant, les utiliser comme armes offensives ou défensives.
Si leurs hôtes étaient pourvus de viande, c’est que les Wagddis s’en nourrissaient aussi, tantôt grillée sur des charbons, tantôt bouillie dans les vases de terre fabriques par eux. C’était même ce que Kollo faisait pour leur compte, acceptant d’être aide par Llanga, sinon par Khamis, qui s’y fût refuse dans sa fierté indigène.
Il convient de noter – et cela au vif contentement de Max Huber – que le sel ne faisait plus défaut. Ce n’était pas ce chlorure de sodium qui est tenu en dissolution dans les eaux de la mer, mais ce sel gemme fort répandu en Afrique, en Asie, en Amérique et dont les efflorescences devaient couvrir le sol aux environs de Ngala. Ce minéral, – le seul qui entre dans l’alimentation, – rien que l’instinct eût suffi a en apprendre l’utilité aux Wagddis comme a n’importe quel animal.
Une question qui intéressa John Cort, ce fut la question du feu. Comment ces primitifs l’obtenaient-ils? Était-ce par le frottement d’un morceau de bois dur sur un morceau de bois mou d’après la méthode des sauvages?… Non, ils ne procédaient pas de la sorte, et employaient le silex, dont ils tiraient des étincelles par le choc. Ces étincelles suffisaient à allumer le duvet du fruit du rentenier, très commun dans les forêts africaines, qui jouit de toutes les propriétés de l’amadou.
En outre, la nourriture azotée se complétait, chez les familles wagddiennes, par une nourriture végétale dont la nature faisait seule les frais. C’étaient, d’une part, des racines comestibles de deux ou trois sortes, de l’autre, une grande variété de fruits, tels que ceux que donne l’acacia andansonia, qui porte indifféremment le nom justifie de pain d’homme ou de pain de singe – tel le karita, dont la châtaigne s’emplit d’une matière grasse susceptible de remplacer le beurre, – tel le kijelia, avec ses baies d’une saveur un peu fade, que compense leur qualité nourrissante et aussi leur volume, car elles ne mesurent pas moins de deux pieds de longueur, – tels enfin d’autres fruits, bananes, figues, mangues, a l’état sauvage, et aussi ce tso qui fournit des fruits assez bons, le tout relevé de gousses de tamarin en guise de condiment. Enfin, les Wagddis faisaient également usage du miel, dont ils découvraient les ruches en suivant le coucou indicateur. Et, soit avec ce produit si précieux, soit avec le suc de diverses plantes – entre autres le lutex distillé par une certaine liane – mêlé à l’eau de la rivière, ils composaient des boissons fermentées à haut degré alcoolique. Qu’on ne s’en étonne point; n’a-t-on pas reconnu que les mandrilles d’Afrique, qui ne sont que des singes cependant, ont un faible prononcé pour l’alcool?…
Il faut ajouter qu’un cours d’eau, très poissonneux, qui passait sous Ngala, contenait les mêmes espèces que celles trouvées par Khamis et ses compagnons dans le rio Johausen. Mais était-il navigable, et les Wagddis se servaient-ils d’embarcations?… c’est ce qu’il eût été important de savoir en cas de fuite.
Or, ce cours d’eau était visible de l’extrémité du village opposée à la case royale. En se postant près des derniers arbres, on apercevait son lit, large de trente à quarante pieds. A partir de ce point, il se perdait entre des rangées d’arbres superbes, bombax à cinq tiges, magnifiques mparamousis à tresses noueuses, admirables msoukoulios, dont le tronc s’enrobait de lianes gigantesques, ces épiphytes qui l’étreignaient dans leurs replis de serpents.
Eh bien, oui, les Wagddis savaient construire des embarcations, – un art qui n’est pas ignoré même des derniers naturels de l’Océanie. Leur appareil flottant, c’était plus que le radeau, moins que la pirogue, un simple tronc d’arbre creusé au feu et à la hache. Il se dirigeait avec une pelle plate, et, lorsque la brise soufflait du bon côté, avec une voile tendue sur deux espars et faite d’une écorce assouplie par un battage régulier au moyen de maillets d’un bois de fer extrêmement dur.
Ce que John Cort put constater, toutefois, c’est que ces primitifs ne faisaient point usage des légumes ni des céréales dans leur alimentation. Ils ne savaient cultiver ni sorgho, ni millet, ni riz, ni manioc, – ce qui est de travail ordinaire chez les peuplades de l’Afrique centrale. Mais il ne fallait pas demander à ces types ce qui se rencontrait dans l’industrie agricole des Denkas, des Founds, des Monbouttous, qu’on peut à juste titre classer dans la race humaine.
Enfin, toutes ces observations faites, John Cort s’inquiéta de reconnaître si ces Wagddis avaient en eux le sentiment de la moralité et de la religiosité.
Un jour, Max Huber lui demanda quel était le résultat de ses remarques à ce sujet.
«Une certaine moralité, une certaine probité, ils l’ont, répondit-il. Ils distinguent assurément ce qui est bien de ce qui est mal. Ils possèdent aussi le sentiment de la propriété. Je le sais, nombre d’animaux en sont pourvus, et les chiens, entre autres, ne se laissent pas volontiers prendre ce qu’ils sont en train de manger. Dans mon opinion, les Wagddis ont la notion du tien et du mien. Je l’ai remarqué à propos de l’un d’eux qui avait dérobé quelques fruits dans une case où il venait de s’introduire.
– L’a-t-on cité en simple police ou en police correctionnelle?… demanda Max Huber.
– Riez, cher ami, mais ce que je dis a son importance, et le voleur a été bel et bien battu par le volé, auquel ses voisins ont prêté main-forte. J’ajoute que ces primitifs se recommandent par une institution qui les rapproche de l’humanité…
– Laquelle?…
– La famille, qui est constituée régulièrement chez eux, la vie en commun du père et de la mère, les soins donnés aux enfants, la continuité de l’affection paternelle et filiale. Ne l’avons-nous pas observé chez Lo-Maï?… Ces Wagddis ont même des impressions qui sont d’ordre humain. Voyez notre Kollo… Est-ce qu’il ne rougit pas sous l’action d’une influence morale?… Que ce soit par pudeur, par timidité, par modestie ou par confusion, les quatre éventualités qui amènent la rougeur sur le front de l’homme, il est incontestable que cet effet se produit chez lui. Donc un sentiment…, donc une âme!
– Alors, demanda Max Huber, puisque ces Wagddis possèdent tant de qualités humaines, pourquoi ne pas les admettre dans les rangs de l’humanité!…
– Parce qu’ils semblent manquer d’une conception qui est propre à tous les hommes, mon cher Max.
– Et vous entendez par là?…
– La conception d’un être suprême, en un mot, la religiosité, qui se retrouve chez les plus sauvages tribus. Je n’ai pas constaté qu’ils adorassent des divinités… Ni idoles ni prêtres…
– A moins, répondit Max Huber, que leur divinité ne soit précisément ce roi Msélo-Tala-Tala dont ils ne nous laissent pas voir le bout du nez!…»
C’eût été le cas, sans doute, de tenter une expérience concluante: Ces primitifs résistaient-ils à l’action toxique de l’atropine, à laquelle l’homme succombe alors que les animaux la supportent impunément?… Si oui, c’étaient des bêtes, sinon, c’étaient des humains. Mais l’expérience ne pouvait être faite, faute de ladite substance. Il faut ajouter, en outre, que, durant le séjour de John Cort et de Max Huber à Ngala, il n’y eut aucun décès. La question est donc indécise de savoir si les Wagddis brûlaient ou enterraient les cadavres, et s’ils avaient le culte des morts.
Toutefois, si des prêtres, ou même des sorciers ne se rencontraient pas, au milieu de cette peuplade wagddienne, on y voyait un certain nombre de guerriers, armés d’arcs, de sagaies, d’épieux, de hachettes, – une centaine environ, choisis parmi les plus vigoureux et les mieux bâtis. Étaient-ils uniquement préposés à la garde du roi, ou s’employaient-ils soit à la défensive, soit à l’offensive?… Il se pouvait que la grande forêt renfermât d’autres villages de même nature, de même origine, et, si ces habitants s’y comptaient par milliers, pourquoi n’eussent-ils pas fait la guerre à leurs semblables comme la font les tribus de l’Afrique?
Quant à l’hypothèse que les Wagddis eussent déjà pris contact avec les indigènes de l’Oubanghi, du Baghirmi, du Soudan, ou les Congolais, elle était peu admissible, ni même avec ces tribus de nains, les Bambustis, que le missionnaire anglais Albert Lhyd rencontra dans les forêts de l’Afrique centrale, industrieux cultivateurs dont Stanley a parlé dans le récit de son dernier voyage. Si le contact avait eu lieu, l’existence de ces sylvestres se fût révélée depuis longtemps, et il n’aurait pas été réservé à John Cort et à Max Huber de la découvrir.
«Mais, reprit ce dernier, pour peu que les Wagddis s’entre-tuent, mon cher John, voilà qui permettrait sans conteste de les classer parmi l’espèce humaine.»
Du reste, il était assez probable que les guerriers wagddiens ne s’abandonnaient pas à l’oisiveté et qu’ils organisaient des razzias dans le voisinage. Après des absences qui duraient deux ou trois jours, ils revenaient, quelques-uns blessés, rapportant des objets divers, ustensiles ou armes de fabrication wagddienne.
A plusieurs reprises, des tentatives furent faites par le foreloper pour sortir du village: tentatives infructueuses. Les guerriers qui gardaient l’escalier intervinrent avec une certaine violence. Une fois surtout, Khamis aurait été fort maltraité si Lo-Maï, que la scène attira, ne fût accouru à son secours.
Il y eut, d’ailleurs, forte discussion entre ce dernier et un solide gaillard qu’on nommait Raggi. Au costume de peau qu’il portait, aux armes qui pendaient à sa ceinture, aux plumes qui ornaient sa tête, il y avait lieu de croire que ce Raggi devait être le chef des guerriers. Rien qu’à son air farouche, à ses gestes impérieux, à sa brutalité naturelle, on le sentait fait pour le commandement.
A la suite de ces tentatives, les deux amis avaient espéré qu’ils seraient envoyés devant Sa Majesté, et qu’ils verraient enfin ce roi que ses sujets cachaient avec un soin jaloux au fond de la demeure royale… Ils en furent pour leur espoir. Probablement, Raggi avait toute autorité, et mieux valait ne point s’exposer à sa colère en recommençant. Les chances d’évasion étaient donc bien réduites, à moins que les Wagddis, s’ils attaquaient quelque village voisin, ne fussent attaqués à leur tour, et, à la faveur d’une agression, que l’occasion ne s’offrît de quitter Ngala… Mais après, que devenir?
Au surplus, le village ne fut point menacé pendant ces premières semaines, si ce n’est par certains animaux que Khamis et ses compagnons n’avaient pas encore rencontrés dans la grande forêt. Si les Wagddis passaient leur existence à Ngala, s’ils y rentraient la nuit venue, ils possédaient cependant quelques huttes sur les bords du rio. On eût dit d’un petit port fluvial où se réunissaient les embarcations de pêche, qu’ils avaient à défendre contre les hippopotames, les lamantins, les crocodiles, en assez grand nombre dans les eaux africaines.
Un jour, à la date du 9 avril, un violent tumulte se produisit. Des cris retentissaient dans la direction du rio. Était-ce une attaque dirigée contre les Wagddis par des êtres semblables à eux!… Sans doute, grâce à sa situation, le village était à l’abri d’une invasion. Mais, à supposer que le feu fût mis aux arbres qui le soutenaient, sa destruction eût été l’affaire de quelques heures. Or, les moyens que ces primitifs avaient peut-être employés contre leurs voisins, il n’était pas impossible que ceux-ci essayassent de les employer contre eux.
Dès les premières clameurs, Raggi et une trentaine de guerriers, se portant vers l’escalier, descendirent avec une rapidité simiesque. John Cort, Max Huber et Khamis, guidés par Lo-Maï, gagnèrent le côté du village d’où l’on apercevait le cours d’eau.
C’était une invasion contre les huttes établies en cet endroit. Une bande, non pas d’hippopotames, mais de chéropotames ou plutôt de potamochères, qui sont plus particulièrement les cochons de fleuve, venaient de s’élancer hors de la futaie et brisaient tout sur leur passage.
Ces potamochères, que les Boers appellent bosch-wark, et les Anglais bush-pigs, se rencontrent dans la région du cap de Bonne-Espérance, en Guinée, au Congo, au Cameroun, et y causent de grands dommages. De moindre taille que le sanglier européen, ils ont le pelage plus soyeux, la robe brunâtre tirant sur l’orange, les oreilles pointues terminées par un pinceau de poils, la crinière noire mêlée de fils blancs, qui leur court le long de l’échine, le grouin développé, la peau soulevée entre le nez et l’œil par une protubérance osseuse chez les mâles. Ces porcins sont redoutables, et ceux-ci l’étaient d’autant plus qu’ils se trouvaient dans des conditions de supériorité numérique.
En effet, ce jour-là, on en eût bien compté une centaine qui se précipitaient sur la rive gauche du rio. Aussi la plupart des huttes avaient-elles été déjà renversées, avant l’arrivée de Raggi et de sa troupe.
A travers les branches des derniers arbres, John Cort, Max Huber, Khamis et Llanga purent être témoins de la lutte. Elle fut courte, mais non sans danger. Les guerriers y déployèrent un grand courage. Se servant des épieux et des hachettes de préférence aux arcs et aux sagaies, ils foncèrent avec une ardeur qui égalait la fureur des assaillants. Ils les attaquèrent corps à corps, les frappant à la tête à coups de hache, leur trouant les flancs de leurs épieux. Bref, après une heure de combat, ces animaux étaient en fuite, et des ruisseaux de sang se mêlaient aux eaux de la petite rivière.
Max Huber avait bien eu la pensée de prendre part à la bataille. Rapporter sa carabine et celle de John Cort, les décharger du haut du village sur la bande, accabler d’une grêle de balles ces potamochères, à l’extrême surprise des Wagddis, ce n’eût été ni long ni difficile. Mais le sage John Cort, appuyé du foreloper, calma son bouillant ami.
«Non, lui dit-il, réservons-nous d’intervenir dans des circonstances plus décisives… Quand on dispose de la foudre, mon cher Max…
– Vous avez raison, John, il ne faut foudroyer qu’au bon moment… Et, puisqu’il n’est pas encore temps de tonner, remisons notre tonnerre!»
![]()
Sa Majesté Msélo-Tala-Tala
![]() ette journée – ou plutôt cet après-midi du 15 avril – allait amener une dérogation aux habitudes si calmes des Wagddis. Depuis trois semaines, aucune occasion ne s’était offerte aux prisonniers de Ngala de reprendre à travers la grande forêt le chemin de l’Oubanghi. Surveillés de près, enfermés dans les limites infranchissables de ce village, ils ne pouvaient s’enfuir. Certes, il leur avait été loisible – et plus particulièrement à John Cort – d’étudier les mœurs de ces types placés entre l’anthropoïde le plus perfectionné et l’homme, d’observer par quels instincts ils tenaient à l’animalité, par quelle dose de raison ils se rapprochaient de la race humaine. C’était là tout un trésor de remarques à verser dans la discussion des théories darwiniennes. Mais, pour en faire bénéficier le monde savant, encore fallait-il regagner les routes du Congo français et rentrer à Libreville…
ette journée – ou plutôt cet après-midi du 15 avril – allait amener une dérogation aux habitudes si calmes des Wagddis. Depuis trois semaines, aucune occasion ne s’était offerte aux prisonniers de Ngala de reprendre à travers la grande forêt le chemin de l’Oubanghi. Surveillés de près, enfermés dans les limites infranchissables de ce village, ils ne pouvaient s’enfuir. Certes, il leur avait été loisible – et plus particulièrement à John Cort – d’étudier les mœurs de ces types placés entre l’anthropoïde le plus perfectionné et l’homme, d’observer par quels instincts ils tenaient à l’animalité, par quelle dose de raison ils se rapprochaient de la race humaine. C’était là tout un trésor de remarques à verser dans la discussion des théories darwiniennes. Mais, pour en faire bénéficier le monde savant, encore fallait-il regagner les routes du Congo français et rentrer à Libreville…
Le temps était magnifique. Un puissant soleil inondait de chaleur et de clarté les cimes qui ombrageaient le village aérien. Après avoir presque atteint le zénith à l’heure de sa culmination, l’obliquité de ses rayons, bien qu’il fût trois heures passées, n’en diminuait pas l’ardeur.
Les rapports de John Cort et de Max Huber avec les Mai avaient été fréquents. Pas un jour ne s’était écoulé sans que cette famille ne fût venue dans leur case ou qu’ils ne se fussent rendus dans la leur. Un véritable échange de visites! Il n’y manquait que les cartes! Quant au petit, il ne quittait guère Llanga et s’était pris d’une vive affection pour le jeune indigène.
Par malheur, il y avait toujours impossibilité de comprendre la langue wagddienne, réduite à un petit nombre de mots qui suffisaient au petit nombre d’idées de ces primitifs. Si John Cort avait pu retenir la signification de quelques-uns, cela ne lui permettait guère de converser avec les habitants de Ngala. Ce qui le surprenait toujours, c’était que diverses locutions indigènes figuraient dans le vocabulaire wagddien – une douzaine peut-être. Cela n’indiquait-il pas que les Wagddis avaient eu des rapports avec les tribus de l’Oubanghi, – ne fût-ce qu’un Congolais qui ne serait jamais revenu au Congo?… Hypothèse assez plausible, on en conviendra. Et puis, quelque mot d’origine allemande s’échappait parfois des lèvres de Lo-Maï, toujours si incorrectement prononcé qu’on avait peine à le reconnaître.
Or, c’était la un point que John Cort tenait pour absolument inexplicable. En effet, à supposer que les indigènes et les Wagddis se fussent rencontres déjà, était-il admissible que ces derniers eussent eu des relations avec les Allemands du Cameroun? Dans ce cas, l’Américain et le Français n’auraient pas eu les prémices de cette découverte. Bien que John Cort parlât assez couramment la langue allemande, il n’avait jamais eu l’occasion de s’en servir, puisque Lo-Maï n’en connaissait que deux ou trois mots.
Entre autres locutions empruntées aux indigènes, celle de Msélo-Tala-Tala, qui s’appliquait au souverain de cette tribu, était le plus souvent employée. On sait quel désir d’être reçus par cette Majesté invisible éprouvaient les deux amis Il est vrai, toutes les fois qu’ils prononçaient ce nom, Lo-Maï baissait la tête en marque de profond respect. En outre, lorsque leur promenade les amenait devant la case royale, s’ils manifestaient l’intention d’y pénétrer, Lo-Maï les arrêtait, les poussait de côte, les entraînait a droite ou a gauche. Il leur faisait comprendre à sa manière que nul n’avait le droit de franchir le seuil de la demeure sacrée.
Or, il arriva que, dans cet après-midi, un peu avant trois heures, le ngoro, la ngora et le petit vinrent trouver Khamis et ses compagnons.
Et, tout d’abord, il y eut a remarquer que la famille s’était parée de ses plus beaux vêtements – le père, coiffe d’un couvre-chef a plumes et drapé dans son manteau d’écorce, – la mère, enjuponnée de cette étoffe d’agoulie de fabrication wagddienne, quelques feuilles vertes dans les cheveux, au cou un chapelet de verroteries et de menues ferrailles – l’enfant, un léger pagne ceint à sa taille – «ses habits du dimanche», dit Max Huber.
Et, en les voyant si «endimanchés» tous trois:
«Qu’est-ce que cela signifie?… s’écria-t-il. Ont-ils eu la pensée de nous faire une visite officielle?…
– C’est sans doute jour de fête, répondit John Cort. S’agit-il donc de rendre hommage à un dieu quelconque? Ce serait le point intéressant qui résoudrait la question de religiosité»
Avant qu’il eût achevé sa phrase, Lo-Maï venait de prononcer comme une réponse:
«Msélo-Tala-Tala…
– Le père aux lunettes!» traduisit Max Huber.
Et il sortit de la case avec l’idée que le roi des Wagddis passait en ce moment.
Complète désillusion! Max Huber n’entrevit pas même l’ombre de Sa Majesté! Toutefois, il fallut bien constater que Ngala était en mouvement. De toutes parts affluait une foule aussi joyeuse, aussi parée que la famille Maï. Grand concours de populaire, les uns suivant processionnellement les rues vers l’extrémité ouest du village, ceux-ci se tenant par la main comme des paysans en goguette, ceux-là cabriolant comme des singes d’un arbre a l’autre.
«Il y a quelque chose de nouveau…, déclara John Cort en s’arrêtant sur le seuil de la case.
– On va voir», répliqua Max Huber.
Et, revenant à Lo-Maï:
«Msélo-Tala-Tala?… répéta-t-il.
– Msélo-Tala-Tala!» répondit Lo-Maï en croisant ses bras, tandis qu’il inclinait la tête.
John Cort et Max Huber furent conduits à penser que la population wagddienne allait saluer son souverain, lequel ne tarderait pas à apparaître dans toute sa gloire.
Eux, John Cort, Max Huber, n’avaient pas d’habits de cérémonie à mettre. Ils en étaient réduits à leur unique costume de chasse, bien usé, bien sali, à leur linge qu’ils tenaient aussi propre que possible. Par conséquent, aucune toilette à faire en l’honneur de Sa Majesté, et, comme la famille Mai sortait de la case, ils la suivirent avec Llanga.
Quant à Khamis, peu soucieux de se mêler à tout ce monde inférieur, il «resta seul à la maison». Il s’occupa de ranger les ustensiles, de veiller à la préparation du repas, de nettoyer les armes à feu. Ne convenait-il pas d’être prêt à toute éventualité, et l’heure approchait peut-être où il serait nécessaire d’en faire usage.
John Cort et Max Huber se laissèrent donc guider par Lo-Maï à travers le village plein d’animation. Il n’existait pas de rues, au vrai sens de ce mot. Les paillotes, distribuées à la fantaisie de chacun, se conformaient à la disposition des arbres ou plutôt des cimes qui les abritaient. La foule était assez compacte. Au moins un millier de Wagddis se dirigeaient maintenant vers la partie de Ngala à l’extrémité de laquelle s’élevait la case royale.
«Il est impossible de ressembler davantage à une foule humaine!… remarqua John Cort. Mêmes mouvements, même manière de témoigner sa satisfaction par les gestes, par les cris…
– Et par les grimaces, ajouta Max Huber, et c’est ce qui rattache ces êtres bizarres aux quadrumanes!»
En effet, les Wagddis, d’ordinaire sérieux, réservés, peu communicatifs, ne s’étaient jamais montrés si expansifs ni si grimaçants. Et toujours cette inexplicable indifférence envers les étrangers, auxquels ils ne semblaient prêter aucune attention – attention qui eût été gênante et obsédante chez les Denkas, les Monbouttous et autres peuplades africaines.
Cela n’était pas très «humain»!
Après une longue promenade, Max Huber et John Cort arrivèrent sur la place principale, que bornaient les ramures des derniers arbres du côté de l’ouest, et dont les branches verdoyantes retombaient autour du palais royal. En avant étaient rangés les guerriers, toutes armes dehors, vêtus de peaux d’antilope rattachées par de fines lianes, le chef coiffé de têtes de steinbock dont les cornes leur donnaient l’apparence d’un troupeau. Quant au «colonel» Raggi, casqué d’une tête de buffle, l’arc sur l’épaule, la hachette à la ceinture, l’épieu à la main, il paradait devant l’armée wagddienne.
«Probablement, dit John Cort, le souverain s’apprête à passer la revue de ses troupes…
– Et, s’il ne vient pas, repartit Max Huber, c’est qu’il ne se laisse jamais voir à ses fidèles sujets!… On ne se figure pas ce que l’invisibilité donne de prestige à un monarque, et peut-être celui-ci…»
S’adressant à Lo-Maï, dont il se fit comprendre par un geste:
«Msélo-Tala-Tala doit-il sortir?…»
Signe affirmatif de Lo-Maï, qui sembla dire:
«Plus tard… plus tard…
– Peu importe, répliqua Max Huber, pourvu qu’il nous soit permis de contempler enfin sa face auguste…
– Et, en attendant, répondit John Cort, ne perdons rien de ce spectacle.»
Voici ce que tous deux furent à même d’observer alors de plus curieux:
Le centre de la place entièrement dégagé d’arbres, restait libre sur un espace d’un demi-hectare. La foule l’emplissait dans le but, sans doute, de prendre part à la fête jusqu’au moment où le souverain paraîtrait au seuil de son palais. Se prosternerait-elle alors devant lui?… Se confondrait-elle en adorations!…
«Après tout, fit remarquer John Cort, il n’y aurait pas à tenir compte de ces adorations au point de vue de la religiosité, car, en somme, elles ne s’adresseraient qu’à un homme…
– A moins, répliqua Max Huber, que cet homme ne soit en bois ou en pierre… Si ce potentat n’est qu’une idole du genre de celles que révèrent les naturels de la Polynésie…
– Dans ce cas, mon cher Max, il ne manquerait plus rien aux habitants de Ngala de ce qui complète l’être humain… Ils auraient le droit d’être classés parmi les hommes tout autant que ces naturels dont vous parlez…
– En admettant que ceux-ci le méritent! répondit Max Huber, d’un ton assez peu flatteur pour la race polynésienne.
– Certes, Max, puisqu’ils croient à l’existence d’une divinité quelconque, et jamais il n’est venu ni ne viendra à personne l’idée de les classer parmi les animaux, fût-ce même ceux qui occupent le premier rang dans l’animalité!»
Grâce à la famille de Lo-Maï, Max Huber, John Cort et Llanga purent se placer de manière à tout voir.
Lorsque la foule eut laissé libre le centre de la place, les jeunes Wagddis des deux sexes se mirent en danse, tandis que les plus âgés commençaient à boire, comme les héros d’une kermesse hollandaise.
Ce que ces sylvestres absorbaient, c’étaient des boissons fermentées et pimentées tirées des gousses du tamarin. Et elles devaient être extrêmement alcooliques, car les têtes ne tardèrent pas à s’échauffer et les jambes à tituber d’une façon inquiétante.
Ces danses ne rappelaient en rien les nobles figures du passe-pied ou du menuet, sans aller cependant jusqu’au paroxysme des déhanchements et des grands écarts en honneur dans les bals-musettes des banlieues parisiennes. Au total, il se faisait plus de grimaces que de contorsions, et aussi plus de culbutes. En un mot, dans ces attitudes chorégraphiques, on retrouvait moins l’homme que le singe. Et, qu’on l’entende bien, non point le singe éduqué pour les exhibitions de la foire, non… le singe livré à ses instincts naturels.
En outre, les danses ne s’exécutaient pas avec accompagnement des clameurs publiques. C’était au son d’instruments des plus rudimentaires, calebasses tendues d’une peau sonore et frappées à coups redoublés, tiges creuses, taillées en sifflet, dans lesquelles une douzaine de vigoureux exécutants soufflaient à se crever les poumons. Non!… jamais charivari plus assourdissant ne déchira des oreilles de blancs!
«Ils ne paraissent pas avoir le sentiment de la mesure…, remarqua John Cort.
– Pas plus que celui de la tonalité, répondit Max Huber.
– En somme, ils sont sensibles à la musique, mon cher Max.
– Et les animaux le sont aussi, mon cher John, – quelques-uns, du moins. A mon avis, la musique est un art inférieur qui s’adresse à un sens inférieur. Au contraire, qu’il s’agisse de peinture, de sculpture, de littérature, aucun animal n’en subit le charme, et on n’a jamais vu même les plus intelligents se montrer émus devant un tableau ou à l’audition d’une tirade de poète!»
Quoi qu’il en soit, les Wagddis se rapprochaient de l’homme, non seulement parce qu’ils ressentaient les effets de la musique, mais parce qu’ils mettaient eux-mêmes cet art en pratique.
Deux heures se passèrent ainsi, à l’extrême impatience de Max Huber. Ce qui l’enrageait, c’est que S. M. Msélo-Tala-Tala ne daignait pas se déranger pour recevoir l’hommage de ses sujets.
Cependant la fête continuait avec redoublement de cris et de danses. Les boissons provoquaient aux violences de l’ivresse, et c’était a se demander quelles scènes de désordre menaçaient de s’ensuivre, lorsque, soudain, le tumulte prit fin.
Chacun se calma, s’accroupit, s’immobilisa. Un silence absolu succéda aux bruyantes démonstrations, au fracas assourdissant des tam-tams, au sifflet suraigu des flûtes.
A ce moment, la porte de la demeure royale s’ouvrit, et les guerriers formèrent la haie de chaque côté.
«Enfin! dit Max Huber, nous allons donc le voir, ce souverain de sylvestres.»
Ce ne fut point Sa Majesté qui sortit de la case. Une sorte de meuble, recouvert d’un tapis de feuillage, fut apporté au milieu de la place. Et quelle fut la bien naturelle surprise des deux amis, lorsqu’ils reconnurent dans ce meuble un vulgaire orgue de Barbarie!… Très probablement, cet instrument sacré ne figurait que dans les grandes cérémonies de Ngala, et les Wagddis en écoutaient sans doute les airs plus ou moins variés avec un ravissement de dilettantes!
«Mais c’est l’orgue du docteur Johausen! dit John Cort.
– Ce ne peut être que cette mécanique antédiluvienne, répliqua Max Huber. Et, à présent, je m’explique comment, dans la nuit de notre arrivée sous le village de Ngala, j’ai eu la vague impression d’entendre l’impitoyable valse du Freyschütz au-dessus de ma tête!
– Et vous ne nous avez rien dit de cela, Max?…
– J’ai cru que j’avais rêvé, John.
– Quant à cet orgue, ajouta John Cort, ce sont certainement les Wagddis qui l’ont rapporté de la case du docteur.
– Et après avoir mis à mal ce pauvre homme!» ajouta Max Huber.
Un superbe Wagddi – évidemment le chef d’orchestre de l’endroit – vint se poser devant l’instrument et commença à tourner la manivelle.
Aussitôt la valse en question, à laquelle manquaient bien quelques notes, de se dévider au très réel plaisir de l’assistance.
C’était un concert qui succédait aux exercices chorégraphiques. Les auditeurs l’écoutèrent en hochant la tête, – à contre-mesure, il est vrai. De fait, il ne semblait pas qu’ils subissent cette impression giratoire qu’une valse communique aux civilisés de l’ancien et du nouveau monde.
Et, gravement, comme pénétré de l’importance de ses fonctions, le Wagddi manœuvrait toujours sa boîte à musique.
Mais, à Ngala, savait-on que l’orgue renfermât d’autres airs?… C’est ce que se demandait John Cort. En effet, le hasard n’aurait pu faire découvrir à ces primitifs par quel procédé, en poussant un bouton, on remplaçait le motif de Weber par un autre.
Quoi qu’il en soit, après une demi-heure consacrée à la valse du Freyschütz, voici que l’exécutant poussa un ressort latéral, ainsi que l’eût fait un joueur des rues de l’instrument suspendu par sa bretelle.
«Ah! par exemple… c’est trop fort, cela!…» s’écria Max Huber.
Trop fort, en vérité, à moins que quelqu’un n’eût appris à ces sylvestres le secret du mécanisme, et comment on pouvait tirer de ce meuble barbaresque toutes les mélodies renfermées dans son sein!…
Puis la manivelle se remit aussitôt en mouvement.
Et alors à l’air allemand succéda un air français, l’un des plus populaires, la plaintive chanson de la Grâce de Dieu.
On connaît ce «chef-d’œuvre» de Loïsa Puget. Personne n’ignore que le couplet se déroule en la mineur pendant seize mesures, et que le refrain reprend en la majeur, suivant toutes les traditions de l’art à cette époque.
«Ah! le malheureux!… Ah! le misérable!… hurla Max Huber, dont les exclamations provoquèrent les murmures très significatifs de l’assistance.
– Quel misérable?… demanda John Cort. Celui qui joue de l’orgue?…
– Non! celui qui l’a fabriqué!… Pour économiser les notes, il n’a fourré dans sa boîte ni les ut ni les sol dièzes!… Et ce refrain qui devrait être joué en la majeur:
Va, mon enfant, adieu,
A la grâce de Dieu…
voilà qu’on le joue en ut majeur!
– Ça… c’est un crime!… déclara en riant John Cort.
– Et ces barbares qui ne s’en aperçoivent point… qui ne bondissent pas comme devrait bondir tout être doué d’une oreille humaine!…»
Non! cette abomination, les Wagddis n’en ressentaient pas toute l’horreur!… Ils acceptaient cette criminelle substitution d’un mode à l’autre!… S’ils n’applaudissaient pas, bien qu’ils eussent d’énormes mains de claqueurs, leur attitude n’en décelait pas moins une profonde extase!
«Rien que cela, dit Max Huber, mérite qu’on les ramène au rang des bêtes!»
Il y eut lieu de croire que cet orgue ne contenait pas d’autres motifs que la valse allemande et la chanson française. Invariablement elles se remplacèrent une demi-heure durant. Les autres airs étaient vraisemblablement détraqués. Par bonheur, l’instrument, possédant les notes voulues en ce qui concernait la valse, ne donnait pas à Max Huber les nausées que lui avait fait éprouver le couplet de la romance.
Lorsque ce concert fut achevé, les danses reprirent de plus belle, les boissons coulèrent plus abondantes que jamais à travers les gosiers wagddiens. Le soleil venait de s’abaisser derrière les cimes du couchant, et quelques torches s’allumaient entre les ramures, de manière à illuminer la place que le court crépuscule allait bientôt plonger dans l’ombre.
Max Huber et John Cort en avaient assez, et ils songeaient à regagner leur case, lorsque Lo-Maï prononça ce nom:
«Msélo-Tala-Tala.»
Était-ce vrai?… Sa Majesté allait-elle venir recevoir les adorations de son peuple?… Daignait-elle enfin sortir de sa divine invisibilité?… John Cort et Max Huber se gardèrent bien de partir.
En effet, un mouvement se faisait du côté de la case royale, auquel répondit une sourde rumeur de l’assistance. La porte s’ouvrit, une escorte de guerriers se forma, et le chef Raggi prit la tête du cortège.
Presque aussitôt apparut un trône, – un vieux divan drapé d’étoffes et de feuillage, – soutenu par quatre porteurs, et sur lequel se pavanait Sa Majesté.
C’était un personnage d’une soixantaine d’années, couronné de verdure, la chevelure et la barbe blanches, d’une corpulence considérable, et dont le poids devait être lourd aux robustes épaules de ses serviteurs.
Le cortège se mit en marche, de manière à faire le tour de la place.
La foule se courbait jusqu’à terre, silencieuse, comme hypnotisée par l’auguste présence de Msélo-Tala-Tala.
Le souverain semblait fort indifférent, d’ailleurs, aux hommages qu’il recevait, qui lui étaient dus, dont il avait probablement l’habitude. A peine s’il daignait remuer la tête en signe de satisfaction. Pas un geste, si ce n’est à deux ou trois reprises pour se gratter le nez, – un long nez que surmontaient de grosses lunettes, – ce qui justifiait son surnom de «Père Miroir».
Les deux amis le regardèrent avec une extrême attention, lorsqu’il passa devant eux.
«Mais… c’est un homme!… affirma John Cort.
– Un homme?… répliqua Max Huber.
– Oui… un homme… et… qui plus est… un blanc!…
– Un blanc?…»
Oui, à n’en pas douter, ce qu’on promenait là sur sa sedia gestatoria, c’était un être différent de ces Wagddis sur lesquels il régnait, et non point un indigène des tribus du haut Oubanghi… Impossible de s’y tromper, c’était un blanc, un représentant qualifié de la race humaine!…
«Et notre présence ne produit aucun effet sur lui, dit Max Huber, et il ne semble même pas nous apercevoir!… Que diable! nous ne ressemblons pourtant pas à ces demi-singes de Ngala, et, pour avoir vécu parmi eux depuis trois semaines, nous n’avons pas encore perdu, j’imagine, figure d’hommes!…»
Et il fut sur le point de crier:
«Hé!… monsieur… là-bas… faites-nous donc l’honneur de regarder…»
A cet instant, John Cort lui saisit le bras et, d’une voix qui dénotait le comble de la surprise:
«Je le reconnais… dit-il.
– Vous le reconnaissez?
– Oui!… C’est le docteur Johausen!»
![]()
En quel état était le docteur Johausen!
![]() ohn Cort avait autrefois rencontré le docteur Johausen à Libreville. Il ne pouvait faire erreur: c’était bien ledit docteur qui régnait sur cette peuplade wagddienne!
ohn Cort avait autrefois rencontré le docteur Johausen à Libreville. Il ne pouvait faire erreur: c’était bien ledit docteur qui régnait sur cette peuplade wagddienne!
Son histoire, rien de plus aisé que d’en résumer le début en quelques lignes, et même de la reconstituer tout entière. Les faits s’enchaînaient sans interruption sur cette route qui allait de la cage forestière au village de Ngala.
Trois ans avant, cet Allemand, désireux de reprendre la tentative peu sérieuse et, dans tous les cas, avortée du professeur Garner, quitta Malinba avec une escorte de noirs, emportant un matériel, des munitions et des vivres pour un assez long temps. Ce qu’il voulait faire dans l’est du Cameroun, on ne l’ignorait pas. Il avait formé l’invraisemblable projet de s’établir au milieu des singes afin d’étudier leur langage. Mais de quel côté il comptait se diriger, il ne l’avait confié à personne, étant très original, très maniaque et, pour employer un mot dont les Français se servent fréquemment, à demi toqué.
Les découvertes de Khamis et de ses compagnons pendant leur voyage de retour prouvaient indubitablement que le docteur avait atteint dans la forêt l’endroit où coulait le rio baptisé de son nom par Max Huber. Il avait construit un radeau et, après avoir renvoyé son escorte, s’y était embarqué avec un indigène demeuré à son service. Puis, tous deux descendirent la rivière jusqu’au marécage à l’extrémité duquel fut établie la cabane treillagée sous le couvert des arbres de la rive droite.
Là s’arrêtaient les données certaines relatives aux aventures du docteur Johausen. Quant à ce qui avait suivi, les hypothèses se changeaient maintenant en certitudes.
On se souvient que Khamis, en fouillant la cage vide alors, avait mis la main sur une petite boîte de cuivre qui renfermait un carnet de notes. Or, ces notes se réduisaient à quelques lignes tracées au crayon, à diverses dates, depuis celle du 27 juillet 1894 jusqu’à celle du 24 août de la même année.
Il était donc démontré que le docteur avait débarqué le 29 juillet, achevé son installation le 13 août, habité sa cage jusqu’au 25 du même mois, soit, au total, treize jours pleins.
Pourquoi l’avait-il abandonnée?… Était-ce de son propre gré?… Évidemment, non. Que les Wagddis s’avançassent parfois jusqu’aux rives du rio, Khamis, John Cort et Max Huber savaient à quoi s’en tenir à cet égard. Ces feux qui illuminaient la lisière de la forêt à l’arrivée de la caravane, n’étaient-ce pas eux qui les promenaient d’arbre en arbre?… De là cette conclusion que ces primitifs découvrirent la cabane du professeur, qu’ils s’emparèrent de sa personne et de son matériel, que le tout fut transporté au village aérien.
Quant au serviteur indigène, il s’était enfui sans doute à travers la forêt. S’il eût été conduit à Ngala, John Cort, Max Huber, Khamis l’eussent déjà rencontré, lui qui n’était pas roi et qui n’habitait point la case royale. D’ailleurs, il aurait figuré dans la cérémonie de ce jour auprès de son maître en qualité de dignitaire, et pourquoi pas de premier ministre?…
Ainsi, les Wagddis n’avaient pas traité le docteur Johausen plus mal que Khamis et ses compagnons. Très probablement frappés de sa supériorité intellectuelle, ils en avaient fait leur souverain, – ce qui eût pu arriver à John Cort ou à Max Huber, si la place n’eût été prise. Donc, depuis trois ans, le docteur Johausen, le père Miroir – c’est lui qui avait dû apprendre cette locution à ses sujets – occupait le trône wagddien sous le nom de Msélo-Tala-Tala.
Cela expliquait nombre de choses jusqu’alors assez inexplicables: comment plusieurs mots de la langue congolaise figuraient dans le langage de ces primitifs, et aussi deux ou trois mots de la langue allemande, comment le maniement de l’orgue de Barbarie leur était familier, comment ils connaissaient la fabrication de certains ustensiles, comment un certain progrès s’était peut-être étendu aux mœurs de ces types placés au premier degré de l’échelle humaine.
Voilà ce que se dirent les deux amis lorsqu’ils eurent réintégré leur case.
Aussitôt Khamis fut mis au courant.
«Ce que je ne puis m’expliquer, ajouta Max Huber, c’est que le docteur Johausen ne se soit point inquiété de la présence d’étrangers dans sa capitale… Comment? il ne nous a point fait comparaître devant lui… et il ne semble même pas s’être aperçu, pendant la cérémonie, que nous ne ressemblions pas à ses sujets!… Oh! mais, pas du tout!…
– Je suis de votre avis, Max, répondit John Cort, et il m’est impossible de comprendre pourquoi Msélo-Tala-Tala ne nous a pas encore mandés à son palais…
– Peut-être ignore-t-il que les Wagddis ont fait des prisonniers dans cette partie de la forêt?… observa le foreloper.
– C’est possible, mais c’est au moins singulier, déclara John Cort. Il y a là quelque circonstance qui m’échappe et qu’il faudra éclaircir…
– De quelle façon?… demanda Max Huber.
– En cherchant bien, nous y parviendrons!…» répondit John Cort.
De tout ceci il résultait que le docteur Johausen, venu dans la forêt de l’Oubanghi afin de vivre parmi les singes, était entre les mains d’une race supérieure à l’anthropoïde et dont on ne soupçonnait pas l’existence. Il n’avait pas eu la peine de leur apprendre à parler, puisqu’ils parlaient; il s’était borné à leur enseigner quelques mots de la langue congolaise et de la langue allemande. Puis, en leur donnant ses soins comme docteur, sans doute, il avait dû acquérir une certaine popularité qui l’avait porté au trône!… Et, à vrai dire, John Cort n’avait-il pas déjà constaté que les habitants de Ngala jouissaient d’une santé excellente, qu’on n’y comptait pas un malade et, ainsi que cela a été dit, que pas un Wagddi n’était décédé depuis l’arrivée des étrangers à Ngala?
Ce qu’il y avait lieu d’admettre, en tout cas, c’est que, bien qu’il y eût un médecin dans ce village, – un médecin dont on avait fait un roi, – il ne semblait pas que la mortalité s’y fût accrue. Réflexion quelque peu irrévérencieuse pour la Faculté, et que se permit Max Huber.
Et, maintenant quel parti prendre?… La situation du docteur Johausen à Ngala ne devait-elle pas modifier la situation des prisonniers?… Ce souverain de race teutonne hésiterait-il à leur rendre la liberté, s’ils paraissaient devant lui et lui demandaient de les renvoyer au Congo?…
«Je ne puis le croire, dit Max Huber, et notre conduite est toute tracée… Il est très possible que notre présence ait été cachée à ce docteur-roi… J’admets même, quoique ce soit assez invraisemblable, que pendant la cérémonie il ne nous ait pas remarqués au milieu de la foule… Eh bien, raison de plus pour pénétrer dans la case royale…
– Quand?… demanda John Cort.
– Dès ce soir, et, puisque c’est un souverain adoré de son peuple, son peuple lui obéira, et, lorsqu’il nous aura rendu la liberté, on nous reconduira jusqu’à la frontière avec les honneurs dus aux semblables de Sa Majesté wagddienne.
– Et s’il refuse?…
– Pourquoi refuserait-il?…
– Sait-on, mon cher Max?… répondit John en riant. Des raisons diplomatiques, peut-être!…
– Eh bien, s’il refuse, s’écria Max Huber, je lui dirai qu’il était tout au plus digne de régner sur les plus inférieurs des macaques et qu’il est au-dessous du dernier de ses sujets!»
En somme, débarrassée de ses agréments fantaisistes, la proposition valait la peine d’être prise en considération.
L’occasion était propice, d’ailleurs. Si la nuit allait interrompre la fête, ce qui se prolongerait, à n’en pas douter, c’était l’état d’ébriété dans lequel se trouvait la population du village… Ne fallait-il pas profiter de cette circonstance, qui ne se renouvellerait peut-être pas de longtemps?… De ces Wagddis à demi ivres, les uns seraient endormis dans leurs paillotes, les autres dispersés à travers les profondeurs de la forêt… Les guerriers eux-mêmes n’avaient pas craint de déshonorer leur uniforme en buvant à perdre la tête… La demeure royale serait moins sévèrement gardée, et il ne devait pas être difficile d’arriver jusqu’à la chambre de Msélo-Tala-Tala…
Ce projet ayant eu l’approbation de Khamis, toujours de bon conseil, on attendit que la nuit fût close et l’ivresse plus complète dans le village. Il va de soi que Kollo, autorisé à se joindre au festival, n’était pas rentré.
Vers neuf heures, Max Huber, John Cort, Llanga et le foreloper sortirent de leur case.
Ngala était sombre, étant dépourvue de tout éclairage municipal. Les dernières lueurs des torches résineuses, disposées dans les arbres, venaient de s’éteindre. Au loin, comme au-dessous de Ngala, se propageaient des rumeurs confuses, du côté opposé à l’habitation du docteur Johausen.
John Cort, Max Huber et Khamis, prévoyant le cas où il leur serait possible de fuir ce soir même avec ou sans l’agrément de Sa Majesté, s’étaient munis de leurs carabines et toutes les cartouches de la caisse garnissaient leurs poches. En effet, s’ils étaient surpris, peut-être serait-il nécessaire de faire parler les armes à feu, – un langage que les Wagddis ne devaient pas connaître.
Tous les quatre, ils allèrent ainsi entre les cases, dont la plupart étaient vides. Lorsqu’ils furent sur la place, elle était déserte et plongée dans les ténèbres.
Une seule clarté sortait de la fenêtre de la case du souverain.
«Personne», observa John Cort.
Personne effectivement, pas même devant la demeure de Msélo-Tala-Tala.
Raggi et ses guerriers avaient abandonné leur poste, et, cette nuit-là, le souverain ne serait pas bien gardé.
Il se pouvait, cependant, qu’il y eût quelques «chambellans de service» près de Sa Majesté et qu’il fût malaisé de tromper leur surveillance.
Toutefois, Khamis et ses compagnons estimaient l’occasion trop tentante. Une heureuse chance leur avait permis d’atteindre l’habitation royale sans avoir été aperçus, et ils se disposèrent à y pénétrer.
En rampant le long des branches, Llanga put s’avancer jusqu’à la porte et il constata qu’il suffirait de la pousser pour pénétrer à l’intérieur. John Cort, Max Huber et Khamis le rejoignirent aussitôt. Pendant quelques minutes, avant d’entrer, ils prêtèrent l’oreille, prêts à battre en retraite, s’il le fallait.
Aucun bruit ne se faisait entendre ni au dedans ni au dehors.
Ce fut Max Huber qui, le premier, franchit le seuil. Ses compagnons le suivirent et refermèrent la porte derrière eux.
Cette habitation comprenait deux chambres contiguës, formant tout l’appartement de Msélo-Tala-Tala.
Personne dans la première, absolument obscure.
Khamis appliqua son œil à la porte qui communiquait avec la seconde chambre, – porte assez mal jointe à travers laquelle filtraient quelques lueurs.
Le docteur Johausen était là, à demi couché sur un divan.
Évidemment, ce meuble et quelques autres qui garnissaient la chambre provenaient du matériel de la cage et avaient été apportés à Ngala en même temps que leur propriétaire.
«Entrons», dit Max Huber.
Au bruit, qu’ils firent, le docteur Johausen, tournant la tête, se redressa… Peut-être venait-il d’être tiré d’un profond sommeil… Quoi qu’il en soit, il ne parut pas que la présence des visiteurs eût produit sur lui aucun effet.
«Docteur Johausen, mes compagnons et moi, nous venons offrir nos hommages à Votre Majesté!…» dit John Cort en allemand.
Le docteur ne répondit rien… Est-ce qu’il n’avait pas compris?… Est-ce qu’il avait oublié sa propre langue, après trois ans de séjour chez les Wagddis?…
«M’entendez-vous? reprit John Cort. Nous sommes des étrangers qui avons été amenés au village de Ngala…»
Aucune réponse.
Ces étrangers, le monarque wagddien semblait les regarder sans les voir, les écouter sans les entendre. Il ne faisait pas un mouvement, pas un geste, comme s’il eût été en état de complète hébétude.
Max Huber s’approcha, et, peu respectueux envers ce souverain, de l’Afrique centrale, il le prit par les épaules et le secoua vigoureusement.
Sa Majesté fit une grimace que n’eût pas désavouée le plus grimacier des mandrilles de l’Oubanghi.
Max Huber le secoua de nouveau.
Sa Majesté lui tira la langue.
«Est-ce qu’il est fou?… dit John Cort.
– Tout ce qu’il y a de plus fou, pardieu!… fou à lier!…» déclara Max Huber.
Oui… le docteur Johausen était en absolue démence. A moitié déséquilibré déjà lors de son départ du Cameroun, il avait achevé de perdre la raison depuis son arrivée à Ngala. Et qui sait même si ce n’était pas cette dégénérescence mentale qui lui avait valu d’être proclamé roi des Wagddis?… Est-ce que, chez les Indiens du Far West, chez les sauvages de l’Océanie, la folie n’est pas plus honorée que la sagesse, et le fou ne passe-t-il pas, aux yeux de ces indigènes, pour un être sacré, un dépositaire de la puissance divine?…
La vérité est que le pauvre docteur était dépourvu de toute intellectualité. Et voilà pourquoi il ne se préoccupait pas de la présence des quatre étrangers au village, comment il n’avait pas reconnu en deux d’entre eux des individus de son espèce, si différente de la race wagddienne!
«Il n’y a qu’un parti à prendre, dit Khamis. Nous ne pouvons pas compter sur l’intervention de cet inconscient pour nous rendre la liberté…
– Assurément non!… affirma John Cort.
– Et ces animaux-là ne nous laisseront jamais partir…, ajouta Max Huber. Donc, puisque l’occasion s’offre de fuir, fuyons…
– A l’instant, dit Khamis. Profitons de la nuit…
– Et de l’état où se trouve tout ce monde de demi-singes…, déclara Max Huber.
– Venez, dit Khamis en se dirigeant vers la première chambre. Essayons de gagner l’escalier et jetons-nous à travers la forêt…
– Convenu, répliqua Max Huber, mais… le docteur…
– Le docteur?… répéta Khamis.
– Nous ne pouvons pas le laisser dans sa souveraineté wagddienne… Notre devoir est de le délivrer…
– Oui, certes, mon cher Max, approuva John Cort. Mais ce malheureux n’a plus sa raison… il résistera peut-être… S’il refuse de nous suivre?…
– Tentons-le toujours», répondit Max Huber en s’approchant du docteur.
Ce gros homme – on l’imagine – ne devait pas être facile à déplacer, et, s’il ne s’y prêtait pas, comment réussir à le pousser hors de la case?…
Khamis et John Cort, se joignant à Max Huber, saisirent le docteur par le bras.
Celui-ci, très vigoureux encore, les repoussa et se recoucha tout de son long en gigotant comme un crustacé qu’on a retourné sur le dos.
«Diable! fit Max Huber, il est aussi lourd à lui seul que toute la Triplice…
– Docteur Johausen?…» cria une dernière fois John Cort.
Sa Majesté Msélo-Tala-Tala, pour toute réponse, se gratta de la façon la plus simiesque…
«Décidément, dit Max Huber, rien à obtenir de cette bête humaine!… Il est devenu singe… qu’il reste singe et continue à régner sur des singes!»
Il n’y eut plus qu’à quitter la demeure royale. Par malheur, tout en grimaçant, Sa Majesté s’était mise à crier, et si fort qu’elle devait avoir été entendue, si des Wagddis se trouvaient dans le voisinage.
D’autre part, perdre quelques secondes, c’était s’exposer à manquer une occasion si favorable… Raggi et ses guerriers allaient peut-être accourir… La situation des étrangers, surpris dans la demeure de Msélo-Tala-Tala, s’aggraverait, et ils devraient renoncer à tout espoir de recouvrer leur liberté…
Khamis et ses compagnons abandonnèrent donc le docteur Johausen et, rouvrant la porte, ils s’élancèrent au dehors.
![]()
Brusque dénouement
![]() a chance se déclarait pour les fugitifs. Tout ce tapage à l’intérieur de l’habitation n’avait attiré personne. Déserte la place, désertes les rues qui y débouchaient. Mais la difficulté était de se reconnaître au milieu de ce dédale obscur, de circuler entre les branchages, de gagner par le plus court l’escalier de Ngala.
a chance se déclarait pour les fugitifs. Tout ce tapage à l’intérieur de l’habitation n’avait attiré personne. Déserte la place, désertes les rues qui y débouchaient. Mais la difficulté était de se reconnaître au milieu de ce dédale obscur, de circuler entre les branchages, de gagner par le plus court l’escalier de Ngala.
Soudain, un Wagddi se présenta devant Khamis et ses compagnons.
C’était Lo-Maï, accompagné de son enfant. Le petit, qui les avait suivis pendant qu’ils se rendaient à la case de Msélo-Tala-Tala, était venu prévenir son père. Celui-ci, redoutant quelque danger pour le foreloper et ses compagnons, se hâta de les rejoindre. Comprenant alors qu’ils cherchaient à s’enfuir, il s’offrit à leur servir de guide.
Ce fut heureux, car aucun d’eux n’aurait pu retrouver le chemin de l’escalier.
Mais, lorsqu’ils arrivèrent en cet endroit, quel fut leur désappointement!
L’entrée était gardée par Raggi et une douzaine de guerriers.
Forcer le passage, à quatre, serait-ce possible avec espoir de succès?…
Max Huber crut le moment venu d’utiliser sa carabine.
Raggi et deux autres venaient de se jeter sur lui…
Max Huber, reculant de quelques pas, fit feu sur le groupe.
Raggi, atteint en pleine poitrine, tomba raide mort.
Assurément, les Wagddis ne connaissaient ni l’usage des armes à feu ni leurs effets. La détonation et la chute de Raggi leur causèrent une épouvante dont on ne saurait donner une idée. Le tonnerre foudroyant la place pendant la cérémonie de ce jour les eût moins terrifiés. Cette douzaine de guerriers se dispersa, les uns rentrant dans le village, les autres dégringolant l’escalier avec une prestesse de quadrumanes.
Le chemin devint libre en un instant.
«En bas!…» cria Khamis.
Il n’y avait qu’à suivre Lo-Maï et le petit, qui prirent les devants. John Cort, Max Huber, Llanga, le foreloper, se laissèrent pour ainsi dire glisser, sans rencontrer d’obstacle. Après avoir passé sous le village aérien, ils se dirigèrent vers la rive du rio, l’atteignirent en quelques minutes, détachèrent un des canots et s’embarquèrent avec le père et l’enfant.
Mais alors des torches s’allumèrent de toutes parts, et de toutes parts accoururent un grand nombre de ces Wagddis qui erraient aux environs du village. Cris de colère, cris de menace furent appuyés d’une nuée de flèches.
«Allons, dit John Cort, il le faut!»
Max Huber et lui épaulèrent leurs carabines, tandis que Khamis et Llanga manœuvraient pour écarter le canot de la berge.
Une double détonation retentit. Deux Wagddis furent atteints, et la foule hurlante se dissipa.
En ce moment, le canot fut saisi par le courant, et il disparut en aval sous le couvert d’une rangée de grands arbres.
Il n’y a point à rapporter – en détail du moins – ce que fut cette navigation vers le sud-ouest de la grande forêt. S’il existait d’autres villages aériens, les deux amis ne devaient rien savoir à cet égard. Comme les munitions ne manquaient pas, la nourriture serait assurée par le produit de la chasse, et les diverses sortes d’antilopes abondaient dans ces régions voisines de l’Oubanghi.
Le lendemain soir, Khamis amarra le canot à un arbre de la berge pour la nuit.
Pendant ce parcours, John Cort et Max Huber n’avaient point épargné les témoignages de reconnaissance à Lo-Maï, pour lequel ils éprouvaient une sympathie tout humaine.
Quant à Llanga et à l’enfant, c’était entre eux une véritable amitié fraternelle. Comment le jeune indigène aurait-il pu sentir les différences anthropologiques qui le mettaient au-dessus de ce petit être?…
John Cort et Max Huber espéraient bien obtenir de Lo-Maï qu’il les accompagnerait jusqu’à Libreville. Le retour serait facile en descendant ce rio, qui devait être un des affluents de l’Oubanghi. L’essentiel était que son cours ne fût obstrué ni par des rapides ni par des chutes.
C’était le soir du 16 avril que l’embarcation avait fait halte, après une navigation de quinze heures. Khamis estimait que de quarante à cinquante kilomètres venaient d’être parcourus depuis la veille.
Il fut convenu que la nuit se passerait en cet endroit. Le campement organisé, le repas terminé, Lo-Maï veillant, les autres s’endormirent d’un sommeil réparateur qui ne fut troublé en aucune façon.
Au réveil, Khamis fit les préparatifs de départ, et le canot n’avait plus qu’à se lancer dans le courant.
En ce moment, Lo-Maï, qui tenait son enfant d’une main, attendait sur la berge.
John Cort et Max Huber le rejoignirent et le pressèrent de les suivre.
Lo-Maï, secouant la tête, montra d’une main le cours du rio et de l’autre les épaisses profondeurs de la forêt.
Les deux amis insistèrent, et leurs gestes suffisaient à les faire comprendre. Ils voulaient emmener Lo-Maï et Li-Maï avec eux, à Libreville…
En même temps, Llanga accablait l’enfant de ses caresses, l’embrassant, le serrant entre ses bras… Il cherchait à l’entraîner vers le canot…
Li-Maï ne prononça qu’un mot:
«Ngora!»
Oui… sa mère qui était restée au village, et près de laquelle son père et lui voulaient retourner… C’était la famille que rien ne pouvait séparer!…
Les adieux définitifs furent faits, après que la nourriture de Lo-Maï et du petit eut été assurée pour leur retour jusqu’à Ngala.
John Cort et Max Huber ne cachèrent pas leur émotion à la pensée qu’il ne reverraient jamais ces deux créatures affectueuses et bonnes, si inférieure que fût leur race…
Quant à Llanga, il ne put se retenir de pleurer, et de grosses larmes mouillèrent aussi les yeux du père et de l’enfant.
«Eh bien, dit John Cort, croirez-vous maintenant, mon cher Max, que ces pauvres êtres se rattachent à l’humanité?…
– Oui, John, puisqu’ils ont, de même que l’homme, le sourire et les larmes!»
Le canot prit le fil du courant et, au coude de la rive, Khamis et ses compagnons purent envoyer un dernier adieu à Lo-Maï et à son fils.
Les journées des 18, 19, 20 et 21 avril furent employées à descendre la rivière jusqu’à son confluent avec l’Oubanghi. Le courant étant très rapide, il y eut lieu d’estimer à près de trois cents kilomètres le parcours fait depuis le village de Ngala.
Le foreloper et ses compagnons se trouvaient alors à la hauteur des rapides de Zongo, à peu près à l’angle que forme le fleuve en obliquant vers le sud. Ces rapides, il eût été impossible de les franchir en canot, et, pour reprendre la navigation en aval, un portage allait devenir nécessaire. Il est vrai, l’itinéraire permettait de suivre à pied la rive gauche de l’Oubanghi dans cette partie limitrophe entre le Congo indépendant et le Congo français. Mais, à ce cheminement pénible, le canot devait être infiniment préférable. N’était-ce pas du temps gagné, de la fatigue épargnée?…
Très heureusement, Khamis put éviter cette dure opération du portage.
Au-dessous des rapides de Zongo, l’Oubanghi est navigable jusqu’à son confluent avec le Congo. Les bateaux ne sont pas rares qui font le trafic de cette région où ne manquent ni les villages, ni les bourgades, ni les établissements de missionnaires. Ces cinq cents kilomètres qui les séparaient du but, John Cort, Max Huber, Khamis et Llanga les franchirent à bord d’une de ces larges embarcations auxquelles le remorquage à vapeur commence à venir en aide.
Ce fut le 26 avril qu’ils s’arrêtèrent près d’une bourgade de la rive droite. Remis de leurs fatigues, bien portants, il ne leur restait plus que cent kilomètres pour atteindre Libreville.
Une caravane fut aussitôt organisée par les soins du foreloper et, marchant directement vers l’ouest, traversa ces longues plaines congolaises en vingt-quatre jours.
Le 20 mai, John Cort, Max Huber, Khamis et Llanga faisaient leur entrée dans la factorerie, en avant de la bourgade, où leurs amis, très inquiets d’une absence si prolongée, sans nouvelles d’eux depuis près de six mois, les reçurent à bras ouverts.
Ni Khamis ni le jeune indigène ne devaient plus se séparer de John Cort et de Max Huber. Llanga n’était-il pas adopté par eux, et le foreloper n’avait-il pas été leur dévoué guide pendant cet aventureux voyage?…
Et le docteur Johausen?… Et ce village aérien de Ngala, perdu sous les massifs de la grande forêt?…
Eh bien, tôt ou tard une expédition devra prendre avec ces étranges Wagddis un contact plus intime, dans l’intérêt de la science anthropologique moderne.
Quant au docteur allemand, il est fou, et, en admettant que la raison lui revienne et qu’on le ramène à Malinba, qui sait s’il ne regrettera pas le temps où il régnait sous le nom de Msélo-Tala-Tala, et si, grâce à lui, cette peuplade de primitifs ne passera pas un jour sous le protectorat de l’empire d’Allemagne?…
Cependant, il serait possible que l’Angleterre…
FIN
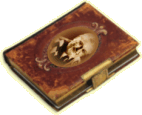
2. Père, en allemand.
3. Expression de M. de Quatrefages.